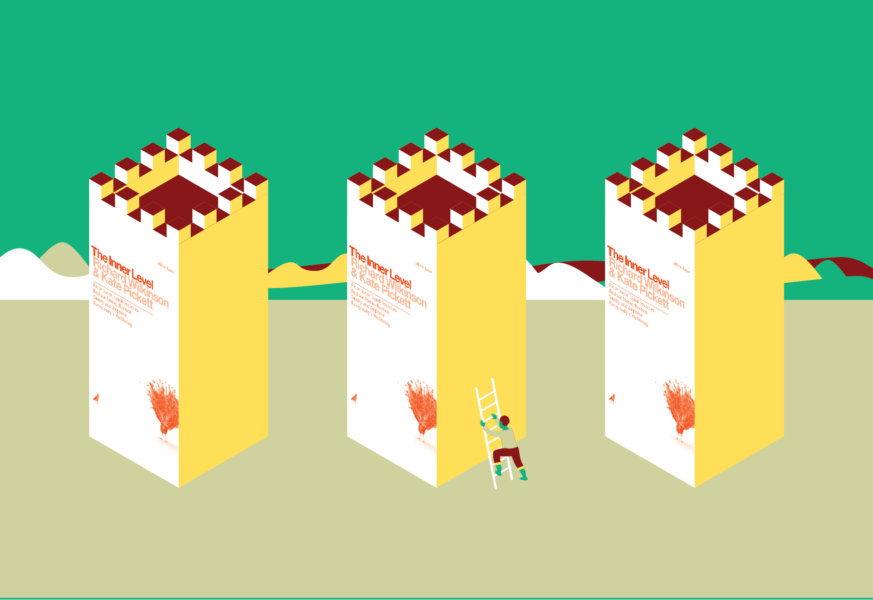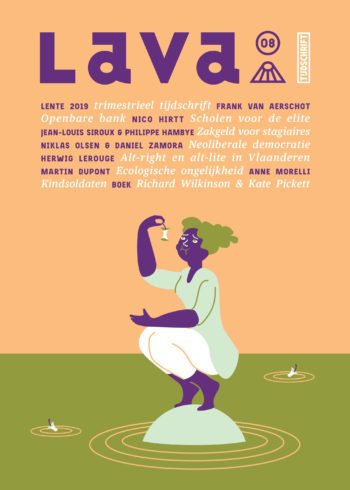Anton Jäger et Federico Finchelstein ne prétendent pas établir une énième définition définitive du populisme. Ils offrent à cette notion une dimension historique, qui fait souvent défaut dans les débats contemporains.

Il n’existe aucun consensus sur la signification du «populisme». Tout acteur politique un peu extravagant peut se voir affublé de l’étiquette de «populiste»: Donald Trump, Marine Le Pen, Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn, Jean-Luc Mélenchon, Geert Wilders, Filip Dewinter, Steve Stevaert, Jan Marijnissen, Jesse Klaver, Victor Orban… la liste est longue. Il n’existe aucun lien idéologique cohérent entre ces individus. Le monde académique ne cerne pas non plus la notion de populisme. En 1969, le politologue anglais Ernest Gellner se plaignait déjà de son caractère insaisissable: «À l’université, tout le monde en parle, mais personne ne sait comment le définir». Cas Mudde, le spécialiste néerlandais du populisme, qualifie la situation de «chaos terminologique». Certains universitaires proposent même de retirer tout bonnement le terme des manuels en raison de son inutilité.

Anton Jäger a étudié l’histoire des idées à Cambridge et y écrit un doctorat sur le populisme. Dans son ouvrage «Kleine anti-geschiedenis van het populisme» (De Geus, 2018), il déclare souhaiter «nettoyer» la notion de populisme, de la façon dont le préconise le linguiste Ludwig Wittgenstein: «Il faut parfois retirer de la langue une expression et la donner à nettoyer». Autrement dit, les mots sans signification claire n’ont selon lui aucun sens. Dans son livre, Jäger examine les interprétations du populisme à travers l’histoire des États-Unis et de l’Europe. Il analyse, en outre, comment et pourquoi les décideurs et les partis politiques sont qualifiés de «populistes». Il veut également expliquer en quoi cette notion est interprétée différemment aux États-Unis et en Europe.
Les deux traditions du Parti populaire
La notion de populisme est apparue pour la première fois en 1892, à la naissance du People’s Party (Parti populaire) dans la petite ville américaine d’Ohama, au Nebraska. Les membres et les partisans du parti se dénommaient «Populistes» «avec un P majuscule», souligne Anton Jäger. Ce n’est que plus tard que les termes «populisme» et «populiste» se sont écrits «avec un P minuscule». Le Parti populaire a notamment été créé en réaction à la crise de 1873. Les banques avaient été sauvées et les agriculteurs en payaient les conséquences. Le Parti populaire visait notamment à nationaliser le rail, à démocratiser la politique monétaire, à interdire les milices privées (qui réprimaient les grèves) et à instaurer le principe du référendum. Il se fondait sur le slogan «Droits égaux pour tous, privilèges pour personne». La ségrégation raciale était de rigueur, les Blancs et les Noirs ne pouvaient fréquenter les mêmes écoles ni les mêmes églises. Le Parti populaire combattait le racisme et des candidats noirs figuraient sur ses listes électorales.
Les banques menaçaient les fermiers d’exécuter leur hypothèque s’ils se risquaient à voter pour le Parti populaire.
Le mouvement du Parti populaire ne figure pas en bas de page dans les livres d’histoire. Lors de l’élection présidentielle de 1892, il a remporté 8,5 % des voix. En 1894, il disposait de neuf sièges au Congrès et a compté 1,2 million de membres dans les États du Sud.
Le parti était plus qu’un aiguillon pour la bourgeoisie américaine. Les banques menaçaient les fermiers d’exécuter leur hypothèque s’ils se risquaient à voter pour un populiste. Avant de devenir président, Theodore Roosevelt accusait le parti d’être une «attaque à la civilisation», un «appel à l’émeute».
Le moteur du Parti populaire était le syndicat des paysans, la Farmers’Alliance. Dans son œuvre monumentale, Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, l’historien et politologue américain Howard Zinn définit la Farmers’Alliance comme «la plus importante tentative d’organisation menée par un groupe de citoyens américains du XIXe siècle»1. Fondée au Texas en 1877, l’organisation représentait en 1892 plus de 2 millions de familles d’agriculteurs. Elle a pris de nombreuses initiatives de coopération avec des associations de la classe ouvrière. Zinn souligne en outre: «Jamais auparavant – ni depuis d’ailleurs – les deux races n’ont été aussi proches dans le Sud que lors des luttes populistes».
Jäger dépeint une histoire passionnante et l’assortit d’anecdotes éloquentes. Dans cette «coalition bigarrée», il distingue deux tendances, qui ont débouché sur un double héritage. La première tendance est celle de Thomas E. Watson qui, après l’implosion du Parti populaire, est devenu adepte des pratiques de lynchage (qui «exprimaient directement la voix du peuple»), défenseur de la ségrégation raciale et membre du Ku Klux Klan. Eugene V. Debs représente la deuxième tendance. Au début du 20e siècle, il a fondé le Parti socialiste, qui se définissait comme le «parti de tous les travailleurs, quelle que soit la couleur de leur peau». A donc succédé au Parti populaire, d’une part, un «ancien populisme vindicatif», dénonçant l’existence d’un complot juif international et célébrant la suprématie blanche et, d’autre part, un «populisme émancipateur et inclusif, promettant l’égalité des droits entre Blancs et Noirs ainsi qu’une politique monétaire démocratique». Un résultat dû au hasard, juge Jäger.
Cette lecture de l’histoire du Parti populaire soulève néanmoins des questions. Howard Zinn établit plutôt des parallèles avec le marxisme. Le populisme se considérait comme un mouvement de classe, partant du principe que les ouvriers et les paysans occupaient la même position matérialiste dans la société. Le programme du parti, en 1892, indiquait en outre dans son introduction: «Le fruit du travail de millions d’ouvriers est volé de manière éhontée pour édifier des fortunes colossales». Il y a aussi des références aux idées marxistes sur l’aliénation du système capitaliste. Pour la plupart des gens, la problématique économique primait sur la question raciale. La Farmers’Alliance déclarait ainsi: «Le Parti populaire n’a pas été fondé pour libérer les Noirs, mais pour libérer tous les hommes (…). Aussi longtemps que les relations de travail ne sont pas libres, il ne peut être question de liberté politique».
Zinn décrit l’homme politique Eugene Debs avant tout comme un syndicaliste et un socialiste: «C’est la crise de 1893 qui poussa Eugene Debs à consacrer sa vie au syndicalisme et au socialisme». En 1893, Debs a fondé le Syndicat américain des chemins de fer (American Railway Union). Arrêté en 1894, il a lu en prison de nombreuses œuvres de littérature marxiste. Six mois plus tard, après sa libération, il a déclaré: «La question est celle de l’opposition entre le socialisme et le capitalisme. Je suis pour le socialisme parce que je suis pour l’humanité». Une encyclopédie rapporte qu’en 1896, Debs a mené campagne en faveur du candidat (démocrate) William Jennings Bryan du Parti populaire, et qu’en 1898, il était à l’origine de la création du Parti socialiste. Dans le chapitre qu’il consacre au mouvement populiste, Howard Zinn ne mentionne toutefois pas Eugene Debs.
Socialiste, économiquement radical, idéologiquement assez conservateur et confronté au racisme dans ses propres rangs, le Parti populaire est un mouvement complexe. Au début du 20e siècle, le parti a implosé parce qu’il n’a pas su rassembler les groupes divergents qu’il représentait – républicains du nord et démocrates du sud, ouvriers des villes et paysans des campagnes, Blancs et Noirs. La tentation des urnes ainsi que les vives divergences émergeant au sein du parti sur une collaboration avec le Parti démocrate ont contribué à cet éclatement.
Le contexte de la fin du 19e siècle aux États-Unis est bien sûr totalement différent du monde actuel. Par conséquent, la question se pose de savoir s’il est utile de puiser par trop dans l’histoire du Parti populaire pour étudier le populisme contemporain.
Les deux conférences et la légitimité libérale
Anton Jäger tire cependant des enseignements de l’histoire du Parti populaire, qui lui sert de pierre de touche pour analyser le populisme contemporain. Il regrette qu’on se rappelle surtout du populisme de Watson, au détriment de celui de Debs. Il en impute la responsabilité au monde scientifique américain, un «milieu qui a toujours considéré avec méfiance le Populisme original».
Lors d’une conférence organisée en 1956, des universitaires ont cherché à expliquer la chasse aux sorcières de Joseph McCarthy. Ces chercheurs «vont changer définitivement la notion américaine – et plus tard européenne – du terme populisme». L’historien Richard Hofstadter a exercé à cet égard une «influence considérable et décisive». Selon lui, les populistes étaient les précurseurs de McCarthy, qui répondait à des sentiments profondément ancrés dans la population. Hofstadter ne considérait pas les populistes comme des réformateurs progressistes, mais comme des «isolationnistes», des «nationalistes extrémistes» et des «anti-intellectuels» antisémites nourrissant un ressentiment à l’égard du «grand capital». Hofstadter reléguait donc le Populisme au rang de l’extrême droite.
«C’est le système de croyance politique des pluralistes qui explique encore le mieux leur hostilité envers le populisme».
Lors d’une autre conférence retentissante organisée à Londres en 1967 par Ernest Gellner, Hofstadter présentait plutôt le populisme comme un mouvement noir en faveur des droits civiques basé sur la lutte des classes en faveur de la justice et de la reconnaissance sociales découlant d’un «lourd traumatisme culturel». La conclusion de Jäger est accablante: «La contribution de Hofstadters a encore plus compliqué la discussion. Qui désormais n’appartenait-il pas à la catégorie des populistes? De l’Argentine à la France, en passant par l’Amérique et la Chine, on voyait des populistes partout». «Les pluralistes n’étaient pas parvenus à clarifier le débat. Ils avaient au contraire embrouillé davantage le concept». Ils n’ont pas réussi à établir de définition commune du populisme.
À travers son argumentation sur ces deux conférences, Jäger critique avec brio l’émergence d’une classe de sociologues autoproclamés «pluralistes», dont le grand adversaire est l’État totalitaire. Les pluralistes représentent toutefois eux-mêmes, selon Jäger, un État technocratique dans lequel la souveraineté populaire est solidement réprimée. Après les élections, il appartient à l’élite de concilier prudemment les aspirations opposées de la population pour garantir la stabilité de la démocratie. Le fait que chacun puisse théoriquement appartenir à l’élite en fonction de ses mérites assure la légitimité du système. «Le résultat n’était donc pas la participation populaire, mais plutôt une «circulation des élites», dans laquelle des cliques gouvernaient le navire de l’État. (…) C’est le système de croyance politique de ces sociologues qui explique encore le mieux leur hostilité envers le populisme», conclut Jäger.
Jäger montre ainsi clairement la détermination politique à «nettoyer» le terme populisme. Toute personne, quel que soit son camp, ne souscrivant pas au principe de la gestion libérale-démocrate du capitalisme pouvait dès lors se faire taxer de «populiste». Le populisme se voit en fait attribuer la même fonction que le «totalitarisme» selon la philosophe Hannah Arendt. Le philosophe slovaque Slavoj Žižek écrit à ce propos: «La promotion, ces dix dernières années, de Hannah Arendt au rang d’autorité intouchable (…) est peut-être ce qui manifeste le plus clairement la défaite théorique de la gauche, c’est-à-dire l’acceptation par la gauche des données fondamentales de la démocratie libérale (la «démocratie» par opposition au «totalitarisme», etc.)»2. Le totalitarisme est devenu un concept idéologique permettant de garantir l’hégémonie de la démocratie libérale et de cataloguer de reflet du fascisme toute critique de celle-ci par la gauche.
Les trois révoltes populistes et la politique identitaire
Au fil de ses recherches, Anton Jäger découvre que la notion de populisme est considérée différemment sur le continent européen. Il distingue trois périodes de «révoltes populistes»: l’émergence de partis tels que le Vlaams Blok (VB) et le Front National (FN), les référendums contre la constitution européenne et le traité de Lisbonne aux Pays-Bas, en France et en Irlande et, enfin, le référendum grec contre le mémorandum européen, le Brexit et l’élection de Donald Trump. Jäger se réfère à chaque fois à la façon dont ces événements politiques sont abordés par les universitaires, les décideurs politiques et les journalistes.
Depuis les années 80, le populisme est la notion par excellence dont on se sert pour cataloguer les partis et les mouvements politiques non conventionnels, tant à gauche qu’à droite de l’échiquier politique. L’élite maudit et invective le populisme: Bernard-Henri Levy le qualifie de «Mal absolu», Alain Minc d’«ivresse démocratique». Les référendums contre les traités européens «ne servent qu’aux populistes de droite», déclare l’écologiste allemand Joschka Fischer; selon le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, ils sont un «numéro de cirque». «Le populisme avec un «p» minuscule est devenu le bâton préféré des élites européennes pour frapper le peuple», conclut Jäger.
Dans son aperçu, Jäger livre par ailleurs d’excellentes critiques sur les théories censées définir le phénomène du populisme. Il met ainsi en cause les «démocrates diplômés», pour qui la division entre la gauche et la droite est dépassée et le populisme est une révolte de statut social reposant sur les écarts de formation. La démocratie devient ainsi une question de statut social et le diplôme son principal signe distinctif. Jäger: «En présentant la manifestation d’un problème – une différence de formation résultant d’une position de classe ou autres – comme l’essence du problème, on en retire le fond». Cette thèse est très utile sur le plan politique: «on pouvait continuer à mettre l’accent sur l’égalité des chances en fixant l’ultime limite entre les diplômés et les non-diplômés (non plus entre les riches et les pauvres)».
Jäger identifie un fil rouge à travers les périodes qu’il étudie: le populisme passe d’un mouvement économique à une forme de politique identitaire. Il illustre ce phénomène à la lumière des idées de scientifiques tels que Stuart Hall, Ernesto Laclau (l’idéologue du populisme) et Cas Mudde. Le sociologue britannique Stuart Hall considérait ainsi en 1983 le thatchérisme comme une forme de «populisme autoritaire». Selon lui, Margaret Thatcher avait réussi, par la manipulation idéologique et avec le soutien des médias, à rassembler sous un même drapeau la petite bourgeoisie, le grand capital et la classe ouvrière. Les critiques de Hall jugeaient que ce dernier, en accentuant le caractère «populiste» du thatchérisme, sous-estimait la dimension de classe et donnait une importance excessive à l’image du phénomène. Le risque de réduire la politique à la politique identitaire était évident.
Jäger pointe la même situation concernant le théoricien politique argentin Ernesto Laclau. Selon ce dernier, le populisme relève moins d’une idéologie que d’une «logique politique». En période de crise hégémonique et sociale, lorsque l’élite en place ne peut plus légitimer son pouvoir, un «moment populiste» survient, lors duquel un dirigeant peut réussir à rassembler certains groupes. La politique ne peut pas fonctionner sans «construction populaire», le regroupement politique contre un ennemi commun, le «nous contre eux». Laclau considère également que le populisme est plus une question de «statut social» que de «classe», plus soucieux d’identité et de culture que d’économie. Selon Jäger, le populisme chez Laclau et Hall peut être qualifié de «politique identitaire anti-individuelle». La politique identitaire formelle concerne les groupes minoritaires, alors que la politique «anti-individuelle» est axée sur le peuple à part entière. «C’était plutôt le Peuple lui-même… qui luttait pour son caractère culturel propre. Ce nouveau Peuple n’était pas nécessairement soucieux de l’économie ni des conflits de classe. Il aspirait surtout à la reconnaissance», écrit Jäger.
Selon Jäger, le politologue néerlandais Cas Mudde appartient également à ce courant de pensée. Mudde estime lui aussi que le populisme est davantage lié à l’identité qu’à l’économie. C’est selon lui une idéologie «faible» qui divise la population en deux identités – le peuple et l’élite –, le peuple pouvant toutefois être défini sur une base ethnique ou économique. En tant qu’idéologie faible, le populisme peut aisément se combiner avec d’autres doctrines. On peut imaginer un populisme de type socialiste, mais aussi de type nationaliste, fasciste ou libéral.
Les populistes n’ont pas beaucoup d’estime pour les classes sociales. Ils n’évoquent qu’un vague peuple et ne se positionnent pas sur l’axe gauche-droite. Le slogan «Ni de droite, ni de gauche» est, depuis les années 90, le slogan préféré du Front national. C’est d’ailleurs aussi le cas pour certains écologistes et le parti espagnol Podemos, qui s’inspirent explicitement d’Ernesto Laclau.
Dans les années 80′, le populisme s’est définitivement inscrit dans la sphère culturelle, explique Jäger. Le débat entre Slavoj Žižek et Ernesto Laclau le montre très clairement. Selon Žižek, dans le populisme, la construction identitaire contre un ennemi commun supplante l’analyse du système. Si la gauche doit devenir plus populiste, le style et l’attitude sont plus importants que le contenu politique. Selon Laclau, la gauche doit principalement s’atteler à traiter les thèmes de l’analyse des classes surannée, de l’hégémonie ou de la politique culturelle. Ce qui frappe Jäger, c’est que Laclau ne tente même pas de remettre en cause la qualification de politique identitaire. «Au lieu de contester les soupçons de Žižek, Laclau répond que tout ce que l’auteur slovène attribue au populisme – la pensée non systémique, la politique culturelle, le stylisme – est pleinement justifié».
Selon Jäger, la plupart des spécialistes considèrent également les votes référendaires contre les traités européens comme une révolte lié au statut social: «La dimension sociale fut de nouveau reléguée au second plan. Les universitaires européens ont introduit une définition du populisme dont les motifs économiques du mouvement d’origine ont disparu sans laisser de trace». La ressemblance avec le débat mené par les pluralistes dans les années 50 est frappante: «Le vocabulaire utilisé dans les nouvelles études sur le populisme était douloureusement reconnaissable à la lumière des années 50: post-matérialisme, perdants de la mondialisation, angoisse du statut social, représentation directe, télépolitique, démocratie des diplômes, ressentiment». Selon Jäger, la notion de populisme est ainsi vidée de son sens. Il se demande si le populisme est bien le dénominateur commun des nouvelles «espèces politiques»: «Le populisme européen ne ressemblait en effet presque plus au terme inventé par un avocat du Kansas en 1892».
Donald Trump, Thierry Baudet, Geert Wilders et le mouvement de la «droite alternative» américaine (Alt-right) s’inscrivent selon Jäger dans le sillage culturel. Le penseur d’extrême droite américain Richard Spencer, à l’origine de l’expression «Alt-right», a salué la victoire de Donald Trump comme un geste posé par la «résistance blanche». Tant Spencer que Baudet considèrent que Trump représente le «nouveau populisme». C’est l’angle sous lequel les études européennes définissent le populisme aujourd’hui. Cependant, les États-Unis acceptent plus difficilement cette étiquette. Jäger estime qu’il est «fondamentalement erroné de qualifier Trump de populiste». Le fait que Trump s’exprime au nom du peuple et fulmine contre l’élite n’est, selon lui, pas suffisant. Il ne représente pas la voix du peuple, mais celle des privilégiés menacés – au sommet de l’échelle sociale, ils craignent d’en dégringoler. «Le programme populiste de Trump ne s’adresse pas aux gens du peuple».
Enfin, Jäger juge qu’il est déplacé d’inscrire dans cette catégorie le populisme d’après-guerre. Il voudrait que la notion revête une signification plus favorable, qu’elle s’inspire de l’idéologie de Debs et non de celle de Watson. Le monde ayant fondamentalement changé depuis l’époque de Debs, il ne s’agirait pas de copier-coller la pensée du Populisme. Toutefois, le «contrôle public de l’apport monétaire, la suppression de l’asservissement aux salaires, la qualité de l’emploi ou la responsabilité de l’État sont des questions aussi brûlantes qu’il y a 130 ans». Aujourd’hui comme au 19e siècle, «la politique économique est totalement isolée de la participation populaire» et l’inégalité des revenus est criante. «Nous ne savons pas comment les choses doivent vraiment fonctionner aujourd’hui. Il semble que le vrai travail doive encore commencer», conclut Jäger.
L’ouvrage de Jäger emmène le lecteur dans un voyage fascinant à travers un siècle d’histoire de la philosophie populiste. À chaque étape, il analyse intelligemment l’actualité du moment. Ses critiques sur les nombreux commentaires journalistiques et théoriques sur le populisme sont très pertinentes. Comme il s’en était fixé l’objectif, Jäger «nettoie» en profondeur le terme «populisme». Cependant, il utilise pour ce faire un peu trop d’eau de Javel. Il retire à presque tout le monde la qualification de populiste, qu’il réserve exclusivement à l’une des deux traditions qu’il décrit du Parti populaire.
Jäger appréhende donc le populisme de manière un peu vague comme une idéologie non identitaire prônant la liberté, l’égalité et le contrôle économique. Ainsi, il finit un peu par tomber dans le même piège que celui dans lequel sont tombés les théoriciens qu’il critique. Comment distinguer son interprétation du populisme de la social-démocratie, de la gauche écologiste ou du marxisme? Son point de vue sème la confusion idéologique à gauche de l’échiquier politique.
Le populisme et le fascisme
Le handicap dont souffre l’histoire des idées de Jäger est qu’elle se fonde sur des conversations théoriques entre des penseurs et des journalistes. Le contexte ne manque pas, mais il se limite aux événements politiques du moment. Ces événements peuvent avoir une incidence importante sur les idées, mais les processus historiques et les mutations sociales à long terme ne sont pas moins utiles à prendre en considération. L’arène politique est également faite de guerres mondiales, de décolonisation et de crises économiques. À la lumière de ces éléments, on obtient d’autres réponses, mais aussi d’autres questions. Cette approche permet par ailleurs de renoncer à l’envie d’établir une définition minimale adéquate, universelle et atemporelle.
Le populisme moderne est une réponse postfasciste au communisme qui ne rompt pas radicalement avec le passé fasciste.
L’ouvrage de Federico Finchelstein From Fascism to Populism in History est ainsi tout à fait complémentaire à celui de Jäger pour appréhender pleinement le «phénomène populiste». «La définition du terme ne manque pas de clarté, mais les théories du populisme manquent principalement de dimension historique», écrit Finchelstein. Les larges définitions selon lesquelles le populisme est un «mouvement qui défend la souveraineté populaire et oppose le peuple aux élites» sont vaines. Plus la définition sera simple, plus on perdra de vue l’importance du rôle joué par le populisme dans l’histoire de la politique. De la même façon, nous ne pouvons pas dissocier l’Europe et les États-Unis du reste du monde.

La victoire sur le fascisme en 1945 joue un rôle crucial dans l’histoire du populisme contemporain. Généralement, pourtant, les études sur le populisme ne tiennent pas compte de cet événement historique de portée mondiale. Selon Finchelstein, le «populisme moderne» puise ses racines dans le fascisme, tout comme différents types de populisme ont ouvert la voie au fascisme à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le populisme et le fascisme sont génétiquement et historiquement liés. Le populisme moderne est une réponse postfasciste au communisme qui ne rompt pas radicalement avec le passé fasciste. Après 1945, de nombreux fascistes et anticommunistes de droite (l’anticommunisme est un élément essentiel de l’idéologie fasciste) ont réalisé que toute association avec la dictature totalitaire et la violence extrême les condamnait à la marginalité.
Dans la démocratie libérale d’après-guerre, certaines caractéristiques fondamentales du fascisme ont regagné en légitimé avec le populisme moderne. Historiquement, le populisme postfasciste représente la «résurgence d’une interprétation autoritaire de la démocratie». Selon l’historien israélien Zeev Sternhell, le fascisme a continué à se développer sur la base d’idéologies opposées aux idées des Lumières3. Entre les deux guerres, ce courant des anti-Lumières constituait la troisième option à côté du libéralisme et du marxisme.
Finchelstein constate que cette troisième voie émerge aujourd’hui à l’échelle mondiale sous la forme du populisme, qui se positionne comme une solution démocratique autoritaire contre la gauche4. Il identifie un trait commun important au populisme et au fascisme: les notions de peuple, de nation et de leader sont leur principale source de légitimité. Le populisme et le fascisme partagent l’idée de l’existence d’un peuple homogène basée sur l’exclusion d’autrui. L’opposition binaire peuple/anti-peuple détermine dans ce cadre les relations politiques.
Dans les deux idéologies, le leader charismatique est le représentant et la personnification du peuple et de la nation. Les adeptes d’un «leadership éclairé» sont considérés comme les membres du peuple, leurs antagonistes politiques comme des ennemis et des traitres à la nation.
Finchelstein souligne cependant que le populisme n’est pas le fascisme. Le populisme est une forme de démocratie autoritaire, alors que le fascisme est une forme de dictature ultraviolente visant à éliminer physiquement ses adversaires. La légitimité du populisme repose sur le processus électoral. Une fois ce processus terminé, le leader est seul à canaliser les désirs du peuple. Si, chez les populistes, la foi dans le leader dépasse de loin la légitimité des élections, le leader n’est pas totalement au-dessus des lois. Le fascisme supprime l’État de droit et la séparation des pouvoirs. Le populisme comble cette faiblesse: il tente de repousser les limites de l’État de droit et vise un pouvoir exécutif fort. L’homogénéisation du peuple est rhétorique chez les populistes. Le peuple est assimilé à la majorité électorale, mais l’«anti-peuple» n’est pas marginalisé et certainement pas éliminé. Les populistes méprisent la presse indépendante; les fascistes la font taire.
En ce sens, le populisme en tant que concept politique a sa place dans le vocabulaire idéologique. À l’instar du marxisme, du libéralisme et du fascisme, le populisme est une idéologie politique globale présentant des différences significatives d’un pays à l’autre. Les deux premières idéologies appartiennent à la tradition des Lumières, les deux dernières au courant des «anti-Lumières».
Le populisme en tant que régime
Le populisme apparaît pour la première fois en tant que régime après la Seconde Guerre mondiale en Amérique latine. «Si la démocratie commence à Athènes, le populisme démocratique moderne commence à Buenos Aires», écrit Finchelstein, faisant référence au régime de Juan Domingo Perón en Argentine5. Perón n’a jamais caché son admiration pour l’Italie de Mussolini. En 1939, il a rejoint une mission d’études de l’armée argentine en Italie «parce qu’un nouveau national-socialisme était expérimenté dans ce pays». Perón était également membre de la loge Grupo de Oficiales Unidos (Groupe d’officiers unis, GOU), dont le mouvement communiste international représentait l’ennemi principal.
Bien que Perón ait pleuré la mort de celui qu’il qualifiait de «pauvre Mussolini» en 1945, il ne souhaitait pas reproduire son modèle. Après l’effroyable Seconde Guerre mondiale, il fallait construire une «troisième voie» entre le capitalisme et le communisme en tant que système démocratique. Perón a été le premier à transformer la dictature fasciste en une démocratie autoritaire fondée sur des élections. Il partageait avec le fascisme l’antilibéralisme, l’anticommunisme, l’antisocialisme, la mobilisation imposée d’en haut et la propagande. Son régime comportait également une conception mythique de l’histoire et des rituels de spectacle politique.
Perón qualifiait sa démocratie d’«organique». Ce caractère organique – terme typique des anti-Lumières – le devait permettre non seulement de «gouverner pendant six ans, mais d’assoir un gouvernement pour soixante ans». Il s’agissait ainsi de «faire naître» un leader. Comme l’a déclaré Perón lui-même: «On naît conducteur. On ne fabrique de conducteurs ni par décret ni par élections». Il détenait le pouvoir au nom du peuple et régnait dans la pratique à sa place. Eva Perón, son épouse, a dit de lui «Perón is a God for all of us. Perón is our sun, Perón is the water. Perón is the life of our country and the Argentine people» (Perón est notre dieu à tous. Perón est notre soleil, Perón est l’eau. Perón est la vie de notre pays et le peuple argentin). Le peuple de Perón n’est pas le peuple universel, mais le peuple argentin. L’Instituto Etnico National (institut ethnique national) souhaitait d’ailleurs distinguer la «bonne immigration» de l’immigration non soluble dans l’identité nationale. Les annales de l’institut indiquent qu’il doit accorder la priorité aux races espagnoles et italiennes plutôt qu’aux Juifs et aux Arabes.
En Argentine, le fascisme transnational et l’anticommunisme se sont ainsi réinventés dans un tout autre contexte. Ernesto Laclau considérait le péronisme comme la nouvelle gauche: «Nationale, populaire et totalement différente de la gauche libérale traditionnelle» et «une forme de pouvoir basée sur la division de la société entre des intérêts sociaux antagonistes». Le populisme de Perón représente pour Laclau la démocratisation, l’égalité et la lutte contre l’oppression. Finchelstein attire à cet égard l’attention sur le fait que Laclau minimise les traits dictatoriaux, militaires et néofascistes de Perón. Laclau a, en outre, nié l’existence d’une gauche non libérale et non péroniste en Argentine.
On ne peut cependant pas taxer le populisme de fausse démocratie et l’assimiler explicitement aux anti-Lumières. Des avancées sociales ont, en effet, été réalisées tant en Argentine que dans d’autres régimes populistes latino-américains6. Le populisme latino-américain mobilisait la classe ouvrière, tandis que le fascisme mobilisait la classe moyenne. Même si les leaders populistes étaient de droite et partisans du fascisme, leurs adeptes les poussaient vers la gauche. Perón puisait en outre son idéologie tant à gauche qu’à droite.
L’exemple de l’Argentine illustre bien que le populisme a présenté des tendances contrastées à travers l’histoire. Finchelstein cite un chercheur selon lequel le populisme «peut jouer le rôle du Bon, de la Brute et du Truand». Il peut stimuler, mais aussi restreindre ou détruire la démocratie. Souvent, il limite les droits politiques. Ses variantes progressistes peuvent néanmoins améliorer l’égalité et les droits sociaux. Finchelstein conclut que: «une caractéristique déterminante du populisme moderne est la fluidité de ses transitions de la droite vers la gauche et inversement».
La nature du populisme est déterminée par les contextes historique et transnational. L’anticommunisme de la période annonciatrice de la guerre froide et le nouveau statut hégémonique du libéralisme était un terreau fertile pour la droite populiste. Le populisme de droite est de retour en Europe, aux États-Unis et, depuis peu, au Brésil, avec Bolsonaro. Cette version est analogue à celle du populisme autoritaire latino-américain, mais dénuée du principe de l’inclusion sociale. Le populisme peut également en revenir à ses bases fascistes, comme le péronisme néofasciste des années 70, Aube dorée, en Grèce, ou Jobbik, en Hongrie. Après l’éclatement de la crise de 2008, un populisme de gauche a par ailleurs également pris pied en Europe.
Finchelstein distingue quatre types de populisme dans l’après-guerre: le populisme classique (surtout présent en Amérique latine), le populisme néolibéral (comme ceux de Carlos Menem en Argentine et de Silvio Berlusconi en Italie), le populisme néoclassique de gauche (Cristina Kirchner, Hugo Chavez, Rafael Correa, Evo Morales et les mouvements Podemos et Syriza) ainsi que les populismes néoclassiques de droite et d’extrême droite (le Front national (FN), le UK Independence Party (UKIP), le Partij voor de Vrijheid (PVV), Avigdor Lieberman en Israël, le Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), le Movimento sociale italiano (MSI), les Ware Finnen en Finlande, Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán et Pauline Hanson en Australie). Le Vlaams Belang (VB) et la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) appartiennent à la dernière catégorie. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon est considérée relever du populisme néoclassique de gauche.
Finchelstein ne verse pas ici dans la «théorie du fer à cheval», selon laquelle les extrêmes – gauche et droite – se ressemblent. Il aborde les variantes du populisme de gauche latino-américain, africain et du sud de l’Europe qui accordent de l’importance aux aspects sociaux et rejettent explicitement l’impérialisme, le colonialisme et le racisme. Confondre le populisme de gauche et le populisme de droite, c’est nier les dimensions antisociale et dictatoriale des populismes de droite et d’extrême droite. «Dans l’histoire, les populismes de gauche et de droite sont généralement diamétralement opposés, tandis que dans le registre positiviste générique, ils sont mélangés. Les théories élevées gomment les différences historiques».
Bien que le parti politique Podemos, s’inspirant expressément de Laclau, prétende dépasser les notions de gauche et de droite et déclare vouloir «créer des identités»7, Finchelstein le situe à gauche de l’échiquier politique, par exemple. En fait, les populistes de gauche occupent souvent la place de la gauche non populiste, laissée vacante après la mutation des sociaux-démocrates en socio-libéraux et néolibéraux, dans le sillage de Tony Blair et de Gerard Schröder. Toutefois, précise Finchelstein, plus Podemos s’est approché de la possibilité de participer au gouvernement, plus il est devenu vertical et populiste. Cette transformation est plus frappante encore en Grèce, avec le parti Syriza, qui, malgré le rejet du mémorandum européen au référendum, s’est soumis aux dictats de la Troïka. Il importe donc de distinguer le populisme en tant que mouvement du populisme en tant que régime.
Le néolibéralisme et le néofascisme
Avec l’élection de Donald Trump, le populisme est mûr pour le 21e siècle. «Comme Rome et Berlin servaient de modèle au fascisme, la campagne xénophobe de Trump aux États-Unis est vite devenue le modèle du populisme à travers le monde» écrit Finchelstein. Silvio Berlusconi, Nigel Farage, Geert Wilders, Marine Le Pen, mais aussi Christina Kirchner, en Argentine, ont salué Trump pour son opposition affichée aux «formes traditionnelles de la représentation démocratique» et la «culture cosmopolite». Le silence dans le camp de la N-VA lors de l’élection de Trump était également éloquent.
Trump se présente comme le leader choisi et prédestiné dont la vérité s’incarne dans le peuple. Il se présente comme l’idéal de l’entrepreneur américain. Ses déclarations comme «C’est un tournant dans l’histoire de notre civilisation, qui déterminera si nous, le peuple, réclamons le contrôle de notre gouvernement» ou «C’est une lutte pour la survie de notre nation, croyez-moi» sont des échos du péronisme – le leader populiste incarne la victoire de la civilisation en des temps apocalyptiques. Trump loue jusqu’à nouvel ordre particulièrement la rhétorique, la répression, l’exclusion et la violence contre ses adversaires et les minorités. Sa réaction ambigüe peu défavorable aux violences perpétrées à Charlottesville par des militants d’extrême droite, la détention d’enfants mexicains séparés de leurs parents ou l’interdiction imposée aux ressortissants de certains pays de pénétrer sur le territoire américain indiquent toutefois une évolution néofasciste.
«À partir de 2017, le populisme américain est devenu le postfascisme le plus conséquent du nouveau siècle», conclut Finchelstein. «Né en périphérie latino-américaine, le populisme a mis moins d’un siècle pour s’installer à Washinton DC. C’est le résultat d’un long processus historique réellement global par lequel un fascisme dictatorial vaincu a été radicalement reformulé en populisme démocratique».
Le débat – trop souvent sémantique – sur le populisme évoqué ci-dessus ne doit pas nous détourner du néolibéralisme autoritaire et antidémocratique. Depuis Margaret Thatcher et Ronald Reagan, certainement, l’idée de liberté a complètement dégénéré en liberté d’entreprendre et d’exploiter au détriment de l’humain et de l’environnement. La politique socioéconomique est aujourd’hui dictée par l’Europe néolibérale. «Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens» a déclaré un jour Jean-Claude Juncker.
Comme le montre le marxiste américain David Harvey, c’est dans le néolibéralisme que prospèrent le nationalisme et l’autoritarisme8. L’État néolibéral doit formellement se limiter à veiller au bon fonctionnement du marché. En réalité toutefois, la «création d’un environnement favorable aux entreprises» et «l’amélioration de la compétitivité» à l’échelle mondiale le forcent à gouverner d’une main de fer pour contrôler les travailleurs. L’individualisation et la commercialisation détruisent la cohésion sociale et la solidarité. Ces valeurs se reconstruisent inévitablement par d’autres voies: les religions, les nouvelles formes d’association (autour des droits et de la citoyenneté, par exemple), mais aussi par la renaissance politique du régionalisme, du nationalisme et du fascisme. «Le néolibéralisme à l’état pur a toujours menacé de faire apparaître sa Némésis, les diverses formes de populisme autoritaire et de nationalisme», conclut Harvey. La question est de savoir si le populisme de gauche peut constituer une réponse à ce problème. Il est déjà rarement envisagé de revoir en profondeur la notion de priorité privé des moyens de production.
- Anton Jäger, Kleine anti-geschiedenis van het populisme, De Geus, Amsterdam, 2018.
- Federico Finchelstein, From Fascism to Populism in History, University of California Press, 2017.
Footnotes
- Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, traduit de l’anglais par Frédéric Cotton, Marseille, Agone, 2002, p. 330.
- Slavoj Žižek, Vous avez dit totalitarisme? Cinq interventions sur les (més)usages d’une notion, Paris, Éditions Amsterdam, 2004.
- Zeev Sternhell, Ni droite, ni gauche. L’idéologie fasciste en France, Editions Complexe, 1987, [1983]
- Ce n’est donc pas par hasard qu’Alain de Benoist, journaliste et philosophe représentant le mouvement de la «Nouvelle Droite» se revendique du populisme. Voir Alain de Benoist, Le Moment Populiste: Droite-Gauche, c’est fini!, Pierre Guillaume de Roux, 2017. Pour de plus amples information sur Alain de Benoist et le Nouvelle Droite, voir Ico Maly, La révolution de la nouvelle droite, revue Lava, N°4, 2018, et Ico Maly, Nieuw Rechts, Epo, Berchem, 2017.
- Les informations sur le régime de Juan Perón proviennent du livre précité de Federico Finchelstein et de Yves Vargas (ed.), De la puissance du peuple. IV. Conservateur et réactionnaires. Le peuple mis à mal. Le temps des Cerises, Pantin, 2010, p. 273-284.
- Perón établit des lois visant à améliorer les conditions de travail, réglemente les loyers, instaurent les congés payés, un treizième mois, etc. Entre 1946 et 1949, les salaires ont augmenté de 60 %. L’État finançait les logements, les écoles, les hôpitaux, les centres de vacances et les centres sportifs. Voir Yves Vargas (ed.), op. cit, p. 281.
- Pablo Iglesias, Politics in a Time of Crisis, Verso, Londres, 2015. «Laclau proposes a very useful tool (…) for a practical interpretation of the autonomy of politics. (…) The left-right distinction and left-right political tools pose huge problems for the interpretation of the political space» (p. 202)
- David Harvey, Brève histoire du néolibéralisme, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2014.