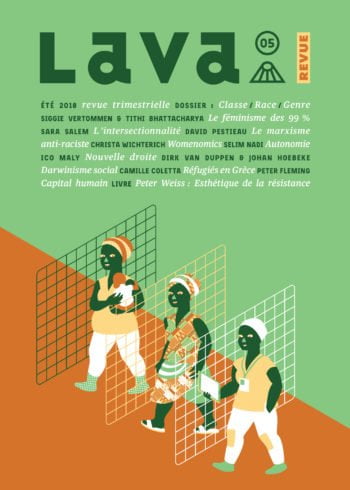Le capitalisme n’est pas seulement la production de marchandises, c’est aussi la reproduction sociale de la vie et de la force de travail. Interview de Tithi Bhattacharya.

Sens de la répartie, esprit vif et cœur à gauche, Tithi Bhattacharya est l’une des grandes figures du front militant féministe, même si en tant que marxiste, elle préfère qu’on l’appelle tout simplement camarade. Historienne, militante, écrivaine et mère de famille, elle est aussi l’auteure d’analyses très pointues sur le capitalisme, la notion de genre, la théorie marxiste, l’Asie du Sud-Est, le colonialisme et l’islamophobie. Ces derniers mois, elle a parcouru le Sud américain à la rencontre des enseignants en grève en Virginie-Occidentale et en Oklahoma pour les encourager. L’an dernier, lorsqu’elle n’était pas occupée à organiser la Grève internationale des femmes, elle se trouvait quelque part en train de livrer un vibrant plaidoyer pour soutenir la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre la politique d’occupation israélienne..

À côté de son activisme et engagement militant débordant, elle a tout de même trouvé le temps d’écrire un nouveau livre. Dans son ouvrage ‘Social Reproduction Theory : Remapping Class, Recentering Oppression’, paru aux éditions Pluto Press, elle explore avec d’autres grandes figures de la gauche comme Nancy Fraser, Lise Vogel, Susan Ferguson, David McNally et Cinzia Arruza, le principe de « reproduction sociale » pour mieux comprendre le quotidien sous le capitalisme. En se focalisant sur les sujets liés à la reproduction sociale comme les crèches, les soins de santé, les pensions et la vie de famille, le livre analyse la relation « holistique » existant entre l’exploitation économique et l’oppression sociale au croisement du genre, de la race, de la classe et de la sexualité.
La théorie de la reproduction sociale connaît un renouveau depuis quelques années. Face à un dogme marxiste qui s’intéresse surtout à l’économie « productive » capitaliste et au rôle du travail salarié, les féministes de la reproduction sociale mettent en lumière tout le travail nécessaire au niveau du « care », de l’émotion, de l’affection et de la reproduction à la maison, sur le lieu de travail et au sein de la communauté pour maintenir en vie le capitalisme en tant que système global.
Selon Bhattacharya, la théorie de la reproduction sociale présente, en tant qu’alternative sophistiquée à l’intersectionnalité, des contenus fondamentaux et des conceptions stratégiques pour les anticapitalistes, les féministes et les antiracistes du monde entier qui « espèrent rallier le monde ». Entretien à cœur ouvert sur son dernier livre, la reproduction sociale, #metoo, la récente vague de grèves et l’importance des récits « chaotiques » sur les questions de genre et de race pour bousculer les analyses de classes « pures ».
Sigrid Vertommen – Selon vous, qu’apporte la théorie de la reproduction sociale aux catégories traditionnelles d’analyse marxiste ? Quel est l’intérêt de tout ce travail sur le plan théorique et politique ?
Tithi Bhattacharya – La théorie de la reproduction sociale (TRS) n’est pas un complément au marxisme, c’est plutôt un approfondissement des idées de Marx sur la théorie de la valeur-travail. Au chapitre 21 de son livre Le Capital (v.1), Marx écrit que tout processus de production sociale est aussi un processus de reproduction, mais il ne développe jamais vraiment le volet reproductif. Son analyse du capitalisme se focalise surtout sur la plus-value que crée le travail lors de la production de biens, mais il ne prend pas en considération la (re)production de la force de travail.
Le livre analyse la relation « holistique » existant entre l ’exploitation économique et l ’oppression sociale au croisement du genre, de la race, de la classe et de la sexualité.
La TRS a pour principal objectif de démontrer qu’au sein du capitalisme il existe un lien fondamental entre la reproduction des forces de travail, d’une part, et la production de biens, d’autre part. Il suffit de songer à tout le travail qui doit être fait à la maison et aux contacts et accords qui doivent être pris avec le partenaire, la baby-sitter, les professeurs ou les voisins avant que la femme n’arrive à son lieu de travail le matin. La TRS analyse les circonstances sociales dans lesquelles le travailleur salarié, en tant que porteur de la force de travail et source de profit, est reproduit sous le capitalisme au quotidien et au niveau intergénérationnel.
La TRS met l’accent sur deux types de reproduction : la reproduction de la force de travail et la reproduction des relations sociales capitalistes. Ces deux types sont interdépendants, ils entretiennent une relation nécessaire, mais contradictoire. Cette relation est nécessaire en ce sens que, pour le marxisme, la reproduction de la force de travail est source de profit pour le capitalisme. S’il n’y a pas de travailleuse, il n’y aura pas de profit non plus. Pour vivre, la travailleuse a besoin de nourriture, de vêtements, d’un toit, de l’enseignement, des soins de santé, etc. Le capitalisme doit dans une certaine mesure se soucier de ces besoins, car s’il cesse d’investir dans tous ces besoins fondamentaux, les travailleurs mourront tout simplement.
Cette relation a également un caractère contradictoire en ce sens que l’investissement dans les besoins fondamentaux du travailleur n’est pas rentable pour le capitalisme. Investir dans des soins de santé publique de qualité, de bons logements sociaux ou une production alimentaire saine et durable réduit les profits directs des capitalistes. Le capitalisme est donc perpétuellement confronté à un dilemme puisque d’un côté, il dépend de la force vitale de la classe des travailleurs, mais de l’autre, il ne veut pas trop investir dans celle-ci. C’est cette relation nécessaire et contradictoire à la fois que la TRS vise et analyse.
Ce qui est fascinant dans votre travail, c’est votre définition très large de la composition de la classe des travailleurs. Selon vous, la classe des travailleurs ne se limite pas aux salariés. Pouvez-vous approfondir ?
Le salarié pourrait être la définition exacte de celui qui travaille aujourd’hui contre un salaire, mais cette vision de la lutte de classe est celle du secrétaire syndical somnolant. Pour nous, marxistes révolutionnaires, fait partie de la classe laborieuse toute personne de la classe productive qui au cours de sa vie a participé à la totalité de la reproduction de la société, que son travail ait été rémunéré ou non.
Cette vision de classe intégrative réunit donc le Latino employé à temps partiel dans un hôtel de Los Angeles, la mère de famille de l’Indiana avec contrat de travail flexible pour pouvoir garder ses enfants à la maison à cause du prix trop élevé des garderies d’enfants, l’enseignant afro-américain employé à temps plein à Chicago, et l’ancien employé blanc du syndicat United Automobile Workers (UAW) de Detroit qui se retrouve au chômage.
Il faut donc oublier l’idée communément admise selon laquelle le capitalisme est un système économique uniquement. Le capitalisme n’est pas seulement un mode de production, c’est aussi un ensemble de relations sociales. Et c’est précisément sur ce point que nous voulons insister dans le livre. Le capitalisme implique exploitation et extraction de plus-value, mais aussi domination, aliénation et oppression. Si on se limite à considérer le capitalisme comme une affaire économique uniquement, dans ce cas notre histoire ne dépasse pas le cadre de l’usine, du champ agricole, de l’entreprise ou du bureau, autrement dit du salaire et du profit.
Avec une approche aussi restreinte du capitalisme, on risque d’oublier que la relation de la travailleuse à son salaire n’existe que par sa relation à la vie. Il est plus que temps d’ajouter la vie et les relations au problème de la tyrannie capitaliste. Les nutriments sociaux nécessaires à une vie épanouie sont les soins de santé, une pension décente, les crèches, les transports publics, la nourriture. Ce sont ces choses qui poussent les gens à aller travailler. Les gens ne vont pas travailler parce qu’ils aiment se retrouver assis derrière un bureau et être réprimandés par leur patron, les gens sont obligés d’aller travailler pour subvenir à leurs propres besoins et ceux de leur famille.
Les gens sont obligés d ’aller travailler pour subvenir à leurs propres besoins et ceux de leur famille.
Le néolibéralisme est parvenu à privatiser la plupart de ces services sociaux. En plus de s’attaquer aux salaires, le néolibéralisme cherche également à privatiser l’eau, l’électricité, le logement, les soins aux personnes âgées et les soins de santé. Toutes ces attaques contre les secteurs vitaux sont immédiatement et radicalement ressenties par la classe des travailleurs, ce qui explique la recrudescence des protestations contre cette politique d’austérité. Annoncer à une travailleuse que son salaire va être diminué est une chose, mais si on lui annonce que son approvisionnement en eau va être coupé, ou que son eau est chargée de substances toxiques comme à Flint, dans le Michigan, elle réalise alors que non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa famille et des personnes qu’elle aime est en jeu.
Les féministes de la reproduction sociale, moi y compris, avons cherché à analyser ces actions de protestation reproductives par rapport à l’eau, aux soins de santé, à la pension, etc. dans une perspective de lutte de classes parce qu’elles sont nécessaires au renouvellement de la force de travail. Le capitalisme ce n’est donc pas seulement la production de marchandises, c’est aussi la reproduction sociale de la vie et de la force de travail, et c’est pour cette raison que le concept de lutte de classes doit sans plus attendre être élargi aux sphères de la reproduction sociale.
Si on dit que la reproduction est un élément du conflit de classes, quelles sont dans ce cas les implications stratégiques pour le travail de fond et organisationnel des syndicats, des organisations de femmes et organisations féministes ?
Les syndicats étaient nos meilleurs outils pour exprimer notre opposition, malheureusement aujourd’hui notre boîte à outils révolutionnaire manque cruellement d’un syndicat militant pour mener la lutte contre les inégalités salariales. Depuis l’avènement du néolibéralisme dans les années 1970, la situation au travail tant au Nord qu’au Sud est marquée par l’absence de syndicats, ou lorsqu’il y en a, ce sont des syndicats faibles et dociles.
Aujourd’hui lorsque les salaires sont attaqués, nous n’avons plus de la part des syndicats le même soutien que celui que nous avions dans les années 1930 ou 1960 pour mener un combat collectif contre ces diminutions salariales. Et ce, dans un contexte où les salaires réels diminuent partout dans le monde et où le temps de travail augmente considérablement. L’espoir que les gens plaçaient dans les syndicats a en outre été trahi d’une part, par des décennies d’actions antisyndicales venues d’en haut, et d’autre part, par la transformation du syndicat en une entreprise que le capitalisme préfère désormais gérer plutôt que combattre. S’il veut recouvrer ses forces, le syndicat doit à nouveau être un outil de pouvoir social de la classe des travailleurs, comme c’était le cas aux États-Unis dans les années 1930 à l’époque du « class struggle unionism » (syndicalisme de lutte de classes).
Cela implique de bien comprendre quels sont les besoins des travailleurs sur leur lieu de travail, d’une part, et leurs besoins en dehors du travail, mais aussi quelle est la relation qui existe entre les deux. Prenons un exemple. Imaginons que votre syndicat vous dise : « Nous allons défendre ton salaire, mais si le ministère de l’Immigration s’en prend à toi et ta famille, nous n’interviendrons pas. » Si on compare ce syndicat à un syndicat qui aide les communautés de migrants dans leur lutte contre les expulsions ou la gentrification raciale, on constate une différence énorme sur le plan du respect, de la confiance et de la reconnaissance. C’est cette forme de syndicalisme de lutte de classes qu’il faut raviver et retrouver.
Notre travail en tant que féministes, marxistes et révolutionnaires en général c’est d’aller à la rencontre des organisations de femmes, des mouvements de libération palestiniens ou encore du mouvement Black Lives Matter pour insister sur la nécessité de lutter contre les inégalités de salaires. À nos syndicats et mouvements syndicaux, nous devons dire que la lutte pour l’équité des salaires ne résoudra pas les problèmes de racisme, de sexisme et d’impérialisme. Un syndicat qui est incapable de faire ce lien n’aura aucune chance de réussir, pas même d’un strict point de vue de lutte salariale.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples de syndicats capables d’établir ce lien ?
Aux États-Unis, on a deux très bons exemples qui ces dernières années ont ouvert la porte à un nouveau type d’organisation syndicale. Le premier est le syndicat des enseignants à Chicago, the Chicago Teachers Union, qui s’est autoproclamé syndicat pour la justice sociale. À Chicago, et en particulier dans les quartiers afro-américains et latinos, de nombreuses écoles ont été fermées au cours des dernières années. Le Chicago Teachers Union s’est battu contre la fermeture de ces écoles et s’est également impliqué aux côtés de la communauté locale dans le combat contre les expulsions. Lorsqu’en 2012, le syndicat s’est effectivement mis en grève, ces communautés marginalisées ont soutenu la grève de manière inconditionnelle parce qu’elles connaissaient déjà le syndicat, parce qu’elles ont reconnu la bannière du syndicat qui avait lutté à leurs côtés. C’est pour ces raisons que la grève des enseignants à Chicago a connu un tel succès.
Plus récemment, et à une beaucoup plus petite échelle, on a aussi l’exemple d’une branche du syndicat des chauffeurs de poids lourds à New York, active dans la lutte contre les nouvelles mesures d’expulsion mises en place par l’administration Trump. C’est là la voie à suivre pour retrouver la force sociale qu’avaient autrefois les syndicats.
La Grève internationale des femmes est un autre exemple de « point de jonction » où tous ces mouvements de lutte peuvent se réunir. Ce projet féministe anticapitaliste fait la promotion d’un féminisme de classe laborieuse, un féminisme pour les 99 %. Syndicats et organisations doivent redoubler d’efforts pour relier les questions traditionnellement considérées comme questions économiques ou de classes et les questions de reproduction sociale. C’est le seul moyen d’aller de l’avant.
Dans un chapitre passionnant de votre dernier livre, Nancy Fraser dresse l’historique des différents modes de reproduction sous le capitalisme, depuis le capitalisme industriel du 19e siècle et le colonialisme jusqu’à l’État-providence keynésien d’après-guerre et le néolibéralisme depuis les années 1970. Quelle est la particularité du mode de reproduction néolibéral ? Et quelle est la différence avec les modes de reproduction précédents ?
On distingue deux tendances dans le mode de reproduction social néolibéral. La première concerne la privatisation directe et brutale des services et institutions de première nécessité. Que ce soit pour l’eau, les soins de santé, l’enseignement, les logements, l’alimentation, les semences ou le pétrole, le néolibéralisme a servi de massue au pacte keynésien qui existait entre l’État et le capital dans le monde d’après-guerre.
La deuxième concerne une autre marchandisation : le travail productif qui auparavant était effectué « gratuitement » via le travail non rémunéré des femmes au foyer ou à une époque plus lointaine encore par les esclaves, est à présent marchandisé et transformé en emplois très mal rémunérés sur le marché du travail. Si on prend l’exemple de l’économie et du marché du travail américains, on observe que la majorité des emplois du secteur des services qui ont été créés dans l’économie américaine sont des emplois qui sont liés à la reproduction sociale de la force de travail et qui sont majoritairement exercés par des femmes. Je veux parler des femmes de ménage, des nounous, des infirmières, des travailleuses du sexe. Sur la totalité des emplois créés dans le secteur des services, 57 % sont des emplois qui relèvent de la sphère de la reproduction sociale, soins de santé, services sociaux et alimentation.
La marchandisation de ces emplois n’a fait qu’alourdir la charge de travail domestique pour les femmes de la classe laborieuse. Le seul groupe qui en a tiré profit c’est un petit groupe de femmes appartenant à l’élite. Elles ont pu briser le plafond de verre pour devenir CEO, professeur ou magistrat en se déchargeant de leurs tâches de reproduction sociale qu’elles ont confiées à une nounou indienne et une femme de ménage afro-américaine. Les femmes de la classe laborieuse et les femmes de couleur, au contraire, ont vu leur charge de travail doubler : travailler au domicile d’une autre personne pour un salaire minimum en plus du travail ménager abrutissant et interminable dans leur propre maison.
À quoi ressemblent la reproduction sociale et le travail reproductif dans votre société postcapitaliste idéale ? Défendez-vous un État-providence fort où les soins et la reproduction sont collectivisés ? Ou êtes-vous plutôt pour la création de biens reproductifs communs, avec crèches autonomes, un revenu de base ou un salaire pour le travail domestique comme outils d’une justice reproductive ?
Nous vivons dans un contexte néolibéral impitoyable où le capitalisme écrase les communautés, les femmes et la nature et menace toutes les activités de la vie quotidienne. De prime abord, la solution keynésienne d’un renforcement de l’État-providence paraît très tentante. Bien sûr, cela me ferait énormément plaisir d’avoir un État-providence élargi et renforcé, prévoyant pour tous des soins de santé et des logements sociaux, je soutiens d’ailleurs les mouvements qui luttent pour atteindre cet objectif, toutefois un renouvellement et une renaissance de l’État-providence ne signifieraient pas la fin de la discussion, mais plutôt un début. C’est ici que se séparent les routes des féministes réformistes et des féministes révolutionnaires.
Nous avons plus d’ambition et nous poursuivons un objectif beaucoup plus vaste, à savoir le démantèlement du capitalisme et l’instauration d’un contrôle des moyens de production et de reproduction exercé démocratiquement par la majorité des citoyens. Si nous luttons pour un tel projet ce n’est pas par romantisme ou utopie, mais parce que nous sommes bien conscientes que même en réussissant à donner un nouveau souffle à l’État-providence, à obtenir la médecine gratuite pour tous, à sauver le NHS (le système de santé publique au Royaume-Uni), et à instaurer un revenu d’intégration en Inde, tout sera une nouvelle fois perdu lors du prochain cycle de crises capitalistes. Le capitalisme est en effet un système sensible aux crises cycliques. Les acquis obtenus en période de prospérité seront une nouvelle fois attaqués en période de crise et la génération suivante devra mener la même lutte encore une fois. Ce que nous voulons, c’est une solution permanente à la fois pour les générations à venir et pour la survie de notre planète.
À quoi devra donc ressembler la reproduction sociale après la révolution ?
Même si, en tant que marxistes, nous ne sommes pas en train de dessiner les plans de la société communiste idéale, je dirais — en me référant aux idées des premiers marxistes et en particulier les bolcheviques — que le principal problème en ce qui concerne l’oppression des femmes c’est la distinction qui est faite entre reproduction et production. Il faut supprimer cette distinction et cela n’est possible qu’en réorganisant la production en fonction des besoins humains. À son tour, cela permettra de « dégenrer » la production sociale en faisant de ces processus la responsabilité sociale de tous et non plus seulement des femmes.
Sur le plan pratique, il faudrait par exemple retirer le travail domestique et non rémunéré des femmes de la sphère privée de la famille et le collectiviser à nouveau. Toutes ces tâches ménagères ennuyeuses, fastidieuses, qui condamnent à l’isolement doivent être retirées de la sphère privée et socialisées soit par les autorités qui fournissent les soins et services collectifs, soit par la participation de chaque membre de la communauté aux tâches familiales. Ce n’est pas que nous, femmes actives, n’aimons pas faire la cuisine, mais c’est que nous n’avons pas le choix et que chaque jour nous sommes obligées de cuisiner après une journée entière de travail. Le fait de ne pas avoir le choix est mortel pour notre esprit et notre âme. La socialisation du travail domestique ne signifie pas qu’il n’y a plus de choix individuel, mais ce choix prend pour la première fois son sens véritable.
Toutes ces tâches ménagères ennuyeuses, fastidieuses, qui condamnent à l ’isolement doivent être retirées de la sphère privée et socialisées
Je ne suis pas vraiment d’accord avec la campagne Wages for Housework (un salaire pour le travail ménager), lancée dans les années 70 par des féministes autonomistes comme Silvia Federici, Selma James et Mariarosa Dalla Costa. Je suis d’accord avec le fait que le travail ménager est la base de la création de valeur puisqu’il reproduit la force de travail, mais le travail ménager ne crée pas de plus-value comme le fait la production de marchandises. Réclamer un salaire pour ce travail est à mon sens une mauvaise stratégie.
Ceci étant dit, nous, les féministes de la reproduction sociale, nous sommes extrêmement reconnaissantes envers ces pionnières du féminisme autonome d’avoir attiré l’attention sur le travail non rémunéré. Bien sûr, elles n’ont pas été les premières à le faire, avant elles il y a eu les bolcheviques et les traditions révolutionnaires des travailleurs noirs aux États-Unis, mais ces traditions révolutionnaires se sont perdues après la guerre. Les féministes autonomes italiennes ont réalisé un travail formidable en exhumant ces traditions radicales et nous ont forcés à considérer le capitalisme dans son ensemble, en tant qu’unité de production et de reproduction.
Comment peut-on s’associer au mouvement #metoo du point de vue de la TRS et d’un point de vue du féminisme marxiste ? Jusqu’à présent ce sont souvent des féministes radicales et libérales qui se sont approprié le thème de la violence sexuelle et sexiste en pointant la nature prédatrice de l’homme comme source de tous les maux.
Le mouvement #Metoo a permis une avancée remarquable. Ce qui est exaltant, ce n’est pas le fait que les femmes aient pris conscience des violences sexuelles sur leur lieu de travail, les femmes en ont toujours eu conscience, elles les ont toujours endurées et contestées, mais ce qui est fantastique c’est que le silence qui nous a été imposé à nous les femmes pendant des décennies a été rompu publiquement. Le fait que ce silence soit un silence imposé introduit une nuance importante. Le silence n’est pas dû au fait que les femmes ont peur de parler, mais il nous est plutôt imposé par les relations sociales capitalistes. Permettez-moi de vous donner deux exemples de ce silence imposé.
Si on songe à tous les obstacles de nature infrastructurelle auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles veulent dénoncer un délit sexuel, et notamment la police et le système judiciaire qui ne sont manifestement pas nos amis, les femmes n’ont d’autre choix que de garder pour elle le traumatisme subi ou en parler à leurs proches et amis intimes uniquement. Si aux États-Unis, vous voulez par exemple dénoncer un sénateur ou un membre du Congrès pour violences sexuelles, vous êtes obligée de suivre une médiation et thérapie d’un an avant de pouvoir introduire une plainte officielle. Ces obstacles s’ajoutent à la honte et aux reproches du type « tu avais trop bu », « ta jupe était trop courte » et autres inepties misogynes de ce genre.
Le second problème est également d’ordre infrastructurel, mais peut-être de manière moins frappante. Pourquoi une femme ne se révolte-t-elle pas contre son patron qui l’agresse sexuellement ou lui fait des avances déplacées ? La réponse du capitalisme à cette question c’est que soit elle a peur, soit elle est complice. La réponse de la TRS c’est que son statut social risque d’être sérieusement compromis en fonction de son origine ethnique, sa classe, son appartenance sexuelle et son statut d’immigrée. La travailleuse immigrée victime de violences sexuelles commises par le patron ou un collègue devra très probablement tenir sa langue et continuer à subir les violences si elle ne veut pas risquer de perdre son emploi ou devoir changer de travail, avec le risque que les mêmes faits se reproduisent.
En plus d’un bas salaire, les travailleurs immigrés n’ont pas droit à un système de soins de santé et de services sociaux solides et fiables. Lorsque vous êtes licenciés dans un pays comme les États-Unis, il n’existe pas de filet de sécurité entre le jour où vous êtes licenciés et celui où vous trouvez un nouvel emploi, ce qui veut dire pas d’accès aux soins de santé et pas de services publics pour vous aider, vous et votre famille, pendant la période où vous vous retrouvez sans emploi. Le problème endémique d’abus sexuels sur le lieu de travail est lié à l’absence de syndicats au travail et à l’absence de service de reproduction sociale en dehors du travail. Ce sont ces choses qui imposent le silence aux femmes et les empêchent de dénoncer les auteurs.
C’est le genre de liens que la Grève internationale des femmes tente d’établir : entre la violence sexuelle et sexiste et les relations capitalistes. Se battre contre un patron ou un mari violent est nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons nous battre pour un système qui nous garantit un syndicat fort en mesure de défendre nos droits au travail ainsi qu’un système de sécurité sociale solide en dehors du travail pour le cas où nous perdrions notre emploi. À Chicago, les femmes de chambre du secteur hôtelier et leurs syndicats se sont battus pour l’obtention d’un bouton d’alarme qu’elles pourraient actionner en cas de problème pendant leur service. Pour moi, le féminisme anticapitaliste est comparable à un bouton d’alarme à actionner contre les violences capitalistes.
Comment vos réflexions, vos idées et vos opinions en matière de reproduction sociale ont-elles enrichi l’organisation du mouvement International Women Strike (IWS) aux États-Unis ?
Cela fait deux ans qu’avec un groupe de camarades féministes fantastiques j’ai adhéré au mouvement International Women’s Strike aux États-Unis. Dans le cadre de notre projet féministe militant, nous tentons de faire plusieurs choses :
Premièrement, agir contre la capitalisation du féminisme. Comme je l’ai expliqué plus haut, la tendance dominante du capital néolibéral n’est pas de jeter la rhétorique féministe par-dessus bord, mais de la transformer en rhétorique centrée sur le capital. Contre cette vision dénaturée du féminisme, l’IWS a donné corps à un féminisme clairement anticapitaliste, le féminisme des 99 %.
Deuxièmement, l’emploi du mot « grève » était très important à nos yeux, mais cela nous a valu des critiques de la part de différentes sections de la gauche américaine. Ce mot, nous l’avons employé délibérément. Ce que nous voulions c’était attirer l’attention sur un principe fondamental de la TRS, à savoir le fait que le travail salarié et la reproduction sociale sont des aspects différents d’une même unité capitaliste et par conséquent s’opposer à une forme implique de se révolter contre l’autre. Nous ne pensions pas, et nous ne le pensons toujours pas, que la force syndicale aux États-Unis puisse être reconstruite en mettant l’accent sur le recrutement sur le lieu de travail au sens strict du terme. Nous croyons plutôt que c’est au travers d’une grande lutte sociale réunissant travailleurs, femmes et gens de couleur que l’on pourra créer le contexte qui permettra de réaliser ce travail syndical. Ce n’est pas un hasard si l’an dernier, trois écoles ont fermé le 8 mars parce que les enseignants, majoritairement des femmes, avaient refusé d’aller travailler, démontrant ainsi concrètement ce qu’était la force d’un féminisme de lutte de classes.
Enfin, il est impossible de débattre de la TRS sans aborder la question de l’action de grève réussie des enseignants et des infirmières actuellement menée dans tous les États-Unis. Je me trouvais en Virginie-Occidentale durant la grève des enseignants et je peux vous dire que j’ai vécu l’un des plus beaux week-ends de ma vie en interviewant les grévistes et en apprenant un tas de choses en les écoutant.
La question qu’il faut se poser est de savoir pourquoi les travailleurs reproductifs — c’est-à-dire nos enseignants, nos infirmières, nos femmes de chambre — constituent la section la plus militante de la classe laborieuse américaine. Ni les patrons, ni les bureaucrates syndicaux n’ont la réponse. Je vais tenter d’y répondre. Ce n’est pas seulement parce que, comme nous l’avons évoqué plus haut, le secteur connaît une très grande expansion, ce qui est effectivement le cas, ou à cause des coupes budgétaires dévastatrices dans ces secteurs, c’est aussi, et ce point est fondamental, parce que le travail de ces personnes crée les conditions nécessaires au fonctionnement du système et les travailleurs en sont conscients. Que se passe-t-il lorsque les écoles ferment ? Lorsque les infirmières refusent de donner des soins ? Lorsque les immigrées refusent de nettoyer ? Le travail sur lequel s’appuie le système, même s’il ne crée pas de plus-value directe, a un pouvoir énorme sur le système. C’est ce que nos enseignants, nos infirmières et nos femmes de ménage ont enseigné au capital.
Et nous espérons que dans les jours à venir il y aura de plus en plus de piquets où ce genre de leçons seront enseignées et transmises.
Vous êtes activiste et professeur à plein temps. Dans quelle mesure la maternité a-t-elle influencé votre vie politique, intellectuelle et professionnelle ? Est-ce plutôt enrichissant, plutôt handicapant ou les deux ?
Je suis membre du mouvement de gauche depuis l’âge de 16 ans. Je me suis toujours considérée comme marxiste ou marxiste révolutionnaire. En cette qualité, je me suis depuis toujours battue contre l’oppression des femmes. Ce n’est que depuis 2008, après la naissance de ma fille que j’ai commencé à ressentir le lien entre la question de genre et le capitalisme, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan physique, et que j’ai insisté pour qu’on me qualifie de féministe marxiste. Ce nouveau terme était très important pour moi. La grossesse, l’accouchement et les premières années passées à m’occuper de ma fille m’ont transformée d’un coup, je suis passée de femme active, énergique et sexuellement désirable en mère de famille constamment fatiguée, angoissée, attentive à son physique et inquiète.
 La poétesse et féministe américaine, Adrienne Rich (également auteure du célèbre livre Of Woman Born : Motherhood as Experience and Institution, ndlr) m’a sauvée en faisant la distinction entre la maternité en tant qu’expérience, dont j’avais plus ou moins profité, et la maternité en tant qu’institution que je haïssais instinctivement. Mon conjoint m’a aidée à davantage profiter de la première et à moins me soucier de la seconde. Après 2008, le mot « féministe » a modifié ma nature alerte en me connectant aux histoires et choses que j’avais toujours défendues, mais pour lesquelles je ne me sentais peut-être pas assez concernée. Cela vaut certainement aussi pour toutes les formes de soins, et pas seulement la maternité. Le féminisme a éveillé en moi un marxisme révolutionnaire de sorte que pour les deux, le sens et le projet en ont été modifiés.
La poétesse et féministe américaine, Adrienne Rich (également auteure du célèbre livre Of Woman Born : Motherhood as Experience and Institution, ndlr) m’a sauvée en faisant la distinction entre la maternité en tant qu’expérience, dont j’avais plus ou moins profité, et la maternité en tant qu’institution que je haïssais instinctivement. Mon conjoint m’a aidée à davantage profiter de la première et à moins me soucier de la seconde. Après 2008, le mot « féministe » a modifié ma nature alerte en me connectant aux histoires et choses que j’avais toujours défendues, mais pour lesquelles je ne me sentais peut-être pas assez concernée. Cela vaut certainement aussi pour toutes les formes de soins, et pas seulement la maternité. Le féminisme a éveillé en moi un marxisme révolutionnaire de sorte que pour les deux, le sens et le projet en ont été modifiés.