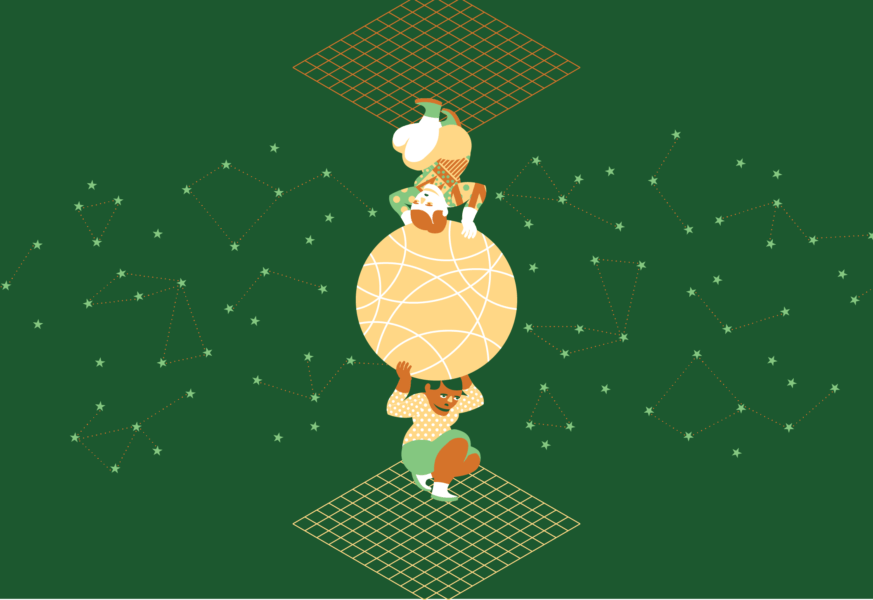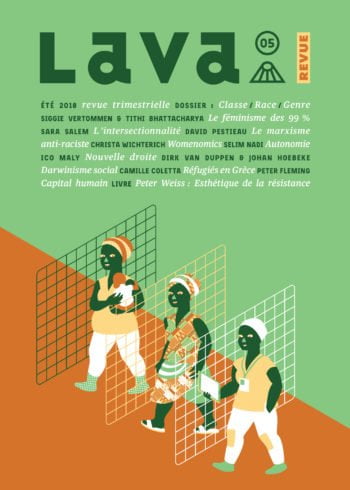L’inclusion des femmes dans le marché de travail n’a pas amené une plus grande égalité entre les sexes mais à un spectre mêlant valeurs émancipatrices, néo-libérales et néo-conservatrices.

Qu’ il s’agisse du débat sur le travail domestique ou de la discussion sur l’égalité des salaires, de la polémique relative au petit nombre de femmes dans des fonctions de direction ou de la reconnaissance professionnelle des travailleuses du sexe, les féministes de gauche ont toujours visé à mettre un terme à la cécité marxiste sur la question du genre, à réfuter le discours de la contradiction principale et de la contradiction secondaire et à rendre visible et objet de débats la catégorie de l’inégalité sociale des genres en tant qu’élément constitutif du capitalisme. Dans une perspective féministe-économiste, la recherche s’ était jusqu’à présent axée d’une part sur l’alliance étrange entre certaines orientations néolibérales et féministes1 et, d’autre part, sur les subjectivités nouvelles qu’ont développées les femmes dans les chaînes transnationales d’aide mutuelle et de création de valeurs.
Récit N°1 : Engels et l’éancipation par le travail salarié
Quand, à partir des années 1980, le taux d’emplois des femmes a augmenté dans le monde entier, les paroles de Friedrich Engels sur l’émancipation par intégration dans les marchés du salariat, sembla devenir réalité. Des jeunes femmes de la campagne en Afrique du Nord, en Extrême-Orient, dans le sud-est asiatique ainsi qu’en Amérique centrale trouvaient un emploi et un revenu dans la production des textiles, des chaussures et des équipements électroniques destinés à l’exportation. Cela les « libérait » ainsi des conditions de vie misérables et patriarcales liées à l’économie de subsistance de l’agriculture et leur permettait de s’intégrer dans l’économie urbaine moderne du travail salarié et de l’argent en les soumettant par la même occasion aux rapports de coercition industriels de la productivité, de la concurrence et de l’aliénation.
Le « libéralisme inclusif » a eu comme résultat global que les femmes travaillent la plupart du temps dans le secteur informel et domestique, souvent à temps partiel.
Ainsi apparurent des systèmes de production sexués, appelés plus tard « chaînes transnationales de création de richesse ». Ils sont fondés sur un grand pool de main-d’œuvre féminine dont l’avantage comparatif est d’être bon marché, adapté et non- organisé syndicalement. Ce développement était accompagné d’une vision évolutive de la modernisation d’après laquelle l’augmentation du travail salarié des femmes serait l’expression d’une tendance universelle vers l’égalité des sexes et permettrait également d’accroître de façon continue les possibilités d’émancipation.
Pourtant, la féminisation de l’emploi dans les diverses régions du monde se développe de façons très diverses : alors que le taux de travail des femmes a augmenté en Amérique Latine et dans les Caraïbes de 40 à 54% entre 1990 et 20151, il était en régression dans d’autres régions. Pendant la même période, il a diminué en Extrême-Orient de 68 à 62% ; en Europe de l’Est de 54 à 50% et au niveau mondial de 52,4 à 49,6%. Or, ces statistiques reprennent seulement les emplois déclarés et non le travail informel de la petite paysanne ou de la commerçante de rue, de l’employée de maison ou de la travailleuse du sexe.
Des scientifiques féministes se sont demandé si des progrès en matière d’émancipation seraient possibles dans des conditions d’exploitation et d’informalisation du travail, par exemple dans l’industrie textile en pleine expansion. Conclusion : l’augmentation des jobs féminins, la contribution importante à la croissance du produit intérieur brut et les augmentations de productivité ne se traduisent pas en salaires décents, ni en droits du travail ni en sécurité sociale.
C’est dans les ateliers informels et les sweatshops non réglementés comme le Rana Plaza au Bangladesh que l’on trouve les plus mauvais salaires et conditions de travail. L’effondrement des bâtiments de l’usine et de ses bureaux en 2013 causant 1126 morts et 2500 blessés graves est devenu une métaphore tragique de la violence structurelle de ce régime de production transnational. L’effondrement du Rana Plaza était la conséquence systémique d’une industrie transnationale orientée vers la croissance et la réduction des coûts où risques et dégâts sont supportés par ceux qui se trouvent en bas de la chaîne de création de richesse. Autre conséquence de ces rapports de production : les tentatives d’organisation des travailleurs et travailleuses pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires sont réprimées de façon violente.
Récit N°2 : Le caractère favorable aux femmes du capitalisme néo-libéral
En 2010, la célèbre chroniqueuse américaine Hannah Rosin a posé la question : « L’économie moderne post-industrielle ne serait-elle pas favorable aux femmes plutôt qu’aux hommes2 ? ». Le contexte était celui de la crise financière de 2008-2009, lors de laquelle les statistiques des États-Unis ont enregistré pour la première fois plus de femmes actives professionnellement que d’hommes.
Selon Rosin, cela aurait sonné le glas de l’homme « gagne-pain de la famille », aurait démontré une inversion des rôles et un « échec du patriarcat ». Cette lecture des relations entre les sexes s’inscrit également dans la tradition de l’émancipation des femmes par le travail salarié et le revenu monétaire. Pour la première fois, les femmes étaient considérées comme les gagnantes de la crise qui, dans l’hémisphère Nord, avait globalement eu surtout des effets négatifs sur l’emploi masculin. Mais, dans l’hémisphère Sud, ce furent les femmes les plus touchées, tout comme lors des crises précédentes. Le cadre général des mutations dans l’emploi était formé par la désindustrialisation de nombreux pays, par les pertes d’emplois causées par l’industrialisation croissante de l’agriculture et par le boom dans le secteur des services où plus de 60% de toutes les femmes actives avaient trouvé du travail.
Là où le fossé s’est rétréci, la raison n’en est pas obligatoirement une hausse des salaires des femmes mais plutôt parfois une baisse des salaires des hommes.
Dans ce contexte, le taux d’emploi masculin a baissé mondialement de 80 à 76% au cours des 20 dernières années. D’autre part, depuis les années 1990, la féminisation de l’emploi est allée de pair avec la mise en œuvre des principes néolibéraux de dérégulation et de flexibilisation des marchés du travail. La flexibilisation apporte de l’emploi et embellit les statistiques de l’emploi. La dérégulation des marchés tout comme la flexibilité et la généralisation des conditions de travail informelles sont censées faciliter l’inclusion, l’ouverture de segments de marché à des personnes jusqu’à présent exclues et marginalisées, les pauvres, les indigènes, les travailleurs des secteurs informels et ceux qui vivent d’une économie de subsistance.
Cette nouvelle version du néo-libéralisme, le « libéralisme inclusif », a eu, pour les femmes au niveau mondial, comme résultat global qu’elles travaillent la plupart du temps dans le secteur informel, à temps partiel et, souvent, comme membres aidant de la famille. Dans l’UE, les femmes représentent 75% de l’ensemble des personnes employées à temps partiel ou occasionnellement, souvent à des bas salaires et sans beaucoup de protection sociale. Le secteur des services est particulièrement flexible et informel ; il fait souvent appel à la sous-traitance, au travail intérimaire et occasionnel. Les salaires y sont par conséquent précaires. Les secteurs des services, des soins de santé et de l’éducation ont été moins touchés par la crise que ceux de la construction et des banques. Toutefois, les emplois féminins dans l’administration et les secteurs sociaux sont menacés par la politique d’austérité, la diminution du secteur public et les privatisations. L’automatisation et la digitalisation de l’industrie 4.0 détruisent encore plus d’emplois. On en fait l’éloge aux femmes comme ouvrant de nouvelles perspectives qui permettront de combiner travail et vie privée par une plus grande flexibilité d’horaire et de lieu de travail via, par exemple, le crowdworking.
Tout en présentant la flexibilisation et l’orientation vers les services comme des mesures structurelles favorables aux femmes, beaucoup d’institutions multilatérales, telles que la Banque mondiale, le Forum Économique Mondial de Davos, les Nations Unies et l’UE, ont mis en oeuvre lors de la crise des mesures favorables à l’égalité, mais en tant que stratégie de maximalisation de la capacité concurrentielle et de la croissance.
Le fantasme de la « sous-utilisation » des femmes en tant que capital humain et de la nécessité de mieux les utiliser en vue de l’augmentation de la productivité, avait déjà été repris en 2007 par la Banque mondiale dans son plan d’action pour le genre via le concept d’émancipation des femmes par leur inclusion dans le marché. Pour la Banque mondiale, il ne s’agissait pas des droits des femmes. En présentant de façon démagogique l‘ égalité des sexes comme de la « smart economics », et en présentant les femmes comme de nouvelles actrices efficaces et rentables du marché, elle voulait surtout faire de l’efficacité, de la croissance et de la rentabilité, des critères universels de l’émancipation des femmes.
Tout cela est présenté comme une opération « win-win » et comme un accroissement des opportunités pour les femmes. Pendant la crise, la Banque mondiale a acquis, grâce à cette orientation vers la croissance, une hégémonie en matière de développement et de politique du genre par rapport aux objectifs féministes et aux objectifs relatifs aux Droits de l’Homme3. Cette offensive en faveur des femmes est soutenue par de grandes multinationales comme Coca Cola et Exxon qui élaborent, en partenariat avec les institutions des Nations Unies, des programmes en faveur des femmes et, de plus en plus, des jeunes filles. Goldman Sachs veut, grâce à la formation « Womenomics » et à l’octroi de crédits, préparer 100.000 femmes à une carrière dans les affaires. La Fondation Nike appelle, au travers d’une campagne « Girl Effect », tout comme Walt Disney avec « Pink Princess », à investir dans les jeunes filles supposées faire avancer l’économie4 en tant que marchés émergeants et futures entrepreneuses indépendantes.
Récit N° 3 : Fermer des brèches, rattraper, égaliser
Les disparités entre sexes sont désignées par le concept de fossé ou d’écart. Les différences entre les femmes et les hommes sur le marché du travail sont caractérisées par un écart au niveau de l’emploi et de la qualité du travail, par des différences dans les salaires et les pensions, par une répartition inégale dans le secteur des soins et dans les fonctions dirigeantes, par un accès inégal aux ressources et aux technologies. Au centre de cette disparité se trouve l’écart dans le taux d’emploi entre hommes et femmes de 26% au niveau mondial (inchangé depuis 20 ans) et l’écart salarial d’en moyenne 23% au niveau mondial. Là où le fossé s’est rétréci, la raison n’en est pas obligatoirement une hausse des salaires des femmes mais plutôt parfois une baisse des salaires des hommes.
Le Japon, la Corée du Sud et la Russie sont les pays où l’écart salarial entre hommes et femmes est le plus grand, plus de 30%. Selon l’Organisation internationale du Travail5, à la vitesse actuelle, l’écart salarial entre hommes et femmes ne sera résorbé que dans 75 ans. Dans l’UE, il y a un écart alarmant de 39% entre les pensions des hommes et des femmes entraînant un risque élevé de pauvreté chez les femmes âgées. À l’avenir, les carrières professionnelles des hommes seront également plus discontinues et les hommes jeunes seront le plus touchés par le chômage. Par conséquent, les pensions des hommes diminueront aussi. Cela pourra conduire à un nivellement par le bas.
Goldman Sachs veut, grâce à la formation « Womenomics » et à l’octroi de crédits, préparer 100.000 femmes à une carrière dans les affaires.
L’écart entre genres résulte aussi d’une segmentation genrée des marchés : certaines professions ou branches sont considérées comme féminines ou masculines, avec des conséquences en matière de valorisation et de niveau de salaire. Ce qui est remarquable, c’est que les différences salariales sont plus grandes dans les fonctions hautement qualifiées et bien rémunérées que dans les catégories de salaires plus bas. Bien que les différences dans l’accès à l’éducation et aux diplômes aient évolué au profit des jeunes filles et des femmes, cela ne s’est pas traduit de façon mécanique sur le marché du travail et dans les professions.
L’activité professionnelle des femmes est -comme l’exprime l’OIT -, limité par le bas par un « plancher collant », caractérisé par des emplois précaires et mal payés. Vers le haut, elle est limitée par un « plafond de verre » qui empêche les femmes d’accéder aux fonctions dirigeantes. L’OIT considère comme précaires la moitié de tous les emplois au niveau mondial, c’est-à-dire des emplois avec une rémunération qui ne permet pas de vivre et sans sécurité sociale. A l’échelle mondiale, les femmes font partie d’une façon disproportionnée des « working poors », c’est-à-dire de ceux qui restent pauvres tout en travaillant.
Ces dernières années, dans les pays occidentaux, l’attention s’est focalisée sur l’égalité hommes-femmes dans les fonctions dirigeantes, là où se prennent les décisions. Le nombre de femmes dans des fonctions dirigeantes n’a augmenté que légèrement et atteint les 23%. Parmi les 500 entreprises reprises dans la liste du magazine Fortune en 2016, cette proportion n’atteint que 10,9%. Seules 13 de ces entreprises étaient dirigées par une femme. Il est intéressant de constater que les pays riches du Nord sont en dessous de la moyenne ; le Japon et l’Allemagne se situant, par exemple, loin derrière la Turquie. La Russie est en tête des statistiques avec 43% de femmes dans les fonctions dirigeantes, suivie de la Chine et d’autres pays d’Europe de l’Est et d’Asie du sud-est. En Norvège, l’introduction d’un taux de femmes de 40% pour les sociétés cotées en bourse a été une étape politique déterminante. Généralement, les entreprises s’opposent à des règles obligatoires et promettent de s’améliorer sur une base volontaire, ce qui bien entendu reste sans effet.
Outre l’écart salarial lié au sexe ou à la classe sociale, il existe également un tel écart entre populations autochtones et migrants. Par ailleurs, les mères de famille sont souvent confrontées à des handicaps évidents dans leur vie professionnelle et leurs revenus par rapport aux non-mères, surtout en Pologne où la famille joue un rôle important. Et ce, malgré des mesures politiques introduites dans de nombreux pays de l’UE pour soutenir l’emploi des mères et des parents célibataires. Cela est dû au fait que, pour soutenir la croissance et la compétitivité, l’UE poursuit un modèle néolibéral de travail : tous les adultes doivent être au travail.
L’écart entre les sexes occupait une place centrale dans le chapitre sur l’égalité du Rapport sur le Développement Mondial 2012. Dans la logique commerciale de la Banque mondiale, ces écarts doivent être éliminés car ils constituent un obstacle à la croissance. Leur point de vue sur l’écart entre les sexes reflète une vision étroite des rapports inégalitaires, coupée des conditions économiques et des rapports concrets entre les sexes culturellement et géographiquement très différents.
Dans la perspective de l’inégalité des sexes, les femmes sont les personnes discriminées et victimes. La vulnérabilité due à la pauvreté ou au manque de résistance à la pauvreté est attribuée au genre et n’a pas de connotation de classe. Il est vrai que l’analyse des écarts entre sexes rend visibles l’inégalité des sexes et l’exclusion des femmes. C’est ce qu’ont toujours demandé les mouvements féministes. Mais l’attitude face à l’élimination de l’inégalité des sexes dans l’accès au marché du travail est très ambivalente, voire paradoxale.
Ainsi, la Banque mondiale veut émanciper les petites paysannes partout dans le monde en leur facilitant l’accès aux additifs agricoles modernes tels que les engrais chimiques et les graines industrielles, cela dans le but d’augmenter leur rendement. Alors que le pouvoir traditionnel des femmes paysannes résidait dans la multiplication et l’échange de leurs propres semences. Cela leur permettait de maintenir leur souveraineté alimentaire et de ne pas être obligées d’acheter très cher des semences industrielles hybrides sur le marché. Au lieu de valoriser la contribution des femmes paysannes à la sécurité alimentaire et de l’améliorer par des mesures de soutien, cette forme d’égalité aide à la mutation de la structure économique agricole vers une agriculture industrialisée dirigée par l’agrobusiness.
Récit N° 4 : L’extraction du travail domestique et sa reconnaissance
Après des années d’interventions critiques des féministes, le travail et l’économie domestiques apparaissent comme un facteur économique majeur dans tous les programmes internationaux d’égalité des genres – de la Banque mondiale à l’OIT. Sans le travail domestique, c’est-à-dire l’activité consistant à soigner et préserver l’homme et la nature, la société ne peut se reproduire socialement et les marchés ne peuvent pas fonctionner. Une contradiction fondamentale de l’accumulation capitaliste consiste dans le fait que l’expansion et la croissance surexploitent et détruisent les ressources de l’homme et de la nature. C’est pour cette raison que les situations de crises constituent un état permanent du processus de reproduction sociale6.
Le marché et la politique présentent perfidement le travail domestique comme relevant de capacités « naturelles » féminines extensibles à l’infini. L’économie domestique est à la fois une matière première et une source d’énergie pour les marchés. Elle sert simultanément à externaliser et à individualiser les risques et les coûts sociaux. Dans des situations de crise et dans le cadre de politiques de régression sociale et d’austérité, les États ont recours au travail domestique non- et sous-payé pour sortir du budget de la sécurité sociale les coûts liés à la reproduction de la force de travail et pour gérer à moindre frais les problèmes sociaux, économiques et environnementaux7).
Le travail domestique est de plus en plus un travail salarié, mais un travail peu considéré et mal payé. Le fait qu’il soit salarié ne signifie pas qu’il soit valorisé. Son entrée dans la sphère économique signifie que la logique du marché, la recherche de l’efficacité, les rationalisations et la concurrence, envahissent la sphère de l’intimité, qui jusque-là avait été préservée du marché. La logique du travail domestique, qui consistait à prendre soin et à développer la relation sociale et à fonctionner à son propre rythme, se soumet à la logique du marché. Un exemple : les modules de soins aux personnes âgées. Des économistes féministes considèrent l’utilisation continuelle et l’exploitation du travail domestique – « l’extraction du travail domestique8 » – comme « le mécanisme central de fonctionnement » du capitalisme néolibéral mondialisé et comme la structure de domination systémique de l’économie capitaliste9.
Certes, quelques pays de l’UE – en particulier les pays scandinaves – essaient d’associer les hommes à la prise en charge des enfants et des personnes âgées en développant des options telles que le congé de paternité (payé) ou les assurances de soin familiales. Mais, jusqu’à présent, peu d’hommes en font usage. Le soi-disant problème de l’inconciliabilité entre vie professionnelle et vie domestique reste un problème majoritairement féminin et privé et est rarement résolu par des institutions publiques.
Au lieu de répartir le travail domestique entre hommes et femmes, on en est arrivé à répartir ce travail entre femmes de différentes classes et ethnies.
Au lieu de répartir le travail domestique entre hommes et femmes, comme le revendiquent les féministes, on en est arrivé à répartir ce travail entre femmes de différentes classes, ethnies et régions du monde. Alors que, dans les métropoles, les femmes issues des classes moyennes, bien qualifiées, ont de plus en plus souvent un emploi salarié, les employées de maison, les nounous, les infirmières et les aides-séniors d’origine immigrée en provenance du Sud, résolvent la crise de la reproduction sociale en palliant aux carences du travail domestique dans le Nord. Des chaînes transnationales de travail domestique transfèrent ce travail des ménages pauvres vers les ménages privilégiés et des pays pauvres vers les pays riches (care drain). Elles déplacent une situation de crise de l’Allemagne en Pologne et ensuite en Ukraine. Quand une aide-séniors polonaise cède son travail à une collègue ukrainienne pour un salaire moindre, cette dernière crée un vide dans son pays10. Les femmes deviennent des mères transnationales. Les extractions nationale et transnationale du travail domestique sont déterminantes pour résoudre les crises, mais restent sous le radar de l’économie politique. Par contre, l’extraction des ressources naturelles est une catégorie importante de l’économie politique, en particulier depuis que des gouvernements de gauche en Amérique Latine ont incité à l’exploitation abusive des ressources naturelles de leur sous-sol afin de financer des programmes sociaux pendant la crise.
Le travail domestique met à l’agenda politique la question de sa reconnaissance. Partout dans le monde, les femmes se plaignent du manque de reconnaissance et donc de valorisation du travail domestique, familial et communautaire non rémunéré et de sa rémunération misérable quand il devient salarié. Partout, des employées de maison luttent pour être reconnues comme des ouvrières « à part entière ». C’est pour elles la seule possibilité d’avoir accès au droit du travail, à la protection sociale et au droit d’association. Grâce à une campagne internationale, organisées de manière indépendante, elles ont pu obtenir en 2011 une convention spécifique à l’OIT, la convention numéro 189 pour un « travail digne ». Ces dernières années, beaucoup de grèves et de manifestations dans le secteur des services ont eu précisément comme point de départ ce manque de reconnaissance et de qualité des emplois. Les puéricultrices allemandes ont manifesté pour une hausse des salaires mais aussi pour une plus grande reconnaissance de leur travail11 12.
Les aide-séniors revendiquent plus de reconnaissance et un assouplissement des modules de soins. Le personnel soignant et les médecins de l’hôpital de la Charité à Berlin sont tellement surchargés qu’ils ne peuvent plus garantir des soins de qualité. Ces luttes montrent que les conditions du marché néolibéral rendent impossibles un travail de qualité dans le secteur – en croissance – des soins, de l’assistance et du service aux personnes. Elles montrent également que, dans le contexte de l’économie domestique, de nouvelles alliances entre travailleurs et patient.e.s ou consommatrices deviennent possibles.
La Banque mondiale considère d’abord le travail domestique non rémunéré des femmes comme une charge de temps et de travail mal allouée et comme une barrière au travail rémunéré. Dans une perspective féministe, le travail domestique, avec sa logique intrinsèque de soin, d’attention et de coopération, est un point de départ pour repenser l’économie dans son ensemble à partir d’une nouvelle perspective : une perspective qui vise à prendre soin des gens et à augmenter la qualité de vie. Etant donné que nous avons de moins en moins besoin de travail salarié productiviste, il nous faut politiser la signification sociale, économique et écologique du travail domestique dans la perspective d’une « vie de qualité pour tous. »
Récit N° 5 : Alors qu’elles devraient manger du gâteau et fonder des entreprises
Le microcrédit a été utilisé au cours des deux dernières décennies comme un instrument sexué d’insertion financière sur le marché. Cet instrument promettait aux femmes pauvres des possibilités de revenus leur permettant de sortir de la pauvreté. Selon le modèle de la banque Grameen, fondée par le lauréat du prix Nobel d’économie, Mohammad Yunus, au Bangladesh, l’inclusion financière était couplée au travail rémunéré et à l’émancipation des femmes. En Asie du sud, les microcrédits sont presque exclusivement offerts aux femmes, car elles ont, contrairement aux hommes, fait preuve d’un taux de remboursement élevé – qui se rapproche de 90%.
Sur base de cette certitude, le Sud a développé des institutions de microfinance qui offrent aux femmes ou groupes de femmes pauvres des microcrédits avec des taux d’intérêt de plus de 30%. Ils éliminent ainsi les systèmes traditionnels d’épargne et de crédit – « Tontine, Merry-go-round, revolving fund, sanghams » – que les femmes de nombreux pays avaient organisés sous forme d’aide de voisinage. Et ils remplacent également les groupes d’entraide financés par des ONG qui fournissent aux femmes un capital de démarrage en tant que travailleuses indépendantes, micro-entrepreneuses ou mini-coopératives afin de développer des activités génératrices de revenus grâce à l’épargne et au crédit.
L’investissement du crédit ne fait pas nécessairement se réaliser l’espoir de pouvoir créer une petite entreprise locale, une idée que l’économiste péruvien Hernando de Soto avait déjà popularisée dans les années 1980 comme une forme de « capitalisme d’en bas ». Bien sûr, il y a quelques histoires de réussites individuelles. Cependant, lorsque les femmes vendent des œufs ou des denrées alimentaires, récoltent des plantes médicinales, ouvrent un salon de coiffure, etc., cela mène souvent – à cause des effets d’imitation – à une offre excédentaire et à une concurrence sur les marchés locaux conduisant à l’exclusion des plus faibles, au lieu de fournir une garantie de moyens d’existence13.
Yunus a développé des projets d’entreprises sociales au Bangladesh avec l’aide de multinationales telles que Nokia, Danone, Adidas, Otto et BASF. Les femmes ont financé avec ces crédits un commerce de détail dans leur village proposant des yaourts, des baskets et des services téléphoniques. Le projet Danone visait à supprimer l’économie d’autosuffisance des ménages et des villages car, au Bangladesh, chaque femme produit son propre yaourt à la maison. En Inde également, les femmes, en ouvrant des petits magasins franchisés à la campagne, jouent un rôle d’avant-garde de l’économie consumériste urbaine. Elles ouvrent le marché aux entreprises, prennent des risques de vente et introduisent la libre concurrence avec les productrices villageoises. En Inde du sud, un groupe de crédit ne propose dans ses mini-supermarchés que des produits emballés de multinationales, comme vitrine de la consommation moderne, mais n’incluent pas dans leur assortiment les épices, huiles et remèdes produites par les femmes du village voisin, car ces produits ne sont pas emballés correctement. Ainsi, les empruntrices rejettent l’économie locale et dévalorisent le travail des femmes comme étant non commercialisable. Ce faisant, les inégalités et conflits d’intérêts entre femmes augmentent.
La majorité des femmes n’utilisent d’ailleurs pas le crédit à des fins de production mais à des fins de consommation. Souvent, les premières dettes remboursées sont celles que la famille ou le mari avaient contractées auprès du prêteur d’argent local qui exige des taux d’intérêt usuraires de plus de 50%. D’autres usages fréquents de ces crédits sont la couverture de frais médicaux pour une opération ou des médicaments, ou l’organisation d’un mariage ou la constitution d’une dot en Asie du sud. Pour les pauvres, ces crédits permettent de pallier aux reculs des subventions d’État et à la diminution des revenus paysans. Les pauvres financent leur reproduction sociale par un niveau de consommation plus élevé. C’est pourquoi Milford Bateman14 considère le microcrédit comme « la montée destructrice d’un néo-libéralisme local », qui met les pauvres dans une situation où ils doivent gérer leur pauvreté de leur propre initiative et d’une manière entreprenieuriale.
La suroffre de crédits dans les villages par la présence de plusieurs agences commerciales plonge beaucoup de femmes dans une spirale d’endettement : poussées par l’encaissement hebdomadaire des intérêts par les agents de la microfinance, elles contractent plusieurs crédits dans des agences différentes afin de pouvoir rembourser rapidement leurs dettes. Mais derrière les taux de remboursement élevés, comme derrière les flux de capitaux et la consommation croissante dans les villages, se cache un endettement de plus en plus élevé. Cela a abouti en Inde à un effondrement du système de la microfinance lorsque les femmes n’ont plus pu rembourser. Certes, les femmes se sentent valorisées par le fait qu’elles aient pu amener dans leur famille plus d’argent que jamais auparavant. Néanmoins, l’émancipation par la féminisation du crédit et des activités des petites entreprises est hautement aliénant et risquant.
Les cercles financiers emprisonnent les femmes pauvres des villages et bidonvilles du Sud dans les chaînes de crédit et d’endettement des marchés financiers mondiaux. Le crédit en tant qu’instrument de réduction de la pauvreté et d’émancipation des femmes réduit le processus de reproduction sociale des pauvres dans la sphère quotidienne à la reproduction de l’industrie financière mondiale15.
Les nouveaux contrats entre sexes
Dans la foulée des premières poussées de la mondialisation dans les années 1980, ce n’est pas seulement en Occident mais aussi dans le Sud que les rôles et relations entre genres ont été remis en question. Pourtant, l’inclusion dans le marché et le travail salarié des femmes ne se sont pas développés de façon claire, linéaire et globale dans la direction de plus grandes égalité et justice entre les sexes. Mais, on a plutôt été confronté à un spectre de nuances variées entre valeurs émancipatrices, néo-libérales et néo-conservatrices, souvent avec des développements paradoxaux ou contradictoires. Se sont aussi développées des subjectivités genrées indépendantes et parfois contradictoires, ayant pour cadre les relations entre les sexes et les pratiques de la vie quotidienne.
Pour les femmes, des champs d’action se sont ouverts dans lesquels elles ont pu poursuivre des stratégies d’appropriation, de garanties d’existence et de reproduction – à l’intérieur des conditions dominantes du marché. La contradiction de la socialisation capitaliste entre assujetissement et liberté de vote s’inscrit dans la vie quotidienne, dans les pratiques domestiques et au travail ainsi que dans les subjectivités. Le travail salarié signifie souvent une émancipation et une valorisation par rapport aux hommes par l’égalité des droits et des chances mais, d’un autre côté, il consitue aussi une adaptation à la norme masculine de l’ « homo oeconomicus », du productivisme et de l’industrialisation. Alors qu’on constate partiellement plus d’égalité dans, par exemple, la compétition économique et les carrières, les inégalités entre femmes, comme entre hommes, augmentent.
La fonctionnalité des femmes sur le marché économique ne se conçoit que si les femmes sont considérées comme sujets néolibéraux forts, comme forces productives capables de gérer ou réduire la pauvreté, d’agir d’elles-mêmes sur les marchés en tant qu’entrepreneuses responsables et de résister à la vulnérabilité16. Par l’intermédiaire des mécanismes de l’inclusion au marché et du néo-libéralisme, un changement économique structurel se développe qui amène plus de marchandisation, d’industrialisation et de rationalisation. D’un autre côté, on constate l’apparition de subjectivités spécifiques au genre et une diversification des pratiques quotidiennes. A cela se rattache aussi, à de nombreux endroits, le développement d’une conscience de ses droits et de potentiels de résistance et de luttes. Globalement, cette « intégration paradoxale » des femmes dans le marché du travail17 ne multiplie pas seulement les identités mais également les contradictions dans les rapports économiques et les rapports entre sexes.
Cet article a été publié originellement dans Zeitschrift für marxistische Erneuerung, nr. 110, juin 2017.
Footnotes
- UN Women (2016) : Progress of the Worlds’ Women 2015-2016. Transforming Economies, Realizing Rights, New York
- Radhakrishnan, Smitha/Solari, Cinzia (2015) : “Empowered Women, Failed Patriarchs : Neoliberalism and Global Gender Anxieties”. In : Sociology Compass 9/9 (2015), 784–802
- The World Bank (2011) : World Development Report 2012. Gender Equality and Development. Washington
- Calkin, Sydney (2015) : Feminism, Interrupted ? Gender and Development in the Age of ‘ Smart Economics.’ Progress in Development Studies 15(4), 295-307.
- ILO (2016) : Women at Work. Trends 2016, Geneva
- Klinger, Cornelia (2013) : Krise war immer. Lebenssorge und geschlechtliche Arbeitsteilungen in sozialphilosophischer und kapitalismuskritischer Perspektive, In : Appelt, Erna/ Aulenbacher, Brigitte/ Wetterer Angelika (Hrsg.) : Gesellschaft. Feministische Krisendiagnosen. Münster. 82-105
- Elson, Diane (2002) : International Financial Architecture : A View from the Kitchen, in : femina politica,1/2002, 26-38
- Wichterich, Christa (2016) : Feministische internationale politische Ökonomie und Sorgeextraktivismus, In : Brand, Ulrich/Schwenken, Helen/Wullweber, Joscha (Hrsg.) : Globalisierung analysieren, kritisieren und verändern. Das Projekt Kritische Wissenschaft, Hamburg, 54-72
- Aulenbacher, Brigitte/Birgit Riegraf/Susanne Völker (2015) : Feministische Kapitalismuskritik, Münster
- Hochschild, Arlie (2000) : Global Care Chains and Emotional Surplus Value, in : Giddens, Tony/Hutton, Will (Hrsg.) : On the Edge. Globalization and the New Millennium, London, 137-179
- Kutlu, Yalcin (2015). Kampf um Anerkennung. Die Sozial- und Erziehungsdienste im Streik. In : Z – Zeitschrift marxistische Erneuerung 103 (September 2015), 126-140
- Winker, Gabriele (2015) : Überforderte Eltern zwischen Lohn- und Reproduktionsarbeit. Neoliberale Familienkonstruktionen ohne Zukunft. In : Z – Zeitschrift marxistische Erneuerung 103 (September 2015), 141-149
- Raza, Werner (2014) : Lokale wirtschaftliche Entwicklung dank Mikrofinanz : Fehlanzeige, in : Klas, Gerhard/ Philip Mader (Hg.) (2014) : Rendite machen und Gutes tun ? Frankfurt. 83-93.
- Bateman, Milford (2010) : Why Doesn´t Microcredit Work ? The Destructive Rise of Local Neoliberalism. London.
- Wichterich, Christa (2016) : “Feministische internationale politische Ökonomie und Sorgeextraktivismus”, In : Brand, Ulrich/Schwenken, Helen/Wullweber, Joscha (Hrsg.) : Globalisierung analysieren, kritisieren und verändern. Das Projekt Kritische Wissenschaft, Hamburg, 54-72.
- McRobbie (2010) : Top Girls. Feminismus und der Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes, Wiesbaden.
- Wichterich, Christa (2009) : gleich, gleicher, ungleich, Paradoxien und Perspektiven von Frauenrechten in der Globalisierung, Königstein/Taunus.