Contrairement à l’ordre juridique étatique, où les trois pouvoirs sont séparés et indépendants, ces compétences sont réunies en la personne de l’employeur. Pour garantir le respect des droits individuels, il faut augmenter les droits collectifs.

À partir du moment où une entreprise fait appel à des agents contractuels (travailleurs), elle acquiert la qualité d’employeur. La législation n’a jamais vraiment remis en question la suprématie de l’employeur, vu comme l’incarnation des fournisseurs de capitaux, au sein de l’entreprise. Et c’est de ce point de vue que la législation réglemente l’intervention de l’employeur dans le cadre des relations de travail. Les droits et devoirs de l’employeur dans ce cadre viennent entériner la subordination du travail, en tant que facteur de production, à l’apport de capital. Sans réellement restreindre cette domination, la législation se limite à la modeler en prescrivant à l’employeur une série de pratiques et comportements. Le droit vient donc institutionnaliser et légitimer le pouvoir de l’employeur. De par la manière dont il est conçu, de par la nature de ses dispositions légales, de par leur contenu et enfin de par le choix de sanctions moins sévères, le droit du travail n’apporte qu’une correction insignifiante au pouvoir de l’entreprise. D’une manière générale, le droit du travail ne sera jamais suffisant en soi pour empêcher l’employeur, si l’envie lui prend, de ne pas respecter ses obligations et engagements envers ses travailleurs… et de leur imposer sa volonté même si elle est contraire à la loi. On peut clairement parler de pouvoir de l’employeur
Le travailleur n’a aucun droit sur le produit, le bien ou le service que lui-même produit.
Tout cela contraste fortement avec les principes de base de la démocratie civile, où le pouvoir appartient au groupe qui peut, par la suite, le déléguer à un ou plusieurs mandataires, qui doivent quant à eux rendre compte de la manière dont le pouvoir est exercé à l’égard du groupe, lequel intervient comme contre-pouvoir. Ce schéma est d’ailleurs le fondement qui régit le fonctionnement du système parlementaire, mais il est également souvent appliqué dans les modèles de gestion d’organisations publiques et privées en vue d’y introduire un élément du processus décisionnel démocratique. Dans une certaine mesure, on peut même le retrouver du côté du capital dans une société, en ce sens que les administrateurs doivent justifier leur politique vis-à-vis de l’assemblée générale des actionnaires.
Or, cette obligation de rendre compte n’existe absolument pas vis-à-vis des travailleurs de la société. Dans les entreprises dotées d’un conseil d’entreprise, le chef d’entreprise a néanmoins l’obligation de communiquer aux délégués du personnel les mêmes informations que celles communiquées aux actionnaires, mais il n’appartient pas au conseil d’entreprise d’évaluer et d’éventuellement sanctionner la politique menée. L’ensemble des travailleurs de l’entreprise ne peut dès lors être vu comme un groupe qui a délégué à la direction de l’entreprise le contrôle et l’administration de celle-ci.
Contrairement à l’apport de capital, l’apport de travail dans le processus de production ne génère aucun droit de propriété sur l’entreprise… ni même aucun droit de contrôle strict sur la politique menée par l’entreprise. La direction de l’entreprise doit rendre des comptes vis-à-vis des fournisseurs de capital, mais pas vis-à-vis de ceux qui fournissent le travail. La loi accorde même à l’employeur un droit d’autorité. Il est question d’un droit unilatéral et réglementaire qui l’autorise à organiser à sa guise les relations de travail en fonction de la production. L’apport de travail génère un droit au salaire. Le contrat de travail est clair: on échange un salaire contre du travail sous l’autorité des fournisseurs de capital, incarnés par l’employeur.
La participation limitée des travailleurs à la politique des relations de travail trouve son fondement dans la réglementation spécifique relative aux organes de concertation au sein de l’entreprise. On peut parler de participation limitée, non seulement en raison de la nature des matières abordées, mais aussi en raison de la nature des compétences octroyées. Le conseil d’entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et la délégation syndicale voient leur intervention limitée aux affaires qui touchent directement ou indirectement les relations de travail. Par conséquent, leurs compétences concernent principalement l’information, la concertation ou la consultation et les négociations collectives. Comme nous le verrons plus loin, les sanctions infligées à l’employeur en cas de mépris de ces compétences ne sont pas très lourdes. Les corrections apportées par le droit du travail ne sont pas (en soi et sans le soutien d’une force syndicale) de nature à rompre le cadre de pouvoir imposé par le patron, de sorte que l’on peut sans hésiter affirmer que le législateur accorde à l’entrepreneur – employeur une gestion autocratique sur les forces de travail (travailleurs et indépendants) au sein de son entreprise.
La gestion autocratique des forces de travail est donc légitimée par le droit et, si nécessaire, elle va jusqu’à s’opposer à la loi en vertu de son pouvoir… Le choix du législateur d’essentiellement réglementer l’apport de travail dans le cadre de la législation sur les contrats de travail limite le champ d’action du travailleur offensé au schéma typique du contrat de travail individuel basé sur l’échange travail contre salaire. En l’absence d’une base légale apportée par une autre loi, le travailleur infortuné se verra contraint de qualifier les mauvais agissements de son employeur de simple violation du principe de bonne foi… et devra se contenter de réclamer des indemnités limitées, que l’employeur paiera peut-être sans trop de réticence sachant qu’il n’est pas obligé de supprimer son mauvais comportement… Il tire donc son pouvoir du droit…
La subordination structurelle du travail au capital
La subordination structurelle du travail au capital est clairement ratifiée par la législation. Cela ressort d’abord et avant tout de la définition même que la loi donne au contrat de travail. Ainsi, le contrat de travail est un contrat par lequel le travailleur s’engage sous l’autorité de l’employeur à effectuer un travail contre un salaire. La loi oblige donc le travailleur à accepter l’autorité des fournisseurs de capital dont l’employeur est l’incarnation.
Exercer son autorité est donc un droit pour l’employeur. Subir le droit d’autorité constitue un devoir pour le travailleur. Or, le travail confère avant tout un droit au salaire. Il apparaît en outre très clairement que le travailleur non seulement ne peut prétendre au moindre titre de propriété sur l’entreprise, mais qu’en plus il n’a aucun droit sur le produit, le bien ou le service que lui-même produit. Malheureusement il n’a pas vraiment le choix… S’il veut pouvoir bénéficier d’une certaine protection au travail et de la sécurité sociale, il lui faut accepter la subordination au capital. Cet échange est typique du modèle fordiste. La subordination du travail est compensée par une sécurité du travail et une protection sociale. La précarisation des relations de travail due à la libéralisation du marché du travail risque surtout de modifier le schéma d’échange fordiste puisque cette compensation ne cesse de diminuer pour de très nombreux travailleurs… La «rétribution» indirecte disparaît peu à peu, tandis que l’odieuse soumission reste…
La domination du capital sur le travail a d’autres ancrages dans la loi. Ainsi, le droit des sociétés dans la structure juridique de la société ne prévoit pratiquement aucune place pour l’apport de travail. À quelques exceptions près, en ce qui concerne les sociétés privées et les sociétés coopératives où l’apport d’une activité peut être honoré, seul l’apport de capital donne droit aux actions et donc à un titre de propriété. La loi qui régit les asbl est peut-être celle qui laisse le plus de place à une participation officielle du personnel dans l’administration de l’entreprise. Toutefois, nous observons ici aussi que les asbl exploitant réellement cette marge sont peu nombreuses…
La gestion autocratique des forces de travail est légitimée par le droit et, si nécessaire, elle va jusqu’à s’opposer à la loi en vertu de son pouvoir.
Sous l’influence du mouvement ouvrier, on a vu se développer dans la législation du travail un système de participation officielle des représentants des travailleurs au niveau de la politique des relations de travail. Le travailleur est ainsi devenu un citoyen jouissant de droits politiques au sein de son entreprise. Il participe à l’organisation du dialogue social. Malgré l’importance sociale manifeste des organes de concertation et de représentation, ils ne font pas à proprement parler officiellement partie de la structure de la société ou de l’entreprise. Ils évoluent en marge et en périphérie de celle-ci.
Le fait que la participation des travailleurs organisés se situe avant tout au niveau du droit à l’information, à la consultation et aux négociations collectives résulte de la convergence des points de vue des employeurs et des travailleurs qui, il est vrai, ont rejeté pour des raisons totalement différentes le droit de codécision du personnel. Si, du côté patronal, on souhaitait que le droit de disposer de l’entreprise reste entièrement aux mains des fournisseurs de capital, du côté des travailleurs on ne souhaitait pas être coresponsable de décisions sur lesquelles on n’avait qu’un contrôle partiel… Dans tous les cas, le résultat est clair… Le cadre du pouvoir patronal est resté intact… Il n’y a pas eu de rupture institutionnalisée et il dépend seulement du poids du contrepouvoir social… Ne pas participer au processus décisionnel, mais pouvoir participer de manière ponctuelle et occasionnelle aux négociations collectives, tel est l’instrument qui permet de modérément restreindre la suprématie du capital.
Les faibles corrections apportées au pouvoir de l’employeur
En vertu du droit de propriété, les fournisseurs de capital et l’employeur, qui les incarne, jouissent donc du droit de disposer de l’entreprise. Autrement dit, ils prennent toutes les décisions relatives à son existence, sa forme juridique, son activité sociale, la manière dont est organisée la production ainsi que la manière dont il sera fait appel au travail (salariat ou sous-traitance). Vis-à-vis des actionnaires, le pouvoir de disposition est concrétisé dans le droit des sociétés. Vis-à-vis des travailleurs, ce droit est incorporé dans le droit d’autorité de l’employeur.
Le droit d’autorité est, de par nature, partial et réglementaire.
Il trouve son fondement dans la loi sur les contrats de travail ainsi que dans le contrat de travail. Il comprend en soi trois compétences et présente une certaine analogie avec la trias politica, sur laquelle est fondée la démocratie citoyenne. L’employeur est donc habilité à intervenir réglementairement (législativement). Il fixe les règles relatives à l’organisation de la production et à l’organisation du travail en tant que dérivé de la production. Il prend les mesures nécessaires à son exécution (pouvoir exécutif). Il jouit d’un droit de sanction à l’égard de ceux qui ne respectent pas ces règles ou leur exécution (pouvoir judiciaire). Contrairement à l’ordre juridique étatique, où les trois pouvoirs sont séparés et indépendants, ces compétences sont réunies en la personne de l’employeur. Analysée d’un point de vue politique, l’entreprise constitue donc une autocratie ou, dit autrement, une dictature sur ceux qui fournissent le travail dans le processus de production.
La nature partiale et réglementaire du droit d’autorité vient encore renforcer le caractère autoritaire des compétences patronales. Même si le droit d’autorité est soumis à quelques restrictions sur le plan individuel au travers du contrat de travail individuel ainsi que sur le plan collectif au travers de sa transposition dans la concertation au sein de l’entreprise, le caractère restreint et la nature même des sanctions légales à l’égard de l’employeur en cas de non-respect ne permettent (généralement) pas de mettre fin à la situation illégale. L’employeur peut donc continuer d’agir illégalement pour autant qu’il paie des dommages et intérêts qui sont souvent limités…
Seul l’apport de capital donne droit aux actions et donc à un titre de propriété.
Avant d’aller plus loin dans notre analyse des restrictions apportées au droit d’autorité au niveau du droit du travail, il apparaît opportun de replacer le droit de l’employeur dans un contexte plus vaste. Ainsi, il ne faut pas perdre de vue que le droit d’autorité se situe dans le prolongement des rapports de production capitalistes, qui sous-évaluent et subordonnent sans trop de scrupules le facteur travail au facteur capital. On ne peut pas non plus ignorer le fait que l’entreprise doit être envisagée comme un marché du travail interne, où l’employeur met les forces de travail (travailleurs et sous-traitants) en concurrence sur le plan social. La politique de ressources humaines rationalise et institutionnalise cette concurrence. Pour terminer, il convient d’ajouter que l’individualisation des relations de travail vient renforcer la domination patronale sur le travail. Le contrat individuel établi entre le travailleur et l’employeur, basé sur une liberté purement formelle, permet à ce dernier de faire peser toute sa force économique dans la relation contractuelle. Les corrections apportées au droit d’autorité dans le droit du travail seront donc principalement axées sur le rabotage des angles de la domination patronale, mais sans jamais être en mesure d’en éliminer les causes.
Le droit d’autorité de l’employeur connaît une double transposition. Il est tout d’abord ancré dans le contrat de travail, qui fixe les limites dans lesquelles ce droit d’autorité peut être exercé. Autrement dit, le contrat de travail définit les limites dans lesquelles l’employeur peut légalement disposer du potentiel du travailleur. Le droit d’autorité est aussi transposé dans le droit réglementant la concertation au sein de l’entreprise. L’employeur peut réglementer et contrôler les relations de travail et sanctionner les comportements dissidents pour autant que les compétences des organes de concertation soient reconnues et respectées. Ce sont ces deux transpositions qui sont à la base des corrections apportées au droit d’autorité au niveau du droit du travail. Malgré l’importance fondamentale pour le travailleur de pouvoir comprendre les circonstances dans lesquelles ont eu lieu ces corrections et de les interpréter, le droit d’autorité ne fait l’objet d’aucune réglementation juridique méthodique et accessible. Il est niché dans l’application d’un amalgame de règles de nature et origine diverses qui, sans l’assistance d’un expert juridique, sont difficiles à comprendre pour le travailleur profane. Connaissances et contrôle des connaissances constituent deux éléments importants dans le développement du pouvoir. Cela dit, l’accessibilité problématique d’une importante partie de la législation du travail explique pourquoi de très nombreux travailleurs, lors de l’exécution du contrat de travail, se retrouvent dès le départ avec un handicap en matière de pouvoir. En d’autres termes, cette réglementation maladroitement élaborée et organisée a également pour effet d’aggraver la subordination du travailleur…
Le droit d’autorité de l’employeur est donc limité et corrigé de deux manières. Tout d’abord, on a le contrat de travail et toutes les obligations légales et conventionnelles qu’il entraîne dans son sillage. Ensuite, on a les obligations légales et conventionnelles pour l’employeur de partager des informations avec les délégués du personnel, d’organiser des consultations, concertations et négociations collectives. La première sorte de limitations et corrections concerne les relations de travail individuelles. En vertu de dispositions légales ou contractuelles contraignantes, c’est au travailleur qu’il revient d’interpeller l’employeur sur ses agissements et comportements peu vertueux. Une question se pose donc en ce qui concerne l’efficacité des corrections et la manière dont le législateur a compensé la subordination économique du travailleur.
On ne peut nier le fait qu’au travers et au moyen du contrat de travail individuel, le législateur a cherché à canaliser le droit de l’employeur de disposer des travailleurs et donc de le limiter. Le caractère contraignant des dispositions du droit du travail doit dès lors être vu comme l’expression de sa volonté de ponctuellement compenser le déséquilibre en matière de pouvoir en imposant à l’employeur le respect de dispositions légales et des conventions collectives de travail (CCT). Si la liberté contractuelle et la prédominance patronale incontestable qui en découle sont en apparence diminuées, la valeur d’une protection juridique se mesure avant tout à son efficacité; or c’est justement là que le bât blesse.
Plusieurs facteurs compliquent la mise en œuvre effective des corrections apportées au droit d’autorité via le contrat de travail individuel. Tout d’abord, lorsque le patron dépasse les limites du droit d’autorité, c’est au travailleur d’entreprendre les démarches. C’est tout simplement la règle lorsque le manquement patronal n’a qu’un impact contractuel (autrement dit, lorsqu’il ne constitue pas un délit). La partie la plus faible économiquement, alors qu’elle se trouve dans une position de subordination et la plupart du temps toujours en service, devra sommer l’employeur, si nécessaire par l’intermédiaire d’un juge, de respecter et observer ses obligations légales ou contractuelles. Étant donné l’accessibilité relative et la complexité du droit du travail, le travailleur va devoir s’assurer les services d’un expert juridique. Outre le coût de cette assistance juridique, il va également devoir accepter le risque de se retrouver avec les frais de procédure à sa charge.
De manière générale, c’est à lui également qu’incombe la charge de la preuve, autrement dit, c’est à lui de démontrer la faute patronale alléguée. Excepté les cas où le législateur inverse ou allège la charge de la preuve, c’est à lui de fournir les preuves alors qu’il n’a pas vraiment accès à l’administration de l’entreprise. Et il y a surtout la manière dont le législateur sanctionne le nonrespect de la législation du travail par l’employeur. Il opte rarement, pour ne pas dire jamais, pour l’invalidation du manquement ou une réparation du dommage en nature. En règle générale, le législateur opte pour le paiement d’un dédommagement par l’employeur. Certaines indemnités (forfaitaires) sont carrément futiles, voire ridicules, et hypothèquent lourdement la volonté d’action du travailleur…
Un rupture du cadre du pouvoir patronal dépend encore du poids du contre-pouvoir social.
En ce qui concerne les manquements de l’employeur qui constituent un délit, les choses sont à peine plus réjouissantes… Alors qu’elle est légalement habilitée à le faire, l’inspection du travail en sous-effectif manifeste est rarement encline à verbaliser… Il semblerait donc que la législation du travail belge, tant louée, ne soit efficace, voire effective, qu’en apparence seulement et l’absence de caractère réellement contraignant va dans le sens d’une justice de classes… Toutefois la réalité mérite d’être davantage nuancée… Comme on va le voir pour les corrections apportées au pouvoir de l’employeur sur le plan collectif, certains facteurs informels jouent aussi un rôle sur le plan individuel, des facteurs qui garantissent une plus grande efficacité des corrections, comme notamment le taux de syndicalisation du personnel au sein de l’entreprise.
Les corrections apportées au droit d’autorité sur le plan collectif sont donc appliquées au travers de leur transposition dans le droit relatif à la concertation au sein de l’entreprise. Lorsqu’après la Seconde Guerre mondiale, le législateur a mis en place des organes de concertation au sein des entreprises, c’était à ses yeux le début d’un processus qui devait déboucher sur la démocratisation de l’entreprise. Après avoir réalisé la démocratie politique, c’était au tour de la démocratie sociale. Une fois mises en place, les compétences des organes de concertation seraient étendues au cours des décennies suivantes. Or, on peut difficilement oser parler de démocratie sociale de nos jours.
Les raisons sont diverses. La première est que le fonctionnement de la concertation au sein de l’entreprise n’a pas grand-chose en commun avec le schéma de base du fonctionnement démocratique d’une entreprise, à savoir un groupe qui délègue le pouvoir à des représentants et exerce ainsi un contrôle en tant que contre-pouvoir. On peut tout au plus dire que le schéma est appliqué dans la désignation des représentants du personnel au sein des organes de concertation. La seconde raison porte sur le contrôle dont disposent les représentants du personnel et les travailleurs sur la politique de l’employeur au travers de leurs compétences. Alors que l’extension des compétences visait une participation des représentants dans un plus grand nombre de matières, aucun contrôle officiel sur le contenu de la politique de l’entreprise ne leur a été octroyé. Les organes de concertation sont restés en marge du fonctionnement effectif de la structure de l’entreprise. La troisième raison concerne l’exclusion permanente des travailleurs de la concertation au sein des entreprises de plus petite taille. Or, aucun modèle ne mérite le qualificatif «démocratique» s’il ne garantit pas les mêmes droits à tous les travailleurs.
En cas de comportement fautif de la part de l’employeur, il se contente de payer l’indemnité, tout en ne changeant rien à son comportement.
Tout cela signifie-t-il que la législation en matière de concertation au sein de l’entreprise n’apporterait aucune plus-value? Pas du tout. Elle acquiert tout son sens et son intérêt dans la construction d’un contre-pouvoir social au sein de l’entreprise. Les compétences d’information, de consultation, de concertation collective ou de négociations collectives garanties par la loi constituent également des formes d’exercice du pouvoir. Le contre-pouvoir social se manifeste lorsque les travailleurs revendiquent et exercent leur droit à l’information, à la consultation, à la concertation collective ou aux négociations collectives. D’autre part, ces compétences exigent de l’employeur qu’il justifie et rende des comptes sur la manière dont il utilise son droit d’autorité. Les travailleurs ne disposent pas d’un droit de sanction officiel lorsque la justification est insuffisante, ils sont néanmoins libres d’invoquer leur droit d’action syndicale et d’ainsi prolonger et renforcer leur contre-pouvoir garanti par la loi en développant un réel pouvoir.
Cela met en évidence une autre fonction de la concertation au sein de l’entreprise, celle de promouvoir le développement d’un contre-pouvoir plus vaste qui pourrait conduire à une action collective, voire à des négociations collectives. La transposition du droit d’autorité de l’employeur dans la concertation au sein de l’entreprise engendre-t-elle une restriction formelle de ce droit? Manifestement pas. L’employeur conserve son rôle d’autocrate et reste légalement habilité à gérer et contrôler de manière unilatérale les relations de travail. Les compétences octroyées aux travailleurs s’inscrivent quant à elles dans un schéma de contre-pouvoir social qui peut et est en mesure de briser le cadre du pouvoir patronal.
L’efficacité des corrections apportées au droit d’autorité sur le plan collectif semble, lorsqu’il s’agit de sanction en droit, tout aussi peu garantie que sur le plan individuel. Si les matières se rapportant à la mise en place du conseil d’entreprise, du CPPT et de la délégation syndicale sont suffisamment protégées pour connaître une application sérieuse, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de contraindre l’employeur à une mise en œuvre effective des compétences de ces organes. Le non-respect et le mépris par l’employeur du droit à l’information, à la consultation, à la concertation collective et aux négociations collectives ne sont en général pas soumis à des sanctions civiles. Autrement dit, lorsque, par exemple, l’employeur n’informe pas le comité des nouveaux moyens collectifs de protection, sa décision ne sera pas entachée de nullité.
Certaines procédures d’information et de concertation, ancrées dans le droit européen, jouissent d’un sort un peu meilleur. C’est notamment le cas des matières qui touchent à la restructuration, comme le licenciement collectif ou le transfert d’entreprise. Il s’agit d’exceptions à la règle générale qui ne prévoit aucune sanction civile spécifique et adaptée. Mais cela ne s’arrête pas là. L’employeur qui ne respecte pas les compétences des organes de concertation se rend généralement coupable de délit. Mais la plupart du temps, le comportement fautif n’est pas sanctionné pénalement. La raison est simple… Du côté des travailleurs organisés, on hésite à dénoncer le manquement. Cette attitude s’explique en partie par la très forte réticence de l’inspection du travail à verbaliser et à celle de l’auditorat du travail à engager des poursuites. Le résultat est sans appel. Le pouvoir de l’employeur, autrement dit le non-respect du droit de concertation par ce dernier, est consacré. Faire appel au contre-pouvoir social reste finalement le seul recours.
Le pouvoir de licenciement des patrons
Sous la pression du mouvement ouvrier, on a vu se développer depuis la fin du 19e siècle une législation du travail cohérente qui, toutefois, n’a jamais vraiment pu (et voulu) se libérer du droit libéral régissant les relations de travail, ni de l’ordonnancement juridique capitaliste. Pire encore, elle en est devenue un sous-système. Cela implique que la fonction protectrice et émancipatrice des normes de droit du travail continue en soi d’être fondée sur les droits fondamentaux de l’ordre juridique étatique libéral et capitaliste.
La liberté économique de choisir son travail, la liberté contractuelle et la liberté et l’égalité des citoyens en droit régissent également le droit du travail en ce qui concerne les matières pour lesquelles le législateur social n’a pas formellement prévu de règle dérogatoire. De son côté, le droit civil des contrats joue un rôle de droit commun pour les relations du travail. En effet, puisque le législateur belge n’a jamais réussi à codifier le droit social de manière à créer un cadre juridique social propre et, de cette manière, à rendre plus accessible la législation sociale pour le travailleur et l’assuré social, le droit civil joue un rôle de droit contraignant face à l’amalgame de règles de nature et origine diverses en droit du travail. Concrètement cela implique que, pour toutes les matières pour lesquelles il n’existe pas de réglementation spécifique, il sera fait application du droit des contrats fondé sur l’égalité et la liberté et ce, malgré les inégalités économiques existant entre un employeur dominant et un travailleur économiquement dépendant. Cela implique également que les règles d’interprétation fondées sur la liberté et l’égalité seront appliquées par le juge à l’égard des normes sociales visant à corriger les inégalités…
En résumé, on peut donc dire que le droit libéral capitaliste qui régit les relations de travail constitue le conditionnement de base d’un droit du travail protecteur et émancipateur, et que ce dernier en est un sous-système. On comprend dès lors pourquoi la législation du travail s’est contentée de corriger le libre marché et la libre concurrence sociale sans l’éliminer. On pourrait résumer cette situation par l’expression «mettre un emplâtre sur une jambe de bois». Le législateur fait de son mieux pour limiter les inégalités économiques et dans une certaine mesure les neutraliser, mais de leur côté, les normes fondamentales libérales génèrent sans cesse de nouvelles exclusions sociales, mais aussi des exploitations et inégalités sociales dans le cadre des relations de travail. La libéralisation du marché du travail ainsi que la flexibilisation et la précarisation qui l’accompagnent sont loin d’avoir amélioré la situation…
La nature libérale du droit du travail ressort de plusieurs autres éléments tels que la liberté quasi illimitée de l’entrepreneur de définir la manière dont il utilisera le travail dans son processus de production. Ou encore, la préférence marquée du législateur de sanctionner pécuniairement les comportements fautifs du patron, ainsi que la tolérance du législateur social face à la marchandisation du travail et ceux qui l’engendrent. La nature procapitaliste de la législation du travail ressort également de la crainte révérencielle du législateur vis-à-vis du pouvoir de licenciement de l’employeur.
La liberté d’entreprise permet à l’entrepreneur de choisir la manière dont il souhaite utiliser le travail dans son processus de production: travail salarié ou travail indépendant et sous-traitance. La liberté économique du travail favorise la liberté d’entreprise. Elle offre à la main-d’œuvre une (prétendue) liberté de choix entre le statut de travailleur ou le statut de sous-traitant. Si elle opte pour le statut de travailleur, elle bénéficie de la protection de la législation du travail et de la sécurité sociale. Si elle opte pour le statut de sous-traitant, elle ne relève pas du droit du travail et doit elle-même s’assurer une protection sociale au travers du statut social d’indépendant. En faisant appel tant à des travailleurs qu’à des sous-traitants, l’employeur crée d’emblée au sein de son entreprise une redoutable concurrence sociale et exerce sur les travailleurs une pression énorme.
Contrairement à l’ordre juridique étatique, où les trois pouvoirs sont séparés, ces compétences sont réunies en la personne de l’employeur.
Ces deux types de contrats sont régis par la liberté contractuelle. Le caractère officiel de cette liberté donne généralement une impression de libre consentement des travailleurs par rapport au statut d’indépendant, même si l’histoire nous a appris qu‘il a souvent été fait appel à la sous-traitance par nécessité économique et que le promoteur ne peut s’empêcher d’exercer son autorité: l’indépendant devient alors un faux indépendant. En dépit de toutes les lois relatives aux relations de travail et aux contrats de travail, c’est au faux indépendant qu’il incombera d’apporter la preuve de sa qualité abusive de sous-traitant. Le droit, afin de satisfaire le promoteur, autorise la concurrence sociale d’une part, et d’autre part fait porter au plus faible économiquement la charge (financière) de démontrer qu’il a été fait un usage abusif du statut d’indépendant.
La préférence marquée du législateur pour les sanctions pécuniaires en cas de comportement fautif de la part de l’employeur est, elle aussi, favorable au capital. En effet, le droit belge préfère généralement la sanction par le biais d’indemnités (de dédommagement) plutôt que la sanction par le biais d’une annulation du comportement contraire au droit. Ce choix renforce le pouvoir de l’employeur qui se contente de payer l’indemnité, tout en ne changeant rien à son comportement. Le travailleur devra se satisfaire d’une indemnité généralement forfaitaire. Si la nature forfaitaire de l’indemnité décharge le travailleur d’apporter la preuve, le fait de devoir se contenter d’un forfait lui ôte toute possibilité d’obtenir une indemnité à hauteur du dommage effectivement subi. Et pour encore mieux servir l’employeur, la législation fiscale prévoit généralement que ces indemnités peuvent être considérées comme passif social et ce, malgré le fait que l’employeur a commis une faute…
En dissociant le travail de la personne qui le preste, nous touchons un élément crucial de l’approche libérale des relations de travail. Le travailleur et l’indépendant vendent ou louent leur potentiel et non leur personne. En tant que micro-entrepreneurs, ils doivent s’assurer qu’ils gèrent correctement ce potentiel de sorte que sa valeur soit préservée. Le chômage correspond à leur exclusion temporaire du marché. Pour les néolibéraux, une mauvaise employabilité est le résultat d’une gestion médiocre de ce potentiel de la part des travailleurs, autrement dit, ce sont les chômeurs qui sont responsables du chômage… Comme nous l’apprend l’histoire sociale, la dissociation entre potentiel de travail et main-d’œuvre a ouvert la voie à des formes extrêmes d’exploitation ainsi qu’à la déshumanisation des relations de travail. Ce qui nous amène une nouvelle fois à une constatation paradoxale. D’une part, le législateur s’efforce au maximum au travers du droit du bien-être d’honorer la personne qu’est le travailleur, mais d’un autre côté, ce même législateur ne fait rien pour empêcher ce mécanisme de dissociation de fonctionner imperturbablement…
La crainte révérencielle persistante du législateur vis-à-vis du pouvoir de licenciement est sans conteste l’ultime étape de la marchandisation. Le principe consiste à autoriser l’employeur à ignorer les règles de droit relatives à la protection contre le licenciement des travailleurs pour autant qu’il soit disposé à payer l’indemnité de licenciement. Autrement dit, l’employeur paie pour son licenciement abusif, qui toutefois n’est pas annulé malgré son caractère abusif. C’est là une constatation plutôt cynique, lorsqu’on sait que, pour le travailleur, le contrat de travail est l’instrument grâce auquel il va pouvoir subvenir à ses besoins. Ce constat renforce la conviction selon laquelle les travailleurs ne sont que des choses que l’on chérit tant qu’elles sont utilisables, mais dont l’entrepreneur peut se débarrasser dès le moment où elles deviennent inutiles…
Miser sur les droits collectifs du travail
Le droit du travail belge continue donc d’être fortement conditionné par la pensée libérale. Il favorise sans trop de scrupules une gestion autocratique au sein de l’entreprise. Dit avec des termes plus raffinés, on peut affirmer que la protection qu’assure la législation du travail s’appuie davantage sur la sécurité d’existence que sur la sécurité d’emploi. Autrement dit, le système tolère qu’en échange d’une indemnisation pécuniaire, l’employeur néglige les normes de droit du travail, y compris lorsque cela conduit à une perte d’emploi pour le travailleur… Tant que les employeurs recouraient principalement à des contrats de travail réguliers (et fixes), la préférence accordée à la consolation en argent (compensation financière) avait encore le soutien des travailleurs. Mais la libéralisation du marché du travail et la perte de qualité des contrats de travail qui en découle (c’est-à-dire l’augmentation constante de la précarisation) a fondamentalement changé la donne. La compensation financière en cas de gestion autocratique ne cesse de rapetisser et la subordination du travail au capital apparaît dans toute sa dureté. Dans ces circonstances, on se demande ce que les travailleurs vont bien pouvoir faire pour garantir le respect des normes du droit individuel du travail. Dans ce cas, miser sur une application cohérente des droits collectifs du travail nous paraît la solution la plus salutaire…
L’inaccessibilité de la législation du travail explique pourquoi des travailleurs se retrouvent avec un handicap en matière de pouvoir.
Le mouvement ouvrier, malgré une législation du travail à caractère libéral, a réussi à organiser de larges couches du groupe des travailleurs. Le mouvement a marqué de son empreinte la conception des droits collectifs du travail. Il a joué un rôle important dans le contrôle et l’application du droit collectif du travail et ses structures. La notion de «représentativité», telle que consacrée en droit, a d’une part permis au paysage syndical de rester stable en modérant la concurrence syndicale et a garanti aux principales organisations une position clé dans l’application des droits collectifs. S’appuyant sur sa propre force et sur l’aspiration des patrons à la paix sociale, le mouvement ouvrier a instauré un dialogue social à trois niveaux: au niveau interprofessionnel, au niveau sectoriel, et à l’échelon de l’entreprise.
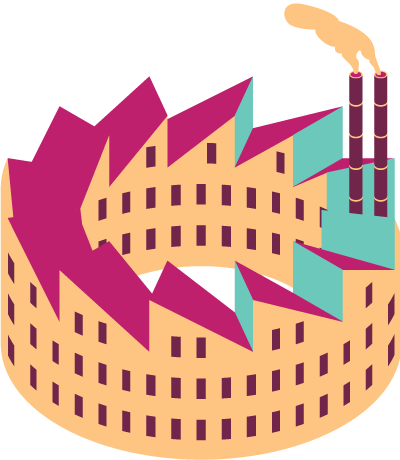 La mise en œuvre d’un système échelonné de conventions collectives de travail, conclues aux trois niveaux précités, ainsi que la promotion du dialogue par les fonctionnaires compétents ont été fondamentales pour la compensation du droit individuel du travail à caractère libéral. Le législateur a ainsi garanti les droits collectifs d’un large éventail de travailleurs et en même temps un usage largement répandu de ceux-ci. La couverture qu’offrent les CCT aux travailleurs belges fait partie des plus élevées de l’Union européenne. Le degré de participation des travailleurs dans la mise en place et le fonctionnement des organes de concertation au sein de l’entreprise est aussi très élevé. Autrement dit, le haut taux de syndicalisation des travailleurs associé à un large éventail de droits collectifs ont permis aux travailleurs un recours répandu au droit du travail belge. L’interaction directe entre droits collectifs et individuels du travail a, dans une certaine mesure, créé un effet d’aspiration au profit de la protection juridique des travailleurs sur le plan individuel. Continuer de miser sur les droits collectifs est, plus que jamais, nécessaire pour pouvoir contrôler et limiter la subordination du travail au capital, et surtout pour la combattre…
La mise en œuvre d’un système échelonné de conventions collectives de travail, conclues aux trois niveaux précités, ainsi que la promotion du dialogue par les fonctionnaires compétents ont été fondamentales pour la compensation du droit individuel du travail à caractère libéral. Le législateur a ainsi garanti les droits collectifs d’un large éventail de travailleurs et en même temps un usage largement répandu de ceux-ci. La couverture qu’offrent les CCT aux travailleurs belges fait partie des plus élevées de l’Union européenne. Le degré de participation des travailleurs dans la mise en place et le fonctionnement des organes de concertation au sein de l’entreprise est aussi très élevé. Autrement dit, le haut taux de syndicalisation des travailleurs associé à un large éventail de droits collectifs ont permis aux travailleurs un recours répandu au droit du travail belge. L’interaction directe entre droits collectifs et individuels du travail a, dans une certaine mesure, créé un effet d’aspiration au profit de la protection juridique des travailleurs sur le plan individuel. Continuer de miser sur les droits collectifs est, plus que jamais, nécessaire pour pouvoir contrôler et limiter la subordination du travail au capital, et surtout pour la combattre…




