Si, dans son nouveau livre, Thomas Piketty appelle à dépasser le capitalisme, il le réduit à une machine à accumuler des richesses et à produire de l’inégalité.
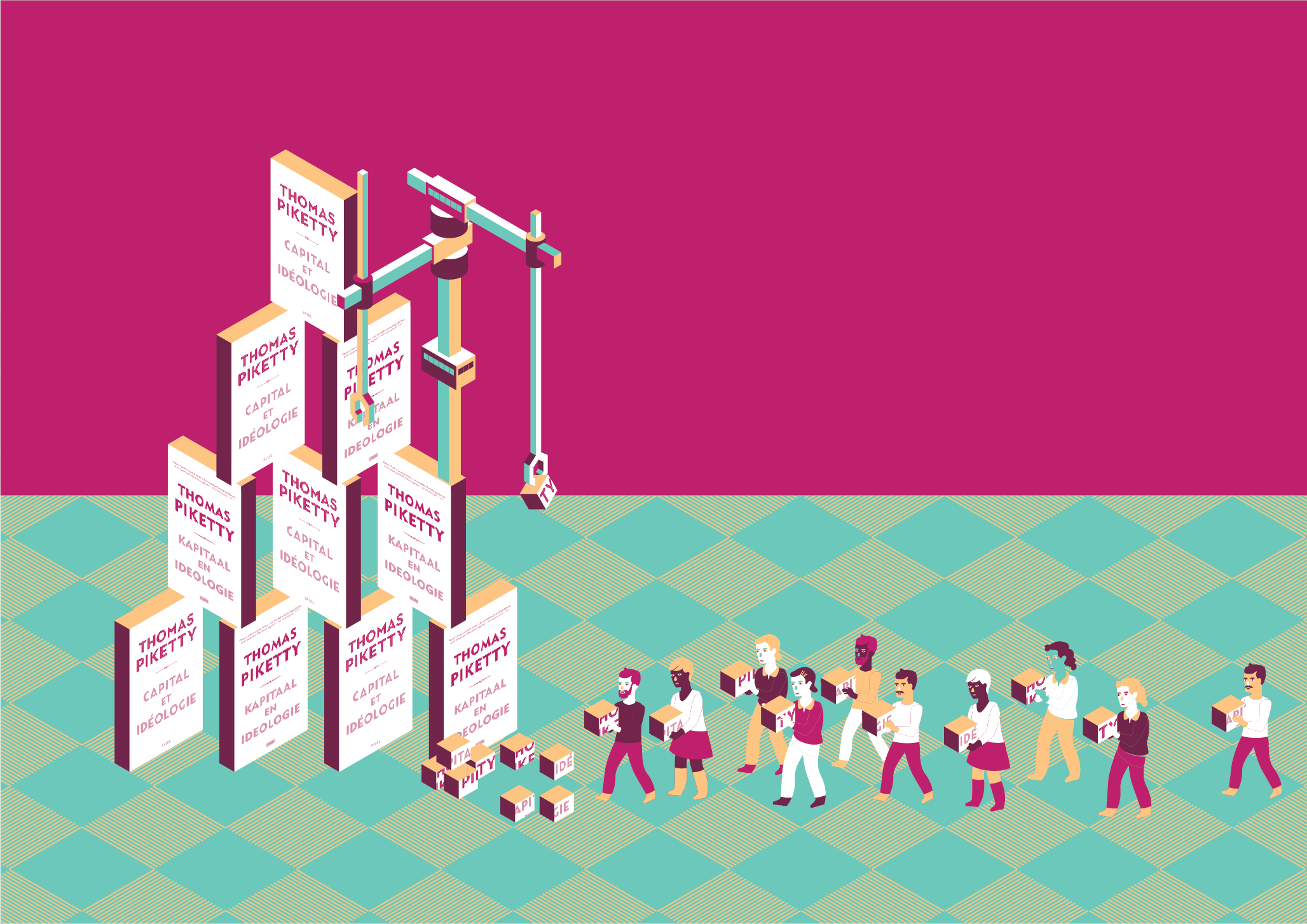
Pourquoi composer une œuvre simple et concise quand on peut en rédiger une longue et fastidieuse? Telle pourrait être la devise de l’économiste français Thomas Piketty. Après les 900 pages des Hauts Revenus en France au 20e siècle publiées en 2001, les 950 feuillets du Capital au 21e siècle en 2013, le voilà de retour avec un pavé intitulé Capital et Idéologie1. Et cette fois, il bat son record: 1200 pages bien tassées. Mais, reconnaissons-le, l’ensemble se lit assez aisément.

Son livre Le Capital au XXIe siècle, publié en 2013 aux éditions du Seuil, a connu un succès inattendu et écrasant. En 2019, il a publié Capital et Idéologie (Éditions du seuil).
Thomas Piketty est devenu un économiste incontournable. Son précédent opus s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires. C’est une performance inhabituelle pour un livre de non-fiction. Spécialiste des inégalités sociales, surtout celles du revenu et du patrimoine2, Thomas Piketty s’attaque maintenant aux idéologies qui tentent de justifier ces systèmes qui rapportent aux uns, alors que les autres triment pour nouer les deux bouts. Un défi monumental qui le pousse à mener une vaste étude historique aux quatre coins du globe.
Outre son succès livresque, l’économiste est intéressant, car il se veut accessible à tous3. De plus, il s’attache à un domaine peu exploré en économie, celui des inégalités sociales. De ce fait, il heurte la science économique traditionnelle.
Piketty s’attache à un domaine peu exploré en économie, celui des inégalités sociales.
De ce fait, il heurte la science économique traditionnelle.
Dans un premier temps, nous présenterons une synthèse très succincte de Capital et Idéologie. Ensuite, nous épinglerons quelques problèmes importants qu’il nous pose.
Une ambition théorique et historique
Le précédent ouvrage de Thomas Piketty avait fait quasiment l’unanimité pour avoir passé au crible plus de deux siècles d’évolution des revenus et des patrimoines des principaux pays européens et des États-Unis, et dressé des statistiques pour une bonne part inconnues à ce jour4. Il en ressortait clairement ce que l’économiste marxiste indien Prabhat Patnaik résumait de cette manière: «En l’absence de chocs du type de ceux de 1914 et de 1945 ou d’une intervention fiscale délibérée contraire, le capitalisme contemporain a tendance à augmenter les inégalités de richesse»5
Cette fois, Thomas Piketty élargit son horizon géographique et s’attaque aux justifications de ces inégalités. Il ne croit pas du tout à la justification principale donnée habituellement, à savoir que ces disparités seraient le prix à payer pour que des «premiers de cordée»6 puissent innover et apporter au monde l’indispensable croissance qui anime depuis la nuit des temps le progrès humain.
Il dispose d’un important groupe d’une centaine de chercheurs qui a affiné les méthodes et a établi des statistiques relativement fiables pour plus de 80 pays. C’est le World Inequality Database7. Grâce à cette base de données, il peut fournir des chiffres en matière d’inégalités de revenus et de patrimoines sur de vastes entités comme la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil, partout où c’est possible. Cette nouveauté est loin d’être négligeable, c’est une mine d’or pour chercheurs et activistes.
Thomas Piketty a une ambition théorique, celle de comprendre pourquoi ces inégalités de revenus et de patrimoines perdurent. Il veut donc examiner les idéologies qui prétendent que ces disparités sont nécessaires à l’évolution du monde. Il en fait un enjeu crucial pour l’avenir immédiat et plus lointain: «La remontée des inégalités socio-économiques, observée à l’intérieur de la plupart des pays et régions de la planète depuis les années 1980-1990, figure parmi les évolutions structurelles les plus inquiétantes auxquelles le monde est confronté en ce début de 21e siècle […] Il est difficile d’envisager des solutions aux autres grands défis de notre temps, à commencer par les défis climatiques et migratoires, si l’on ne parvient pas dans le même temps à réduire les inégalités et à bâtir une norme de justice acceptable par le plus grand nombre.» (p.36)
Il remonte ainsi dans le temps pour décrire les sociétés précapitalistes qu’il appelle, selon une terminologie de Georges Dumézil, sociétés trifonctionnelles. Suivant cette terminologie, la société serait composée de trois classes: le clergé ou les intellectuels de l’époque (les lettrés); la noblesse ou seigneurs guerriers (les chefs militaires); le tiers état, composé de tous les travailleurs, paysans, artisans, commerçants. Dumézil restreignait cette classification aux peuples dits indo-européens. Piketty l’étend à quasiment tous les pays et toutes les régions du globe (p.72), ce qui est un choix très contestable, comme nous le verrons par la suite.
La social-démocratie a abandonné son projet initial et est devenue un simple gestionnaire du capitalisme.
L’idéologie dominante s’appuie alors sur la religion et sur un ordre militaire protecteur, le seigneur accordant préservation et garanties en échange d’une rente. Mais cette idéologie est remise en cause en Europe, à cause de la nature éclatée de cette dernière. La réflexion philosophique qui émerge alors institue une différenciation fondamentale entre les fonctions régaliennes réservées à l’État et l’accaparement de biens qui peut être réalisé par des individus sous le couvert du droit. C’est ce que Thomas Piketty nomme justification propriétariste. C’est une «idéologie politique plaçant au cœur de son projet la protection absolue du droit de propriété privée (conçu en principe comme un droit universel)» (p.190). Par ailleurs, il qualifie le capitalisme comme étant «la forme particulière que prend le propriétarisme à l’âge de la grande industrie et des investissements financiers internationaux» (p.159), soit à partir de 1850. On notera que l’auteur définit le capitalisme à partir de l’idéologie propriétariste et non l’inverse.
Avec cette idéologie, les revenus et patrimoines ne cessent d’augmenter pour les plus nantis, alors que la majorité touche des salaires de misère et ne possède quasiment aucun bien. Ces inégalités sociales culmineront avec la Belle Époque.
Les guerres mondiales et la crise majeure des années 1930 vont ébranler ce projet. Il sera nécessaire de refonder le capitalisme pour éviter qu’il ne s’effondre. Thomas Piketty souligne cependant qu’indépendamment de ces cataclysmes, il y aurait eu un balancier pour rétablir une meilleure répartition des richesses, parce que le courant idéologique égalitaire gagnait du terrain (p.238).
Toujours est-il que, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, les écarts entre les plus riches et la majorité de la population se sont réduits entre 1914 et 1980 environ. Un mouvement qui a pris fin avec l’arrivée au pouvoir des néolibéraux et néoconservateurs dans deux pays importants sur le plan géopolitique, avec Margaret Thatcher en 1979 en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis en 1980. Une idéologie néo-propriétariste a fait son apparition et domine jusqu’à aujourd’hui les débats sur les inégalités, avec comme conséquence évidente des inégalités sociales qui rappellent celles de la Belle Époque.
Cette montée des disparités de revenus et de patrimoines a été facilitée par les échecs des politiques de gauche. Thomas Piketty ne rate aucune occasion pour rappeler à quel point le communisme soviétique a été un désastre complet, même si de temps à autre il lui reconnaît quelques mérites. Ainsi, l’URSS laisse en matière de différence de richesses un bilan plutôt positif, même s’il y avait des passe-droits et des avantages non recensés statistiquement pour l’élite de l’époque. La Russie d’Eltsine et de Poutine a inversé totalement la tendance et est devenue une nation profondément inégalitaire.
D’autre part, la social-démocratie a abandonné son projet initial au point de devenir un simple gestionnaire du capitalisme, n’osant plus critiquer le propriétarisme. Sur ce plan, l’économiste met en évidence un revirement net des partis de gauche durant la fin du 20e siècle. À partir des données sur les élections (obtenues à partir de sondages) et sur l’origine sociale des votants, il note une modification importante du public adhérant à un projet socialiste ou socialisant: de 1950 à 1980, les partis de gauche, toutes tendances confondues, attirent les voix des populations les plus défavorisées; à partir de 1980 environ, ils gagnent à leur cause davantage les plus diplômés (qui ne sont pas nécessairement les plus fortunés, qui eux votent toujours pour la droite conservatrice, p.887); les plus démunis s’abstiennent ou votent pour les courants appelés social-nativistes. Il en conclut: «Au cours du dernier demi-siècle, [la gauche électorale] est graduellement devenue le parti des diplômés, et notamment des cadres et des professions intellectuelles.» (p.843)
Le dernier chapitre de l’ouvrage (en dehors de la conclusion) est consacré à l’alternative préconisée par Thomas Piketty. Il l’articule autour de deux piliers: une refonte des droits de propriété, pour favoriser «un principe de propriété temporaire du capital»; une démocratisation du pouvoir et du fonctionnement dans les entreprises.
Pour cela, il propose une série de mesures dont les principales sont les suivantes: 1. une taxation des fortunes comme il le propose depuis longtemps maintenant (et qui était déjà développée dans son livre précédent); 2. une allocation importante aux jeunes de moins de 25 ans8, financée par l’impôt sur la fortune, au lieu d’un héritage obtenu souvent trop tard; 3. limiter les droits de vote à 10% dans les entreprises de grande taille et activer la participation des salariés dans les conseils d’administration, en promouvant ce qui existe déjà en cette matière en Allemagne et en Suède. C’est ce qu’il qualifie de socialisme participatif ou même de dépassement du capitalisme: «En combinant les deux éléments, on aboutit à un système de propriété qui n’a plus grand-chose à voir avec le capitalisme privé tel qu’on le connaît actuellement, et qui constitue un réel dépassement du capitalisme.» (p.1138) Il précise aussi: «Dans un tel système, les milliardaires disparaîtraient, de fait. Mais la petite propriété privée, elle, aurait toute sa place, tout comme l’entreprenariat.»9
Il est clair que si on définissait le capitalisme comme étant le propriétarisme à l’époque de la grande industrie et de la finance internationale, si des limites étaient posées à la propriété privée, la domination de cette idéologie pourrait être battue en brèche, du moins partiellement. Mais si on voit plus classiquement dans le capitalisme un système économique d’exploitation, où des patrons, possédant les entreprises, les usines et les bureaux, engagent des travailleurs contre un salaire qui ne rémunère pas la totalité de la richesse produite, on peine à accepter cette issue.
Le rejet du marxisme
Thomas Piketty fonde son analyse historique sans référence aux concepts marxistes, si ce n’est de façon anecdotique. Cela le met assez rapidement en difficulté sur le plan théorique. Ce qu’il refuse dans le marxisme, c’est son déterminisme supposé. Il veut s’en débarrasser à tout prix. D’autant que dans la théorie marxiste, il y a une détermination de l’infrastructure, de la sphère économique ou socio-économique sur le reste, dont les idées et les idéologies, mais en dernière instance. Le problème est de savoir ce qu’il faut entendre par cette dernière précision et certains préfèrent ne pas s’embarrasser de cette question et donc rejeter le marxisme à cause de son déterminisme. Pour Piketty, cette démarche lui permet aussi d’affirmer le rôle prééminent des idées, de l’idéologie et du débat contradictoire. Mais nous verrons cela dans la partie suivante.
Ceci n’est pas sans conséquence car l’économiste a tendance à confondre la position sociale des gens avec ce qu’ils en disent eux-mêmes. C’est le cas, par exemple, dans la classification de la société trifonctionnelle où les ordres établis (noblesse, clergé et tiers état) étaient ceux que les dirigeants avaient eux-mêmes définis à l’époque. Il n’y a aucune raison de penser que cette classification soit réellement pertinente.
Définir une société, un système par son idéologie, c’est faire l’impasse sur l’étude de ce qui provoque les conflits et les oppositions fondamentales. Comme l’écrit Alain Bihr: «En un mot, il n’y a pas de sociétés ternaires10, il y a tout au plus des sociétés à idéologie ternaire.» Il ajoute: «S’en remettre à l’idéologie dominante d’une société (qui est toujours celle du ou des groupements qui y sont dominants) pour comprendre cette société, c’est à coup sûr passer à côté de ses rapports sociaux essentiels.»11
Que les inégalités sociales sont le produit de la situation des classes sociales et des rapports sociaux de production échappe totalement à Piketty.
Comme la plupart des économistes, Thomas Piketty ne sait pas ce qu’est la production. Il se focalise sur les inégalités sociales, sans voir que derrière celles-ci, il y a des rapports sociaux de production. Il s’intéresse à l’effet distributif sans se préoccuper aucunement de la manière dont les biens et services sont produits et des relations sociales qui se nouent pour obtenir ce résultat. Ce qui était la force de l’analyse de Marx. Même un auteur comme Jean Pisani-Ferry, proche du parti socialiste et d’Emmanuel Macron, le lui reproche: «Marx était fasciné par le capitalisme, par la force avec laquelle une mutation du rapport social pouvait induire des bouleversements dans l’ordre productif. Il plaçait au centre de sa lecture la dialectique des forces productives et des rapports de production. Piketty paraît s’en désintéresser complètement, il réduit le capitalisme à une machine à accumuler des richesses et à produire de l’inégalité.»12
Cette mauvaise compréhension des fondamentaux socio-économiques se retrouve dans sa définition de la classe sociale. Pour lui, «la notion de classe sociale doit être elle-même envisagée comme une notion profondément multidimensionnelle. Elle met d’abord en jeu tout ce qui concerne la profession, le secteur et le statut de l’activité, le salaire ou les autres formes de revenu du travail, les qualifications, l’identité professionnelle, la position de direction ou d’encadrement, la possibilité de participer aux décisions et à l’organisation de la production.» (p.839-840) Il ajoute qu’elle peut «être déterminée par l’âge, le genre, les origines nationales ou ethniques (ou perçues comme telles) et les orientations religieuses, philosophiques, alimentaires ou sexuelles». Il termine de cette façon: «Enfin, la classe sociale est étroitement déterminée par la propriété.» (p.840)
Ainsi, on pourrait avoir la classe des femmes lesbiennes végétariennes, bouddhistes, trentenaires, diplômées du supérieur, employées, gagnant l’équivalent du SMIC à côté d’autres femmes qui se différencieraient de ce groupe par l’une ou l’autre caractéristique comme sexagénaire, hindouiste, ouvrière, mangeuse de viande… Ce qui est absurde. Une classe sociale n’est pas une catégorie sociale. C’est un concept à caractère explicatif et pas seulement descriptif.
Et celui-ci est déterminé fondamentalement par la position de chacun face aux moyens de production, par la terre principalement dans les sociétés précapitalistes, et par les entreprises, les usines, le capital sous le capitalisme. Ainsi, sous le féodalisme, il y a essentiellement des serfs, paysans qui versent une rente, un impôt, une corvée face à un seigneur censé les protéger. De ce fait, les nobles et le clergé font partie de la même classe, celle des possédants de la terre13. Sous le capitalisme, les «ouvriers», qui regroupent la plupart des salariés, ne détiennent que leur force de travail. Ils sont obligés pour survivre de la vendre aux patrons qui contrôlent les firmes, en échange d’un salaire qui ne correspond pas à la valeur que ces travailleurs créent.
La position dans la structure sociale – propriétaire ou salarié, exploiteur ou exploité – est une place objective qui délimite les intérêts et les actions sociales. Les relations de classe catégorisent bien plus fondamentalement que toute autre relation sociale. Un croyant peut devenir athée, ou inversement. Normalement, cela ne change rien à sa position sociale. On peut difficilement dire la même chose d’un salarié. Un salarié qui veut survivre ne peut généralement pas choisir d’arrêter de vendre sa force de travail. Il peut essayer de devenir indépendant et même engager des aides à son commerce, mais il commencera au bas de l’échelle. Il lui sera malaisé de gravir les échelons. De son côté, le capitaliste, lui aussi, doit se plier aux lois du système: rester compétitif ou périr. Et que le capitaliste soit un gourou féru de yoga ou un amateur d’armes ne changera fondamentalement rien à sa position dans la structure économique.
Voilà ce que Thomas Piketty, avec ses outils d’analyse, ne comprend pas et ne peut pas comprendre: les inégalités sociales et leur évolution sont le produit de la situation des classes sociales et des rapports sociaux de production. Il reprend, pourtant, l’affirmation de Marx et d’Engels dans le Manifeste du parti communiste: «L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte de classes.» Mais il tient à préciser: «L’affirmation reste pertinente, mais je suis tenté à l’issue de cette enquête de la reformuler de la façon suivante: l’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des idéologies et de la quête de la justice. Autrement dit, les idées et les idéologies comptent dans l’histoire.» (p.1191) Ce qui n’est manifestement pas la même chose.
L’idéologie, moteur de l’histoire?
Ainsi, Thomas Piketty accorde à l’idéologie une place prépondérante. Il en fait un facteur central du changement. Il redéfinit l’histoire sur base non des classes sociales, mais sur celle de l’idéologie. Dès le début de son ouvrage, il tient à donner une définition de cette dernière: une idéologie est «un ensemble d’idées et de discours a priori plausibles visant à décrire comment devrait se structurer la société». (p.16) Il précise: «Chaque société humaine doit justifier ses inégalités: il faut leur trouver des raisons, faute de quoi c’est l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer.» (p.13) De ce fait, l’auteur suggère, comme le précise d’ailleurs Alain Bihr14, que l’idéologie dominante pourrait ne pas être celle du groupe dominant.
Sans doute Thomas Piketty devrait lire et apprendre de l’expérience de l’ancien ministre grec des Finances, Yánis Varoufákis.
De ce fait, il en arrive à accorder la place centrale aux débats d’idées. Il écrit, en effet, par rapport au «déterminisme marxiste»: «J’insiste au contraire sur le fait qu’il existe une véritable autonomie de la sphère des idées, c’est-à-dire de la sphère idéologico-politique. Pour un même état de développement de l’économie et des forces productives (dans la mesure où ces mots ont un sens, ce qui n’est pas certain), il existe toujours une multiplicité de régimes idéologiques, politiques et inégalitaires possibles.» (p.21) À de nombreuses reprises dans le livre, il affirme comme ici: «Comme toujours, l’histoire montre que rien n’est écrit d’avance.» (p.629) Sous-entendu que le débat au niveau des conceptions politiques et des solutions pratiques pourrait la changer.
En tant que marxiste, on peut adhérer à la thèse que l’idéologie est importante et que les efforts de conviction sont indispensables pour faire avancer les choses, le progrès social, technique, humain… Certains marxistes ont été trop déterministes en liant les positions idéologiques directement à des intérêts économiques ou en associant une situation à une nécessité presque mathématique découlant des causes qui l’ont provoquée. Marx, Engels ou Lénine, par exemple, se sont régulièrement plaints de ce qu’ils appelaient un marxisme vulgaire, qui ne correspondait pas à leurs vues. Thomas Piketty ne peut pas rejeter l’apport de ces auteurs sur cette base. Ce serait rejeter la social-démocratie sur les seules politiques menées par Tony Blair, Gerhard Schröder ou François Hollande15.
Rien n’est écrit d’avance, il est vrai. La révolution bolchevique d’octobre 1917 n’était pas inscrite dans les astres. Ni les échecs, par la suite, en Allemagne et en Hongrie. Mais tout n’est pas non plus possible au gré des arguments pertinents des uns et des autres. Il y a des avenirs plus probables que d’autres. En général, cela est lié à la situation économique et aux rapports de forces construits à ce moment-là. La plupart du temps, les populations ont besoin de faire des expériences avant d’adopter une position qui corresponde réellement à leurs intérêts. Cela se passe souvent après qu’elles se sont fait berner par des discours lénifiants, proposant des solutions qui n’en sont pas réellement.
C’est la base de toutes les théories réformistes: passer de la critique radicale d’un phénomène à la critique de ses excès.
Ainsi, la Révolution française est une période où, le pouvoir royal étant démis, beaucoup d’évolutions différentes sont possibles. De nombreuses idées et conceptions circulent. Il y a notamment celles de Gracchus Babeuf, qui fonde en 1796 la Conjuration des Égaux pour lutter contre le Directoire qui dirige le pays depuis un an. Il prône une extension de l’égalité instituée en droit en une situation de fait, à la base des conceptions qui donneront plus tard l’anarchisme et le communisme. Il devra vivre en clandestinité, mais grâce à des informateurs il sera finalement capturé. Il sera exécuté avec d’autres contestataires le 27 mai 1797. Il était incontestablement populaire. Mais plusieurs tentatives de le libérer de sa geôle échoueront. Quelles chances réelles avait-il de réaliser son projet, aussi émancipateur qu’il soit, en cette fin du XVIIIe siècle? Sans doute très peu. Alors, les idées sont importantes. Sans Babeuf y aurait-il du socialisme et du communisme? Peut-être, mais pas le même. Seulement, la réalisation concrète de ces conceptions dans des projets solides qui tiennent la route dépend quand même des conditions matérielles dans lesquelles elles apparaissent. C’est ce que tend à nier Thomas Piketty.
Comme l’écrit encore une fois Alain Bihr: «En fait, en dépit des quelques passages où il se réfère à ce que l’histoire contemporaine comprend de luttes sociales, de luttes mettant en jeu les classes sociales et leurs rapports, leurs organisations et leurs représentations, tout se passe comme si Thomas Piketty était convaincu qu’il lui suffit de présenter son projet et de le livrer au débat public pour que les idées ainsi avancées fassent leur chemin et finissent par créer, par la seule vertu de leur argumentation et la richesse de l’information statistique sur laquelle elles reposent, la majorité politique qui serait nécessaire à leur mise en œuvre dans le cadre de démocraties parlementaires.»16
Sans doute Thomas Piketty devrait lire et apprendre de l’expérience de l’ancien ministre grec des Finances, Yánis Varoufákis. Au moment de l’expérience Syriza durant la première moitié de 2015, celui-ci a tenté de convaincre ses collègues européens du bien-fondé de sa politique: réaménager la dette publique, arrêter l’austérité et stabiliser l’économie nationale17. Mais il s’est retrouvé face à un mur: il fallait à tout prix faire plier ce gouvernement de gauche radicale. Il n’était pas question de savoir si c’était la meilleure solution pour la Grèce ou pour l’Union européenne. C’était une question de classe sociale, de pouvoir, de domination.
Dès son introduction, Thomas Piketty en appelle à dépasser le capitalisme et à développer un «socialisme participatif». Mais ce socialisme n’a rien à voir avec les expériences socialistes qui ont été menées avec plus ou moins de succès ou d’échec en URSS, Chine, Cuba, Vietnam ou ailleurs. Alors de quel socialisme parle-t-il? Où est le dépassement du capitalisme?
Il écrit en effet: «Je préfère parler de “socialisme participatif” pour insister sur l’objectif de participation et de décentralisation et pour distinguer nettement ce projet du socialisme étatique hypercentralisé expérimenté dans les pays relevant au 20e siècle du communisme de type soviétique (et encore à l’œuvre dans une large mesure au sein du secteur public chinois).» (p.1115) Il précise «Mais le mot “socialiste” reste utilisable. Trente ans après la chute du communisme, il faut prendre du recul. Le socialisme démocratique18, qui a ses limites, a eu aussi ses succès: il a transformé les sociétés européennes extrêmement inégalitaires d’avant 1914 en des sociétés plus égalitaires, plus qu’aucun autre modèle n’a su le réaliser.»19 En clair, il affiche le caractère politique de son projet: «Pour moi, c’est un prolongement de la social-démocratie.»20
Le principal changement de voie qu’il propose par rapport à ce courant qui aujourd’hui gère le capitalisme aux côtés d’autres partis du même acabit est qu’il veut revenir à l’orientation d’origine et abandonner les dérives social-libérales actuelles. D’une certaine manière, il aimerait retrouver cet élan qui pouvait émaner de la IIe Internationale21 à ses débuts, où les militants voulaient dans un premier temps arracher la démocratie politique, à savoir le suffrage universel, puis conquérir le pouvoir économique. On remarquera à ce propos que les propositions de Thomas Piketty concernent en particulier ce dernier aspect, celui de restreindre le pouvoir des patrons et d’étendre celui des salariés.
Mais, tout en dénonçant fermement l’idéologie propriétariste, il défend une forme de propriété privée indispensable et «raisonnable»: «L’instauration d’une propriété sociale et temporaire permettrait de dépasser le système hyperpropriétariste actuel: il ne s’agit pas de supprimer toute forme de propriété – on ne touche pas à la petite propriété privée, il y aura même toujours des fortunes de quelques millions d’euros – mais de rester dans des formes de propriétés raisonnables, dans le respect de l’intérêt général.»22
Dans cette citation, Thomas Piketty ne s’en prend plus au régime propriétariste, mais hyperpropriétariste. C’est la base de toutes les théories réformistes: passer de la critique radicale d’un phénomène à la critique de ses excès. Si on reste sur la première position, on veut une modification en profondeur. Avec la seconde, il suffit de se limiter aux exagérations tout en laissant le système intact, car il est sain tant qu’on reste «raisonnable».
Or, tout nous apprend que le capitalisme n’est «raisonnable» que si la lutte des classes, les rapports de forces l’y obligent. C’est la conclusion à laquelle est arrivé Prabhat Patnaik en lisant Le Capital du 21e siècle: en dehors de chocs comme des guerres et des crises, le système tend à l’inégalité sociale, donc aux écarts de richesses qui empoisonnent le monde actuel. Manifestement, Thomas Piketty n’aboutit pas aux mêmes leçons.
En fait, il ne comprend pas l’accumulation du capital et ce qui la rend si implacable. Comme la plupart des économistes, il n’aborde pas le sujet, il l’élude. Pourtant, c’est cette accumulation qui est le véritable moteur du capitalisme. C’est elle que recherchent avec avidité et cupidité les entrepreneurs, parce qu’elle leur procure richesses et puissance. Si la propriété des entreprises et des usines reste privée, même en y mettant toutes sortes de restrictions comme le propose Thomas Piketty, les patrons les plus malins et qui n’ont pas trop de scrupules n’auront de cesse de contourner ces législations contraignantes. On l’observe sous nos yeux avec ces multiples stratégies d’évasion et même de fraude fiscale. On retombera alors nécessairement dans le capitalisme le plus vil et le plus sordide.
C’est pourquoi Alain Bihr en conclut: «Le projet politique soutenu par Thomas Piketty à la fin de son ouvrage n’est en rien révolutionnaire mais simplement réformiste. Son “socialisme participatif” vise à refonder le projet social-démocrate classique: introduire des réformes de structure dans le capitalisme contemporain pour le rendre moins inégalitaire ou même le moins inégalitaire possible. Projet au demeurant suffisamment honorable par la hardiesse de certaines de ses propositions pour qu’il soit inutile de l’affubler de vertus qu’il n’a manifestement pas et pas même vocation à avoir.»23
Un nouveau Keynes?
 Thomas Piketty présente ainsi une alternative très classiquement sociale-démocrate et réformiste. Son travail sur les inégalités de richesses et de revenus, qu’il poursuit dans ce livre, est remarquable. Il fournit en statistiques relativement fiables les militants de tout bord qui n’acceptent plus ce travers de la société moderne. Mais les conclusions que l’économiste en tire ne sont pas les nôtres.
Thomas Piketty présente ainsi une alternative très classiquement sociale-démocrate et réformiste. Son travail sur les inégalités de richesses et de revenus, qu’il poursuit dans ce livre, est remarquable. Il fournit en statistiques relativement fiables les militants de tout bord qui n’acceptent plus ce travers de la société moderne. Mais les conclusions que l’économiste en tire ne sont pas les nôtres.
Peut-être même faut-il voir en Piketty le nouveau Keynes, celui qui se rend compte que l’inégalité trop forte conduit le capitalisme à l’explosion? Dans ce cas, il ne serait pas celui qui veut dépasser le capitalisme, mais celui qui le remettrait sur les rails, un objectif suivi à l’époque par Keynes. L’avenir nous le dira.
Pour notre part, nous préférons conclure par cette citation de Joan Robinson24, reprise par Prabhat Patnaik: «Tout gouvernement qui aurait le pouvoir et la volonté de remédier aux défauts majeurs du système capitaliste aurait la volonté et le pouvoir de l’abolir complètement, alors que les gouvernements qui ont le pouvoir de conserver le système n’ont pas la volonté de remédier à ses défauts.»25
Thomas Piketty, Capital et Idéologie, Éditions du Seuil, Paris, 2019.
Footnotes
- Thomas Piketty, Capital et Idéologie, Éditions du Seuil, Paris, 2019. Les indications de pages dans cet article se réfèrent à cette édition.
- Un revenu est une rentrée d’argent (ou équivalent) pour un ménage ou un individu durant une période de temps limitée, par exemple un an. Un patrimoine est l’état de sa fortune, principalement biens immobiliers et avoirs financiers, à un moment donné.
- On trouvera les données statistiques et autres (techniques, etc.) dans l’annexe qu’il met à disposition de tous sur son site: www.piketty.pse.ens.fr/fr/ideologie.
- Pour un aperçu à la fois élogieux et critique de cette étude, voir Henri Houben, «Le Capital du 18e au 21e siècle», Études marxistes n°107, juillet-septembre 2014, p.29 à 51.
- Prabhat Patnaik, «Capitalism, Inequality and Globalization: Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-first Century », Monthly Review, 17 octobre 2014.
- Pour reprendre la référence avancée par le président français Emmanuel Macron.
- On peut voir leurs données et analyses sur le site: wid.world.
- Pour la France, il suggère de fournir à chaque jeune de 25 ans un fonds de 120000 euros, argumentant que l’héritage avantage les plus aisés, les plus diplômés et qu’avec l’allongement de l’espérance de vie, il intervient généralement trop tard (quand les gens sont déjà installés).
- Libération, 11 septembre 2019.
- Ou trifonctionnelle.
- Alain Bihr, Des “sociétés ternaires” aux “sociétés de propriétaires”: comment Thomas Piketty analyse la transition du féodalisme au capitalisme, À l’encontre, 5 novembre 2019.
- Jean Pisani-Ferry, «Piketty: Les pleins et les déliés», L’Express, 12 septembre 2019.
- Même si dans le clergé, il peut y avoir différentes positions sociales.
- Alain Bihr, Débat. Capital et idéologie: un titre en trompe-l’œil, À l’encontre, 29 octobre 2019
- Cela peut nous amener à réfléchir. Mais si on veut dénoncer l’idéologie sociale-démocrate, il faut aller aux sources de celle-ci et étudier Edouard Bernstein, Karl Kautsky et Emile Vandervelde (notamment).
- Alain Bihr, Le “socialisme participatif” de Thomas Piketty: un socialisme utopique aux allures scientifiques, À l’encontre, 19 novembre 2019.
- Il raconte son expérience dans Conversations entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe, Les Liens qui libèrent, Paris, 2017.
- Il entend par là la social-démocratie, bien entendu.
- L’Écho, 13 septembre 2019.
- L’Écho, 27 décembre 2019.
- La IIe Internationale a été créée en 1889.
- Libération, 11 septembre 2019.
- Alain Bihr, op. cit.
- Joan Robinson (1906-1983) était une économiste keynésienne critique britannique.
- Prabhat Patnaik, op. cit.




