L’allocation universelle est généralement perçue comme une idée de gauche. Cependant, un regard plus attentif sur son histoire, nous offre une tout autre image
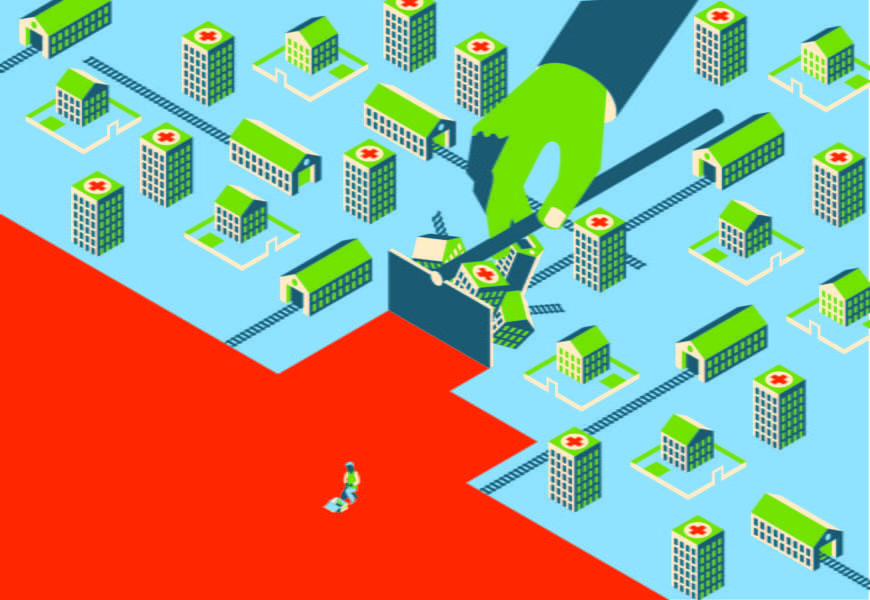
L’idée d’une allocation universelle1 suscite, depuis le début de la crise de 2008, un engouement renouvelé. La proposition paraît simple et séduisante : elle consisterait à verser, à chaque citoyen, un « revenu de base2 » inconditionnel qui aurait pour but de délivrer nos sociétés de la pauvreté, de la précarité ou du chômage. Dans son acception de « gauche », chaque citoyen pourrait par conséquent être délivré de l’impératif de travailler et délivré des institutions parfois autoritaires de l’État social pour laisser place à de nouvelles activités autonomes et dépasser les injonctions mortifères de l’emploi « à tout prix ». Dans une société où le travail disparaitrait, l’allocation universelle se présente par conséquent comme la technique sociale propre à une société post-industrielle.
- Ce texte est une version courte et adaptée d’un des chapitres de l’ouvrage Contre l’allocation universelle paru aux éditions Lux en 2017 et dirigé par Mateo Alaluf et Daniel Zamora.
Récemment, elle a été mise à l’ordre du jour du gouvernement de droite finlandais, proposant de remplacer une partie du système de sécurité sociale par un revenu de base versé à tous ses habitants. Au Canada, c’est la province de l’Ontario qui s’est engagée à conduire un projet expérimental de grande ampleur à l’été 2017. En Europe, c’est surtout aux Pays-Bas que l’expérience est la plus avancée. Cette année, c’est normalement dans une vingtaine de municipalités — dont Utrecht — que l’expérience sera lancée afin d’en tester empiriquement les effets sur les bénéficiaires. En France, c’est le candidat malheureux à l’élection présidentielle Benoît Hamon qui en avait fait sa mesure phare. De nombreux partis politiques discutent désormais ouvertement, un peu partout dans le monde, d’un revenu inconditionnel versé à chaque citoyen. À droite comme à gauche, la proposition fait débat et est appréciée pour ses supposés avantages ( éradiquer la précarité pour les uns, se débarrasser des vieilles institutions bureaucratiques de sécurité sociale pour les autres). Son caractère d’apparence à la fois « libéral » et « social » semble dessiner un clivage original partageant d’un côté ceux qui continuent à penser dans le vieux cadre des classes et de la révolution industrielle et ceux qui auraient compris que, dans la nouvelle « économie de la connaissance », il est nécessaire de transformer en profondeur notre imaginaire et nos institutions. Désormais, le plein emploi serait une utopie, la stabilité d’emploi une revendication dépassée au regard du dynamisme nécessaire aux nouvelles activités « créatives » et les vieilles institutions du salariat ( droit du travail, sécurité sociale, syndicats… ) de vieilles machines à exclure et des freins au progrès et à la liberté individuelle.
Cette popularité croissante de l’allocation universelle a été de pair, au cours des trente dernières années, avec son insertion dans une longue tradition intellectuelle. En effet, ses principaux protagonistes l’associent généralement aux idées de Thomas More, Charles Fourier ou Thomas Paine qui, en leur temps, auraient formulé des propositions se rapprochant supposément de celle du revenu de base. Pourtant, à y regarder de plus près, ce type de filiation souffre de profondes limites. En effet, peut-on réellement associer à l’idée d’une allocation universelle la défense, par More, d’un niveau de vie minimal pour tous ? À cette allure, il pourrait être également le précurseur d’une sécurité sociale universelle ou de l’impôt progressif.
Désormais, le plein emploi serait une utopie, la stabilité d’emploi une revendication dépassée et les vieilles institutions du salariat des machines à exclure
Comme toute idée politique, l’allocation universelle s’est en fait dotée de sa propre mythologie, construite bien entendu a posteriori, afin d’offrir à la proposition une histoire idéalisée remontant jusqu’au 16e siècle. La reconstruction d’une filiation totalement fictive et plus que contestable au plan intellectuel correspond par conséquent moins à une réalité historique qu’à une manière de fonder en légitimité des idées qui sont plus récentes qu’il n’y paraît. L’historien Eric Hobsbawm a montré à quel point nombre d’institutions, d’idées politiques ou même d’organisations utilisent des matériaux anciens pour se doter de « traditions inventées » ayant pour but d’offrir l’illusion de la permanence. L’effet premier de l’enracinement de l’allocation universelle dans un passé lointain a donc pour paradoxale conséquence d’empêcher toute historisation, de porter hors du regard des sciences sociales sa genèse, refoulant par conséquent ses propres conditions historiques de possibilité.
En réalité, sa formulation moderne — qui se situe dans les années soixante — verra sa popularité exploser avec la crise économique de 1973 et ses conséquences. Tant à gauche — souvent au sein du mouvement écologiste naissant — qu’auprès d’une nouvelle droite néolibérale, l’idée d’une allocation fera son chemin dans les programmes politiques. En ce sens, l’allocation universelle semble être une revendication de crise, brandie dans les situations de net recul social et de forte offensive des politiques d’austérité. Le paradoxe est donc profond : plus les politiques sont à droite et plus le mouvement social est sur la défensive, plus le revenu de base semble gagner du terrain. Plus les conquêtes sociales semblent inaccessibles, plus l’idée d’une allocation universelle semble faire sens. Ainsi, l’allocation universelle paraît ne pas être l’aboutissement de nombreuses conquêtes sociales passées, mais, au contraire, l’alternative de leur abandon. Elle est ce que les botanistes appellent communément un « bio-indicateur ». Elle nous renseigne sur l’état d’avancement du néolibéralisme. Son soutien prolifère là où les réformes néolibérales ont été les plus dévastatrices.
L’enjeu d’une telle allocation n’est donc pas uniquement de nature technique ( quel montant ? est-ce possible ? comment l’implémenter ? quels effets ?), mais met en cause les fondements intellectuels de la gauche d’après-guerre. Loin des histoires reconstruites, je montrerai que l’idée d’allocation universelle n’a été rendue possible que par la remise en cause des institutions de protection sociale. En ce sens, elle entretient un rapport intime avec l’émergence du néolibéralisme tant dans le type de réponse qu’elle offre à la crise que dans la conception de justice sociale qu’elle véhicule.
Pour saisir le sens politique d’une proposition telle que celle de l’allocation universelle, il faut, au préalable, revenir sur ce à quoi elle s’oppose. En effet, l’État social ainsi que son système de sécurité sociale relèvent d’une logique opposée à celle du revenu de base. En ce sens, leur naissance et des droits qui y seront associés ne sont pas un simple artefact technique. Ils sont le produit d’une profonde et lente transformation de la manière dont nous avons conçu la question sociale et qui a commencé à émerger dès le milieu du 19e siècle contre le régime libéral qui a prévalu durant l’industrialisation. Cette « révolution » sociale sera notamment constituée par quatre grandes transformations.
C’est tout d’abord la notion de responsabilité individuelle qui est mise en question. En effet, l’avènement des institutions de protection sociale a été rendu possible par le développement d’une conception macro-économique des problèmes sociaux. Ainsi, les principes de « responsabilisation » des pauvres, de non-intervention dans les politiques économiques libérales du 19e siècle seront totalement discrédités. Désormais le paupérisme et le chômage sont perçus comme l’effet du système économique lui-même et non seulement la conséquence d’un comportement individuel défaillant ( fainéantise, immoralité…). Le problème de la misère ouvrière ou du chômage ne peut plus être traité par les mesures disciplinaires du régime libéral, caractérisées notamment par le travail forcé dans les workhouses anglaises ou les dépôts de mendicité. Ce n’est plus la responsabilité individuelle qui est mise au premier plan de l’action politique et économique, mais les variables macro-économiques.
La logique de l’État social consiste par conséquent en l’extension sans précédent de mécanismes visant à soustraire les individus de la violence des rapports marchands
Deuxièmement, ce déclin de la notion de responsabilité individuelle impliquera la revendication de droits sociaux avec une perspective universelle et non plus de faveurs arbitraires et individuelles comme cela avait pu être le cas avec les formes de charité en vigueur jusqu’à la fin du 19e siècle. En effet, si les problèmes tels que le chômage ou la pauvreté sont des phénomènes sociaux, il est naturel que l’État s’emploie à y remédier collectivement. La socialisation d’une partie des richesses produites afin d’offrir des droits collectifs ( à la santé, l’éducation, à une pension… ) instaure, à côté de la propriété privée, une propriété sociale destinée à faire réellement entrer le salariat dans la citoyenneté. Elle sera la solution trouvée par le 19e siècle à ce qu’Émile Buret nommait « la séparation absolue du capital et du travail ».
Troisièmement, l’inspiration de cette propriété socialisée se traduit alors dans un rôle nouveau pour l’État, un État qui ne se limite plus à agir dans les « marges », mais qui agit sur l’ensemble du corps social. Cette transformation de la protection sociale étend le champ d’action de l’État au sein de la sphère économique. En effet, pour offrir des droits il est nécessaire de séparer l’accès à certains biens de l’accès des individus au marché. Cette « démarchandisation » vise à offrir une sécurité dans des aspects essentiels de l’existence ( santé, travail, revenus, éducation, etc. ) et contribue à un rapport de force plus favorable des classes dominées face aux classes dominantes. La logique de l’État social consiste par conséquent en l’extension sans précédent de mécanismes visant à soustraire les individus de la violence des rapports marchands et à institutionnaliser leur force collective autour du rapport salarial moderne et des droits qui en découlent. Cette idée, qui fut celle que défendait Karl Polanyi dans La grande transformation3, voit dans tout principe de protection sociale l’objectif de dégager l’individu des lois du marché et donc de reconfigurer les rapports de force entre capital et travail.
Enfin, derrière la régulation de la sphère économique, se cache également l’avènement de l’idéal égalitaire, véritable cœur idéologique du projet social de l’après-guerre. Si derrière les institutions de charité publique se cachait l’idée d’une justice sociale pour les pauvres « méritants », avec la révolution de l’État social c’est l’ambition de l’égalité qui se dessine. En effet, les niveaux d’inégalité qui ont prévalu dans l’avant-guerre sont partiellement tenus pour responsables des conflits qui ont mené le vieux continent au désastre. C’est au cours des années 1870-1914 qu’on a atteint des niveaux d’inégalités extrêmement élevés et cela semble par conséquent confirmer l’idée, popularisée par Marx, d’une accumulation infinie des richesses dans quelques mains. Désormais, le problème de l’insécurité sociale se pose de moins en moins en termes de « pauvreté » absolue ( ou de « paupérisme » ) mais au regard de la distribution générale des revenus, de l’étendue des écarts existants entre les riches et les pauvres. En ce sens, il revient désormais aux politiques sociales d’incarner la lutte contre les inégalités et l’instauration, sur le long terme, d’un droit universel aux biens fondamentaux. L’extension toujours plus grande et l’incorporation toujours plus large de la population dans les systèmes de protection sociale amèneront par conséquent de nombreux auteurs à prédire la fin de la pauvreté. La solution aux problèmes sociaux se superpose donc au projet d’universalisation des institutions d’assurance sociale.
Le retour de la pauvreté
Cet optimisme va pourtant rapidement se fissurer au regard d’une pauvreté persistante. Et c’est d’abord aux États-Unis que se produit ce retournement avec l’immense succès du livre de Michael Harrington The Other America, paru en 1962 et vendu à plus d’un million d’exemplaires. Harrington rend alors compte de cette « autre Amérique », composée de travailleurs non qualifiés, de minorités, de personnes âgées, qui vivent dans l’ombre du rêve américain et de sa croissance économique. Il pense que cette Amérique pauvre est devenue invisible suite à l’enthousiasme généré par le New Deal. D’une certaine façon, le développement économique d’après-guerre aurait contribué à l’oubli des plus démunis et de la question de la pauvreté. Cet espoir déçu, il serait dès lors temps de remettre celle-ci au cœur du débat politique.
En France, dès le début des années 70 la question de la pauvreté revient à l’avant-plan du débat avec les ouvrages de deux hauts fonctionnaires. Tout d’abord René Lenoir en 1974, avec Les exclus : Un français sur dix. L’ouvrage de Lenoir sera important de par la stature de la personne. En effet, il est ministre à l’action sociale sous le gouvernement du président français Valéry Giscard d’Estaing l’année de parution de son livre. Cette position particulière lui vaudra un grand écho et une influence certaine pour infléchir les politiques sociales vers la question des « exclus ». Enfin, il faut noter le livre de Lionel Stoléru, en 1974 également, où il est question de « vaincre la pauvreté dans les pays riches4 ».
Cependant, loin de se limiter à une dénonciation, leur intervention va également participer d’une transformation plus générale de la manière de concevoir la justice sociale et des solutions à apporter. En effet, l’ambition de l’universalisation de la sécurité sociale qui dominait jusqu’au milieu des années soixante est petit à petit abandonnée au profit d’une défense spécifique des fameux « nouveaux pauvres » que seraient les nombreuses fractions « exclues » du salariat et de la prospérité des « trente glorieuses ». C’est le début des nombreux débats sur « l’exclusion » et sur l’incapacité des politiques sociales d’après-guerre, voire sur la responsabilité qu’elles auraient dans ce problème. Se développe l’idée que cette « pauvreté dans l’abondance » ne peut être réduite par le biais des institutions classiques et qu’elle remet en cause les politiques sociales qui avaient été menées jusqu’à lors. La sécurité sociale, l’État social ou le droit du travail auraient « exclu » les pauvres du partage de la richesse et contribueraient à les maintenir dans leur situation d’exclusion. Il ne s’agit donc pas d’élargir la sécurité sociale puisqu’elle serait en partie responsable de cette exclusion. On défend alors couramment que la sécurité sociale et les services publics sont inefficaces, bureaucratiques et totalement inaptes à s’adresser à ceux qui en auraient « vraiment besoin ». Plus généralement, de nombreux travaux ( « de gauche », comme « de droite » ) vont dénoncer les systèmes de protection comme des institutions de contrôle social moins destinés à émanciper les bénéficiaires qu’à maintenir leur asservissement vis-à-vis du pouvoir d’État.
En quelques années, la sécurité sociale ainsi que les droits institués par l’État social semblent assaillis de toutes parts. En ce sens, si jusqu’à lors le discours dominant avait été celui de la lente intégration des pauvres dans les institutions du salariat, c’est désormais la rupture qui est prônée. Comme le soulignent de manière très pertinente Jacques Fourier et Nicole Questiaux, la majorité des analyses du milieu des années 60 aux années 70 cherchent à démontrer « l’échec du système de protection » sociale et la « déperdition d’énergie au cours du processus de redistribution » et promeuvent une « idée simple » : « assurer à chacun un minimum garanti plus ou moins indépendant de sa participation à la protection5». Il est avant tout question d’établir un plancher pour les exclus de la compétition économique, et non plus de la régulation de la sphère économique elle-même par l’État. À l’idée assurantielle, accusée de maintenir le « quart-monde » et les « marginaux » dans la pauvreté, se substitue par conséquent l’idée, auprès de nombreuses associations, d’un « revenu minimum », d’un « bien-être minimum », ou encore d’un « minimum social ». Ce minimum serait avant tout « humanitaire » ou « citoyen » et non plus conçu comme une forme de solidarité liée au travail.
Cette perspective immédiate est cependant annonciatrice du projet plus ambitieux auquel aspirent nombre d’acteurs en ce début de décennie. En effet, l’idée d’impôt négatif prôné par Milton Friedman, puis celle d’allocation universelle, pour remplacer complètement le système de sécurité sociale, font leur chemin.
L’impôt négatif : ancêtre de l’allocation universelle
Cette focalisation sur l’idée de limiter une politique sociale au minimum vital ouvrira donc rapidement l’espace à la proposition de l’impôt négatif comme alternative aux anciennes politiques sociales. L’idée, popularisée par Milton Friedman en 19626, est relativement simple : elle consiste à ce que l’État offre une allocation à toute personne se trouvant en dessous d’un certain niveau. Il n’est plus question de faire de différence entre ceux qui travaillent ou pas, les « méritants » ou les « non-méritants ». Tout le monde recevrait, en dessous d’un certain seuil de revenus, un complément du gouvernement ( un impôt négatif). L’objectif est donc de faire en sorte que personne ne puisse être en dessous d’un niveau minimal et d’éviter également des pertes de temps administratives. Pour Friedman, cela va évidemment de pair avec la fin des services publics, de la sécurité sociale et de toute forme de « socialisation » des revenus à des fins collectives. Selon ses préceptes, il est préférable de subsidier directement les individus et non de leur offrir des services collectifs inefficaces, injustes et affectant le libre jeu du marché. Son idée va faire écho aux nombreuses tares que l’on attribue à un système dépassé et séduire au-delà des frontières partisanes. En France, c’est principalement Stoléru et Lenoir qui défendront, dans leurs livres respectifs, l’idée d’un tel impôt. Afin de lutter contre la pauvreté, Stoléru prône alors une réforme radicale de la sécurité sociale qu’il compare à une « passoire inefficace » et Lenoir présente l’impôt négatif comme « la meilleure technique » pour œuvrer à « la disparition de la pauvreté7 ».
Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, cette idée fera également partie des revendications de long terme de certaines associations de terrain comme ATD-Quart Monde, défendant qu’à côté des mesures immédiates, « la technique de l’impôt négatif présente plus de cohérence et de garantie que les législations actuelles instituant les droits garantis8 ». Cette attirance vers un système plutôt connoté à droite nous éclaire sur l’ambiguïté des revendications associatives concernant la pauvreté et, plus spécifiquement, de leur rapport à l’État et aux systèmes assurantiels. Ces ambiguïtés ne sont cependant pas limitées au secteur associatif. À titre d’exemple, l’intérêt que portera à ce système un intellectuel comme Michel Foucault, dès la fin des années 70, révèle assez clairement l’humeur anti-institutionnelle d’une nouvelle gauche relativement sceptique quant aux bienfaits de « l’étatisme » 9. En effet, Foucault consacrera à l’impôt négatif un long passage de son cours relatif à la naissance de la biopolitique. Si l’ensemble du cours qu’il donne oscille subtilement, comme le remarque le sociologue José Luis Moreno Pestaña, « entre analyses et évaluations positives10 », le passage sur l’impôt négatif est quant à lui relativement positif. C’est précisément la non-sélectivité dans les critères d’attribution qui plaît particulièrement au philosophe. Ce système semble être à ses yeux une réponse à la gouvernementalité et aux formes de normalisation des conduites qu’imposent les vieilles institutions centralisées et étatistes de la sécurité sociale. Comme il le remarque, « peu importe cette fameuse distinction que la gouvernementalité occidentale a cherché si longtemps à établir entre les bons pauvres et les mauvais pauvres, ceux qui ne travaillent pas volontairement et ceux qui sont sans travail pour des raisons involontaires. Après tout, on s’en moque et on doit se moquer de savoir pourquoi quelqu’un tombe sous le niveau du jeu social ; qu’il soit drogué, qu’il soit chômeur volontaire, on s’en moque éperdument11 ». Comme le note très bien Pestaña, Foucault pense que « le néolibéralisme ne projette pas ses modèles sur l’individu : ils n’ont aucun effet performatif et ne projettent aucune forme de normalité ; ils ne sont qu’un cadre d’intelligibilité pour comprendre le comportement du sujet12 ». L’Homo œconomicus est un agent dont seuls les calculs rationnels intéressent ; ses choix ne sont donc pas jugés d’un point de vue moral, mais simplement compris au travers de son intérêt. Après tout, ce n’est pas à l’État de décider ce que l’agent doit faire de son argent ( santé, éducation, consommation…), c’est à lui seul de décider en dehors de tout jugement normatif. Le nouveau système permettrait alors d’assister la population « flottante » ou excédentaire par rapport au marché du travail « sur un mode en effet très libéral, beaucoup moins bureaucratique, beaucoup moins disciplinariste qu’un système qui serait centré sur le plein emploi et qui mettrait en œuvre des mécanismes comme ceux de la sécurité sociale13 ». Au fond, on évite par ce biais tout ce que Foucault a dénoncé durant des années au fil de ses travaux, toutes ces formes de contrôle des corps, des conduites, de la sexualité qui étaient présentes — souvent de façon occulte — dans de nombreuses politiques sociales de réduction des inégalités.
La popularité d’un tel système ne sera cependant pas uniquement théorique et mènera aux premières expériences d’envergure des effets d’une telle réforme. C’est tout d’abord aux États-Unis que son instauration est sérieusement considérée. Si elle est évoquée dès le milieu des années 60 au sein du gouvernement Johnson, c’est surtout sous la présidence de Richard Nixon qu’elle est envisagée. Son plan d’aide aux familles, conçu comme un impôt négatif, n’a cependant pas dépassé le stade d’expériences menées notamment au New Jersey. En France, Giscard cherchera à l’instaurer dès son élection à la présidence en 1974 et, au Canada, une expérience d’impôt négatif ( Mincome14) est menée entre 1975 et 1979. Dans nombre de pays européens, l’impôt négatif fait son apparition dans les programmes politiques des partis de droite qui arrivent au pouvoir entre le milieu des années 70 et le début des années 80.
L’allocation universelle : le collectif Fourrier
Ces idées vont rapidement faire leur chemin auprès d’importants intellectuels marqués à gauche mais voyant l’État avec suspicion. Cette nouvelle gauche, fortement influencée par Mai 68 et par l’autogestion, cherche à casser avec une gauche trop centralisatrice, cherchant à conquérir le pouvoir d’État et parfois qualifiée de « jacobine ». À leurs yeux, l’idée de l’impôt négatif pourrait être une source d’émancipation et de progrès social si elle est conçue de manière adéquate. Elle pourrait servir de point d’accrochage pour une gauche libertaire, être une voie « capitaliste vers le communisme » selon les termes de Philippe Van Parijs15 lui-même. En s’émancipant des vieilles institutions du salariat ainsi que de la centralité du travail qu’elles imposent, il serait désormais possible, par l’instauration du revenu de base, de transformer profondément la logique économique capitaliste. Politiquement, l’idée émerge dès 1977 aux Pays-Bas et dès le début des années 80 dans de nombreux pays européens tels que l’Allemagne, la Belgique ou le Royaume-Uni.
Cependant, la première formulation précise et chiffrée de cette proposition remonte ( à notre connaissance ) à 1984, où, en Belgique, le philosophe Philippe Van Parijs, le sociologue Paul-Marie Boulanger et l’économiste Philippe Defeyt ( tous proches du mouvement écologiste et du « pilier » catholique belge), remportent avec le collectif Fourier le prix de la Fondation Roi Baudouin16 pour leur proposition de remplacer la sécurité sociale par un système d’allocation universelle. Si le projet du collectif ne se revendique pas des idées néolibérales en vogue à ce moment, il commence cependant par ces lignes pour le moins étonnantes :
Supprimez les indemnités de chômage, les pensions légales, le minimex17, les allocations familiales, les abattements et crédits d’impôt pour personnes à charge, les bourses d’études […], l’aide de l’État aux entreprises en difficulté. Mais versez chaque mois à chaque citoyen une somme suffisante pour couvrir les besoins fondamentaux d’un individu vivant seul. Versez-la lui qu’il travaille ou qu’il ne travaille pas, qu’il soit pauvre ou qu’il soit riche, qu’il habite seul, avec sa famille, en concubinage ou en communauté, qu’il ait ou non travaillé dans le passé. […] Et financez l’ensemble par un impôt progressif sur les autres revenus de chaque individu.
Parallèlement, dérégulez le marché du travail. Abolissez toute législation imposant un salaire minimum ou une durée maximum de travail. Éliminez tous les obstacles administratifs au travail à temps partiel. Abaissez l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Supprimez l’obligation de prendre sa retraite à un âge déterminé.
Faites tout cela. Et puis observez ce qui se passe18.
Aux yeux des concepteurs, « ce qui se passera » est relativement clair : le chômage sera « aboli », la pauvreté « vaincue ». Mieux. C’en serait fini des institutions bureaucratiques et de leurs tracasseries administratives qui n’en finissent pas, l’économie serait enfin émancipée des contraintes de l’État — ils réclament une « réduction radicale des activités de l’État » — et, plus spécifiquement, du droit du travail. L’allocation permettrait en outre de rendre le travail « facultatif », de délivrer les femmes des rapports de domination domestiques ainsi que de « décimer » les tâches ingrates que les allocataires sociaux étaient obligés d’accepter sous peine de perdre leur allocation. En maximisant le marché ( par la destruction effective de toutes les régulations qui l’entravent ) tout en garantissant ce revenu de base, on pourrait bénéficier à la fois des vertus du marché et du socialisme. Le revenu de base serait, en somme, la synthèse des utopies libérale et socialiste.
Cette ambiguïté d’une politique se présentant de gauche mais qui sera pourtant qualifiée de « libérale » reflète en réalité les paradigmes intellectuels dans lesquels Philippe Van Parijs navigue durant cette période. Le philosophe, très attiré par les théories libertariennes, n’hésite pas à y voir une sorte d’alternative à l’opposition traditionnelle entre gauche et droite. À ses yeux, l’allocation universelle est « un projet radical qui crève l’axe gauche/droite », un projet qui échappe « à la polarité coutumière entre la droite favorable à plus de marché et la gauche favorable à plus d’État. Car en décrétant le droit à un revenu propre indépendamment de toute prestation pour le marché ou pour l’État, il promeut systématiquement le développement d’une troisième sphère économique, celle des activités “ autonomes ”19. » Selon le philosophe, il permet de sortir d’une gauche de « l’étatisation20 », et d’affronter sérieusement la critique néolibérale des impasses du socialisme d’une manière nouvelle.
Pour Friedman, cela va de pair avec la fin des services publics, de la sécurité sociale et de toute forme de « socialisation » des revenus à des fins collectives
Ainsi, des mouvements concomitants surgissant des deux côtés du spectre politique, sont en faveur d’une liquidation pure et simple de la sécurité sociale et des régulations du marché du travail au profit d’une lutte contre la pauvreté articulée autour d’un système de revenu universel. Ceci montre à quel point le début des années 80 allait bouleverser les configurations passées ainsi que la manière de concevoir les politiques sociales.
Le triomphe de l’idéologie néolibérale
La popularité croissante de l’allocation universelle au tournant des années 80 va donc accompagner, voire accélérer, le consensus naissant autour des idées néolibérales. Ainsi, la conception même de la justice sociale qu’incarne l’idée du revenu de base est en tout point opposée à l’esprit du socialisme d’après-guerre. Loin de mettre les variables macro-économiques au centre de sa politique, c’est l’individu qui revient au cœur du projet politique qu’elle porte. En effet, en versant à chaque individu un revenu de base, ce n’est plus l’idée d’une gestion collective d’un revenu socialisé qui domine, mais son appropriation privée. Ce qui est défendu désormais, c’est le libre choix de chacun de faire ce qu’il entend avec cette somme au détriment de son usage social. Ce qu’on valorise, c’est non plus le retrait collectif des individus du jeu du marché, mais, au contraire, leur chance d’y participer. L’accès aux biens sociaux n’est plus garanti socialement, mais au travers de la participation de tous au marché.
Ce qu’on valorise, c’est non plus le retrait collectif des individus du jeu du marché, mais, au contraire, leur chance d’y participer
Par ce biais, c’est l’idée même d’une lutte contre les inégalités qui est abandonnée. En ce sens, il est intéressant de remarquer que Lionel Stoléru, dans le même esprit que Milton Friedman, avançait un argument philosophique de fond, faisant une différence entre une politique qui cherche l’égalité ( socialisme ) et une politique qui veut simplement supprimer la pauvreté sans remettre en cause les écarts ( libéralisme). Pour lui, « les doctrines […] peuvent inciter à retenir soit une politique visant à supprimer la pauvreté, soit une politique cherchant à plafonner l’écart entre riches et pauvres21 ». C’est ce qu’il nomme la « frontière entre pauvreté absolue et pauvreté relative22 ». La première renvoie simplement à un niveau déterminé arbitrairement ( auquel l’impôt négatif ou l’allocation universelle s’adresse ) et l’autre aux écarts généraux entre les individus ( auxquels s’adressent la sécurité sociale et l’État social). Aux yeux de Stoléru « l’économie de marché est capable d’assimiler des actions de lutte contre la pauvreté absolue », mais « elle est incapable de digérer des remèdes trop forts contre la pauvreté relative23 ». Voilà pourquoi, argumente-t-il, « je crois que la distinction entre pauvreté absolue et pauvreté relative est en fait la distinction entre capitalisme et socialisme…24 » Mais le remplacement de l’égalité par la lutte contre la pauvreté renvoie également au changement du principe de justice sous-jacent. C’est en effet par cette opération idéologique fondamentale que s’affirme une notion de justice sociale articulée autour de l’égalité des chances. Si l’égalité visait à réduire les écarts de revenus, l’égalité des chances, elle, ne porte que sur la manière dont sont distribuées les inégalités. Elle veille à ce que celles-ci ne soient pas le produit d’injustices ayant compromis une concurrence libre et non faussée. Ainsi, l’exclusion, le racisme ou le sexisme faussent le jeu économique en favorisant, dès le départ, certains individus plutôt que d’autres. L’objectif de l’égalité des chances ne vise dès lors pas à abolir la compétition ( en établissant l’égalité réelle), mais à garantir que la compétition soit équitable, que nous soyons tous sur la même ligne de départ. En offrant un revenu de base, il serait par conséquent possible de pallier les discriminations et de rétablir l’équilibre du jeu économique. Cependant, une société à parfaite égalité des chances ne serait pas nécessairement moins inégale que celle dans laquelle nous vivons. Elle serait probablement plus « diverse » et moins marquée par le poids de nos origines sociales. Nous aurions donc, au départ, tous la même opportunité de devenir riches, mais il n’en reste pas moins que seul un certain nombre d’entre nous le deviendrait. L’égalité des chances vise donc à produire une société méritocratique et non égalitaire. Si elle est plus enviable qu’une société traversée de discriminations, elle n’est pas pour autant moins injuste. Les seules injustices vues comme illégitimes sont désormais celles qui se présentent comme des entorses au libre jeu du marché ( exclusion, discrimination… ) et non pas l’inégalité en tant que telle.
Par conséquent, c’est la notion même de droit social qui est remise en question. Pour Friedman, par exemple, il était préférable de verser une somme déterminée à chaque individu afin qu’il décide individuellement s’il préfère consommer plus de santé ou partir en vacances. L’entreprise néolibérale s’est dès lors dans une certaine mesure construite contre l’attribution d’un statut spécifique aux biens tels que la santé ou l’éducation. Ils ne sont pas un « droit » quantifiable objectivement et devraient être soumis aux règles du marché tout en maximisant les chances de chacun de pouvoir les « consommer ». Si les partisans de l’allocation universelle n’ont jamais défendu une telle version de leur proposition ( ils ne disent en général rien des services publics et peu de ce qu’il adviendrait du reste des systèmes de protection tels que de la santé), il n’en reste pas moins que c’est bien cette dynamique qui est favorisée. Par ailleurs, l’attribution d’une allocation universelle « généreuse » — autrement dit permettant de faire le « choix » de ne pas travailler — est inconcevable financièrement sans, de fait, une forte réduction des autres dépenses sociales « collectives ». L’instauration d’une allocation universelle pourrait constituer alors une privatisation massive de ressources autrefois collectives afin d’étendre la sphère du marché au lieu de la restreindre. Elle opère donc contre la tendance qui s’est constituée historiquement à la fin du 19e siècle visant à se servir de l’État contre le marché. En effet, le système d’imposition qu’impose l’allocation universelle n’est pas réellement « moins d’État », mais un État qui étend la sphère du marché.
La mondialisation d’une idée conservatrice
Ce déplacement aura d’importants effets sur l’évolution des politiques de développement. Dans le tiers monde, là où l’on a le plus expérimenté des versions circonscrites de cette allocation, le constat est particulièrement interpellant. Au tournant des années 90, les principales organisations internationales ( FMI, PNUD, ONU… ) substitueront progressivement à un discours axé sur l’accès aux droits celui de la lutte contre la pauvreté. Durant cette décennie, le thème de la pauvreté devient l’enjeu central et l’allocation universelle une réponse en vogue. Ce changement est à situer dans le contexte de la fin de la guerre froide, à un moment où il s’agirait de faire « table rase » des « dogmes du passé » notamment en ce qui concerne le rôle de l’État et la redistribution des revenus dans les politiques de développement. De ce point de vue, comme le notera Francine Mestrum, « aussi paradoxal que cela puisse paraître à première vue, la lutte contre la pauvreté constitue un recul par rapport a la protection sociale existante connue dans le monde occidental et plus ou moins embryonnaire dans le monde pauvre25 ». À ce titre, il est par ailleurs intéressant de lire les textes des principales organisations internationales à ce sujet. On peut ainsi lire dans les rapports du PNUD que si « la réduction de la pauvreté tend encore à être identifiée avec la sécurité sociale ou la protection sociale », cela part « peut-être de bons sentiments », mais est en réalité « inefficace26 ». Aux yeux de l’organisation du développement, « la sécurité sociale ne représente peut-être pas le meilleur emploi qu’un pays en développement peut faire des ressources dont il dispose27 ». La mise en place de ces politiques a par conséquent accompagné les nombreux plans « d’ajustement structurel » prônés par ces mêmes organisations et réclamant souvent la privatisation de tout service public et de tout système de protection sociale en échange de crédits visant à payer des dettes parfois illégitimes. Ces réformes, maximisant les « lois du marché », créent par conséquent dans ces pays des inégalités renforcées qui sont compensées avec de maigres budgets de lutte contre la pauvreté. C’est ainsi que si la pauvreté absolue ( mesurée au nombre de personnes vivant en dessous de 1,25 dollar par jour ) a, en moyenne, baissé au cours des trente dernières années, les inégalités au sein de chaque pays ont, quand à elles, augmenté. En un sens, cette politique de dérégulation de la sphère économique a été de pair avec celle de la lutte contre la pauvreté. C’est une politique qui donne d’une main ce qu’elle retire dix fois de l’autre.
Il n’est en ce sens pas anodin de voir les plus grandes fortunes mondiales ou les gourous de la Silicon Valley s’engager dans ce combat contre la pauvreté ou pour une forme d’allocation universelle tout en défendant, sans contradiction apparente, les « vertus » du néolibéralisme28. Ces nouvelles stratégies permettent alors de mettre les questions sociales à l’ordre du jour politique sans pour autant devoir lutter contre les inégalités et les mécanismes structurels qui les produisent. Elles veulent faire des pauvres des agents économiques rationnels mais leur refusent toute forme de service public. Cela ne veut évidemment pas dire que pour ces pays, où il n’existe bien souvent plus aucune forme de protection sociale, l’établissement d’un revenu garanti soit une mauvaise chose. Bien souvent, et les chiffres le montrent, cela peut améliorer le quotidien de nombreuses personnes. Cependant, que leur sort se soit amélioré ne signifie pas qu’il aurait été moins souhaitable pour eux d’avoir une santé et une éducation gratuite.
Sortir de l’idéologie néolibérale
Si le système de l’allocation universelle ou de l’impôt négatif n’a jamais vu le jour de manière intégrale, c’est pourtant bien l’esprit de ces propositions qui dominera les politiques sociales européennes des dernières décennies : réduire les dépenses publiques qui visent la collectivité tout en garantissant certains droits résiduels pour les plus démunis. Ces politiques vont dès lors accompagner le lent démantèlement des droits sociaux en offrant de maigres compensations au regard des économies qui seront faites dans les dépenses publiques. Les effets de cette politique sont connus. Les richesses ont considérablement augmenté, mais elles sont de moins en moins bien réparties. C’est ainsi que l’ambition de lutter contre la pauvreté s’est substituée à celle de combattre les inégalités. Or, de l’une à l’autre, bien plus qu’une simple variation lexicale, c’est tout un imaginaire politique qui s’est reconfiguré. Déconnectée de l’inégalité, la pauvreté n’est plus pensée de façon relationnelle comme la conséquence de l’inégale répartition des richesses. Les mesures contre la pauvreté se déploient aujourd’hui en marge des politiques économiques et sociales globales, sans jamais les remettre en cause ni les affecter. Ces mesures prônent l’égalité des chances face au marché et non l’égalité réelle contre le marché. En réalité, seule l’idéologie néolibérale, qui est au cœur de notre imaginaire politique actuel, a permis d’alimenter le fantasme d’une lutte contre la pauvreté sans redistribution des richesses.
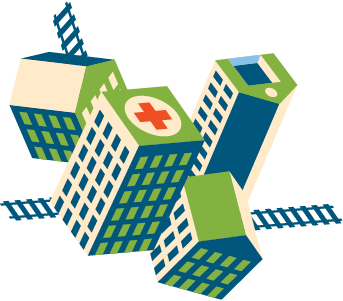 Nous devons par conséquent aujourd’hui renouer avec l’héritage émancipateur de l’après-guerre. Les institutions que le mouvement ouvrier a instaurées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont bien plus que des instruments de « stabilisation » du capitalisme. Certes, ces institutions sont traversées par des contradictions politiques importantes, mais elles constituent également, en germe, les éléments d’une société différente, ou le marché n’aurait plus la place centrale qu’il occupe aujourd’hui. Nous devons donc poursuivre le travail idéologique et politique qui a été entamé avec la naissance de l’État social, radicaliser son héritage, le pousser toujours plus loin et imaginer avec lui, et non pas contre lui, une société réellement égalitaire et démocratique. L’utopie n’est pas uniquement un au-delà, mais, aussi, un déjà là.
Nous devons par conséquent aujourd’hui renouer avec l’héritage émancipateur de l’après-guerre. Les institutions que le mouvement ouvrier a instaurées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont bien plus que des instruments de « stabilisation » du capitalisme. Certes, ces institutions sont traversées par des contradictions politiques importantes, mais elles constituent également, en germe, les éléments d’une société différente, ou le marché n’aurait plus la place centrale qu’il occupe aujourd’hui. Nous devons donc poursuivre le travail idéologique et politique qui a été entamé avec la naissance de l’État social, radicaliser son héritage, le pousser toujours plus loin et imaginer avec lui, et non pas contre lui, une société réellement égalitaire et démocratique. L’utopie n’est pas uniquement un au-delà, mais, aussi, un déjà là.
Footnotes
- Elle est aussi couramment appelée revenu de base, revenu de citoyenneté, revenu d’existence, revenu d’autonomie, crédit social, impôt négatif, LIBER…
- Son montant est variable selon les versions de la proposition.
- Karl Polanyi, The Great Transformation, 1944 ; traduit en français comme La Grande Transformation : Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 1983.
- Lionel Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Flammarion, Paris, 1974.
- Jacques Fournier, Nicole Questiaux, « Encore les pauvres », dans Traité du social, Dalloz, Paris, 1976, p. 650.
- Milton Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1962.
- René Lenoir, Les exclus : Un français sur dix, Seuil, Paris, 1974, p. 136.
- Mouvement ATD-Quart Monde, Livre blanc : Le sous-prolétariat en Belgique, Bruxelles, juin 1977, p. 33.
- Voir à ce propos : Daniel Zamora, Michael C. Behrent, Foucault and Neoliberalism, Polity Press, Cambridge, 2016.
- José Luis Moreno Pestaña, Foucault, la gauche et la politique, Textuel, Paris, 2011, p. 120.
- Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Hautes Études, EHESS, Gallimard/Seuil, Paris, 2004, p. 210.
- Ibidem.
- Ibid., p. 213.
- Sur les résultats du Mincome, voir : Evelyn L. Forget, « The town with no poverty », University of Manitoba, février 2011.
- Une des figures fondatrices de l’allocation universelle depuis les années 1980.
- Le projet recevra, de la part de la Fondation Roi Baudouin, le prix Agora-Travail dans le cadre de son programme Dialogue pour l’avenir. Il sera publié pour la première fois dans le recueil Le travail dans l’avenir, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 1984.
- Le minimex est le revenu minimal destiné aux personnes n’ayant pas accès aux prestations de sécurité sociale. Il est l’équivalent du RMI en France.
- Collectif Charles Fourier, « L’allocation universelle », La Revue nouvelle, no 4, avril 1985, p. 345.
- Philippe Van Parijs, « L’avenir des écologies : deux interprétations », La Revue nouvelle, no 1, janvier 1986, p. 44.
- Philippe Van Parijs, « Relever le défi », La Revue nouvelle, no 1, janvier 1986, p. 332.
- Lionel Stoléru, op. cit., p. 237.
- Ibid., p. 286.
- Ibid., p. 287.
- Ibid., p. 286.
- Francine Mestrum, Mondialisation et pauvreté, L’Harmattan, Paris, 2002, p. 23.
- Vaincre la pauvreté humaine, Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000, New York, PNUD, 2000, p. 42-44.
- PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Paris, Economica, 1991, p. 55.
- Voir notamment : Dylan Matthews, « Why a bunch of Silicon Valley investors are suddenly interested in universal basic income », Vox, 28 janvier 2016.




