- John Bellamy Foster est éditeur de Monthly Review et enseigne la sociologie à l’université de l’Oregon. Il est l’auteur de The Endless Crisis : How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China (avec Robert Mc. Chesney) et de The Great Financial Crisis : Causes and Consequences (avec Fred Magdoff). Foster est en outre mondialement connu pour son travail sur l’environnement avec entre autres The Ecological Rift : Capitalism’s War on the Earth (avec Brett Clark et Richard York), Ecology Against Capitalism et Marx’s Ecology : Materialism and Nature.
Monopolisation, stagnation, militarisation, financiarisation et mondialisation forment le quintette du capitalisme monopoliste financier.
« Commençons par le commencement. L’idéologie et la politique défendue depuis la Maison-Blanche de Trump sont néofascistes. » Telle était la réaction de John Bellamy Foster à l’élection de Trump. Cependant, comme le précise Foster, « si Trump est pour le néofascisme, le reste de l’appareil d’État, le Congrès, la justice, les services de sécurité, les gouvernements locaux et, par extension, les médias et l’enseignement ne le sont pas (encore). »

« Nous assistons pour l’instant à un combat dans l’État. Cette période est ce que les nazis appelaient la Gleichschaltung1. Steve Bannon parle de “déconstruction de l’administration de l’État”. » Le ton est donné, le contexte est en place.
Ce qui est intéressant chez Foster, c’est que Trump ou pas Trump, il parvient, grâce à ses théories sur le capital financier monopoliste, à éclairer la situation du point de vue de l’économie politique.
Ruben Ramboer : Qui soutient Trump, en cette période de Gleichschaltung ?
John Bellamy Foster : Trump a d’abord le plein soutien de Wall Street : entre l’élection et fin février, les actions ont connu jusqu’à 13 % de hausse. Son principal soutien provient de l’industrie des carburants fossiles, du complexe financier et de l’industrie militaire. Il a toujours eu le soutien de secteurs importants de la « classe des milliardaires », alors que d’autres secteurs soutenaient encore Clinton. Aujourd’hui, il est la coqueluche du 1 % parce qu’il promet de supprimer au moins 75 % de toute la réglementation des entreprises. Enfin, 88 % des électeurs républicains approuveraient ses mesures.
« Putting America first again », en revenir à l’Amérique d’abord. En Europe, le slogan de Trump signifie d’abord protectionnisme : augmentation des tarifs à l’importation, enterrement de l’accord de partenariat transpacifique et retour de l’industrie manufacturière aux États-Unis. Angela Merkel a dit aussi qu’avec Trump, il n’y aurait pas de TTIP. Allons-nous vers une rupture avec la période d’après-guerre, où les États-Unis avaient su imposer leur hégémonie mondiale grâce au libre-échange ?
« America first », d’abord l’Amérique, c’est du nationalisme économique et militaire. Sur le plan du commerce, Trump va louvoyer entre protectionnisme et libre-échange, selon ce qui lui convient. Il pense avoir plus de poids avec des accords bilatéraux qu’avec des accords multilatéraux. La stratégie de Trump n’est pas tellement dirigée contre l’Europe, elle vise en premier lieu à faire dérailler économiquement la Chine. Afin de la mettre sous pression, il y aura certainement des tentatives d’attirer dans une alliance les autres parties de la triade — l’Europe et le Japon.
En ce qui concerne la politique commerciale, comme dans les autres domaines, Trump a en face de lui le Congrès. Plus encore que les démocrates, les républicains traditionnels s’opposent au protectionnisme, qu’ils accepteraient cependant s’il devait leur procurer des avantages. En vérité, si les États-Unis s’éloignent du libre-échange, c’est justement parce que leur hégémonie sur l’économie mondiale s’érode, comme on l’a vu dans les phases ultimes du déclin de l’hégémonie britannique.
Ce qui joue à l’avantage de Trump, c’est que les entreprises américaines sont très méfiantes à l’égard de la Chine. Forbes écrivait en 2016 que la Chine allait éclipser l’économie américaine en 2018. Je ne connais pas leurs calculs, mais le fait que le patronat s’en inquiète et perçoive comme une menace ce changement d’hégémonie est en soi significatif. Pour les États-Unis, habitués à dominer le monde, cela constituera vraiment un important changement. D’année en année, depuis 2000, la part des États-Unis dans l’économie mondiale ne cesse en effet de diminuer.
Trump veut accroître les dépenses militaires de 54 milliards de dollars : une hausse de 10 % du budget de la défense. Lui-même dit qu’il s’agit d’un des « plus importants développements militaires de l’histoire des États-Unis ». N’oubliez pas que Hitler fut le premier « keynésien militaire », comme l’ont montré les économistes Michael Kalecki et Joan Robinson. Hitler a prouvé que, jusqu’à un certain point, il était possible de stimuler une économie en dépensant dans l’armement. Il y a déjà eu à plusieurs reprises dans le passé un accroissement des dépenses militaires des États-Unis et cela est depuis lors profondément enraciné dans le système américain. Mais Trump va bien plus loin encore. Il se targue déjà de pouvoir pousser l’Allemagne et les autres pays de l’OTAN à accroître leurs dépenses militaires en assumant leur juste part au sein de cette même OTAN.
En parlant de politique keynésienne, que pensez-vous de son annonce de vouloir investir mille milliards de dollars dans les infrastructures ?
The Financial Times a qualifié cette proposition de leurre. Trump n’a pas vraiment l’intention d’accroître significativement les dépenses de l’État dans les infrastructures. Pour dire cela, on s’appuie sur une analyse douteuse du secrétaire au Commerce Wilbur Ross. Celui-ci prétend que l’octroi de 137 milliards de dollars d’allégements fiscaux aux entreprises de construction va leur procurer le levier financier nécessaire pour accroître les dépenses d’infrastructure de mille milliards de dollars en dix ans. La plupart des économistes considèrent cela comme une opération blanche, consistant à donner du capital au capital de sorte que les entreprises puissent enregistrer des bénéfices supérieurs sur des dépenses qu’elles feraient de toute manière. On est très loin ici de dépenses de l’État en infrastructures et cela ne fera qu’accroître encore les contradictions de la suraccumulation.
L’accroissement des dépenses militaires est la seule chose qui reste à Trump, parce que le Congrès républicain ne lui permettra pas d’autres dépenses. Les 54 milliards de dollars d’augmentation du budget de la défense semblent un montant élevé, mais c’est en réalité une petite somme pour stimuler une économie de 1 800 milliards de dollars. Et, exactement comme en Europe, cette économie est dans une impasse, avec une croissance de 1,6 % seulement en 2016. Pour vous donner une idée, en crise pendant les années 30, l’économie a connu une croissance moyenne de 1,3 %. Larry Summers, secrétaire au Trésor sous Bill Clinton et conseiller économique sous Barack Obama, estimait qu’il y avait une chance sur trois pour qu’une récession survienne d’ici un an aux États-Unis et une chance sur deux d’ici deux ans. Quand nous savons que Trump compte financer ses dépenses militaires par des économies sur d’autres dépenses de l’État, l’effet de stimulus va s’avérer finalement très limité.
En fait, Trump n’espère pas tant stimuler l’économie par des dépenses, mais par moins d’impôts sur les sociétés et moins de régulation dans les entreprises. Or, l’argent qui sera libéré affluera davantage vers le secteur financier qu’il ne se traduira par de nouveaux investissements. Les entreprises sont déjà assises sur une montagne de cash de plusieurs milliers de milliards de dollars qu’elles n’investissent pourtant pas. Pour Trump, la dérégulation est la clé d’investissements meilleur marché et plus lucratifs. Cela ne résout en rien le problème de la saturation des marchés et de la capacité de production non utilisée qui sapent précisément les investissements et cela aura comme conséquence un accroissement de la financiarisation et de la stagnation.
Stagnation et financiarisation : les concepts centraux de la théorie économique du capital monopoliste. Dans la tradition des économistes Paul Baran et Paul Sweezy, vous pensez que la stagnation est l’état normal de l’économie actuelle. Vous appelez cela la « crise sans fin ». C’est l’opposé de l’idée spontanée que les crises constituent plutôt l’exception.
Le terme « stagnation » n’est pas neuf. L’économiste polonais Kalecki parlait déjà dans les années 30 des tendances à la stagnation en raison de monopoles de plus en plus grands. Plus tôt encore, l’économiste radical Thorstein Veblen et des marxistes comme Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg et V. I. Lénine avaient développé les premières théories du capitalisme monopoliste. Paul Baran et Paul Sweezy avaient synthétisé une bonne partie de toutes ces idées et il en avait résulté en 1966 le classique Le Capitalisme monopoliste2, une théorie sur la façon dont l’accumulation capitaliste a été modifiée par le développement de méga-entreprises. Récemment, Larry Summers a remis ce terme à la mode. Pour The Financial Times, il a écrit en 2013 l’article « Why stagnation might prove to be the new normal », qui a eu un grand retentissement. La redécouverte de la stagnation est certainement bienvenue, mais les économistes traditionnels n’en saisissent pas l’essence. Ils ne perçoivent pas le problème comme une tendance propre au système.
Selon la théorie du capital monopoliste, les marchés ne se comportent absolument pas librement. En lieu et place de la concurrence entre de nombreuses entreprises qui ne s’influencent pas mutuellement, il y a une rivalité entre des méga-entreprises qui sont très au courant de leurs faits et gestes mutuels. Elles sont bien plus rentables que toute autre entreprise en raison de leur puissance de monopole et, par-dessus tout, parce qu’elles évitent de se livrer mutuellement une guerre des prix. Aucune d’elles n’a quoi que ce soit à y gagner. Marx avait déjà insisté sur la concentration et la centralisation du capital, mais il ne percevait pas encore cela comme une phase nouvelle du développement économique. Sa critique de l’économie politique reste le point de départ nécessaire de toutes les analyses du capitalisme, mais, du fait qu’au cours du 20e siècle une poignée d’entreprises s’est mise à contrôler des secteurs industriels entiers, on se trouve devant une tout autre situation.
Et pourquoi cela mène-t-il à la stagnation ?
Il y a un seul point sur lequel tous les économistes sont d’accord : l’absence d’investissements conduit au marasme économique et à la crise. Pour le reste, leurs avis divergent sur à peu près tout. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des investissements dans la reconstruction de l’Europe, dans le secteur automobile et dans le secteur militaire du fait de la guerre froide et des grandes guerres régionales en Asie. Puis, tout cela s’est complètement épuisé. Depuis les années 50, la croissance économique moyenne baisse : elle est passée de 4 % dans les années 50 et 60, à 3 % environ durant la période 1970-1990 et à moins de 3 % au cours des deux dernières décennies.
Les conséquences de la disparition de la guerre des prix vont très loin. L’excédent économique croissant atterrit dans un nombre de plus en plus restreint de méga-entreprises. Dans un capitalisme plus compétitif en revanche, les bénéfices sont quelque peu répartis dans la société, en raison de la baisse des prix. Confronté à une demande en baisse, le monopoliste, lui, ne procédera pas à une baisse des prix, mais bien à une réduction de l’utilisation des capacités. On a donc encore une capacité de production excédentaire. Il faut être fou pour investir dans de nouvelles usines quand 30 % des usines sont à l’arrêt. Le secteur automobile, par exemple, peut produire 94 millions de voitures, soit 34 millions de plus que ce qu’il vend, ce qui correspond à la production de quelque cent usines.
Sous le capitalisme monopoliste, les taux de profit sont plus importants, l’exploitation plus intense et la capacité de production excédentaire plus grande que dans le capitalisme compétitif. Il n’existe pas de possibilités de rentabilité suffisante pour absorber dans des investissements productifs l’énorme surplus de capital. Bref, plus une économie est monopoliste, plus forte est la tendance à la stagnation.
La question de l’accumulation, de la croissance et de la crise est ainsi mise sens dessus dessous. Plutôt que de considérer le ralentissement de la croissance ou la stagnation comme des anomalies dues à des facteurs extérieurs, le défi consiste dès lors à expliquer que c’est une croissance plus rapide qui est une anomalie due à un certain nombre de stimulants.
Comment stimule-t-on une économie stagnante ? Qu’advient-il alors de l’excédent économique des méga-entreprises ?
La consommation capitaliste et les investissements ne sont pas les deux seules issues pour l’absorption de l’excédent économique : celui-ci peut également être « gaspillé ». Cette idée de Baran et Sweezy est cruciale. Le « gaspillage » est un concept central dans l’étude du capital monopoliste et il couvre bien des dépenses : efforts de vente (publicité, marketing, emballage, obsolescence planifiée, changement de modèle, noms de marque, surveillance fouillée des comportements sur Internet, récolte des données, etc.), guerre, impérialisme, dépenses militaires et non militaires de l’État. Le gaspillage peut créer un peu de croissance et d’emploi, et susciter l’impression que l’économie tourne. Mais le stimulus s’avère en fin de compte largement insuffisant pour empêcher la stagnation.
Trump va louvoyer entre protectionnisme et libre marché, selon ce qui lui convient.
Le gaspillage ultime, c’est la spéculation. Dès les années 80, nous avons assisté à un véritable tournant de l’économie de la production vers les finances spéculatives en tant que principale impulsion à la croissance. Les booms économiques des années 80 et 90 proviennent de la croissance rapide de la spéculation financière à l’aide de l’augmentation de l’endettement, surtout dans le secteur privé. Mais alors qu’auparavant, on estimait que l’expansion financière allait de pair avec la prospérité dans l’économie réelle, ce n’est désormais plus le cas : l’expansion financière ne nourrit plus une économie réelle, mais une économie en stagnation.
Compte tenu de l’essor important de cette financiarisation, je ne parle plus de capital monopoliste, mais de capital financier monopoliste. Les aspects intrinsèquement liés de la monopolisation, de la stagnation, de la financiarisation et de la mondialisation nous ont amenés dans une nouvelle phase historique, le capital financier monopoliste, qui est l’institutionnalisation de la stagnation et du gaspillage. Un manque de créneaux d’investissements rentables, combiné à un gaspillage énorme, cela semble peut-être paradoxal. Mais ce n’est pas la théorie qui est paradoxale, c’est son objet : le capitalisme.
Huit ans après la chute de Lehman Brothers, règne toujours l’idée que le capitalisme de casino, avec ses bulles spéculatives, est à la base de la crise économique. Mais vous tordez le cou à cette idée. Selon vous, le capital monopoliste ne peut exister sans financiarisation et crédits et c’est précisément grâce à la stagnation que le secteur financier, le secteur FIRE, pour Finance, Insurance et Real Estate ou finance, assurance, immobilier, a pu prendre un tel essor.
 Ce qui, en surface, semble un problème de spéculation est en réalité un problème de stagnation dans le centre de l’économie mondiale. Le capital excédentaire des entreprises et des riches, l’excédent économique ne trouve plus d’investissements rentables dans l’économie réelle et s’écoule vers le secteur financier en gonflant le secteur FIRE. Celui-ci répond de façon habile en fournissant toute une gamme exotique d’instruments complexes : contrats à terme, options, dérivés, swaps, hedge funds, subprimes, titrisation, etc.
Ce qui, en surface, semble un problème de spéculation est en réalité un problème de stagnation dans le centre de l’économie mondiale. Le capital excédentaire des entreprises et des riches, l’excédent économique ne trouve plus d’investissements rentables dans l’économie réelle et s’écoule vers le secteur financier en gonflant le secteur FIRE. Celui-ci répond de façon habile en fournissant toute une gamme exotique d’instruments complexes : contrats à terme, options, dérivés, swaps, hedge funds, subprimes, titrisation, etc.
L’économie réelle stagne donc alors que l’économie financière atteint des sommets : comme la spéculation est stimulée, les cours grimpent et le capitaliste devient de plus en plus riche. Mais le plus grand stimulant de l’économie financière, c’est le fait que sont dirigés vers les marchés financiers tous les flux monétaires de la vie courante — hypothèques, habillement, enseignement public, assurances. Des montages sont systématiquement élaborés pour tout transformer en finance. Des montants de plus en plus importants sont conditionnés sous forme de produits financiers de plus en plus nombreux qui constituent la base d’un boom spéculatif.
Le résultat de tout cela a été la création de montagnes de dettes, parallèlement à la croissance extraordinaire des bénéfices financiers. On y est allé vraiment fort : les dettes privés (ménages et entreprises) sont passés de 110 % du produit intérieur brut des États-Unis en 1970 à 293 % en 2007. Les bénéfices financiers ont crû de plus de 300 % entre 1995 et 2007. Des dettes de tous types ont dopé l’économie : hypothèques, prêts pour l’achat d’une voiture, cartes de crédit, prêts pour les études. Les dettes sont passées de 150 % du produit intérieur brut en 1980 à 350 % juste avant la crise de 2008.
Cette croissance financière a toutefois eu des effets sur l’économie réelle et a contré les tendances à la stagnation…
Oui, effectivement. Des études montrent que la consommation de luxe a augmenté de 7 % avec la hausse des cours des actions. Grâce aux valorisations des placements et de l’immobilier qui grimpaient à vue d’œil, les plus riches ont acheté une deuxième maison. La financiarisation a également créé des emplois supplémentaires. Mais proportionnellement au chiffre d’affaires, le secteur financier embauche beaucoup moins de monde que d’autres secteurs. Et les dettes qui ont financé la consommation ont engendré une dépendance croissante de toute l’économie à une bulle, puis à une autre bulle et ainsi de suite.
Quand on est à la barre d’une telle économie de la bulle, on met tout en œuvre pour ne pas la voir éclater. On cherche donc des manières de la gonfler plus encore : déréguler et diriger de nouveaux flux d’argent vers les marchés financiers en leur permettant l’accès à de nouveaux secteurs. La seule stratégie de survie envisageable dans cette économie consiste à relancer perpétuellement le processus de spéculation. Même Larry Summers a facilement admis qu’une économie caractérisée mondialement par la stagnation avait tendance à créer de nouvelles bulles. L’économie alterne une nette stagnation avec de brèves périodes de maigre croissance dues à l’exubérance financière.
Selon vous, il est faux de croire que c’est le néolibéralisme ou l’idéologie du libre marché poussée à son paroxysme qui sont la source des problèmes actuels. Vous écrivez : « La victoire de l’économie néolibérale n’a pas été le résultat d’arguments convaincants ou de recherche en astrophysique. Nous la voyons plutôt comme le pendant politico-économique de l’apparition du capital financier monopoliste. »
À Monthly Review, nous évitons l’utilisation du concept de néolibéralisme. C’est une étiquette que l’on colle souvent sur l’économie actuelle, mais le néolibéralisme n’est pas un système. C’est la stratégie politique utilisée par le capital financier monopoliste pour diriger tous les flux d’argent vers la spéculation. Les écoles publiques deviennent des écoles privées, avec peut-être encore plus de moyens publics, mais elles sont gérées comme des entreprises privées. L’enseignement devient un business comme un autre, avec des écoles et des universités qui investissent en bourse. Des systèmes de pension privés transforment les caisses publiques des pensions en fonds destinés à la spéculation. Tout cela fait partie de la stratégie qui consiste à tout transformer en croissance financière. Et ainsi, impitoyablement, la politique néolibérale procède à une marchandisation de toute la société.
Où situez-vous l’industrie manufacturière dans votre discours sur le capital financier monopoliste ? Devons-nous encore faire une distinction entre un capitaliste financier et un capitaliste industriel ? L’un parie et spécule, l’autre investit et crée des emplois ?
C’est le discours de Paul Krugman et consorts. Ils souhaitent une sorte de keynésianisme conservateur old-school. Leur message central est celui-ci : il faut réguler et retourner à un capitalisme industriel. Or, si c’était peut-être encore faisable au milieu du 20e siècle, cela ne l’est plus aujourd’hui. Tout le système de financiarisation est allé bien trop loin. Le capital industriel est d’ailleurs mêlé au secteur financier. La General Motors, par exemple, a un bras financier complètement orienté sur les investissements et la spéculation avec les fonds de pension de son personnel.
Quand on est à la barre d’une telle économie de la bulle, on met tout en œuvre pour ne pas la voir éclater.
L’accumulation de capital au sens traditionnel du terme n’est plus la pratique habituelle, c’est l’augmentation de capital sur les marchés financiers qui est aujourd’hui centrale. De ce fait, régulation et keynésianisme sont devenus impossibles. Évidemment, un milliardaire aime une économie réelle florissante, mais, ce qui le préoccupe par-dessus tout, c’est de garder sa fortune intacte. L’inflation effraie énormément le capital. Elle menace naturellement la valeur des fortunes. En évitant une guerre des prix, le capital financier monopoliste obtient une tendance inflationniste intrinsèque. On peut le vérifier historiquement. Au 19e siècle, le niveau général des prix aux États-Unis baisse continuellement, sauf au cours des années de la guerre de Sécession. Durant la totalité du 20e siècle, le niveau des prix monte, sauf dans les années de la grande dépression.
Ainsi, la financiarisation et la maîtrise de l’inflation deviennent l’enjeu de toute la politique économique. Ce sont les banques new-yorkaises qui contrôlent la FED, la banque centrale des États-Unis. C’est le capital financier qui tient désormais les rênes et le principal foyer du pouvoir économique ne se situe plus dans les conseils d’administration d’une centaine de multinationales, mais s’est réellement déplacé vers les marchés financiers. Depuis les années 70, la financiarisation est la stratégie : injecter de l’argent dans le système pour le maintenir en fonctionnement. Investir dans l’économie réelle et réguler ne sont pas des options.
Pourtant, après le déclenchement de la crise, bien des voix se sont fait entendre pour réguler plus sévèrement le secteur financier. Dirigeants politiques et dirigeants des banques centrales ne parlaient que de transparence, de régulation, de contrôle et de moralisation du capitalisme. Ils promettaient d’agir contre les agences de notation, contre les paradis fiscaux, contre les bonus et contre les fonds de spéculation…
Il n’y a rien eu de tout cela. C’était un vœu pieux. Après chaque régulation suit une nouvelle dérégulation, puisque la régulation empêche la spéculation. Lorsqu’une bulle se développe, le gouvernement en place veut éviter qu’elle éclate. Aucun gouvernement capitaliste ne répondra négativement à la demande de dérégulation du secteur financier en cas de menace d’effondrement. Trump, par exemple, a déjà annoncé qu’il allait déréguler. La bulle doit se remettre à croître au profit du capital. Il est tout à fait possible qu’elle aboutisse à une nouvelle crise, plus grave encore, mais ce sont des soucis pour plus tard. Depuis que la financiarisation a débuté dans les années 70, l’économie mondiale a été ravagée par une quinzaine de crises financières, souvent qualifiées par euphémisme de « pénurie de crédit ». Ces crises croissent en échelle et en impact3.
On a ainsi décrit dans les grandes lignes le monde où évoluent les banquiers, les courtiers, les traders, les grands actionnaires, les présidents-directeurs généraux. Qu’en est-il des conséquences du capitalisme monopoliste financier pour les travailleurs, les retraités et les éléments les plus faibles de la société ?
Selon la théorie du libre marché, lorsqu’il y a guerre des prix et que la productivité augmente, les prix baissent en raison de la concurrence et une partie de la richesse retourne à la population sous forme d’augmentation de pouvoir d’achat. Mais les monopolistes résistent aux baisses de prix afin que tous les gains de productivité aillent vers eux. La croissance de la productivité aux États-Unis a été de 2,2 % entre 2000 et 2007, mais le salaire horaire médian a baissé de 0,1 %. En 1970, les salaires représentaient encore 53 % du produit intérieur brut contre 46 % en 2005. L’effort de vente du capital financier monopoliste a également des conséquences négatives. Les coûts de modification des modèles, du design des emballages et de la publicité sont bien sûr facturés au client. En fait, c’est un excédent gaspillé que les travailleurs doivent payer alors que la valeur d’usage reste la même.
Le travail est mondialement confronté à la politique du « diviser pour régner » du capital financier monopoliste. Les multinationales font appel pour cela à des sous-traitants qui hésitent rarement à recourir à la forme la plus brutale d’exploitation, sans la moindre régulation. La plupart des obstacles au libre-échange — qui n’est rien d’autre que la mobilité du capital — ont été éliminés, alors que la mobilité du travail se limite généralement à l’État-nation ou est endiguée par d’autres facteurs comme la langue, la culture ou les lois sur l’immigration. L’utilisation à la baisse de la capacité de production, caractéristique du capitalisme monopoliste, va de pair avec ce que nous appelons la « stagnation de l’emploi ». Le chômage mondial oscille autour de 15 %, quoi que prétendent les statistiques officielles.
L’économie politique de Marx reste le point de départ, mais avec une poignée d’entreprises qui contrôlent toutes les industries, on se trouve devant une tout autre situation.
La situation réelle se retrouve dans d’autres statistiques : famine croissante, accès à la santé limité, sans-logis plus nombreux, médiations de dette qui explosent, etc. Et tout cela en même temps que le détournement des flux d’argent vers le secteur financier, la hausse des dépenses militaires, le réchauffement climatique, les économies dans la sécurité sociale, les allégements fiscaux pour les plus riches, le démantèlement de l’enseignement, la limitation de l’accès aux soins de santé et à la justice. Nous pouvons effectivement, à l’instar de Naomi Klein, parler de « capitalisme du désastre ». Le succès rencontré par Bernie Sanders a montré que les gens étaient furieux. Ils sont nombreux dans la classe ouvrière à avoir voté conservateur, mais ils ont été très nombreux aussi à se retrouver dans son discours, car jamais auparavant ils n’avaient entendu quelqu’un qui répondait de la sorte à leurs attentes.
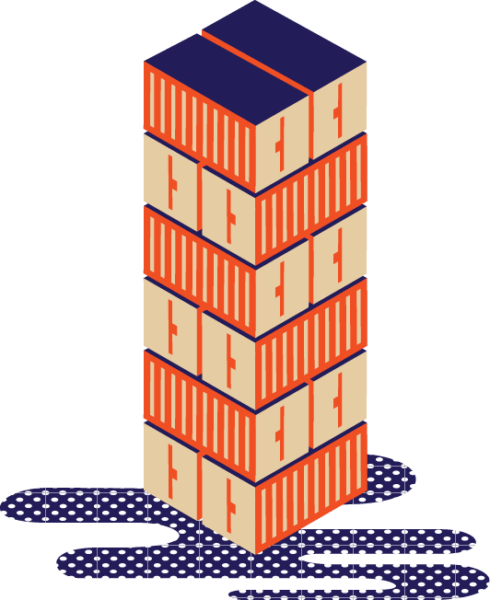 La dette publique et le déficit budgétaire sont l’alpha et l’oméga de la politique gouvernementale. Les dogmes de l’Union européenne sont une dette publique n’excédant pas 60 % et un déficit budgétaire de 3 % maximum. Ces dogmes ont des effets ravageurs pour la population et il n’est pas rare qu’ils se traduisent par des dettes et déficits plus élevés encore parce qu’ils étouffent l’économie. L’exemple de la Grèce est significatif. Pourquoi alors cette focalisation sur les finances publiques ?
La dette publique et le déficit budgétaire sont l’alpha et l’oméga de la politique gouvernementale. Les dogmes de l’Union européenne sont une dette publique n’excédant pas 60 % et un déficit budgétaire de 3 % maximum. Ces dogmes ont des effets ravageurs pour la population et il n’est pas rare qu’ils se traduisent par des dettes et déficits plus élevés encore parce qu’ils étouffent l’économie. L’exemple de la Grèce est significatif. Pourquoi alors cette focalisation sur les finances publiques ?
Remarquez tout d’abord qu’avant le déclenchement de la crise, ce sont les dettes des entreprises privées qui étaient au plus haut niveau, ensuite celles des ménages et, en dernier lieu seulement, celles de l’État. Pourquoi alors cette approche conservatrice des finances de l’État en comparaison avec les finances des ménages et des entreprises ?
Si la situation en Europe est assez unique en raison des complications engendrées par l’euro, une unité monétaire partagée par plusieurs États-nations, cette approche conservatrice revient plus généralement à créer une assurance pour le capital financier des banques et des entreprises. Par crainte de voir la bulle éclater, le capital cherche son salut dans d’autres titres financiers. Dans ce contexte, le rôle de l’État a été considérablement modifié. Les pouvoirs financiers ont décrété qu’il leur fallait un État relativement libre d’endettement et disposant de liquidités en suffisance. Désormais, la fonction de l’État consiste principalement à agir comme prêteur en dernier ressort. Et ce rôle est encore rendu plus important en raison du problème du too big to fail (trop important pour faire faillite) : les entreprises financières sont devenues si gigantesques qu’en cas de faillite, elles entraîneraient toute l’économie dans leur chute. Elles appellent cela « assainir », mais, en fait, il s’agit de prévoir une tirelire pour renflouer les entreprises quand leur faillite est proche. L’État doit alors servir de garantie, la monnaie doit être soutenue et la valeur de l’argent doit être protégée.
Des impôts plus élevés pour le financement de programmes sociaux ne sont pas de mise dans une politique néolibérale. Au contraire, les programmes de sécurité sociale sont un terrain fertile pour la dérégulation, la marchandisation et la privatisation qui permettent de faire converger de nouveaux flux d’argent vers les marchés financiers. La consolidation du capital financier est devenue plus importante que la production et que l’emploi. Et c’est ainsi que l’État se soumet de plus en plus aux besoins d’une ploutocratie.
La crise ne semble pas toucher les multinationales. Les chiffres que vous mentionnez dans le livre The Endless Crisis sont stupéfiants. Au bout d’un an, le top 500 s’était déjà complètement rétabli du krach de 2008. Un an plus tard à peine, les revenus augmentaient de 335 % et les marges d’exploitation étaient multipliées par quatre en 2009. Que nous disent ces chiffres ?
En 2000, la bulle Internet a surtout été associée à des entreprises Internet surévaluées, mais ce n’était rien d’autre qu’une crise financière circonscrite à la Bourse, avec des milliers de milliards de dollars qui sont partis en fumée. À l’époque aussi, les entreprises étaient parvenues à compenser leurs pertes. À chaque crise qui touche le capital se pose la question de savoir qui paie la facture. Normalement, les coûts devraient peser sur le capital, mais il existe toutes sortes de façons pour les répercuter en fin de compte sur la population.
Un autre facteur qui explique la bonne santé des multinationales, c’est que, pendant une crise, la concentration et la centralisation progressent à grands pas. Les grandes banques contrôlaient environ 40 % du marché quand a éclaté la grande crise financière de 2007 ; elles en contrôlaient 80 % en 2009 ! Quelques géants avaient absorbé d’autres géants. Des quinze plus grosses banques des États-Unis en 1991 (représentant ensemble quelque 1 500 milliards de dollars en actifs financiers), il n’en restait que cinq en 2008 (représentant ensemble quelque 8 900 milliards de dollars).
La planche à billets de la FED a aussi été déterminante dans le sauvetage et la restauration des bénéfices. La FED a littéralement jeté son argent par les fenêtres en le prêtant à des conditions particulièrement avantageuses. Personne ne connaît les montants réels, mais, début 2009, les États-Unis avaient déjà engagé 12 000 milliards de dollars pour renflouer les institutions financières en leur injectant des capitaux et en leur assurant des garanties bancaires. Plus que tout autre pays au monde, les États-Unis ont le pouvoir de faire tourner la planche à billets avec un important assouplissement quantitatif de sorte que bien des entreprises se portent mieux après la crise qu’avant.
Le secteur automobile, par exemple, peut produire 94 millions de voitures, soit 34 millions de plus que ce qu’il vend.
Après le déclenchement de la crise, Obama a déballé un plan de 700 milliards de dollars en incitants fiscaux à l’économie. Cela représente peu de chose, comparé au volume de l’économie des États-Unis. Et ce sont des broutilles en comparaison avec les montants de la FED. Je raconte souvent la petite histoire que voici à mes étudiants — elle est fictive, mais sans doute pas très éloignée de la vérité. Quand il est entré à la Maison-Blanche, Barack Obama avait invité Ben Bernanke, le président de la FED, en vue d’échanger quelques réflexions. Quand ils se sont vus, Barnanke a dit à Obama : « Nous sommes aux prises avec une crise financière, mais vous ne devez vraiment pas vous faire de souci à ce propos. Nous résoudrons bien le problème avec une injection de quelques milliards de dollars dans les entreprises. Vous, à votre tour, vous recevrez 700 milliards de dollars à dépenser. Une partie de cet argent ira également aux entreprises, mais vous pourrez toujours faire croire que vous faites quelque chose pour la population et pour l’économie. Votre boulot est de vous en tenir à notre ligne, de telle sorte que nous ne soyons pas obligés de vous torpiller. »
Quelle serait la petite histoire pour Trump ?
Pour Trump, je penserais plutôt à une rencontre avec les services de renseignement américains à propos de la Russie. On ne peut le savoir avec certitude, mais il est possible que la chose se soit déroulée comme suit. Le 23 janvier, Trump se rend au quartier général de la CIA à Langley, en Virginie. Il est accompagné de Michael Flynn, le nouveau conseiller national pour la sécurité, et de Steve Bannon, le stratège de la Maison-Blanche. Des représentants des seize autres services de renseignement sont également au rendez-vous.
Après les félicitations d’usage, on explique à Trump qu’il doit poursuivre la guerre froide contre la Russie. Il rétorque que la Maison-Blanche travaille à un accord avec Poutine. Flynn embraie avec une déclaration de guerre : « La guerre sponsorisée par la CIA contre le régime d’Assad en Syrie doit cesser. En compagnie de la Russie, nous allons balayer l’EI de la carte et la Chine sera la prochaine cible. » Après quelques questions des services de renseignement, Bannon intervient et leur lance qu’ils doivent la fermer et s’accommoder du nouvel ordre politique. On pouvait entendre les mouches voler, du côté de la CIA et des autres services d’espionnage.
Quelques semaines plus tard, la NSA riposte avec un nombre record de révélations dans les principaux journaux nationaux. Celles-ci sont toutes dirigées contre Flynn et les négociations avec la Russie destinées à mettre un terme aux sanctions. Flynn est acculé à la démission, afin de protéger Trump. Trois jours plus tard, Trump demande au milliardaire Stephen Feinberg de faire une enquête sur les services de renseignement. Feinberg est le CEO de Cerberus Capital Management, la maison mère de Dyncorp, l’une des cinq plus grandes entreprises de la défense et de la sécurité. En d’autres termes, Bannon et Trump sont convaincus que, par des tromperies et des intimidations, ils peuvent mettre au pas le deep state4.
Baran et Sweezy insistaient sur l’importance des dépenses militaires dans l’absorption de l’excédent économique. Vous avez dit que les dépenses militaires de Trump n’allaient certainement pas résoudre les problèmes de stagnation, mais il en met quand même un coup : 100 000 nouveaux fantassins, 18 000 nouveaux marines, la marine de guerre passe à 350 navires et les forces aériennes à 1 200 chasseurs. Il s’en va en guerre ?
Grâce à sa puissance militaire, la Maison-Blanche veut obtenir une série de victoires géopolitiques. Cela consiste surtout à accroître le contrôle sur le golfe Persique et à contrer la Chine, en particulier dans la mer de Chine méridionale. Bannon, un néofasciste déclaré, est un grand partisan d’une « guerre judéo-chrétienne » contre l’Islam et contre la Chine. Les divergences au sein de la classe dirigeante ne portent pas sur le fait de savoir si les États-Unis doivent ou non utiliser leur puissance militaire pour étendre leur empire. Si Obama et Clinton cherchaient plutôt leur salut dans une nouvelle guerre froide contre la Russie, Trump a la Chine en vue comme ennemi ultime. Il prêche une croisade nationaliste, religieuse et raciste du même genre que dans Le choc des civilisations de Samuel Huntington.
Trump ne laisse aucun doute non plus sur le fait qu’il est prêt à « envoyer des troupes sur le terrain » au Moyen-Orient. Et il a l’intention d’étendre son arsenal nucléaire. Les perspectives militaires sont particulièrement inquiétantes. Comme le dit Istvàn Mészaros : « Nous sommes entrés potentiellement dans la phase la plus létale de l’impérialisme. » Le secrétaire à la Défense James Mattis est vu comme une colombe, malgré son surnom de « chien enragé ». C’est inquiétant.
Retournons à l’économie. Le processus de monopolisation est caractéristique de l’histoire du capitalisme. Vous avez déjà évoqué les fusions dans le secteur financier. Récemment, on a vu Kraft Heinz vouloir fusionner avec Unilever. Plus près de chez nous, il y a eu la reprise de SAB Miller par AB InBev, la fusion de De Telegraaf avec la Mediahuis, de Delhaize avec Albert Heijn, Peugeot qui reprend Opel, etc. Quand cela va-t-il s’arrêter ?
Cela ne s’arrêtera pas, du moins pas dans ce système. Le meilleur indicateur du taux de monopolisation est la capacité des grandes entreprises à engranger des profits plus élevés que leurs concurrents plus petits. Eh bien, la part des bénéfices bruts totaux du top 200 des entreprises américaines en pourcentage du total des bénéfices d’entreprise dans l’économie est passée de 13 % en 1950 à plus de 30 % en 2008.
Les grandes entreprises éliminent les petites ou les absorbent. Karl Marx est le premier à s’en être rendu compte au 19e siècle. Il fait une distinction entre centralisation et concentration. La concentration est l’accumulation propre du capital. Marx a résumé cela dans la formule A-M-A’, argent, marchandise, plus d’argent. On commence par de l’argent et on finit par de l’argent. La motivation ne peut être autre que le profit. La phase suivante part alors de A’ et se termine par plus grand encore, A’’. On obtient ainsi un effet de boule de neige. Outre la concentration, il y a ce que Marx appelle la centralisation : la tendance à la convergence de capitaux distincts afin de constituer des unités plus importantes par le biais de fusions, de reprises ou d’absorption d’une entreprise en faillite.
Le néolibéralisme n’est pas un système. C’est la stratégie politique utilisée par le capital financier monopoliste pour diriger tous les flux d’argent vers la spéculation.
L’exemple le plus frappant est la constitution de US Steel en 1901. Ce fut la première entreprise en milliards de dollars, formée par la combinaison d’au moins 165 entreprises sidérurgiques, l’empire financier de J.P. Morgan fournissant les crédits nécessaires. Le capital monopoliste et le capital financier étaient déjà étroitement associés.
Marx faisait aussi le lien entre le développement du marché du crédit et les sociétés anonymes : une place boursière organisée autour de titres industriels. Cela concorde assez bien avec la situation d’aujourd’hui. Entre-temps, cela fait longtemps que la concentration ne se fait plus simplement horizontalement comme dans l’exemple de US Steel, mais aussi verticalement, quand, par exemple, l’entreprise sidérurgique absorbe ses fournisseurs. La phase suivante a alors été la fusion avec d’autres industries, avec comme résultat de gigantesques entreprises qui règnent dans quatre ou cinq secteurs différents, une entreprise automobile étant, par exemple, également active dans l’industrie cinématographique. Nous obtenons ainsi des conglomérats.
Au niveau international, peut-on encore parler de concurrence entre multinationales ?
Dans la crise des années 70, il y avait effectivement plus de concurrence internationale. Des producteurs étrangers étaient actifs sur les marchés américains. Un fabricant japonais d’automobiles était allé produire des voitures sur le sol américain. Plus tard, ce sont les Coréens qui sont venus, etc. On a alors perçu cela comme une augmentation de la concurrence, mais, en fait, il s’agissait d’une mondialisation du capitalisme. À l’intérieur des frontières de chaque pays, il y a eu davantage de compétition, mais, à l’échelle mondiale, la concentration et la centralisation se sont accrues. Un nombre de plus en plus restreint d’entreprises contrôlent désormais une part de plus en plus grande du marché mondial. Le capital monopoliste étant devenu mondial, la concurrence diminue donc au niveau mondial. Il en résulte une énorme concentration des gains. Le top 500 des entreprises mondiales engrange 40 % du revenu planétaire contre moins de 20 % en 1960. Et cette part augmente aussi du fait que la crise accroît fortement la concentration.
Il est important de bien comprendre le lien entre capital monopoliste et multinationales. En essence, il s’agit du même phénomène. Lénine pensait déjà en ces termes, mais ce fut l’économiste industriel Stephen Hymer qui fournit la preuve de la naissance du capital multinational dans le prolongement de la tendance à la concentration et à la centralisation du capital. Il appela cela la loi de l’expansion de la taille des firmes : partant de l’atelier, en passant par l’usine, par les entreprises nationales, par l’entreprise multidivisionnelle, pour en arriver à l’entreprise multinationale. En 1963, Baran et Sweezy donnèrent un nom à l’enfant : la multinationale. L’important, c’est que le stade de la multinationale n’est pas possible dans un pays tant que le stade du capitalisme monopoliste (à distinguer du capitalisme compétitif) n’est pas atteint.
Parce qu’ils n’avaient pas d’autre explication, les économistes du libre marché ont repris la théorie développée par Hymer en son temps. Plus tard, ils se sont toutefois rangés derrière la théorie des coûts de transaction qui met l’accent sur l’efficience, l’optimalisation des coûts et les économies d’échelle. L’intégration verticale fut alors perçue comme le fait, par exemple, d’éviter des frais de transaction en faisant des achats en interne dans la firme. Cela leur donnait l’avantage — ce qu’ils admettaient explicitement — de continuer à penser dans le cadre de la théorie du libre marché. Bien que déjà développée dans les années 30, ce n’est pas un hasard si l’explication par les coûts de transaction a de nouveau le vent en poupe avec la montée du conservatisme du libre marché dans les années 70 et 80, à une époque où toute allusion à la constitution de monopole était conspuée. Mais, dans notre conception, une multinationale est du capital monopoliste. Chaque méga-entreprise est d’ailleurs une multinationale et en ce sens elle est inhérente au système.
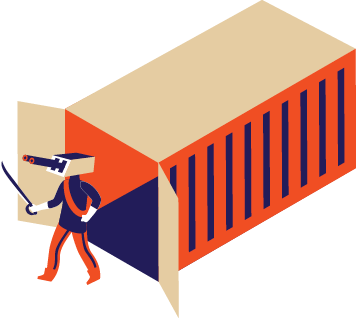 Vous décrivez Thomas Piketty comme un « membre hautement accrédité de l’élite néoclassique ». Pourtant, dans son best-seller mondial, Le capital au XXIe siècle, il plaidait en faveur d’un impôt sur les grosses fortunes. Qu’en pensez-vous ?
Vous décrivez Thomas Piketty comme un « membre hautement accrédité de l’élite néoclassique ». Pourtant, dans son best-seller mondial, Le capital au XXIe siècle, il plaidait en faveur d’un impôt sur les grosses fortunes. Qu’en pensez-vous ?
Piketty est sans aucun doute un expert mondial de l’inégalité, entre autres en raison de son impressionnante banque de données. Il estime que le « principe de l’accumulation sans fin » est la principale contradiction de l’économie actuelle. Cela débouche dans le capitalisme sur une « prospérité hyperconcentrée » et sur toutes sortes d’autres irrationalités. C’est pourquoi il plaide en faveur d’une « utopie utile » : un impôt annuel progressif sur la prospérité individuelle. Il est curieux de voir un économiste traditionaliste lancer une proposition qui est toujours considérée comme anticapitaliste. Cependant, cette proposition n’est pas vraiment neuve puisqu’en 1937, Kalecki fut le premier à l’avoir élaborée.
Dans son travail, Piketty continue à s’appuyer sur l’économie néoclassique. Il confond également certaines choses. Il utilise le terme capital pour prospérité et, chez lui, accumulation du capital remplace croissance de la fortune. Dans une perspective marxiste, ça prête particulièrement à confusion. Néanmoins, Piketty montre bien le côté héréditaire des fortunes et il explique clairement que, dans une économie capitaliste, la fortune est bien plus importante que le revenu. Imaginez que l’inégalité des revenus reste la même, l’inégalité des fortunes augmentera quand même. Mais Piketty ne choisit pas vraiment son camp. Il ne parle pas de changement de système, alors que l’inégalité est précisément inhérente au système. C’est un social-démocrate. Chez lui, on obtient modestement un peu moins d’inégalité. C’est certes mieux, mais ça ne résout pas le problème.
Que faut-il donc faire ?
Il faudrait vraiment se concentrer sur les besoins sociaux en faisant passer en premier les besoins fondamentaux des humains et de l’environnement. L’alternative à la stagnation, ce sont des emplois pour les chômeurs, des maisons pour les sans-logis, des soins de santé, une sécurité de revenu et un environnement convenable pour tout le monde.
Le principe de l’accumulation sans fin au profit de quelques-uns doit céder la place au principe de la satisfaction des besoins de tous.
Il est inadmissible qu’une économie dirigée par une centaine de méga-entreprises, basée sur le statu quo avec ses conséquences que sont le gaspillage, l’exploitation et la guerre, pose les bases de l’avenir. Le principe de l’accumulation sans fin au profit de quelques-uns doit céder la place au principe de la satisfaction des besoins de tous.
Mais, comme le formulait l’économiste de Cambridge et élève de Keynes, Joan Robinson : « Tout gouvernement qui aurait le pouvoir et la volonté de réparer les principaux défauts du système capitaliste aurait la volonté et le pouvoir de l’éliminer complètement. » Le changement radical devra surtout venir d’en bas.
Footnotes
- Mise au pas ou nazification : la soumission de toutes les organisations au NSDAP.
- Monopoly Capital, traduit en français en 1968.
- Les dernières ont été la crise asiatique de 1997, la crise du rouble de 1998, la bulle Internet de 1997 à 2001, la crise argentine de 2001 et, enfin, la grande crise financière de 2007-2009 (NDLR).
- Une espèce de cabinet fantôme englobant les services secrets et hostile à la nouvelle administration, selon Trump et ses partisans (NDLR).




