Comme l’inflation des années 1970, l’inflation actuelle annonce la fin d’une époque. La question centrale de la crise de l’inflation est la répartition de la charge entre les salaires et les bénéfices.

L’inflation frôle les 10 % en Belgique, 9,9 % en moyenne au deuxième trimestre de 2022. La presse évoque presque chaque jour ce phénomène qui frappe les économies capitalistes depuis un an… Nous en avons discuté avec le journaliste Romaric Godin, spécialiste en macroéconomie chez Mediapart.
Ben Van Duppen. L’inflation n’a jamais été aussi élevée. Dans un article de Mediapart que nous avons relayé1, tu dis que l’inflation change tout aujourd’hui. Qu’est-ce qui est différent par rapport à l’inflation qu’on a pu connaître dans le passé ?
Romaric Godin. On sort d’une période de quatre ou cinq décennies où le modèle qui a permis la plus grande expansion capitaliste, depuis la naissance de ce système économique, se fondait sur l’idée de la modération des prix. On a même parlé de « la grande modération ». Officiellement, dans l’histoire économique, elle s’arrête en 2008. En réalité, elle a continué après la crise financière… Il y avait un risque de déflation, avec une baisse des prix qui entraînerait une spirale de baisse des profits et de la demande à cause du chômage… Les banques centrales sont intervenues pour éviter l’emballement de cette spirale et maintenir un niveau des prix assez faible.

Aujourd’hui nous sommes bien loin de cette « grande modération »… À la place, les gens font face à l’inflation et aux fortes augmentations des prix. Comment en est-on arrivé là ?
Pour comprendre pourquoi l’inflation change tout, il faut comprendre comment cela fonctionnait. Jusqu’au début des années 1970, on avait de forts gains de productivité qui étaient fondés sur deux éléments : le progrès technique et son intégration dans le processus de production. Entre l’invention de la maîtrise de l’électricité au début du XIXᵉ siècle et l’électrification de la production, il y a 150 ans. Les gains de productivité sont très rapides, et ils se développent par un élargissement des marchés dans les pays occidentaux à travers le développement de la consommation de masse. Dans ce système, l’inflation est structurellement plus élevée, mais elle ne pose pas de problème particulier puisqu’elle est compensée par les gains de productivité. On peut partager la valeur ajoutée entre les profits et les salaires… Il ne faut pas idéaliser cette époque mais le partage de la richesse, permis grâce aux gains de productivité, est resté relativement stable. C’est déjà énorme dans l’histoire du capitalisme. On observe un cercle vertueux qui se met en place et qui est modérément inflationniste, autour de 4 à 6 %. La hausse des prix permet ce partage de la valeur ajoutée et elle est amortie par les gains de productivité…
La modération salariale, les réformes du marché du travail, la précarisation des emplois doivent être acceptées au nom de la modération des prix.
À la fin des années 1960, ce système entre en crise. Le taux de profit commence à décliner, les gains de productivité commencent à se réduire, la concurrence internationale se fait plus forte… Le schéma national des économies commence à s’internationaliser, la concurrence se développe et l’inflation devient un problème, car elle n’est plus amortie par les gains de productivité.

Se pose alors à nouveau la question : « Qui paye le coût de l’inflation ? » Le choix qui va être pris sera celui du système de modération des prix. Il ne règle pas la redistribution des richesses. Si vous avez des prix plus bas, il y a toujours la question : « Qui paye ces prix faibles ? » Le récit économique invite alors les gens à s’oublier comme producteur et à se définir comme consommateur. La modération salariale, les réformes du marché du travail, la précarisation des emplois doivent être acceptées au nom de la modération des prix. Cela remplace le modèle fordiste qui prônait l’augmentation des salaires pour écouler les produits… Ce système induit trois choses :
- 1) la fragilisation du salariat par les réformes du marché du travail, l’affaiblissement du rôle des syndicats dans la formation des salaires ;
- 2) la mondialisation de la production pour pouvoir produire moins cher. Cela va faire augmenter le chômage dans les pays occidentaux, ce qui pèse sur la formation des salaires (de manière directe en France ou en Belgique, ou indirecte comme en Allemagne avec la hausse des travailleurs pauvres).
- 3) la financiarisation qui permet de compenser la baisse de la productivité, et donc la baisse du taux de profit, issue des activités productives pour les entreprises. Le krach de 1987 ne se transforme pas en crise économique parce que la banque centrale des États-Unis, la Fed, décide de soutenir les marchés. Une garantie est accordée par les banques centrales à la finance. Il y a une inflation, non visible pour le commun des mortels, qui permet de compenser les prix et les taux de profits bas.
Aujourd’hui, ces trois piliers sont en train de vaciller. La guerre en Ukraine a un effet amplificateur, mais l’inflation à des niveaux préoccupants est présente depuis le deuxième semestre de 2021 avec la désorganisation des chaînes de valeurs2 à cause des résurgences du COVID…
Les causes de l’inflation ne se limitent plus seulement aux chaînes de valeurs perturbées et aux entreprises qui ne peuvent pas suivre la reprise de l’économie comme les économistes traditionnels l’expliquaient au début de la crise… L’énergie joue aussi un rôle très important.
En effet, l’autre point de départ est le secteur de l’énergie. Comme on a financiarisé les marchés de l’énergie, la gestion est faite sans aucune vision d’avenir. Il y a eu beaucoup de désinvestissement pour faire un maximum de profits, notamment dans le secteur pétrolier ces trois dernières décennies… Au mois d’avril 2020, on verra même des prix négatifs sur certains cours du pétrole qui sont censés être des contrats d’anticipation… Pourtant, si on écoutait la justification de la financiarisation de l’économie, le contrat à trois mois d’avril 2020 aurait dû être extrêmement élevé en anticipant la reprise… À ce prix-là, on ferme des puits, on désinvestit encore plus … Puis arrive le rebond et cela ne suit pas, car il s’agit d’industries lourdes. Nous sommes face à une demande mondiale inférieure à son niveau de 2009, mais l’offre est incapable d’y répondre…
La pandémie a aussi réanimé une conscience et une fierté de classe, comme l’a argumenté Nic Görtz dans Lava3. Qu’est-ce que cela a changé d’un point de vue économique ?
Il y a une prise de conscience que les métiers les plus pénibles étaient aussi les plus indispensables au fonctionnement des économies et tout le discours qui justifiait la modération salariale disparaît avec le « quoi qu’il en coûte » pendant la crise COVID. L’État peut, en cas de crise, pourvoir aux pertes de revenus. Aux États-Unis, on voit se développer le phénomène de la « grande démission », car les gens n’acceptent plus de travailler dans n’importe quelle condition pour n’importe quel salaire, d’autant plus que les prix bas ne sont plus garantis… Il y a aussi la résurgence de conflits sociaux dans des secteurs où on n’en avait plus vu depuis des décennies, une augmentation de la syndicalisation et de la pression du monde du travail. Plus la mondialisation se désagrège, plus la pression sur les salariés est forte et plus la conscience qu’il faut lutter pour son salaire se développe.
Avec la hausse des taux, on risque un krach boursier comparable à celui des années 1970, à l’époque il a fallu 15 ans pour le résorber.
La guerre en Ukraine a ensuite accéléré l’inflation sur le prix des matières premières et certaines entreprises en ont bénéficié pour leurs taux de profit. Une vraie spirale inflationniste se met en place et se répand dans le reste de l’économie. Elle va toucher aussi la financiarisation, car, pour casser les revendications salariales, la meilleure solution c’est la récession. Les banques centrales retrouvent leurs réflexes monétaristes et veulent répondre à l’inflation par la hausse des taux, la réduction de la masse monétaire, la réduction du crédit, la récession et le chômage.
Les banques centrales en viennent donc à souhaiter le chômage et la récession pour lutter contre l’inflation ? Comment est-ce possible ? Et quelles sont les conséquences de ces recettes économiques ?
Cette logique est due à leur vision monétariste, mais cela ne correspond pas à la réalité. Même s’il y a une reprise de conscience et des luttes sociales, ces dernières ne débouchent pas sur des hausses de salaire susceptibles d’alimenter l’inflation. En revanche, les hausses de taux coupent l’herbe sous le pied des marchés financiers qui vivaient, depuis 2008, sous respiration artificielle via les banques centrales. Si on retire cette respiration artificielle, on se retrouve face à un bear market selon les euphémismes des analystes financiers, c’est-à-dire un krach boursier. Il est assez modéré, mais comparable à celui des années 1970, à l’époque on a mis 15 ans pour résorber ce krach. La finance est la bouée de sauvetage d’un capitalisme à bas régime. Pour sauvegarder les profits, elle constitue l’élément clé dans la structure capitaliste depuis 50 ans. C’est pour cela qu’on a vu se développer l’innovation financière à plusieurs reprises. D’abord, dans les années 1980, avec les marchés à terme ou les produits dérivés. Puis, dans les années 2000, avec les subprimes et la titrisation, c’est-à-dire la financiarisation de ce qui n’était pas financiarisé jusque-là. La SNCF, par exemple, vendait ses wagons non utilisés sous forme de titres financiers. À partir de 2015, c’est la financiarisation du virtuel avec les cryptomonnaies, les NFT’s, le métaverse, … Ce sont chaque fois des pas supplémentaires pour marchandiser ce qui peut l’être dans l’espoir de faire du profit.
Et donc, en relevant les taux comme elle l’a fait en juillet, la Banque Centrale européenne va saper les fonds qui soutenaient cette financiarisation de l’économie ?
Effectivement, cela ne pouvait fonctionner qu’avec des injections de liquidités massives. L’outil productif n’apporte pas les liquidités suffisantes à cause de cette baisse des gains de productivité qui rend difficile l’augmentation du taux de profit brut, à partir du travail des gens. Il faut trouver le trouver ailleurs et, avec la finance, c’est simple. Tout peut être financiarisé tant que quelqu’un achète. À partir du moment où les banques centrales ne jouent plus le rôle de bouée de sauvetage pour la finance, le capitalisme fait face à sa réalité brute, il lui est très difficile d’assumer la croissance du profit, car la seule façon dans un capitalisme de bas régime pour y parvenir c’est d’augmenter le taux d’exploitation, diminuer les salaires, et il ne peut plus compter sur le récit de la modération. Progressivement, on va avoir une lutte des classes exacerbée où le monde du travail se retrouve confronté à un régime d’inflation qui est plus élevé.
De l’autre côté, le capital ne voudra pas céder d’un pouce concernant les salaires et les conditions de travail. Au contraire, il va demander encore plus, soit directement, soit indirectement via la destruction de l’État providence. Pour pallier cette confrontation, les entreprises en situation d’oligopole vont profiter de l’inflation pour augmenter leurs prix et avoir recours à une forme de rente afin de permettre la croissance de leurs profits. Dans leur logique monétariste, les banques centrales pensent toujours qu’il est possible, en relevant les taux, de faire baisser l’inflation pour revenir au système de modération des prix… Cependant, quand on l’a fait dans les années 1980, la croissance de la productivité se situait entre 3 et 4 % par an. Aujourd’hui, elle est à 1 %, voire négative dans certains pays.
Mais alors, pourquoi les économistes néolibéraux des banques centrales pensent-ils que la hausse des taux une bonne recette pour l’économie ?
La clé de tout, selon eux, c’est la sauvegarde de la croissance du profit. L’innovation et son financement devraient permettre l’augmentation de la productivité et donc régler le problème. Leur cadre d’analyse est resté fondamentalement monétariste, ce qui est en réalité typiquement néolibéral. Il faut faire un petit pas de côté pour comprendre cette vision…
Les monétaristes ne sont pas libertariens au point où ils ne veulent plus d’État. En fait, ils intègrent plusieurs éléments keynésiens et néoclassiques de la révolution conceptuelle qui a eu dans les années 1960-70 en sciences économiques. D’un côté, on reconnaît que la demande peut être un problème à certains endroits et que l’État doit intervenir pour la soutenir. De l’autre, on va souligner l’efficience des marchés, le caractère optimal de la redistribution par le marché, la rationalité des agents… Et on retrouve même parfois des éléments libertariens !
Des années 1980 jusqu’en 2000, ce sont surtout les recettes néoclassiques qui sont vantées… Quand c’est la crise, tout le monde est keynésien.
Tout cela forme une synthèse dont les éléments sont utilisés en fonction des situations, c’est la force du néolibéralisme. Dans les années 1980-1990, jusqu’en 2000, ce sont surtout les éléments néoclassiques qui sont vantés… Quand c’est la crise, tout le monde est keynésien, l’État doit intervenir et réguler. Dans cette vision, l’économie se stabilise toujours, il faut seulement trouver les bons outils. Dans le cas de l’inflation, il s’agit des taux d’intérêt puisque, comme le dit Milton Friedman, il s’agit toujours et partout d’un phénomène monétaire. Selon l’économiste américain, l’inflation indique qu’une partie de l’argent qu’on a versé sur les marchés, arrivée dans l’économie productive, crée un surplus de demande…
Mais aujourd’hui cela ne résiste pas à l’analyse, nous sommes à peine au-dessus du niveau de 2021, il est impossible qu’il y ait une surchauffe de la demande. Quand on regarde les conférences de presse de la BCE, elles se structurent toujours de la même façon. Une première partie traite des conditions dites fondamentales, c’est une analyse keynésienne qui porte sur la croissance, l’état de l’offre et de la demande. Une deuxième partie vient ensuite avec l’analyse monétariste. Tous les communiqués de la BCE sont des bijoux de l’idéologie néolibérale, vous avez les deux éléments de la synthèse qui sont toujours présents. Selon les néolibéraux, l’inflation n’est pas un problème de répartition, mais de visibilité pour les agents économiques… Cela brouille les anticipations, donc les investissements et la reprise des gains de productivité. Tout ça n’est qu’un paravent et la vraie question est bien celle de la répartition entre capital et travail, que l’inflation soit faible ou forte. En France, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, dit qu’il faut absolument éviter la boucle prix-salaires alors que le pouvoir d’achat a reculé de 0,9 % au premier trimestre et les salaires réels de 1,3 %.
La financiarisation dont tu parles compense la baisse de la productivité, mais est-ce temporaire ? Est-ce une forme d’avance faite à l’économie réelle ? Cela ne résout en rien le problème systémique…
Tout à fait. C’est ce qu’on appelle le capital fictif. Il y a un effet de contre-tendance, mais qui est toujours provisoire. Une fois qu’on a élargi les marchés, tout marchandisé, quand on essaye de gagner de la productivité sur les livreurs de repas, on aperçoit les limites à un moment donné… La financiarisation commence dans les années 1980, elle connaît une première crise en 1987, une deuxième en 2000, puis une troisième en 2008. À chaque fois elle est sauvée par les banques centrales, mais à chaque fois la crise est plus profonde parce qu’une nouvelle innovation financière vient renforcer la bulle financière et précipite la prochaine crise… Il y a une dynamique entre l’État et le monde de la finance pour sauvegarder cette contre-tendance malgré qu’elle soit en crise depuis 1987. La financiarisation soutient le taux de profit, mais elle connaît aussi la crise donc elle doit être sauvée par les autorités pour soutenir ce taux de profit… Quitte à ce que la prochaine crise soit encore plus forte… C’est une fuite en avant, mais cela ne crée pas de valeur réelle en effet ! La création de valeur à partir du travail humain est de plus en plus faible, c’est bien le problème avec le capitalisme actuellement, c’est ce que nous dit la baisse des gains de productivité.
Karl Marx parle du concept de la baisse tendancielle des taux de profit dans le Livre III du Capital. Il nous explique que l’économie capitaliste voit baisser le taux de profit à mesure qu’elle se développe… Est-ce que tu parles de la même chose quand tu évoques la baisse de la croissance de la productivité ? Quelles en sont les causes ?
Cela se rejoint. D’habitude, la baisse de la productivité est perçue comme une conséquence d’autres éléments comme le sous-investissement alors que la baisse tendancielle des taux de profit est vue par Marx comme un signe de maturité du capitalisme.
Avec la deuxième révolution industrielle, je pense que nous avons atteint un niveau de composition organique du capital, c’est-à-dire de mécanisation de la production, qui est telle que les ruptures innovatrices à la Schumpeter ne sont plus possibles. Marx disait que plus on avance dans la mécanisation, plus il est difficile d’avancer encore davantage. Robert J. Gordon, un économiste orthodoxe, a écrit dans les années 2010 que, plus on avance dans le progrès technique, plus les innovations sont difficiles. Il pense qu’elles peuvent encore exister, personnellement je pense que l’histoire nous montre depuis 50 ans que c’est très compliqué.
On a parlé des entreprises qui avaient profité de l’inflation pour gonfler les prix, et donc augmenter leur taux de profit… Et on nous annonce une inflation encore plus forte à l’automne dans le secteur agroalimentaire, qu’en pensez-vous ? Certaines entreprises ont modéré l’inflation ?
Quand on regarde la structure des profits, on remarque qu’il y a une explosion dans les secteurs qui sont les plus touchés par l’inflation (l’énergie et les transports). Sur le marché agroalimentaire, on entend ce discours qui dit que les profits ne participent pas à l’inflation parce que les capitalistes auraient pris sur leurs marges… Mais ce n’est pas la réalité ! À l’été 2021, les prix des matières premières sont redescendus donc il y aurait dû y avoir un creux si les prix suivaient le cours des matières premières et qu’il s’agissait uniquement d’inflation importée…
En France, Bruno Le Maire, dit qu’il faut absolument éviter la boucle prix-salaires alors que les salaires réels ont reculé de 1,3 %.
En fait, l’accélération a commencé et elle s’est exacerbée en février avec la guerre en Ukraine. Comme il n’y a pas eu d’augmentations de salaires, et même des baisses de salaires réels en France et en Allemagne sur le premier trimestre, il est évident que les producteurs ont profité de la hausse des prix pour sauvegarder leurs marges. Par ailleurs, les entreprises vendent des stocks achetés quand les cours étaient bas et aujourd’hui elles déstockent au prix fort du marché. À l’automne, on va avoir une période d’inflation très forte. Si vous avez une inflation au-delà de 10 % et que les salaires n’augmentent pas, il va y avoir de gros problèmes qui ne se résoudront pas à coup de primes…
En Belgique, nous avons l’indexation automatique des salaires qui est fortement attaquée par la Fédération des entreprises (FEB). Le patronat s’attaque à ce mécanisme important de protection de nos salaires, en prétendant qu’il ferait augmenter l’inflation. Au Luxembourg, ils ont décidé de suspendre cette indexation pendant neuf mois… Qu’est-ce que vous en pensez ?
C’est un élément essentiel et vous avez raison de demander une indexation réelle et pas une indexation limitée, « à la carte ». La question de compétitivité c’est la question de la compétition entre les économies capitalistes. Une réponse qui peut être fournie d’un point de vue néoclassique c’est que rien ne vaut l’indexation des salaires pour faire pression sur les taux de profit afin d’investir massivement pour augmenter la productivité et pouvoir ainsi amortir l’indexation des salaires. Comme le problème, actuellement, ce sont les gains de productivité, l’indexation des salaires c’est la solution pour l’économie capitaliste ! Cette logique était quasiment canonique dans les années 1970. On disait que la France avait connu une expansion extraordinaire parce que, grâce à la pression des salaires après mai 68, les entreprises avaient investi massivement et avaient gagné en productivité. De plus, l’indexation des salaires permet de préserver la demande intérieure, les marchés existants. Il faudrait se battre pour gagner 5 centimes face aux Allemands sur le marché argentin et saper le marché belge en le faisant ? Les Allemands ont détruit leur marché intérieur, car ils ont fait de la modération salariale avant tout le monde dans les années 2000. Les produits allemands étaient déjà plus compétitifs, mais pas parce qu’ils étaient moins chers, ils ont joué sur l’aspect qualitatif et technologique. Jusque dans les années 1970-80, le miracle allemand, c’était le miracle de l’investissement massif… Les salaires étaient indexés et il n’y avait pas de problème. L’indexation doit être défendue, cela permet de mettre en avant le fait que l’inflation est un problème de répartition de la valeur créée et pas uniquement de création monétaire. Si quelqu’un doit payer, il faut se poser la question du « qui ?» Les capitalistes ont les moyens de faire face à l’indexation, les salariés n’ont pas les moyens de faire face à la désindexation.
Les capitalistes souhaitent que l’inflation diminue. Leurs prévisions vont également toujours dans ce sens, comme celles de la BCE qui annoncent le retour de l’inflation à 2 % pour 2023 et 2024. Ces prévisions sont-elles crédibles ? Est-ce vraiment si important que l’inflation retombe à ce chiffre sacré de 2 % ?
C’est possible, mais 2 % d’inflation à quel prix ? Si ces 2 % d’inflation s’accompagnent d’une explosion du chômage et des faillites, ils ne seront dus qu’à la rente. Ce sera une déflation réelle et il n’y aura qu’une couche d’entreprises qui ne gagneront de l’argent que grâce à leur position d’oligopole et grâce à la rente… À mon sens, le vrai critère aujourd’hui c’est l’évolution des revenus réels. S’il y a 2 % d’inflation, mais une baisse des revenus réels équivalente à celle qu’on observe aujourd’hui avec 6 à 8 % d’inflation en France, la situation ne change pas. La vraie question aujourd’hui est : « Comment le système économique peut-il produire 2 % d’inflation avec une augmentation des revenus réels suffisante ? » et là nous sommes face à une impasse, car la politique qui répondrait à cette question n’est pas mise en place.
L’État ne doit pas être la roue de secours pour la recherche du profit, mais plutôt l’élément organisateur d’une nouvelle société.
Cela pourrait engendrer une baisse des taux de profit et donc une baisse de l’investissement et une augmentation du chômage. Cela pèsera alors sur les salaires et l’augmentation des revenus réels ne durera pas… 2 % d’inflation, cela ne veut pas dire grand-chose, ce qui compte c’est l’inflation ressentie qui est en fait plus réelle que l’inflation headline, statistiquement mesurée. En France, on nous dit que c’est formidable, car on a l’inflation la plus basse de la zone euro… Mais si on regarde l’évolution des revenus réels en France et en Allemagne, l’inflation ressentie est la même.
Chacune de vos analyses aboutit à la conclusion qu’il faut changer de système économique. Que doit-on faire maintenant à votre avis ?
Certains disent : « accrochez-vous plutôt à ce que vous avez », mais la position du salariat dans le capitalisme actuel est extrêmement défavorable si elle compte sur les ajustements de marché. Cela risque de mener à un effondrement du niveau de vie des gens, en premier lieu celui des plus faibles, si on ne fait rien. Comment tenir une société avec une telle pression sur le travail ? La seule solution, c’est la police. C’est un régime autoritariste qui est renforcé par une instrumentalisation des problèmes sociétaux et, notamment, de l’immigration. On voit comment les libéraux utilisent le racisme et l’islamophobie pour diviser la société et détourner l’attention afin de la contrôler, car elle connaît des tensions sociales extrêmes. Je décris une forme de l’effondrement du capitalisme, mais cela ne veut pas dire que l’on va en être débarrassé en regardant le film se jouer… Au contraire, le capitalisme va survivre et s’adapter en se politisant et en s’appuyant sur l’État si on ne fait rien. Depuis les années 1920, le capitalisme se sert de l’État pour organiser sa propre survie.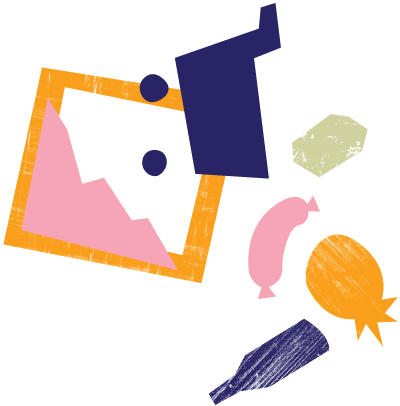
On ne peut plus fonctionner sur ce régime d’accumulation en pensant que la croissance de création de valeur capitaliste va tous nous sauver… C’est une illusion pour le climat, mais aussi d’un point de vue social. Pour maintenir sa croissance, le capitalisme va exacerber la lutte des classes. Face à cela, il faut revenir à une vision du gouvernement par les besoins réels. Aujourd’hui, on considère que les besoins sont déterminés par le marché, ils sont réels puisque les individus sont libres et rationnels et le marché doit pourvoir à ces besoins réels en générant du profit. En bref, celui qui cherche à faire du profit répond aux besoins réels de la société. C’est ce schéma de pensée qu’il faut casser. Il faut partir de la satisfaction des besoins pour organiser la société et non pas partir de la recherche de profits. Il est temps de s’y mettre très concrètement. Il y a des outils : la planification et la socialisation, car la gestion des entreprises doit intégrer et être déterminée par les besoins. L’État ne doit pas être la roue de secours pour la recherche du profit, mais plutôt l’élément organisateur d’une nouvelle société. Cela semble peut-être grandiloquent et utopiste, mais je pense que l’utopie, c’est de croire qu’on va s’en sortir sans devoir le faire. La définition des besoins ne peut être envisagée que d’un point de vue démocratique. Contrairement au récit capitaliste, tous les besoins ne se valent pas. Il y a des besoins plus fondamentaux que d’autres et il faut donc se concentrer sur ceux-ci. Le risque, c’est la tentation autoritaire pour faire face à la crise.
Footnotes
- Romaric Godin, « L’inflation qui change tout », Lava Revue, 14 juin 2022.
- Une chaîne de valeurs est l’ensemble des étapes de la production d’un bien de consommation. Avec la mondialisation, la fragmentation des chaînes de valeurs à l’échelon international s’est intensifiée, ce qui a renforcé l’interdépendance des économies nationales.
- Nic Görtz, « Avec le Corona, retour au prolétariat ! », Lava 13, 23 juin 2020.




