L’histoire sans fin des réformes de l’État belge a créé autant de portes d’entrée pour un «ethnolibéralisme» dans lequel prospère l’extrême droite.
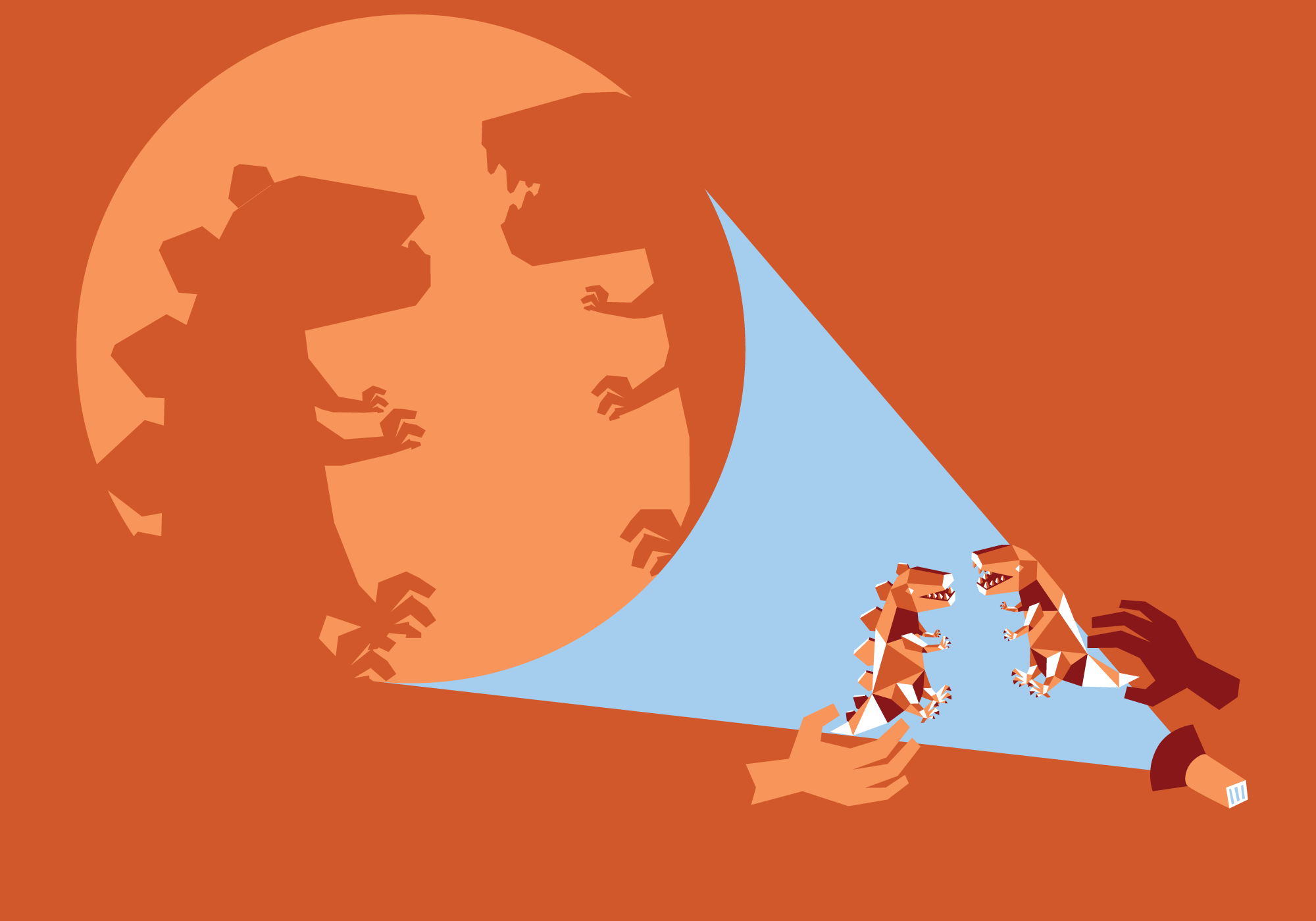
La Belgique de 2020 ressemble toujours plus à la planète Terre du 30 octobre 1938. Ce soir-là, des centaines de milliers d’Américains écoutant une adaptation radiophonique du roman de science-fiction La Guerre des mondes d’H.G. Wells crurent que la planète était réellement en train d’être envahie par des Martiens. De nos jours, de très nombreux Belges sont persuadés de vivre une guerre larvée: le pays est en «crise communautaire». Pire, cette guerre se livre déjà ouvertement depuis plus d’un an, sur les champs minés de l’impossible formation d’un gouvernement fédéral.
Une autophobie invétérée
Heureusement pour eux, les auditeurs états-uniens de 1938 furent rapidement détrompés. Tel est loin d’être le cas de la population belge, à laquelle la fiction La Guerre des communautés est servie jour après jour depuis des décennies. Cette population a fini par y croire. Pour les lecteurs de Lava qui ne se sentiraient pas concernés, qu’ils songent au fait que la fable est tellement enracinée qu’un média national peut désormais en jouer sciemment et faire marcher les Belges, exactement comme le fit Orson Welles en 1938.
De nos jours, de très nombreux Belges sont persuadés de vivre une guerre larvée: le pays est en «crise communautaire».
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit le 13 décembre 2006, quand la première chaîne de la télévision publique francophone a interrompu ses programmes pour annoncer la prise d’indépendance de la Flandre, la fuite du roi et — horreur ultime — la fin de la Belgique. Scénario hollywoodien auquel de très nombreux Belges crurent d’autant plus spontanément qu’il leur avait été suggéré depuis le berceau. L’ex-commissaire européen et puissant homme d’affaires Étienne Davignon l’explique très bien dans cette tragicomédie: «Depuis le temps qu’on en parle, un jour quelque chose devait se passer. Si quelqu’un se réveille en disant: ‘Je n’ai jamais pensé que ça pourrait arriver’ , c’est vraiment quelqu’un qui vit dans un autre monde que la Belgique!» Que, durant une demi-heure, la rédaction ait ou non oublié d’afficher son bandeau «Ceci est une fiction», ce «canular» n’en est pas moins un énorme acte manqué dans une pièce que les sphères politiques et médiatiques se jouent depuis des décennies.
De tous les Européens, les Belges sont parmi les plus forts pour jouer à se faire peur. Cette peur est un terreau idéal pour l’indifférence et pour sa face cachée, la haine de soi ou la haine de l’autre («les Flamands», «de Walen» ou «de Franstaligen»). Mais cette peur n’est pas seulement inculquée de manière spectaculaire, par des opérations coup de poing comme la mystification de la RTBF de 2006. Elle l’est constamment, de manière moins sensible, à chaque fois que l’une ou l’autre actualité vient relancer la presse-fiction et ses envoyés spéciaux sur le front communautaire. Par exemple, il ne s’est trouvé que quelques voix pour dénoncer l’écœurante campagne médiatique menée pendant plus d’une année par la coalition des médias dominants «wallons» et «flamands» autour de «la mère de toutes les élections» – «de moeder aller verkiezingen» du 25 mai 2014. Ce suffrage allait mener mécaniquement à l’impasse finale, voire à la fin de la Belgique. Plus rares encore sont ceux qui, tel le chercheur de la Vrije Universiteit Brussel Dave Sinardet, analysent les effets ségrégatifs du discours de la plupart des médias belges, discours très similaire des deux côtés de la «frontière linguistique».
Ici comme dans d’autres dossiers, les dysfonctionnements de la presse dominante — en l’occurrence, le journalisme-fiction, qui est au journalisme ce que la science-fiction est à la science — empêchent tout débat national serein et, par conséquent, toute prise de décision un peu démocratique. Cela dit, ce ne sont pas ces médias en tant que tels qui sont à l’origine de l’autophobie collective. Comme toute peur, celle-ci aussi est une réaction largement imaginaire à l’inconnu. Or, cet inconnu a ceci de particulier en Belgique qu’il ne correspond pas seulement à l’extraterrestre qui fait peur, dont on ne comprend pas la langue et qui d’ailleurs est toujours plus invisibilisé, soit «le» Flamand aux yeux «du» Wallon et «de» Waal aux yeux «du» Vlaming. L’inconnu, c’est aussi ce qui réunit l’un et l’autre, à savoir la Belgique elle-même. L’autophobie belge repose largement sur l’absence d’informations durablement vérifiées sur la Belgique et sur ses parties (qui ne se résument pas aux communautés).
Un État coupé de l’histoire et de la culture
Ces informations-là ne sauraient être produites par le journalisme, qui se donne pour mission de couvrir l’actualité et le court terme. Elles sont le domaine des sciences humaines et sociales, à commencer par l’histoire. Il est donc temps de se poser la question: mais que fait la science? Question difficile à traiter en si peu de temps, mais question urgente vu la mystification en cours.
Relevons d’abord quelques problèmes du côté de l’historiographie, en commençant par le commencement: les origines de la Belgique. Plus d’un historien, francophone et néerlandophone, se plaît à écrire que la Belgique est un pays indépendant depuis 1830. Cette évidence est au cœur du bon sens national. Sur son site officiel, l’État lui-même commence par se présenter en ces termes: «La Belgique accède à l’indépendance en 1830.» Pourtant, cette évidence n’a rien d’évident: elle confond le pays, ensemble historique plus ou moins cohérent qui précède l’État, et l’État. C’est l’État belge qui est devenu souverain en 1830, après une genèse sur une période plus ou moins étendue. L’amalgame est tel que dire «la Belgique» revient généralement, quand on y songe, à dire «l’État belge». Un nombre incalculable d’approximations, d’erreurs et de malentendus en découlent. Ainsi, comme l’État belge passe généralement pour «artificiel» (y aurait-il quelque part un État naturel?), la Belgique le serait aussi, et vice-versa.
La réduction de la Belgique à une structure institutionnelle fait que tous les phénomènes qui précèdent l’État belge ou qui le débordent ne sont guère étudiés.
L’État apparaît alors comme le tout de la Belgique, alors qu’il ne faut pas être d’obédience libérale pour comprendre que cette simplification ne correspond pas aux réalités bien plus complexes des contrées en question. Aussi les (rares) éléments d’«histoire de la Belgique» dont disposent les personnes vivant dans l’une ou l’autre de ces contrées concernent très généralement l’État. Cette confusion navrante délégitime toutes ces autres connaissances qui pourtant subsistent malgré tout dans les esprits et concernent toutes les dimensions qui ne sont pas solubles dans l’État: le rapport à l’autorité (notamment à l’État), le rapport à l’étranger, au corps, à l’argent, à l’art, à la nature, à la toponymie, à l’humour, à la langue ou plutôt aux langues, toujours au pluriel où que l’on soit en Belgique wallonne, brabançonne, picarde, flamande, lorraine ou germanophone, etc.
Bref, la réduction de la Belgique à une structure étatique fait que tous les phénomènes qui précèdent l’État belge ou qui le débordent ne sont guère étudiés. Ils sont encore moins transmis en tant que tels, si ce n’est de manière fragile et fragmentaire, par exemple à travers le travail de fourmis des innombrables cercles d’histoire locale. Comme dans n’importe quel autre pays, ce patrimoine est certes enregistré dans ces archives spéciales que sont les œuvres littéraires, celles de Maurice Maeterlink, Stijn Streuvels, Georges Simenon, Hugo Claus, Claire Lejeune, Tom Lanoye, Eugène Savitzkaya, Dimitri Verhulst, etc. Pour ne pas parler du théâtre, de la bande dessinée, du cinéma, de la chanson ou de la peinture. Mais, contrairement à la plupart des autres pays, ces données sont trop rarement répertoriées et analysées pour être dûment diffusées au grand public.
Il suffit pour s’en convaincre de se poser deux questions. La première est de savoir s’il existe quelque chose comme des Belgian Studies, au même titre que les English Studies répandues en Grande-Bretagne et à travers le monde, ou au même titre que les Études françaises, les French Studies, les Dutch Studies, les American Studies, les Studii italiani, les German Studies, les Luxembourg Studies, etc. La réponse est non. Seconde question: lequel des quarante-huit ministères belges a pour mission de gérer ce patrimoine belge? Réponse: aucun. «La culture» à l’échelle du pays a beau avoir une histoire aussi complexe que spécifique, perdurer de mille façons et être reconnue au pays et surtout à l’étranger, elle n’existe pas aux yeux de l’État belge. Celui-ci reconnaît des «institutions culturelles fédérales» mais non pas des phénomènes culturels «fédéraux»: ceux-ci sont automatiquement communautarisés, c’est-à-dire ethnicisés sous le label invraisemblable «bicommunautaires».
Pourquoi l’État néglige-t-il ces informations sur la Belgique en général et sur lui-même en particulier? Tout d’abord, il n’a jamais enseigné sa propre histoire, sauf de manière schématique et fort lacunaire dans l’enseignement secondaire, ou alors en vase clos, à travers certains cursus universitaires, etc. L’État en Belgique n’a pas l’exclusivité de cette discrétion. Un peu partout, ses homologues cherchent à avoir le monopole de la production et de la diffusion des informations (statistiques, etc.) les concernant. Quant à l’histoire de la Belgique, celle-ci a été instrumentalisée par l’État, de manière à étatiser la Belgique et à «nationaliser» l’État, à en faire «naturellement» un État-nation. Elle est un récit officiel simplifié et lissé. Elle est d’autant plus cadrée aujourd’hui que, entre 1970 et 1993, les Communautés ont pris les commandes de l’audiovisuel public, de l’enseignement, de l’enseignement supérieur et de l’essentiel des politiques scientifiques. Cela fait des décennies que les programmes de recherche relatifs à l’ensemble du pays se raréfient, ce qui contraste avec la plupart des autres pays dans le monde.
En somme, ce sont les conditions de possibilité d’un sens commun national — la fameuse «identité nationale» ou «conscience nationale» — qui se disloquent. Avant de s’en réjouir ou de le déplorer, il faudrait savoir d’où vient un tel comportement suicidaire. Voici quelques hypothèses.
Histoire d’un auto-démantèlement
Pendant longtemps, l’État belge a été sûr de lui-même, malgré sa position de petit dernier convoité par trois grandes puissances mondiales à ses frontières. Mélange antinomique de principes issus des Lumières et de l’Ancien Régime, cette monarchie parlementaire ne s’en est jamais remise au «peuple belge» dans son ensemble, mais seulement à ses élites bourgeoise, aristocratique et cléricale. Ne retenant dans la devise républicaine française que le terme «liberté», elle est très loin d’avoir fondé la société de manière interventionniste sur les principes d’égalité et de fraternité.
La politique d’auto-démantèlement de l’État belge par instances supranationales interposées s’inscrit dans son habitude ancienne d’externaliser les dossiers à risque.
Pour exorciser la société de ses tensions internes, l’État belge a toujours préféré emprunter des voies détournées. D’une part, il voit dans l’exportation et le commerce international les plus sûrs moyens de préserver la paix sociale. Dès les années 1830, il mène une politique de synergie des plus volontariste avec les marchés européens. Il s’appuie ouvertement sur une alliance existentielle avec le monde de la finance et l’industrie. D’autre part, sur le plan intérieur, il cherche à ménager à tout prix tous les décideurs politiques, économiques, etc., en privilégiant le compromis pour le compromis (compromis dit «à la belge»).
Il recourt même à une sorte de délégation de pouvoir, une externalisation de compétences susceptibles de créer des tensions. Externalisation d’actes politiques d’ordre exécutif et législatif aux trois partis politiques «de gouvernement» (catholique, libéral et socialiste), faisant de la Belgique un des premiers et principaux exemples de particratie. Externalisation de services publics aux «piliers» qui sont associés à ces partis et qui divisent la société en trois univers relativement imperméables. Externalisation de services publics à des entreprises privées, dont l’exemple le plus emblématique est l’entreprise d’exploitation du Congo de 1885 à 19601.
Les effets croisés de ces différentes formes de sous-traitance du pouvoir ont permis à l’État belge de mener sa barque en bonne intelligence avec «le peuple». Mais c’est surtout sa politique économique internationale dont il tire orgueil. Entre 1860 et 1914, la conquête de nouveaux marchés et de territoires outre-mer place la Belgique dans le peloton de tête des grandes puissances économiques de la planète. Son cocktail de nationalisme politique et d’internationalisme économique fait d’elle une championne du libre-échangisme, première nation européenne à ériger cette doctrine en principe de toutes ses relations commerciales. Sa politique étrangère est toujours plus guidée par des objectifs commerciaux définis d’abord par les milieux d’affaires.
Dès le tournant du XIXe siècle, l’État belge se fait l’apôtre d’un véritable internationalisme libéral. En spéculant sur l’idée selon laquelle les «petits pays» ont plus à gagner de l’intégration des marchés que de la compétition entre les «grands pays», il joue gros en s’engageant corps et âme dans la création d’instances économiques internationales. Après 1945, il mise sur la nouvelle superpuissance états-unienne et redouble d’inventivité dans la mise sur pied d’instances supranationales inséparablement économiques et politiques.
L’État belge se livre alors à une véritable politique d’abandon de pans entiers de sa souveraineté. Aucun autre pays n’a été en si peu de temps signataire d’autant de traités internationaux dans autant de domaines différents. La Belgique ou plutôt l’État belge est parmi les cofondateurs de toutes les institutions qui promeuvent la réorganisation libérale et atlantiste du monde. Ces institutions le lui rendent bien: le FMI, le GATT, l’OCDE, l’Assemblée générale des Nations unies, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Parlement européen, toutes ces institutions flambant neuves ont pour premier dirigeant ou président un Belge. En 1958, Bruxelles devient la capitale de la CEE et, en 1966, le siège de l’OTAN.
La politique d’auto-démantèlement de l’État belge par instances supranationales interposées s’inscrit dans son habitude ancienne d’externaliser les dossiers à risque. C’est aussi par l’externalisation qu’il va essayer de gérer la «question linguistique». Là aussi, à ses propres dépens.
Un auto-démantèlement néolibéral
Tout d’abord, cet État a toujours sous-estimé l’importance du patrimoine culturel lié au territoire et aux populations qui y vivent. Un de ses actes culturels fondateurs a consisté à faire de la langue des élites au pouvoir, le français, sa langue, tout en décrétant, à travers sa Constitution, que «l’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif». Ce grand écart donnera naissance au mouvement flamand. En effet, comme pour toute liberté définie dans un esprit libéral, seuls les citoyens qui en ont les moyens peuvent se payer le luxe de jouir de la liberté linguistique — en gros, la bourgeoisie francophone censitaire. Pour les autres, c’est-à-dire une majorité dans toutes les parties du pays, cette langue conditionne leur ascension sociale, alors qu’elle n’est pas leur langue maternelle. Cela crée un sentiment d’injustice, de ressentiment et parfois, surtout là où les dialectes ne sont pas proches du français, de haine.
À s’entêter à donner au français un rôle qu’aucune langue n’a jamais joué auparavant en Belgique, l’État déclenche deux aspirations autonomistes en son propre sein. Plutôt que de prendre acte d’une réalité nationale multilingue, il édicte des «lois linguistiques» pour la seule partie «flamande», donnant ainsi naissance à une «frontière linguistique». Forcé à poursuivre l’homogénéisation linguistique du Nord et, par contrecoup, du Sud, on le voit (y compris le chef de l’État) prêter toujours plus foi à l’existence des deux peuples qu’il est en train d’engendrer lui-même. Le mouvement flamand et son alter ego wallon s’accordent ainsi avec l’État belge pour adopter une même logique «ethnique-territoriale». C’est ce mélange de légèreté, d’orgueil et d’entêtement au niveau du pouvoir qui permet de comprendre de nombreux paradoxes historiques, notamment le fait que, au moment même où il se félicite de la popularisation du nationalisme belge après 1918, l’État est amené à organiser en interne sa propre bipartition en scindant son administration, son armée, sa justice et son enseignement en deux «régimes» linguistiques associés chacun à un territoire.2
Mais le mouvement flamand suit sa matrice belge non seulement sur le plan de l’unilinguisme — «de taal is gans het volk», soit «une langue, un peuple» —, mais aussi en matière économique. Non, le fédéralisme belge ne trouve pas son origine dans la rencontre des revendications culturelles flamandes et des revendications économiques wallonnes, comme le veut une légende naïve diffusée par le site de «la Belgique» ou Wikipédia. Le mouvement flamand se fait aussi culturel que socio-économique dès la fin du XIXe siècle. Il se dote alors d’un programme économique cohérent. Son principal inspirateur, l’économiste Lodewijk De Raet, explique que l’énergie ethnique («volkskracht») ne pourra renaître que si l’ethnie flamande est formée en néerlandais pour un marché du travail entièrement défrancisé. Ce n’est qu’alors que l’ethnie flamande pourra entrer en libre concurrence avec l’ethnie wallonne dans le cadre d’une vaste «concurrence ethnique mondiale» («wereldmededinging»). Cette «doctrine De Raet» constitue le socle des organisations patronales «flamingantes» depuis leur début. Or ce courant partage avec les associations patronales «belgicaines» la défense inconditionnelle d’une économie de marché exportatrice et compétitive, encouragée par les autorités publiques sans interventionnisme, à la manière de l’État belge.
Pendant l’entre-deux-guerres, le mouvement flamand obtient la néerlandisation de l’Université de Gand, fonde ses propres banques, etc. Il dispose de relais toujours plus nombreux au sein des gouvernements successifs. Exemple parmi d’autres: le ministère des Affaires économiques est dirigé quasi sans interruption par des politiciens qui lui sont plus ou moins acquis. Les politiques qu’ils mènent affichent moins leurs aspirations culturelles qu’un soutien à une économie nationale dont ils approuvent les fondamentaux. Elles combinent libéralisme économique et interventionnisme, voire autoritarisme étatiques. Ce syncrétisme s’apparente à la «troisième voie» néolibérale qui se dessine alors en Europe et qui vise à transformer l’État en stimulateur du marché.
Parmi les économistes flamingants des années trente, on trouve le professeur de l’Université Catholique de Louvain et étoile montante du Parti Catholique Gaston Eyskens. Le «De Raet catholique» a complété ses études aux États-Unis, notamment auprès de Frank Knight, l’un des maîtres de l’icône néolibérale Milton Friedman. Adepte d’un libéralisme mâtiné de catholicisme corporatiste, Eyskens croit dans les vertus régulatrices de la «concurrence mondiale» à laquelle il exhorte les ethnies flamande et wallonne. Lié notamment à l’Autrichien Richard Coudenhove-Kalergi, un des pionniers du paneuropéanisme fédéraliste et néolibéral, il est lui-même favorable à un fédéralisme européen et mondial lié à une économie mondiale intégrée. Pour la Belgique, il rêve d’une régionalisation économique à base ethnique qui préparerait un fédéralisme belge au diapason du fédéralisme européen.
Les sept réformes de l’État doivent beaucoup à la propension originelle de l’appareil étatique belge à gérer les conflits par l’externalisation des compétences en cause.
À la fin des années 1950 l’épicentre économique du pays se déplace de la Wallonie à la Flandre. Eyskens prend alors a la tête d’une coalition de démocrates-chrétiens et de libéraux, après avoir été gouverneur de la Banque mondiale et avoir été successivement ministre de l’Économie, ministre des Finances et Premier ministre. Sa Loi unique de 1960 vise à stimuler les secteurs industriels nouveaux portés par les multinationales (américaines) et par la fraction «moderniste» de la bourgeoisie belge: la nouvelle bourgeoisie flamande, fer de lance de la «concurrence mondiale» en Belgique. Pour la première fois, l’État suit une logique régionale sur fond ethnique, tout en servant ses créanciers à travers des économies au détriment de la population et de ses droits sociaux. L’État belge devient ainsi l’un des premiers en Europe à endosser le rôle que lui assigne le projet de société néolibéral: celui de stimulateur universel de la productivité et de la rentabilité, y compris dans ses propres rouages.
Ainsi, la fédéralisation, entamée dans les faits avant la guerre, prenait aussi forme sur le plan économique. Une fois scindé le ministère de la Culture et «bétonnée» la «frontière linguistique» dans la foulée de la Loi unique, il ne faudra plus que quelques années au système des partis pour «adapter», sans débat parlementaire notable, les structures de l’État unitaire «dépassées» aux «réalités nouvelles» fabriquées en son sein. Celles-ci seront coulées dans le marbre d’une Constitution révisée en 1970, à nouveau sous la houlette du premier ministre Eyskens. Le nouvel organigramme met en place — cas unique au monde et pour le moins risqué — deux niveaux équivalents à l’État central (rebaptisé «fédéral» en 1994): les Régions et les Communautés. Eyskens réalise ainsi «son idéal de jeunesse fédéraliste»: une régionalisation économique fondée sur une logique communautariste. En 1980, la Région et la Communauté flamandes décident de fusionner, créant ainsi le sous-État (deelstaat) «Flandre». La doctrine De Raet est ainsi presque réalisée: la Communauté flamande contrôle désormais presque tous les leviers éducatifs et professionnalisants et une partie des leviers économiques.
Les sept réformes de l’État doivent beaucoup à la propension originelle de l’appareil étatique belge à gérer les conflits par l’externalisation des compétences en cause. Sa politique étatique de désétatisation tourne ainsi à la sous-traitance de tous ses pouvoirs non régaliens. Ce faisant, l’État belge s’applique, sans jamais impliquer directement le «peuple belge», un principe-clef de la mise au pas néolibérale des États-nations: l’externalisation, «soit par privatisation, soit par délégation à des entités autonomes»3.
Le moteur ethnolibéral de la «crise communautaire»
Dans les années 1970, la «spirale d’endettement» déclenchée par la «crise» de 1973 érige les économies budgétaires au rang de dogme de l’économie néolibérale. Une véritable concurrence budgétaire et fiscale va s’instaurer entre les entités fédérées. Les libéraux néerlandophones de Guy Verhofstadt sont les premiers à prôner ouvertement le fédéralisme comme levier néolibéral: il est bon de scinder des ministères en vertu du principe néomanagérial de la désagrégation. Les nationalistes flamands de la Volksunie n’ont plus qu’à pousser le raisonnement un peu plus loin et à mettre le credo des économies au service du démantèlement de l’État belge en tant que tel. Devenu ministre du Budget en 1991, leur leader Hugo Schiltz résume en une phrase cette politique à la fois néolibérale et ethnique, ethnolibérale, en germe dans la Loi unique de 1960: «Federaliseren is saneren», fédéraliser revient à assainir. Ou plus exactement, assainir revient à fédéraliser, à démanteler. Cette corrélation infernale entre «réformes» de l’État et «réformes» néolibérales ne s’est plus démentie depuis.
En 2004, la formation séparatiste Nieuw-Vlaamse Alliantie est lancée avec le soutien massif du patronat «progressiste» flamand et d’une bonne partie des médias (y compris francophones). Ce parti est l’incarnation politique tardive de l’idéologie ethnolibérale qui inspire depuis si longtemps le nationalisme flamand. En à peine six ans, il accède au sommet de la particratie belge. En 2014, il mène une coalition comprenant un seul parti francophone (le Mouvement Réformateur, représentant un quart à peine de l’électorat francophone). Son objectif explicite est de durcir les politiques de rigueur néolibérales de manière à dégoûter de leur propre pays «les Francophones» et à les obliger à accepter la scission de ce qui reste de l’État «fédéral», à commencer par la sécurité sociale (en partie déjà scindée par le gouvernement di Rupo). C’est ce qu’il appelle «de Franstaligen uitroken», enfumer les francophones comme des rats.4
En fait, ce n’est pas la Belgique, mais ce qui devrait être son État qui ne fonctionne pas, et pour cause.
Menacé sur sa droite par les néofascistes du Vlaams Belang, la N-VA déserte le pouvoir fin 2018. Il expliquera par réseaux sociaux et médias interposés que «België» ne fonctionne pas. En fait, ce n’est pas la Belgique, mais ce qui devrait être son État qui ne fonctionne pas, et pour cause. Menée depuis des décennies dans une logique mi-particratique, mi-technocratique de rationalisation ethnolibérale, la «chirurgie institutionnelle» belge a produit une complexité contre-productive, qui n’incite toujours pas le «peuple belge» à se déprendre de la Belgique. Cette complexité, la N-VA essaie d’en tirer encore argument pour en réclamer cyniquement la rationalisation ultime: un «confédéralisme» qui a pour préalable la scission totale de l’État belge. Cela fait un an que ce scénario aux relents d’apartheid, sans chiffrage honnête ni feuille de route, est pris au sérieux par la particratie et certains médias qui couvrent les difficiles «négociations gouvernementales».
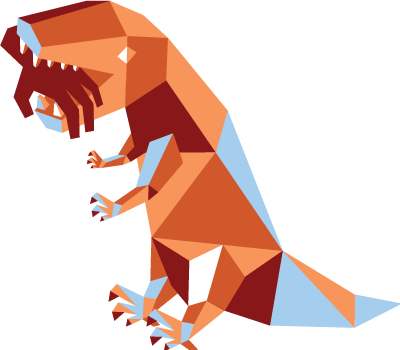 Il y a belle lurette que, avec de tels échafaudages hors sol, la réalité a fini par dépasser la fiction. En dépit du bandeau de la RTBF «Ceci est une fiction», de très nombreux téléspectateurs, habitués à être tournés en bourriques, ont continué de regarder leur écran en croyant de bonne foi qu’il leur montrait la réalité. Le problème dans la non-formation d’un gouvernement depuis le26 mai 2019 n’est pas la N-VA. Certes, le parti séparatiste joue un jeu de poker menteur qui lui réussit d’autant mieux qu’il n’est pas dénoncé comme tel par les partis du gouvernement de Charles Michel. Mais dans la ‘débelgification’de l’État sur des bases ethniques, dans l’invisibilisation des réalités culturelles «bicommunautaires», dans la prise d’otage de la démocratie par la particratie et, enfin, dans la néolibéralisation des politiques publiques, la formation populiste n’a pas joué de rôle de premier plan. L’ethnolibéralisme n’a pas été inventé ni même radicalisé par le mouvement patronal-politique appelé N-VA.
Il y a belle lurette que, avec de tels échafaudages hors sol, la réalité a fini par dépasser la fiction. En dépit du bandeau de la RTBF «Ceci est une fiction», de très nombreux téléspectateurs, habitués à être tournés en bourriques, ont continué de regarder leur écran en croyant de bonne foi qu’il leur montrait la réalité. Le problème dans la non-formation d’un gouvernement depuis le26 mai 2019 n’est pas la N-VA. Certes, le parti séparatiste joue un jeu de poker menteur qui lui réussit d’autant mieux qu’il n’est pas dénoncé comme tel par les partis du gouvernement de Charles Michel. Mais dans la ‘débelgification’de l’État sur des bases ethniques, dans l’invisibilisation des réalités culturelles «bicommunautaires», dans la prise d’otage de la démocratie par la particratie et, enfin, dans la néolibéralisation des politiques publiques, la formation populiste n’a pas joué de rôle de premier plan. L’ethnolibéralisme n’a pas été inventé ni même radicalisé par le mouvement patronal-politique appelé N-VA.
Celui-ci n’a eu qu’à pousser un peu plus loin l’«efficience» ségrégationniste qui préside à une «fédéralisation» vite devenue incontrôlable pour la particratie en place. Il a bénéficié de la «crise» économique mondiale de 2008, puis de la «crise» de l’immigration des années 2015 pour enfin descendre, comme en d’autres temps, le boulevard que lui ont ouvert et soigneusement balayé les zélés serviteurs des «réformes»de l’État successives.
Footnotes
- Pour les dernières recherches sur cet autre passé laissé dans l’ombre, lire Zana Matthieu Etambala, Veroverd. Bezet. Gekoloniseerd. Congo 1876-1914, Gorredijk, Sterck & Devreese, 2020.
- Olivier Boehme, Greep naar de markt. De sociaal-economische agenda van de Vlaamse Beweging en haar ideologische versplintering tijdens het interbellum, Louvain, Lannoo Campus, 2008, p.426.
- Françoise Dreyfus, «La révision générale des politiques publiques, une conception néolibérale du rôle de l’Etat? », Revue française d’administration publique, 4 (2010), 136, p.857-864, p.858.
- Paul Dirkx, «L’autre laboratoire européen du séparatisme. En Belgique, le poker menteur comme méthode de gouvernement», Le Monde diplomatique, 64, 764 (novembre 2017), p.10-11.




