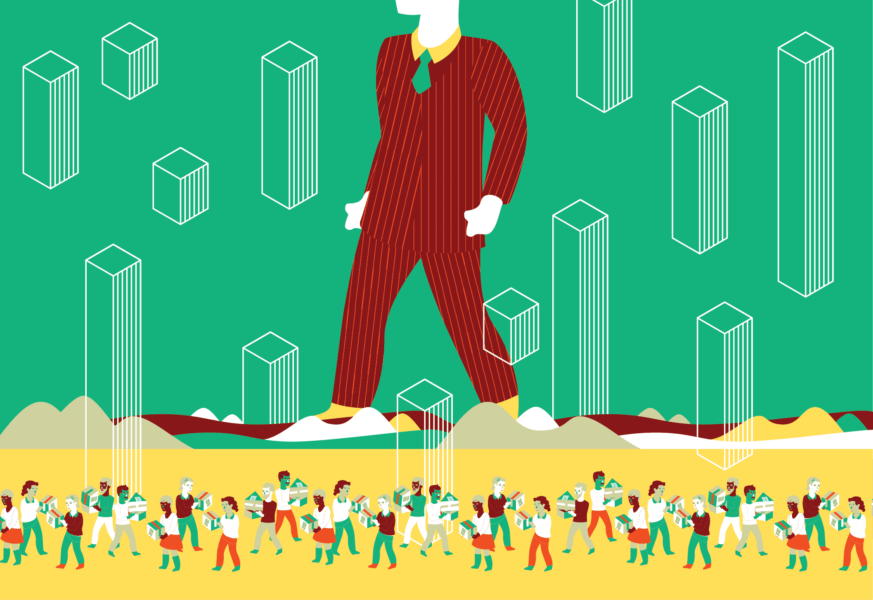Limiter les pathologies dont souffre le capitalisme contemporain à une intensification du néolibéralisme et à une augmentation des inégalités est un diagnostic réducteur. Entretien sur l’état du monde avec la sociologue Saskia Sassen.

Dans son dernier livre, Expulsions. Brutalité et complexité dans l’économie globale, Saskia Sassen donne une série de points de vue, de faits et données chiffrées sur des thèmes aussi variés que la politique d’austérité au Nord, les programmes d’ajustement structurel au Sud, les finances, la pratique du land grabbing (accaparement des terres), le changement climatique, les expulsions locatives, l’incarcération, les populations déportées, les zones mortes dans les eaux océaniques…
L’auteure, qui parvient à assembler harmonieusement le tout, établit des liens surprenants avec certains concepts clés comme les predatory formations (formations prédatrices) et la systemic edge (limite systémique). Elle révèle ainsi la logique systémique de ce qu’elle appelle les expulsions, titre de son dernier livre qui fait ainsi référence aussi bien à l’exclusion des personnes, qu’à la suppression d’emplois ou à la destruction d’habitats, d’économies locales et même de certaines parties de la biosphère.
Ruben Ramboer: Intéressons-nous tout d’abord à votre concept de systemic edge (limite systémique). Vous dites que les fléaux de notre époque sont tellement extrêmes que les statisticiens ne les enregistrent plus. Voulez-vous rendre visibles des tendances plus globales en partant de situations extrêmes?
Saskia Sassen: Prenons un exemple et remontons un peu dans le temps. Dans la seconde moitié du 18esiècle, l’Angleterre apparaissait comme une économie essentiellement rurale. Mais en réalité, l’économie politique dominante était le capitalisme industriel. Les moutons des campagnes alimentaient en laine les machines des usines dans les villes. On pourrait donc dire qu’à l’époque les moutons et les machines se situaient à la «limite systémique», autrement dit, ils évoluaient dans une nouvelle ère industrielle et urbaine malgré les apparences d’économie rurale de l’Angleterre.

Saskia Sassen est sociologue et économiste à l’Université de Columbia. Ses recherches portent principalement sur les villes, les migrations et le rôle de l’État dans l’économie mondiale. Elle est l’auteur, entre autres, d’Expulsions (2014) et de The Global City (1991).
Aujourd’hui, je constate également que l’économie politique en déclin du vingtième siècle a entraîné l’émergence de nouvelles logiques systémiques. Un couloir de la mort a été mis en place dans les années1980 avec la destruction ou la mise sous pression des États-providence et des mouvements ouvriers en Occident et en Amérique latine. Il en a été de même dans les pays communistes, même si cela s’est fait avec des modalités spécifiques pour chacun, ou encore dans d’autres pays comme l’Inde, l’Égypte et plusieurs pays d’Afrique. Dans ces pays, le déclin a commencé dans les années1990. Le passage du keynésianisme à la mondialisation, la privatisation et la dérégulation ont mis en branle une dynamique totalement différente. Nous sommes ainsi passés de l’inclusion et de l’intégration à l’éloignement et à la déportation, du rassemblement au refoulement et à l’exil forcé des personnes.
On ne peut pourtant pas dire que le 20e siècle ait été particulièrement rose et plaisant.
Non, certainement pas. Si je parle de déclin, ce n’est pas pour idéaliser le vingtième siècle. En effet, les principales caractéristiques de ce siècle ont été la guerre, le génocide, la faim, etc. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l’économie politique a surtout été guidée par une logique d’inclusion, avec le développement d’une classe moyenne, des mesures visant à l’intégration des plus pauvres, non seulement en Occident, mais aussi partout dans le monde. En Afrique noire, plusieurs pays ont également connu une période de production de masse, avec des villes florissantes, le développement d’une classe moyenne et des systèmes de soins de santé et d’enseignement efficaces. Aujourd’hui, la limite systémique est devenue un lieu d’exclusion et non plus un lieu d’intégration, comme c’était le cas durant la période keynésienne. À l’époque, il y avait une dynamique de production de masse et de consommation de masse.
Aujourd’hui, les inégalités continuent d’augmenter et il est possible de mieux les décrire en tant que forme d’expulsion. Les inégalités ont toujours été une caractéristique des économies de marché avancées, mais elles sont aujourd’hui d’un tout autre ordre que dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis en sont bien entendu l’exemple le plus significatif. Avant que n’éclate la crise de 2008, la croissance des revenus était élevée, mais extrêmement inégale. La plus grosse partie est allée aux 10%, et plus spécifiquement au 1% des ménages les plus riches. Les 90% restants ont vu leurs revenus diminuer de 4,2% entre 2001 et 2005. Quant au 1% des ménages les plus riches, leurs revenus ont connu une hausse de 280% entre 1979 et 2007. Une tendance qui se poursuit à l’heure actuelle. Si les inégalités entre pays expliquent en grande partie les inégalités mondiales, ce sont les inégalités au sein même des pays qui continuent de croître depuis les années1980 alors que les inégalités entre pays ont diminué.
Aujourd’hui, les inégalités continuent d’augmenter et il est possible de mieux les décrire en tant que forme d’expulsion.
On observe plusieurs mutations brutales dans différents domaines: croissance rapide des bénéfices des grandes entreprises, augmentation rapide des déficits budgétaires, augmentation des populations carcérales au Nord, et de plus en plus de populations déportées au Sud. Chacun de ces domaines a ses spécificités, mais lorsque les conditions deviennent extrêmes, elles contribuent à mettre en route une nouvelle phase, une phase caractérisée par l’éloignement, l’expulsion et l’exclusion. Cela va beaucoup plus loin qu’une simple intensification des inégalités et de la pauvreté. Même si cette tendance n’est pas encore tout à fait visible et identifiable, il faut s’attendre à une généralisation progressive des conditions extrêmes sur la limite systémique.
Le grand nombre de sans-abri, de personnes âgées livrées à elles-mêmes, de personnes vivant dans des bidonvilles, de détenus, de personnes défavorisées sans aucun accès aux services sociaux, etc. est le reflet d’une nouvelle tendance. Sans oublier les économies en déclin, les vastes superficies de terres dévastées, les zones mortes des eaux océaniques, les espèces animales en voie de disparition… L’éradication est donc devenue la principale dynamique sur la nouvelle limite systémique – tant sur le plan économique, social que biosphérique.
En vous focalisant sur les extrêmes, ne risquez-vous pas de vous attarder sur des exceptions plutôt que de révéler ces tendances?
C’est aussi pour cela que je parle de tendances qui ne sont pas encore visibles pour les statisticiens. Le PIB, par exemple, est un indicateur économique extrêmement problématique. La croissance était un facteur fondamental dans le projet d’État-providence. C’était entre autre un moyen pour augmenter les richesses à se partager, même si certains en profitaient plus que d’autres. Aujourd’hui, le PIB est entièrement consacré à la croissance des entreprises. Toute chose ou toute personne qui constitue une entrave aux bénéfices de l’entreprise est écartée – expulsée.
Prenons par exemple, le marché global des terres. Si une entreprise ou un gouvernement étranger fait l’acquisition d’une grande parcelle de terrain pour sa production d’huile de palme à destination des biocarburants, cela revient à déloger des petits agriculteurs, de la production rurale locale et même l’ensemble de la faune et de la flore. C’est là le sort qui est aujourd’hui réservé à d’immenses étendues de terres en Amérique centrale et en Afrique. Il est possible qu’à très long terme, la terre s’amende mais, en attendant, les descendants des agriculteurs et des producteurs ruraux expulsés devront vivre entassés dans des bidonvilles à la périphérie des grandes villes. Tout cela se traduit par la croissance des bénéfices des entreprises et l’accroissement des PIB nationaux.
En ce qui concerne la redistribution des revenus, son évolution est camouflée. Un tiers de la population active est décemment rémunérée. Ses dépenses en vêtements, appartement, voiture personnelle, etc. ont donné l’impression qu’il y avait plus de richesses dans les villes qu’auparavant. La rénovation des centres urbains donne également l’impression que «tout le monde s’en sort particulièrement bien». Le problème, c’est qu’il manque un élément dans ce tableau, à savoir la classe moyenne modeste et la classe ouvrière. Ce sont eux les perdants. Celui qui se promène dans une rue branchée en Occident ne voit pas la paupérisation de la classe moyenne car celle-ci vit toujours dans les mêmes jolies maisons. Mais derrière ces belles façades se cachent d’importants problèmes financiers. De plus en plus de familles sont contraintes de vendre leurs biens pour pouvoir payer leurs factures, de plus en plus de jeunes adultes sont contraints de vivre chez leurs parents car ils ne trouvent pas de logements abordables. Pour moi, ces situations extrêmes permettent de mieux comprendre la dynamique plus globale, apparemment moins extrême, de nos économies politiques.
Tout cela nous amène aux politiques d’austérité en Europe. La Grèce, l’Espagne et le Portugal sont, selon vous, «les laboratoires d’expérimentation des décideurs européens». Que voulez-vous dire par là?
Les mesures qui ont été imposées à ces pays sont extractives et touchent plus durement la classe ouvrière, mais aussi la classe moyenne modeste. Les banques et les multinationales jouissent d’une liberté de mouvement absolue. Les gouvernements occidentaux, les banques centrales et le FMI insistent sur la nécessité de réduire la dette publique, d’épargner sur le budget de la sécurité sociale si on veut qu’elle reste «payable», de déréguler. C’est le discours dominant. Cela permettrait de restaurer la confiance des investisseurs et des marchés financiers, condition sine qua non d’une reprise économique.
De plus en plus de familles sont contraintes de vendre leurs biens pour pouvoir payer leurs factures.
Autrement dit, on nous promet qu’une fois les excès corrigés, nous reviendrons à une situation normale, comme aux beaux jours de la période d’après-guerre. Or, cette promesse empêche de voir à quel point ce monde a bel et bien disparu et aussi à quel point les entreprises n’en veulent plus, quoi qu’en disent les politiciens. Ce qu’elles veulent c’est un monde où les gouvernements dépensent de moins en moins pour les services publics et les besoins sociaux. On a affaire à un projet de réduction, non pas des bénéfices des entreprises, mais de l’espace économique du pays.
La transformation brutale de la Grèce illustre parfaitement ce qui vient d’être dit. La classe moyenne modeste mais aussi la classe moyenne plus aisée ont été massivement exclues de l’accès à l’emploi, aux services sociaux, aux soins de santé et au logement. Un tiers de la population active grecque s’est retrouvée sans travail ni accès aux services de base. La Grèce, mais aussi l’Espagne et le Portugal montrent à quel point l’espace économique peut être réduit. Ce genre de réduction n’est pas quelque chose d’habituel dans un pays en développement qui n’est pas en guerre. Les chômeurs ont tout perdu. Sans travail, sans logement, sans assurance maladie, ils se retrouvent facilement sur la touche. Les petits indépendants coulent. Faim et suicides augmentent. Les étudiants et professionnels hautement qualités émigrent. De nombreux enfants sont confiés aux églises par des parents trop pauvres pour pouvoir les nourrir.
Cela ressemble beaucoup à une forme d’épuration ethnique sur le plan économique qui consiste à résoudre les problèmes en les éliminant. Les exclus n’apparaissent plus dans les chiffres et leur impact négatif sur la croissance est neutralisé. Cette redéfinition de l’économie la rend à nouveau présentable en matière de chiffres, avec même une légère augmentation du PIB par habitant. Ainsi, après avoir exclu près de 30% de son économie, la Grèce a été déclarée «sur la bonne voie» par la Troïka, en route vers une reprise économique.
Dans l’UE des 27, le risque de pauvreté concerne 120millions de personnes, soit 24,2% de la population. Ces personnes sont extrêmement défavorisées sur le plan matériel ou vivent avec de très faibles revenus. Pour le chômeur de longue durée, le petit indépendant en faillite, le détenu, la personne qui met fin à ses jours au Nord ou pour les populations déportées au Sud, c’est un tout autre discours. Mais la tendance suit une seule et même direction: l’expulsion.
Existent-ils des indicateurs qui d’une manière ou d’une autre prennent en compte les tendances que vous décrivez?
Le Genuine Progress Indicator (GPI) est un indicateur qui inclut les facteurs sociaux et les coûts environnementaux dans les calculs, de sorte qu’il tient également compte du coût de la pollution, de la criminalité, des inégalités ainsi que des activités qui génèrent des richesses en dehors du commerce de l’argent, comme le travail domestique et le bénévolat. Une étude menée dans 17pays, représentant près de la moitié de la population mondiale, a démontré que le GPI a connu un pic en 1978 mais que, depuis, il n’a cessé de diminuer malgré un PIB par habitant en constante augmentation.
Les tendances sont également visibles au niveau des chiffres relatifs à l’impôt. Au cours de la première décennie du 21esiècle, la croissance des profits aux États-Unis a été trois fois plus rapide que celle de l’impôt récolté. Selon Richard Murphy, l’évasion fiscale des multinationales et des plus riches s’élevait, en 2010, à 3000milliards d’euros au niveau de l’économie mondiale. Ce qui représente 5% de l’économie mondiale et près de 18% des recettes fiscales mondiales. Les grands perdants dans toute cette histoire, ce sont les gens. Et cette situation est la plus manifeste aux États-Unis où les revenus des 90% n’ont cessé de diminuer depuis le début du 21esiècle, tandis que ceux des 10%, et en particulier du 1%, ont connu une hausse phénoménale.
Les autorités sont donc aussi confrontées à des difficultés financières. L’appel à réduire la dette publique semble dès lors assez logique, non?
Toute cette problématique autour de la dette est en réalité un régime disciplinaire. Ce que nous connaissons aujourd’hui en Europe sous le vocable d’assainissement de la dette publique ressemble très fort aux Programmes d’ajustement structurel (PAS) imposés au Sud par le FMI et la Banque mondiale à partir des années1980. Ces programmes ont repositionné les pays concernés en tant que sites d’extraction. Après vingt ans de PAS, un grand nombre de ces pays se retrouvent avec une dette publique beaucoup plus élevée qu’auparavant. Entre 1982 et 1998, le montant de leur dette a quadruplé. Au cours de cette même période, ils ont remboursé en intérêts quatre fois le montant de leur dette d’origine. Ils ont remboursé plus d’argent au FMI que ce qu’ils ont investi dans le développement, et notamment pour la santé et pour l’enseignement. Pour chaque dollar d’aide étrangère, les pays africains paient 1,4dollar en coûts financiers liés à la dette.
En définitive, c’est pratiquement la totalité de l’Afrique et une importante partie de l’Amérique latine et de l’Asie centrale qui sont repositionnées dans une économie mondiale massivement restructurée avec une demande croissante de terres et terrains pour la nourriture, l’eau et les minéraux. Après des décennies d’amortissement de la dette et de concurrence de la part d’entreprises étrangères, il ne reste pas grand-chose des secteurs économiques modernes de ces pays. La destruction des économies traditionnelles a facilité l’accès à ces terres pour les entreprises et gouvernements étrangers. Les entreprises locales et la classe moyenne ont été balayées par le brain drain, les conflits militaires et les PAS. Partout dans le monde, les dettes des États-nations ont augmenté. Pour éviter l’effondrement, on a fait appel aux sociétés financières, avec comme conséquence le fait qu’une importante partie des revenus a servi à payer les intérêts sur la dette. C’est là une forme extrême de capitalisme extractif.
Comment l’industrie financière est-elle un processus d’extraction? Quelle est la différence entre finance et banques traditionnelles?
Les finances font partie de notre histoire depuis des millénaires. En soi, il n’y a aucun problème avec les dettes et les instruments financiers. Ils peuvent permettre en effet la réalisation de projets d’envergure, comme l’assainissement de sites toxiques ou les investissements dans une énergie plus verte ou encore dans le social. En Chine, le capital financier a permis de sortir de la pauvreté un nombre considérable de personnes. Toutefois, ce sont là des investissements dans la production, l’infrastructure et autres économies matérielles. C’est le contraire d’une financiarisation des crédits à la consommation, hypothèques, prêts étudiants, pensions, fonds municipaux, etc.
Ce qui est nouveau et caractéristique de la période actuelle, c’est la capacité de la finance à créer des instruments extrêmement complexes qui permettent de pratiquement tout titriser. La question est de savoir si nous avons besoin d’instruments financiers aussi complexes pour financer les besoins fondamentaux des entreprises et des familles. La réponse est non. Les banques traditionnelles vendent de l’argent qu’elles ont en leur possession, les sociétés financières quant à elles vendent une chose qu’elles ne possèdent pas.
Cette problématique autour de la dette est en réalité un régime disciplinaire.
Pour y parvenir, la finance doit envahir et conquérir — titriser — les secteurs non financiers, dans son propre intérêt et pour son avantage. La titrisation, c’est la relocalisation d’un immeuble, d’un bien ou d’une dette dans le circuit financier. Là, il devient mobile et peut être acheté et vendu sur des marchés proches ou lointains. Grâce aux produits financiers complexes, des éléments qui relèvent de la sphère familiale (bourses d’études, prêts automobiles, dettes municipales) sont titrisés. Les ingénieurs financiers construisent ensuite de longues chaînes d’instruments de spéculation qui tous reposent sur la prétendue stabilité de l’input. Nous n’avons plus affaire ici aux mathématiques des modèles micro-économiques, mais aux mathématiques de la physique. Et les coulisses de Goldman Sachs pullulent de physiciens.
Quelles sont les conséquences de cette financiarisation?
Entre 2006 et 2010, 13,6millions de ménages ont fait l’objet d’une expulsion aux États-Unis. C’est là une forme brutale d’accumulation primitive et le résultat d’une opération extrêmement complexe recourant à des expertises en finance, droit, comptabilité et mathématiques. Suite à la perte de recettes fiscales pour les communes, c’est l’ensemble des zones métropolitaines qui va devoir payer les frais. La décision de sauver les banques avec l’argent du contribuable a engendré une diminution de la croissance, une augmentation de la pauvreté parmi les citoyens et pour les gouvernements, et elle a conduit à des politiques d’austérité. Par contre, la global finance a de nouveau engrangé des superprofits.
D’une certaine manière, la finance a radicalement transformé notre monde de bien des façons. La titrisation et la ventilation ont caché ce qui était en train de se passer, et le tourbillon de la titrisation a détruit à grande échelle les économies saines, les dettes publiques saines et les ménages sains. Si quelque chose va mal, la nature brutale de la violence économique affleure à la surface, comme avec les expulsions locatives massives dans des pays aussi divers que les États-Unis, l’Espagne ou la Lettonie. Ou encore les pertes massives de fonds municipaux à la suite de la spéculation.
Prenons le logement. Dans les comptes de l’État, on le retrouvait aux rubriques secteur de la construction, marché immobilier et marché hypothécaire. Mais depuis les années1980, les hypothèques ont été titrisées, divisées en plusieurs composantes plus petits et associées à d’autres et finalement transformées en instrument financier pour la spéculation. L’instrument pouvait servir de garantie dans le circuit de l’investissement et la valeur du logement ou de l’hypothèque ne comptait plus. Résultat: on s’est retrouvé avec un instrument extrêmement complexe et opaque. Dans ce paquet, aucun élément ne représente la maison entière. La source de profit, ce n’est plus le paiement de la traditionnelle hypothèque mais la vente du paquet financier qui contient des centaines de fragments d’hypothèque. De plus, selon la logique de la finance, il est également possible de faire du profit en spéculant sur la chute du cours.
Selon Giovanni Arrighi, lorsque les finances spéculatives deviennent dominantes au cours d’une période donnée, c’est que cette période est proche du déclin. Sommes-nous en train de vivre un tel moment?
Dans un certain sens, oui. Mais cela prendra du temps. D’une certaine manière, nous sommes aveuglés par la multiplication des immeubles de standing, des boutiques chics, des restaurants branchés dans les centres urbains. La croissance paraît dominante, mais en réalité elle est très partielle et sélective. Elle repose sur la paupérisation de plus de la moitié des ménages. On sait aujourd’hui que les bénéfices engrangés par les couches les plus riches de la population ne ruissellent pas vers le bas. On sait aussi que les épidémies causées par la pauvreté et un système de soins de santé inadapté finiront à terme par également toucher les plus riches. Cela fait partie des limites de la financiarisation.
Avant la crise de 2008, la valeur (fictive) des produits financiers dérivés en circulation s’élevait à 630000milliards de dollars, soit 10fois le PIB mondial. Un tel décalage ne s’était encore jamais vu en Occident. Quelques années après la crise, après que des milliards se sont envolés en fumée, et après la faillite de nombreuses entreprises, pouvoirs publics, ménages et économies entières, elle a à nouveau augmenté et est passée à 800000 milliards de dollars en 2012, et à 1million de milliards en 2013. La force de la finance, et donc ce qui la rend si dangereuse, c’est sa capacité à amasser des fortunes même lorsque les ménages, les économies et les gouvernements perdent de la valeur.
Il ne faut pas oublier que la crise de 2008 n’est pas la première de ce type. Les crises récurrentes sont caractéristiques de ce système financier. Aux États-Unis, il y a eu depuis le krach boursier de 1987 cinq grandes opérations de sauvetage des banques. À chaque fois, c’est l’argent des contribuables que l’on a injecté dans le système financier. Quant à l’industrie financière, elle a utilisé cet argent comme nouveau levier, avec pour objectif encore plus de spéculation et plus de profit, et non pas le remboursement des dettes, puisque, aujourd’hui, cette industrie est entièrement tournée vers la dette.
La finance a besoin de conquérir de nouveaux secteurs économiques pour pouvoir se développer. Mais une fois qu’elle a soumis l’essentiel de l’économie à sa logique, elle se heurte à ses propres limites, et la spirale descendante semble s’enclencher. Lorsque dans un secteur tout est financiarisé en une longue chaîne d’instruments financiers, il n’y a plus de valeur à extraire. Arrivé à ce stade, la finance a besoin de nouveaux secteurs non financiarisés. Le fait que les sociétés financières soient capables de miser à la fois sur la croissance d’un secteur et sur son déclin en est un exemple mordant. Goldman Sachs a développé d’un côté des produits dérivés qui ont facilité l’accès de la Grèce à l’UE et, d’un autre côté, elle a développé des instruments pouvant déboucher sur des profits en cas de banqueroute du pays.
La pratique du land grabbing, ou accaparement des terres, est une autre forme d’expulsion. Selon Oxfam, des terrains d’une superficie totale égale à huit fois celle du Royaume-Uni auraient été vendus ou loués entre 2000 et 2010. Cet accaparement des terres est peut-être moins violent, mais il est beaucoup plus dévastateur que les conquêtes territoriales de l’époque impériale. Pourquoi?
La pratique de l’accaparement des terres est un phénomène qui s’est développé au cours des vingt dernières années. Le recours de plus en plus fréquent à cette pratique n’est pas très visible. Mais de fait, trente gouvernements et une centaine d’entreprises possèdent des terres à l’étranger, en particulier en Afrique mais aussi en Amérique latine et dans des régions plus pauvres d’Europe. Parmi les entreprises qui recourent à cette pratique, les entreprises minières sont les plus connues. Même si les économies de plantations y recourent très probablement beaucoup plus. De nombreux pays ont acquis de vastes parcelles de terre à l’étranger pour la culture d’aliments et matières premières biologiques. Tout cela se fait au nom d’une énergie plus verte, mais il n’y a pas grand-chose de vert là-dedans.
Partout dans le monde, les dettes des États-nations ont augmenté.
L’acquisition de terres à l’étranger n’est pas un problème en soi. Cela se fait depuis très longtemps. Le problème, c’est que la forte augmentation de ces acquisitions affecte considérablement la nature des économies locales – la propriété foncière et la souveraineté de l’État sur son territoire. L’accaparement des terres n’a strictement rien à voir avec l’implantation d’une usine Ford génératrice d’emplois en Europe ou d’une usine Volkswagen au Brésil.
Les terres acquises par les étrangers sont de vastes superficies de territoire national incluant villages, petites exploitations agricoles et districts industriels ruraux. L’accaparement des terres balaie cette complexité politico-structurelle. Des millions de petits propriétaires fonciers sont expulsés. Le territoire national est relégué au rang de propriété foncière étrangère destinée à des plantations qui chassent les gens, suppriment les économies locales et détruisent la biosphère.
Il n’y a pas que le problème d’accaparement des terres, il y a aussi l’accaparement des eaux. En pratiquant la fracturation hydraulique, les entreprises minières sont devenues les plus grosses consommatrices d’eau, qu’en outre elles polluent, directement et indirectement. Les fabricants de sodas et embouteilleurs d’eau ont également augmenté leur consommation d’eau. Nestlé, par exemple, a construit de gigantesques pipelines et utilise d’immenses navires-citernes pour transporter l’eau sur de longues distances. On estime que d’ici 2030, la demande en eau aura augmenté de 50%. Certains parlent de l’eau comme du «nouveau pétrole». Le grand patron de Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, a déclaré à propos de la privatisation des ressources hydriques: «Il faut attribuer à l’eau un prix du marché, car l’eau est un nutriment comme un autre». Pour lui, considérer l’eau comme un droit public est une «solution extrême».
Dans «Terre morte, eau morte», le dernier chapitre de votre livre, vous brossez un tableau plutôt apocalyptique de la terre: six énormes décharges dans les océans contenant 7millions de tonnes de plastique, 400zones côtières cliniquement mortes, 75% des terres agricoles infertiles en Amérique centrale, concentrations de méthane dans l’eau, séismes causés par la fracturation hydraulique, pollution chimique…
C’est mon chapitre favori. J’aime le titre «Terre morte, eau morte». Le terme «changement climatique» est beaucoup trop propre. Pour parler de ces phénomènes brutaux, il faut des termes brutaux.
J’aimerais aborder une des conséquences de cette destruction, à savoir la migration. L’Europe, l’Australie et les États-Unis ont réagi en construisant des murs, des camps, des centres fermés et des push backs. «Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde» est un argument souvent entendu. Ou encore: «La Convention de Genève ne s’applique pas aux candidats à l’Eldorado.»
Je trouve particulièrement pénible la manière dont sont dépeints les réfugiés que l’on présente comme des candidats à l’Eldorado alors que ce sont les entreprises occidentales qui ont expulsé les populations rurales locales avec leur pratique d’accaparement des terres. Pourquoi sont-ils si nombreux à fuir le Honduras, le Salvador ou le Guatemala? Les petits agriculteurs ont été chassés de leur terre par les milices privées des riches propriétaires terriens. Les réfugiés forment la deuxième moitié du cycle généré par l’accaparement des terres pratiqué par les pays riches. La migration commence dans les bureaux des directions des multinationales et des quartiers généraux militaires. Mais personne ne fait le lien entre ces événements.
Auparavant, le prototype du migrant c’était la personne qui mettait sur pied son petit commerce, qui envoyait de l’argent à ses proches et rêvait de pouvoir rentrer au pays rendre visite à sa famille ou y retourner pour de bon. Mais aujourd’hui, on a affaire à une nouvelle forme de migration, avec comme épicentres la mer Méditerranée, l’Amérique centrale et la mer d’Andaman. Ce qui pousse les gens à partir, ce n’est plus vraiment la quête d’une vie meilleure, mais la destruction de leur habitat. Des familles et communautés entières ont ainsi été chassées. Elles n’ont plus d’endroit où aller. L’endroit où se trouvait leur maison est devenu une plantation, une zone de guerre, un désert, une mine, une zone inondée, une ville privée. Toutes ces personnes qui ont été chassées et expulsées de leur maison, de leur terre ou de leur travail viennent alimenter les réseaux criminels de trafic et traite d’êtres humains.
Toutes les formes de dégradation de la qualité du sol, de l’eau et de l’air touchent beaucoup plus durement les communautés défavorisées. On estime que cette dégradation a engendré 800millions de déportés dans le monde, dont 80% sont accueillis par le Sud. La population de réfugiés a un impact économique beaucoup plus important sur le Sud en général. Au Pakistan, par exemple, on a 605réfugiés pour 1USD de PIB par habitant; en Allemagne, seulement 15. Ce sont donc les pays les plus pauvres qui portent le fardeau.
Vous dites que nous nous trouvons à l’aube d’une nouvelle ère, une ère marquée par les expulsions. Mais vous écrivez également que ces tendances ne sont ni des exceptions ni le résultat d’une crise. Mais, au contraire, le résultat d’une «intensification systémique des relations capitalistes». Quelle est la différence avec des concepts comme «accumulation par dépossession» (David Harvey), «accumulation primitive» (Karl Marx) ou «rupture métabolique» (John Bellamy Foster)? Le terme «expulsion» apparaît un peu comme un concept fourre-tout.
J’aime tous les termes que vous citez. Si j’ai opté pour le terme «expulsion», c’est non seulement pour mettre en lumière cette situation de privation, mais aussi la violence active. Je mets également l’accent sur les dynamiques actuelles qui engendrent des expulsions à très grande échelle, plutôt que sur les dynamiques qui existent depuis le début du capitalisme. Par ailleurs, tout cela se fait en utilisant le terme de développement économique. L’utilisation de ce terme est une invitation à ne pas penser, à ne pas approfondir, à ne pas chercher… Le développement, cela ne peut être que positif, non?! Ce sont nos référentiels qui rendent cette distorsion possible. La plantation se développe, le PIB par habitant augmente, mais les conséquences pour les 200petits agriculteurs qui produisaient de la nourriture pour les habitants locaux et ceux des villages voisins ne sont pas prises en compte… Elles sont totalement invisibles dans les livres comptables. C’est là le problème. Les concepts d’expulsion/exclusion ainsi que celui de formations prédatrices facilitent mes recherches. J’avais besoin de déstabiliser les définitions en place. Je voulais aussi que la notion de «territoire» ait une plus grande résonance dans cet ensemble de concepts.
La migration commence dans les bureaux des directions des multinationales et des quartiers généraux militaires.
On peut dire que le rapport entre capitalisme avancé et capitalisme traditionnel est caractérisé par l’extraction et la destruction, un peu comme la relation entre le capitalisme traditionnel et les économies précapitalistes. Avec du recul, le capitalisme avancé est probablement entré dans une nouvelle phase dans les années1980: une période qui a réinventé les mécanismes d’accumulation primitive. Certaines formes de croissance extrêmement destructrices sont considérées comme positives. Finalement, cela conduit à la paupérisation et à l’exclusion d’un nombre toujours plus grand de personnes qui ont perdu leur utilité en tant que travailleurs et consommateurs. Des acteurs économiques qui jouaient autrefois un rôle fondamental dans le développement du capitalisme, comme la petite bourgeoisie et la bourgeoisie traditionnelle nationale, sont devenus inutiles.
Le sous-titre de votre livre est « Brutalité et complexité dans l’économie globale » . Vous insistez sur le fait que les brutalités ne sont pas des actes directs et univoques commis par les multinationales ou les plus riches, et sur le fait qu’il n’est pas simple de montrer du doigt la Banque mondiale ou le FMI. Pour vous, ces brutalités sont le fait de «formations prédatrices» plutôt que d’une poignée d’individus ou de multinationales qui tirent les ficelles. Pouvez-vous préciser?
Pour comprendre comment la complexité engendre la brutalité, prenons l’exemple du commerce du carbone, principale «innovation» des accords interétatiques pour sauvegarder le climat. Dans les faits et dit assez brutalement, le commerce du carbone n’est rien d’autre que le combat de pays qui cherchent à étendre leur droit de polluer. Ce que veulent les gouvernements, c’est soit augmenter leur droit de polluer par le biais de quotas «légaux», soit augmenter les quotas qu’ils peuvent revendre aux autres gouvernements qui voudraient polluer davantage. L’objectif n’est donc pas de réduire la destruction, mais d’obtenir pour son pays un droit de détruire le plus étendu possible.
Cela entraîne un décalage profond entre la situation de la planète et la logique dominante qui régit les réponses et les politiques adoptées. Les États profitent de la politique climatique qui fait consensus: le commerce du carbone. Atmosphère polluée, terre dévastée et océans à l’agonie sont devenus une généralité, une réalité détachée du paysage géopolitique et de la politique dominante.
Ce que je veux faire comprendre, c’est que ce ne sont pas simplement des entreprises et personnes qui entrent en jeu. Il s’agit de formations beaucoup plus complexes qui s’alimentent l’une l’autre et se répètent. En raison de cette complexité, déclarer illégales les pratiques d’accaparement des eaux par Nestlé, par exemple, ne suffit pas. Nestlé accapare l’eau de centaines de sites à l’insu des gouvernements ou sans qu’ils puissent exercer le moindre contrôle. Nestlé peut ainsi extraire l’eau des sites jusqu’à la dernière goutte, et c’est seulement à ce moment-là que ses actions apparaissent au grand jour. Je défends donc la thèse selon laquelle on n’a pas vraiment affaire à une élite prédatrice, mais plutôt à des formations prédatrices, un mélange d’élites avec des capacités systémiques, la finance intervenant comme principal facilitateur.
Ces formations poussent à la concentration. La concentration au sommet n’est pas une nouveauté bien sûr. Ce qui est inquiétant, c’est la forme extrême qu’elle revêt aujourd’hui. En 2012, les cent milliardaires les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 240milliards. Cela suffirait à éradiquer quatre fois la pauvreté dans le monde. Aujourd’hui, les structures où se produit cette concentration sont des assemblages complexes d’éléments multiples. La concentration n’est pas le résultat du transfert des richesses par une poignée de bandits. Un système capable de concentrer autant de richesses à une telle échelle est un système à part, totalement différent du système qui, à une époque, a été capable d’accroître les richesses de la classe ouvrière et de la classe moyenne en Occident en général, dans une grande partie de l’Amérique latine et dans certains pays d’Afrique, comme la Somalie par exemple.
Quelles sont les conséquences de ces complexités pour la résistance et la lutte des classes? Comment lutter contre ces formations prédatrices? Les zones où se trouvent les exclus «ne sont pas des trous noirs», écrivez-vous, mais de nouveaux chantiers potentiels qui créent de nouvelles économies locales, de nouvelles histoires et de nouvelles formes d’appartenance.
En effet, les endroits vers lesquels les gens ont été chassés pourraient devenir des laboratoires pour le développement de nouvelles formes d’économie ou d’autres formes de société. Ce qui veut dire que chaque site local a de l’importance, et ce à un niveau global. Bien sûr, c’est là un défi. Une chose qui n’est pas simple à organiser. Même si les possibilités existent, cela ne sera pas facile. Pour commencer, il va falloir reconnaître les conséquences négatives de tout ce qui a été et est encore considéré comme croissance positive. Il va falloir faire pression sur les autorités nationales, mais aussi locales. Nous avons 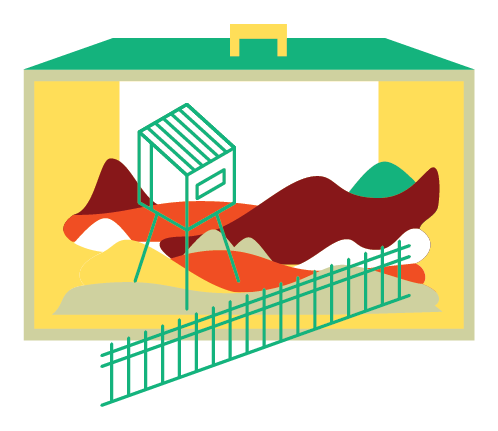 besoin de l’expertise du monde entier pour pouvoir étudier et écrire sur ce qui se passe dans le monde. Je pense que nous en sommes au tout début. Cela ne sera jamais une opération totalement aboutie, mais cela permettra de mobiliser et de révéler au grand jour les destructions et extractions, qui sont trop souvent camouflées.
besoin de l’expertise du monde entier pour pouvoir étudier et écrire sur ce qui se passe dans le monde. Je pense que nous en sommes au tout début. Cela ne sera jamais une opération totalement aboutie, mais cela permettra de mobiliser et de révéler au grand jour les destructions et extractions, qui sont trop souvent camouflées.
Saskia Sassen, Expulsions. Brutalité et complexité dans l’économie globale, Paris, Gallimard, 2016.