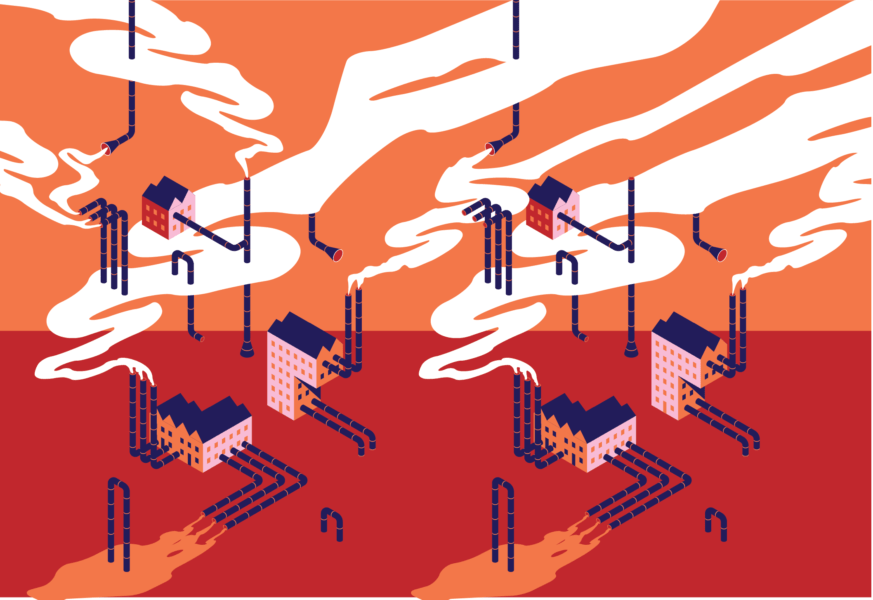En inscrivant la responsabilité des dérèglements climatiques dans la sphère individuelle, les partisans de la cause climatique l’ont dépolitisée.

Un des enjeux majeurs soulevés par les changements climatiques d’origine humaine est celui de la transformation des modes de production et de consommation. Si cette transformation paraît unanimement indispensable, la question de ses modalités reste, elle, en suspens. Du côté des pouvoirs politiques, la transition « écologique » ou « énergétique » est devenue une catégorie d’action publique justifiant le soutien aux divers dispositifs qui explorent des alternatives en matière de commerce (circuits courts, ressourceries1), d’agriculture ou d’aménagement urbain (« quartiers en transition », « incroyables comestibles»2). Sans doute y a-t-il là matière à se réjouir dans la mesure où ces initiatives tendent à favoriser l’invention ou la revalorisation de manières de produire, de consommer et de vivre susceptibles de s’affranchir des logiques marchandes et concurrentielles. Demeure cependant entiers deux problèmes qui s’enchâssent. D’une part, celui de la résistible récupération et dilution de ces alternatives confrontées aux tentations de l’institutionnalisation. D’autre part, celui de l’extension sociale de ces initiatives qui, pour le dire vite, amusent les plus privilégiés et indiffèrent ou étonnent les plus précarisés.
La modification des comportements individuels ne se décrète pas.
Appréhender ces deux enjeux suppose d’affronter ouvertement la dimension politique de la cause climatique : une transformation durable (dans les deux sens du terme) des modes de production et de consommation suppose un bouleversement des logiques de distribution des pouvoirs de toute sorte et, donc, des rapports de force entre les classes sociales. Il s’ensuit que, pour échapper aux aspirations commerciales ou institutionnelles et conserver leur vitalité critique, les alternatives doivent assumer et nourrir leur dimension contestataire et conflictuelle. Car, comme expliqué dans la première partie de ce texte, la question climatique est principalement dépeinte comme un problème marchand, technologique et moral. Or ces cadrages dépolitisants ont pour conséquence non pas tant une transformation des modes de consommation et de production qu’un renforcement de l’ordre social capitaliste. La seconde et la troisième sections montrent ainsi comment les classes favorisées voient les logiques de leur domination consolidées par une telle valorisation publique des enjeux climatiques. La dernière partie conclut sur la nécessité pour le mouvement écologiste de ne pas délaisser sa composante critique et combative.
L’éco-citoyen, le marché et la technologie
Mes enquêtes sociologiques ont notamment mis au jour comment, en France au cours des années 2000, s’est installée une morale éco-citoyenne soutenue par une constellation d’acteurs mobilisés pour sonner l’alarme climatique : ministère de l’environnement, experts et scientifiques, journalistes ou encore militants écologistes ont fédéré leurs énergies pour sommer tout un chacun de prendre quotidiennement en main l’avenir de la planète3. Unes de journaux, numéros spéciaux de magazines, documentaires, films, publicités, brochures, salons, festivals, essais : depuis une quinzaine d’années la plupart des supports culturels surfent régulièrement sur la vague éco-citoyenne. Car ce qu’il y aurait de bien avec l’écologie, c’est que tout le monde pourrait agir, chacun pourrait faire sa part. D’où vient cette croyance et qu’en est-il réellement ?
Le postulat selon lequel la prise de conscience façonne la pratique est souvent mis en avant par des spécialistes de psychologie comportementale dont les présupposés ne sont pas si éloignés de ceux des économistes néo-classiques théorisant le « choix rationnel ». En situation d’information pure et parfaite, les individus se comporteraient rationnellement. Murmurant à l’oreille des décideurs, ces experts autoproclamés du changement soulignent par exemple l’importance de véhiculer des messages positifs, encourageants, non culpabilisants et non alarmistes. Ils incitent à travailler les imaginaires en créant des récits climatiques inspirants. En France, des psychologues médiatiquement réputés mais académiquement marginaux tels que Beauvois et Joule ont, aux côtés des communicants de l’État, consolidé une doxa que j’ai qualifiée de « sensibilisatrice »4. Face à un problème jugé abstrait et lointain dans le temps et dans l’espace, il convient de sensibiliser, dans les deux sens du verbe : rendre sensible les perturbations climatiques pour faire prendre conscience de la nécessité pour tout un chacun d’agir. Un dispositif central de cette doxa a été la campagne de communication du ministère de l’Environnement dont la signature fut, pendant près de neuf ans : « Économie d’énergie, faisons vite, ça chauffe. »5 En inscrivant la responsabilité des dérèglements climatiques dans la sphère privée des comportements individuels plutôt que dans la sphère publique des choix collectifs, les partisans de la cause climatique l’ont dépolitisée. Certes ils ont ainsi assuré sa valorisation publique. Mais ils l’ont également lessivée de sa portée idéologique, maintenant ainsi à l’abri de la critique les causes structurelles de l’amplification et de l’accélération des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre).
L’individualisation du problème climatique perpétue cette dimension centrale de l’ordre social qu’est la hiérarchie des styles de vie.
À la faveur de la mobilisation pour la COP21 en 2015 à Paris, la perspective d’une « transformation écologique des sociétés », et non plus seulement des individus, marque cependant une possible inflexion de ces raisonnements et discours dominants. Le récit des solutions s’impose à l’ensemble des protagonistes avec en particulier un pavillon officiel des solutions au Grand-Palais et un village militant des solutions à Montreuil. Chacun doit poursuivre la réforme écologique de son mode de vie, mais les acteurs politiques et économiques sont aussi sommés d’œuvrer à une « transition » vers une économie décarbonée, vers une société postcarbone. Cette conception du changement est sans doute un peu plus politique que celle qui prévalait jusqu’à présent. Sauf que ce sont les approches économiques et technologiques qui se taillent la part du lion. La déclaration finale de la conférence « Our Common Future under Climate Change », ayant réuni près de 2 000 scientifiques à l’Unesco en juillet 2015, en atteste. Des six solutions proposées, la quatrième est ainsi la plus emblématique de l’esprit du texte quand elle précise que : « Un objectif ambitieux d’atténuation nécessitera toute une série de mesures, parmi lesquelles les investissements dans la recherche, le développement et le transfert de technologies ; l’élimination progressive des subventions aux énergies fossiles ; et la mise en place d’une tarification du carbone. » Ces visions dominantes de la « transformation » tendent à se satisfaire d’une réorganisation des activités commerciales qui repose sur la (re)conversion de certains secteurs d’activités et la réorientation des investissements, l’amélioration de l’efficacité énergétique des appareils productifs et l’invention de nouveaux procédés de fabrication ou de nouveaux modes de déplacements et d’échanges. « Inventer » et « innover » forment les deux maîtres-mots de cet écologisme technologique qui a trouvé un second souffle dans le web 2.0 et les récentes promesses de l’économie circulaire ou collaborative. En somme, ce ne serait pas tant la société qu’il s’agirait de transformer que ses infrastructures, en particulier économiques6.
Le marché et la technologie devraient donc être les moteurs du changement. Au-dessus de la mêlée des rapports sociaux, ils seraient au service de l’éco-citoyen. Ce dernier constitue en effet un prolongement indispensable, dans la sphère domestique, de l’idéologie du capitalisme vert autrement qualifiée, par le vocable managérial, de « modernisation écologique ». Si l’économisation des questions écologiques est un processus bien étudié7, sa déclinaison dans la philosophie éco-citoyenne a été moins remarquée. Les deux tendances avancent pourtant de concert. La prolifération de normes édictant les comportements éco-vertueux est solidaire de ressorts économiques. La bonne conduite des individus est en effet récompensée, « incitée », par des gains financiers. Les prêts à taux zéro, les crédits d’impôts, les bonus-malus, les éco-vignettes, le jeu des taxations ou les politiques d’étiquetage des performances écologiques des biens (« écolabelling ») constituent autant de dispositifs cherchant à actualiser des dispositions comptables chez les individus. Ceux-ci sont notamment encouragés à anticiper les gains à moyens termes d’une légère hausse de leurs dépenses à court-terme ; ils gagnent à maîtriser les ruses de leur feuille d’imposition pour, par exemple, se montrer stratèges en matière de déplacement et entrepreneurs en matière de logement.
Cette approche n’est pas complètement saugrenue : on peut en effet observer des franges non négligeables de la population s’efforcer de souscrire à ces injonctions morales valorisant un ethos comptable. Elle pèche cependant par cécité sociale : d’une part, elle ne perçoit pas l’insuffisance des réorientations verdoyantes qui n’érodent que très marginalement l’empreinte carbone des éco-vertueux ; d’autre part, elle tient à distance la plupart des classes populaires qui ne se reconnaissent pas dans ces prescriptions normatives célébrant la prévoyance du long terme et la réflexivité du moindre geste. Plus précisément, l’examen sociologique des rapports que les Français entretiennent avec l’éco-citoyenneté donne ainsi à voir8 :
- Une indifférence des fractions les plus démunies et instables des classes populaires. Non pas que leurs membres ne soient pas inquiets des risques environnementaux, conscients de leurs expositions aux pollutions et familiers des écosystèmes naturels, mais ils se préoccupent moins de glaner des profits symboliques en adoptant les mœurs et pratiques « à la mode ». « On n’a pas les moyens de se la péter écolo », résume un enquêté. Pour ces personnes, il importe moins de faire attention à la planète qu’à son porte-monnaie.
- Un désintérêt des fractions économiques des classes populaires établies dont les enquêtés n’ont certes pas d’aversion pour l’éco-citoyennisme, mais orientent tous leurs efforts pour flirter avec les promesses de la société de consommation, ce qui ne laisse que peu de place au souci de verdir le quotidien pour le vernir symboliquement. Tout au plus concèdent-ils, comme cette enquêtée, que si « ça ne me coûte rien de le faire, je le fais. »
- Une adhésion soutenue des fractions culturelles de ces classes populaires établies et « petits-moyens »9 dont les membres se montrent les plus disposés à verdir autant que faire se peut leurs faits et gestes, et ce pour des motifs proprement environnementaux. Travaillant souvent dans les métiers du care ou pour la « main gauche de l’État » (Bourdieu), ils font valoir une intégration sociale où le symbolique et le sens des autres priment sur le matériel et le confort personnel. C’est au sein de ces franges de la population que se recrute une grande partie des personnes prenant part aux diverses alternatives écologiques.
- Une adhésion tiraillée au sein des fractions culturelles des classes moyennes et favorisées : soucieux des enjeux écologiques d’un côté, ils se heurtent de l’autre aux exigences liées à leur appartenance aux classes favorisées. Ils sont ainsi incités par leurs pairs à mener un train de vie pas toujours en phase avec leurs aspirations éthiques. Il apparaît de surcroît que l’adoption d’attitudes écologiques n’est pas seulement motivée par des raisons environnementales mais vient répondre à des désirs sanitaires (comme manger sainement) ou de confort (comme l’isolation). Cette dilution des préoccupations écologiques dans une pluralité de ressorts de l’action, dont on s’aperçoit qu’ils sont moins altruistes qu’ils ne le prétendent de prime abord, se retrouve au sein des différentes fractions des classes privilégiées.
- Un verdissement à éclipse et une adhésion distinctive au sein des fractions économiques des classes moyennes et supérieures. La norme de la réforme de soi y est valorisée conformément à la conception néolibérale et postmoderne d’individus supposés réflexifs et autonomes. Ces enquêtés manifestent ici ou là leur bonne conscience écologique tout en maintenant un rythme de vie global générant d’importantes pollutions. Ils adhèrent à l’aspect comptable et gestionnaire qui accompagne la promotion des éco-gestes. Un enjeu est ici d’équiper et de valoriser symboliquement l’enrichissement économique.
Ces constats, indicatifs, s’appuient sur des déclarations de pratique. Ils ne renseignent pas les comportements effectifs, mais la façon dont ceux-ci sont mis en avant. Ils éclairent non pas la mise en pratique des comportements réputés éco-vertueux, mais les usages sociaux des normes éco-citoyennes. Or une caractéristique de ces préceptes est de ne jamais pointer du doigt les modes de vie les plus nocifs pour la planète dont on sait qu’ils sont encore les plus valorisés socialement et caractéristiques des classes privilégiées : mobilité fréquente, rapide et lointaine, multi-équipement, exploitation de grandes surfaces, etc. Alors qu’on pourrait s’attendre à ce que les enjeux écologiques soient l’occasion pour les fractions culturelles des classes dominantes d’affirmer ce qui les distingue de leurs voisinages sociaux10, la morale éco-citoyenne contribue plutôt à un adoucissement des clivages entre les différentes fractions des classes privilégiées et bien intégrées socialement. L’ordre social s’en trouve d’autant plus consolidé que lorsqu’on descend dans la hiérarchie sociale, on observe une dynamique inverse, les distensions entre les fractions culturelles et économiques des classes populaires s’accentuant face à cette morale de classe faite par, et finalement pour, les catégories relativement aisées de la population.
Préserver les les styles de vie dominants et polluants
Autrement dit, l’individualisation des enjeux climatiques bénéficie doublement à ceux qui, pourtant, adoptent les styles de vie les plus énergivores11. D’une part, elle leur permet d’afficher une bonne conscience écologique sans avoir à réviser substantiellement leurs modes de vie. D’autre part, elle renforce leur cohésion interne et leur pouvoir de domination. Elle rend effectivement possible la neutralisation, par digestion, de la critique dont leurs systèmes de valeur pourraient faire l’objet dans un contexte de détérioration des écosystèmes naturels. Inversement, l’éco-citoyennisme inflige une double peine aux classes populaires : ils sont tenus à distance de l’engouement affiché pour l’écologie et ils se trouvent collectivement fragilisés face à ces injonctions morales qui peuvent en séduire quelques-uns mais en laissent beaucoup indifférents. De surcroît, alors que leurs modes de vie, matériellement contraints, sont les moins pollueurs, ils sont aussi les plus vulnérables face aux nuisances environnementales. Enfin, ces paradoxes de l’éco-citoyenneté atteignent leur comble dès lors que le manque de civisme généralement attribué aux plus défavorisés soupçonnés de salir la nature continue, à en croire nos entretiens, d’être le stigmate le plus répandu sur le terrain écologique. On aperçoit ainsi l’intérêt heuristique de coupler l’étude des inégalités d’exposition aux pollutions avec l’analyse des inégalités de contribution à ces mêmes désastres écologiques. Il apparaît notamment que l’individualisation du problème climatique perpétue cette dimension centrale de l’ordre social qu’est la hiérarchie des styles de vie. C’est pourtant à une redéfinition des critères de la « réussite » qu’il faudrait politiquement œuvrer.
En somme, le verdissement des comportements individuels obéit moins à des injonctions morales qu’à des conditions matérielles d’existence. En d’autres termes, tenir compte des prescriptions éco-citoyennes requiert des ressources inégalement distribuées, notamment une certaine stabilité socioprofessionnelle rendant possible la projection dans un avenir plus ou moins proche. À rebours des prophéties psychologisantes postulant un possible changement par les mentalités et la culture, les sciences sociales rappellent que nos désirs, nos aspirations et nos visions du monde s’ancrent dans, et s’ajustent à, nos possibilités objectives et matériellement ordonnées, pas l’inverse. Par exemple, on observe que ce sont des changements biographiques d’ordre structurel qui entraînent une modification durable des modes de vie : déménagement, séparation ou mise en couple, arrivée ou départ d’un enfant, obtention ou perte d’un emploi, etc. Il s’ensuit que seule une profonde transformation de l’organisation sociale et de ses règles de fonctionnement semble à même d’engendrer des révisions massives de comportements individuels. Il paraît donc urgent de politiser le changement en cherchant à modifier prioritairement non pas les comportements individuels mais les institutions sociales à travers lesquelles les individus intériorisent des principes de classement de ce qui compte, des critères d’évaluation de ce qui est légitime, principes et critères qui gouvernent le goût pour certaines pratiques et l’aversion pour d’autres.
Changements structurels ?
Non seulement la modification des comportements individuels ne se décrète pas, mais elle ne saurait aboutir à une organisation sociale dont la matrice principale serait dictée par les impératifs écologiques. Pour saisir comment celle-ci peut s’esquisser et à quoi elle pourrait ressembler, il faut se tourner vers les diverses expérimentations et réappropriations collectives des territoires, de la technologie, de la mobilité, des temporalités ou des institutions politiques. Les entrepreneurs de monnaies locales, d’épiceries solidaires, de chantiers participatifs ou de permaculture aident à saisir le sens et la substance des changements structurels qu’exigent les enjeux écologiques. Mais, pour faire face à la récupération dépolitisante par les experts et décideurs conventionnels, cette composante positive et constructive de la critique doit absolument s’articuler à une seconde composante de la critique, celle négative et combative de l’écologie politique. Car faute de défaire l’existant, par exemple la valeur symbolique des styles de vie dominants et des mécanismes qui les portent, les alternatives « citoyennes » encourent le risque d’être récupérées par l’ordre social capitaliste12. Celui-ci, comme l’ont bien montré Eve Chiapello et Luc Boltanski, endogénéise constamment les critiques et opère par réajustements permanents ; il « a besoin de ses ennemis, de ceux qu’il indigne et qui s’opposent à lui, pour trouver les points d’appui moraux qui lui manquent et incorporer des dispositifs de justice dont il n’aurait sans cela aucune raison de reconnaître la pertinence. »13 On ne compte ainsi plus les offres écologiques récupérées, institutionnalisées et ce faisant vidées par les tenants du pouvoir de leur potentiel critique et alternatif. Si les éco-quartiers ou le bio ont pu constituer des perspectives subversives, ils sont devenus des industries devant attester des belles intentions qui pavent le capitalisme.
Le combat contre des intérêts structurés et prédateurs ne se passe pas dans la convivialité.
Cette tendance tient à une proximité construite de longue date entre une large partie du mouvement écologiste et les décideurs économiques. Depuis les années 1980, le premier s’acculture progressivement aux logiques des seconds qui, ce faisant, tendent à considérer les membres de la « société civile » moins comme des opposants que comme des partenaires stratégiques. Les uns comme les autres partagent un rejet des contestations « radicales », des subversions « agressives », des changements « conflictuels » ou des lectures systémiques des enjeux. Les uns comme les autres se montrent prêts à négocier des changements incrémentaux, parcellaires, progressifs, doux, sans heurts ni malheurs. Cette vision se veut fédératrice. Elle mobilise les registres du défi, de la citoyenneté heureuse, du dynamisme, de l’inventivité, de la créativité. Que l’on soit politiquement de droite ou de gauche importe peu tant que, dans la joie et main dans la main, nous apportons tous notre grain de sel au réformisme écologique. L’enthousiasme semble tel qu’il devient difficile de procéder à un examen critique de ces perspectives. Pourtant, derrière ces récits visant à rendre « sexy » des problèmes jugés déprimants, se niche, nous l’avons vu, un psychologisme caractéristique des classes moyennes (et) supérieures et se joue la disqualification de conceptions du changement plus structurelles, plus matérielles et peut-être aussi plus réalistes.
 En effet, les réformes visant à changer de l’intérieur les règles du jeu se heurtent à des limites proprement sociales dans la mesure où lorsqu’elles sont mises en œuvre par des agents toujours attachés aux logiques prévalant dans la situation précédente, celle-ci a toutes les chances de persister sous une forme ou sous une autre. Le mouvement écologiste doit donc, en son sein, résister aux sirènes du « réformisme », du « pragmatisme » et de « l’incrémentalisme » qui le conduisent bien souvent à dissoudre ses élans transformateurs dans une bienveillance crédule à l’égard des tenants de l’ordre établi. Cela suppose de continuer à lutter diversement dans les ZAD ou contre les exploitations d’énergies fossiles. Car le combat contre des intérêts structurés et prédateurs ne se passe pas toujours dans la convivialité. Si faire preuve de réalisme sociopolitique conduit parfois au désenchantement, c’est aussi prévenir. On ne pourra pas engager une transformation des sociétés à la hauteur des dégâts environnementaux en cours en se contentant d’innovations en tout genre qui sont certes bienvenues mais insuffisantes. La crise écologique requiert un sursaut collectif pour une transformation sociale, radicale, pleinement politique.
En effet, les réformes visant à changer de l’intérieur les règles du jeu se heurtent à des limites proprement sociales dans la mesure où lorsqu’elles sont mises en œuvre par des agents toujours attachés aux logiques prévalant dans la situation précédente, celle-ci a toutes les chances de persister sous une forme ou sous une autre. Le mouvement écologiste doit donc, en son sein, résister aux sirènes du « réformisme », du « pragmatisme » et de « l’incrémentalisme » qui le conduisent bien souvent à dissoudre ses élans transformateurs dans une bienveillance crédule à l’égard des tenants de l’ordre établi. Cela suppose de continuer à lutter diversement dans les ZAD ou contre les exploitations d’énergies fossiles. Car le combat contre des intérêts structurés et prédateurs ne se passe pas toujours dans la convivialité. Si faire preuve de réalisme sociopolitique conduit parfois au désenchantement, c’est aussi prévenir. On ne pourra pas engager une transformation des sociétés à la hauteur des dégâts environnementaux en cours en se contentant d’innovations en tout genre qui sont certes bienvenues mais insuffisantes. La crise écologique requiert un sursaut collectif pour une transformation sociale, radicale, pleinement politique.
Footnotes
- Une ressourcerie gère sur un territoire la collecte et la valorisation de déchets.
- Les « incroyables comestibles » sont des exploitations communautaires de petits potagers disséminés, mis à disposition des habitants.
- Jean-Baptiste Comby, La question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public, Paris, Raisons d’agir, 2015.
- Promouvant leurs approches auprès des institutions publiques, notamment auprès de l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie, ils ont publié un livre ayant rencontré un succès commercial important : Jean-Louis Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2002.
- Pour une analyse sociologique de cette campagne d’une durée inédite, avec un volet partenarial significatif et l’appui des psychologues précités, voir : Jean-Baptiste Comby, « Faire du bruit sans faire de vagues. Une analyse sociologique de la communication de l’Etat sur les questions climatiques », Communication, vol. 31 (2), 2013.
- Le rapport remis par Alain Grandjean (économiste, membre des conseils scientifiques du Shift Project et de la Fondation Nicolas-Hulot) et Pascal Canfin (ancien ministre du Développement, conseiller au World Resource Institute) au président de la République le 18 juin 2015 et intitulé « Mobiliser les financements pour le climat » offre un autre exemple de l’emprise de ces visions économicistes et technologistes de la « transformation ». Celles-ci s’élaborent dans des think-tank tels que The Shift Project. Redesigning the Economy to Achieve Carbon Transition, dernière consultation le 22 septembre 2015.
- Yannick Rumpala, Régulation publique et environnement, questions écologiques/réponses économiques, Paris, L’Harmattan, 2003.
- Nous nous appuyons là sur des données fraîchement analysées (publications scientifiques en cours) : 84 entretiens en population générale réalisés entre 2013 et 2017, et financés par l’Agence nationale de la Recherche (projet « Ressorts Sociaux de la Conversion Écologique »).
- Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet, Yasmine Siblot, La France des « petits-moyens ». Enquêtes sur la banlieue pavillonnaire, Paris, La Découverte, 2008
- Lindsey B. Carfagna et al., « An emerging eco-habitus : The reconfiguration of high cultural capital practices among ethical consumers », Journal of Consumer Culture, 14(2), 2014, pp.158–178 ; Rebecca Elliott, « The taste for green : The possibilities and dynamics of status differentiation through ‘ green’ consumption », Poetics, n° 41, 2013, p. 294–322.
- Nous nous permettons de renvoyer au chapitre 5 de notre ouvrage et dans lequel nous convoquons diverses statistiques confirmant ce que deux collègues belges avaient déjà remarqué : « Du point de vue environnemental, ne vaut-il pas mieux être pauvre et mal informé que riche et conscientisé ? », Joël Dozzi et Grégoire Wallenborn in Cornut Pierre, Bauler Tom et Zaccaï Edwin (dir.), Environnement et inégalités sociales, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2007, pp. 49-57. Pour une illustration amusante de cette réalité sociologique, voir la capsule vidéo de Groland sur le développement durable : www.dailymotion.com/video/x8n2mo.
- Par ordre social capitaliste, nous entendons : les mécanismes qui, en structurant la distribution des richesses matérielles et symboliques, ordonnent de façon plus ou moins hiérarchique les relations entre les groupes sociaux dans une société où priment les raisonnements marchands à des fins capitalistiques. Cette proposition conceptuelle rejoint une définition du capitalisme comme « configuration historique spécifique des rapports marchands et des structures étatiques au sein de laquelle l’obtention d’un gain économique privé par tous les moyens, ou presque, est un objectif primordial et la mesure de tout succès. » (Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, Craig Calhoun, Le capitalisme a-t-il un avenir ?, Paris, La Découverte, 2014, p. 16). Et ces cinq spécialistes de l’histoire sociale et politique du capitalisme de poursuivre en suggérant que : « L’émergence d’une organisation différente et plus satisfaisante du marché et de la société humaine n’est nullement exclue. »
- Luc Boltanski, Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.