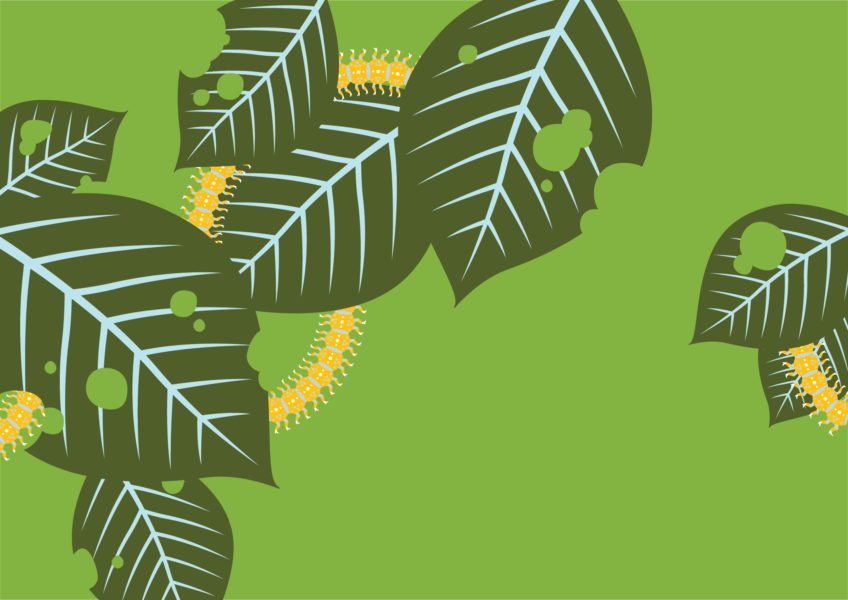La thèse de Mariana Mazzucato regorge de vérités puissantes qui forment l’essence de l’économie hétérodoxe moderne. Sa conception de la valeur n’échappe toutefois pas à certains sérieux écueils.
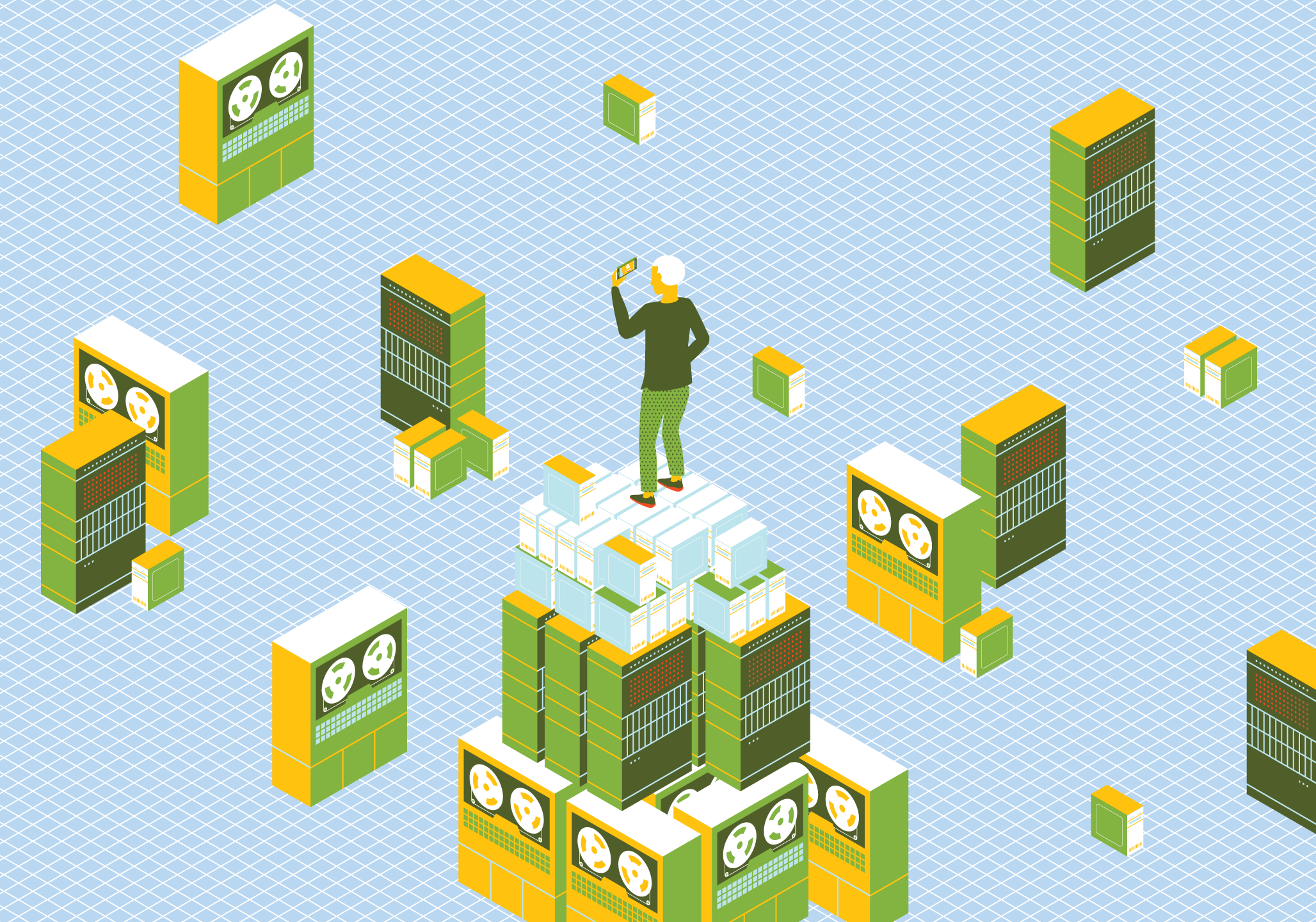
Selon Quartz magazine1, elle serait l’une des économistes les plus influentes au monde. D’origine italo-américaine, Mariana Mazzucato vit et travaille en Grande-Bretagne. Auteure de travaux récompensés à maintes reprises, elle conseille le parti travailliste britannique sur les questions de politique économique. La représentante radicale au Congrès américain Alexandria Ocasio-Cortez fait elle aussi appel à ses lumières, tout comme la sénatrice Elizabeth Warren, possible prochaine candidate démocrate à la présidence américaine, ainsi que la dirigeante du parti national écossais Nicola Sturgeon. Elle vient par ailleurs de remporter l’anti-Nobel d’économie qui récompense la ou le meilleur économiste anti-establishment de l’année2.

Elle a écrit deux ouvrages majeurs: The Entrepreneurial State (2013)3 et a (2018)4. Dans les cercles économiques et politiques classiques et conservateurs, on la considère comme radicale, voire inquiétante. Mariana Mazzucato a en effet mis en lumière le rôle important qu’ont pu jouer États et gouvernements dans la création d’innovations technologiques et l’apport d’investissements productifs. Or, la plupart des économistes et politiques néolibéraux classiques de droite, forts de leur foi en la liberté du marché, frémissent à l’idée d’un État moteur d’innovation et d’investissement dans des activités utiles.
L’état entrepreneur
Dans son premier livre, The Entrepreneurial State, elle révèle que les nouvelles technologies des 20e et 21e siècles, loin d’être l’œuvre d’inventeurs isolés ou d’entrepreneurs capitalistes dynamiques, doivent au contraire leur développement à des institutions publiques et étatiques. Car oui, ce sont des financements publics qui ont permis de concevoir et de réaliser les grandes avancées technologiques, sociales, productives ou encore les progrès majeurs dans les soins de santé. On pense ainsi au web mondial et à Internet, nés de la course à la conquête spatiale et d’investissements dans le domaine de la défense.
D’Internet aux nanotechnologies, la plupart des grands progrès, ont été financés par le gouvernement.
Comme l’explique Mariana Mazzucato: «L’histoire de la Silicon Valley n’est pas celle d’un État démissionnaire qui aurait laissé le champ libre à des capitalistes audacieux et des bricoleurs du dimanche disposés à prendre des risques. D’Internet aux nanotechnologies, la plupart des grands progrès, tant au niveau de la recherche fondamentale que de la commercialisation à grande échelle, ont été financés par le gouvernement. Les entreprises ne s’en sont mêlées qu’à partir du moment où elles ont vu qu’il y avait du profit à en tirer. Toutes les technologies innovantes liées à l’iPhone, que ce soit Internet, le GPS, l’écran tactile ou encore l’assistant vocal Siri, ont été financées par le gouvernement.»
Elle poursuit: «À l’origine, Apple a touché 500.000 dollars de la Small Business Investment Corporation, un outil de financement public du gouvernement américain. Compaq et Intel ont, elles aussi, bénéficié d’aides provenant non pas de capitaux-risques, mais bien d’un programme appelé Small Business Innovation Research (SBIR). En effet, les investisseurs en capital-risque exigeant un retour de plus en plus rapide, les prêts et bourses du SBIR ont dû intervenir davantage dans le financement de départ de divers projets des départements de la Santé ou de l’Énergie des États-Unis. 75% des médicaments les plus innovants n’ont pas été financés par des géants de l’industrie pharmaceutique ou des investisseurs en capital-risque, mais bien par l’Institut national de santé publique (NIH). Au cours de la décennie passée, le NIH a investi 500 milliards de dollars (dont 32 milliards rien qu’en 2012) dans la recherche fondamentale dans le domaine biotechnologique et pharmaceutique. Les investisseurs privés se sont effectivement intéressés à l’industrie des biotechnologies vers la fin des années 1980 et le début des années 1990, mais les gros investissements dans ce secteur ont tous été réalisés entre les années 1950 et 1970.» En d’autres termes, c’est le contribuable qui a permis à des milliardaires tels que Steve Jobs ou Jeff Bezos de devenir «uber» riches.
Mariana Mazzucato démontre que les investissements privés issus de capitaux-risques ou de sociétés financières privées sont plus nuisibles que profitables à la société. «Les investisseurs privés sont arrivés 20 ans après que l’État a subventionné les secteurs les plus à risque et les plus gourmands en capitaux. Et leur volonté d’engendrer des bénéfices en trois à cinq ans n’a pas fait de bien à l’industrie. Ce secteur regorge aujourd’hui d’entreprises qui ne produisent rien et contribuent peu à l’économie, au-delà des bénéfices que les investisseurs privés empochent au moment de revendre leurs parts.»
C’est le contribuable qui a permis à des milliardaires tels que Steve Jobs ou Jeff Bezos de devenir «uber» riches.
Dans son excellent ouvrage, The Bleeding Edge, Bob Hughes5 nous montre aussi comment le capitalisme et la quête du profit détournent l’innovation des besoins réels des gens et retardent la mise en adéquation des deux. Ainsi, en 1935, le Kodachrome, le premier film disponible dans le commerce, n’a pas été inventé par une entreprise capitaliste, mais bien dans une cuisine, par deux musiciens créatifs à leurs heures perdues. Aucune entreprise n’a non plus consacré de temps ni d’argent à tenter d’établir s’il était possible de faire voler un avion avec des passagers à bord. Ce sont les frères Wright qui s’en sont chargés, dans leur coin. Il en va de même pour la xérographie (privatisée plus tard par Xerox) ou la disquette informatique (que s’appropriera IBM). Tous ces progrès ont été réalisés par des individus durant leur temps libre et, bien souvent, sans l’aval de leur employeur, plus enclin à consacrer des recherches à des systèmes permettant de s’enrichir rapidement qu’à l’innovation.
L’un des cas d’espèce les plus célèbres est celui du Colossus, le premier véritable ordinateur numérique programmable, développé durant la Deuxième Guerre mondiale par des ingénieurs de la Poste britannique, dans le giron public. Au lendemain de la guerre, ces pionniers ont été réaffectés à leurs emplois préalables et le développement des ordinateurs est resté en jachère pendant des dizaines d’années, faute d’intérêt de la part des entreprises. Une étude du Brookings Institute a révélé que c’était l’État qui avait assuré 75% du financement destiné au développement de l’informatique en 1950. Les entreprises privées se montrant réticentes à embrayer, il faudra attendre les années 80 pour voir le potentiel de cette innovation s’épanouir.
Ce n’est donc pas un hasard si l’on observe un ralentissement de la productivité depuis le début des années 1980. Le capitalisme connaît en effet depuis lors la période dite néolibérale, marquée notamment par un déclin brutal de la participation de l’État au PIB des économies capitalistes les plus développées. Depuis, les investissements provenant du secteur capitaliste n’ont jamais généré le même taux de productivité par habitant que les périodes antérieures, où les gouvernements investissaient davantage. Dans les années 1970, la baisse de la rentabilité dans toutes les grandes économies a freiné les investissements publics dans les technologies et le «capital humain», afin de réduire les taxes sur le capital et de maintenir un faible niveau salarial. L’heure était alors à la privatisation, ce qui a, certes, légèrement amélioré la rentabilité dans le secteur capitaliste (avec toutefois des baisses successives), mais l’a fait au détriment de l’augmentation de la productivité.
La valeur dans nos économies
Ceci nous amène au second livre de Mariana Mazzucato, The Value of Everything6. Elle tente d’y définir qui (et ce qui) crée de la valeur dans nos économies. Une tâche pour le moins complexe que tous les grands économistes du capitalisme ont tenté de résoudre depuis Adam Smith: «Qui crée réellement de la richesse dans notre monde? Et comment déterminons-nous la valeur ainsi générée ?»
Dans son ouvrage, elle suit le raisonnement suivant: 1) les comptes nationaux ne tiennent pas compte de la valeur créée par les budgets publics via leur contribution aux investissements et à l’innovation; 2) la finance s’est insinuée dans ces comptes sous prétexte qu’elle serait productive et créatrice de valeur alors qu’en réalité, elle ne fait qu’ «extraire» de la valeur de secteurs productifs et que générer spéculation et dictature du court terme, etc.; 3) le capitalisme moderne voit se développer un secteur monopolistique plus occupé à traquer les bénéfices qu’à créer de la valeur.
Mariana Mazzucato affirme: «Jusqu’aux années 1960, la finance n’était généralement pas considérée comme un secteur “productif” de l’économie. On estimait qu’elle contribuait au transfert de la richesse existante, mais pas à la création de nouvelles richesses. Et, en effet, les économistes étaient tellement convaincus de cette fonction de simple intermédiaire qu’ils ne jugeaient même pas utile d’intégrer la plupart des services bancaires (acceptation de dépôts, octroi de crédits) dans leur calcul des biens et services produits par l’économie. La finance ne figurait dans leurs mesures du produit intérieur brut (PIB) qu’en tant qu’ “intrant intermédiaire”, soit un service contribuant au fonctionnement d’autres industries elles-mêmes créatrices de valeur. Le vent a tourné vers 1970. Les comptabilités nationales, qui représentent sous forme statistique la taille, la composition et l’orientation d’une économie donnée, ont alors commencé à inclure le secteur financier dans le calcul du PIB, à savoir la valeur totale des biens et services produits par l’économie en question.»
Et aujourd’hui, «Ce n’est pas uniquement l’ampleur du secteur financier qui pose problème ni le fait qu’il se développe plus vite que l’économie non financière (par exemple l’industrie). Le problème, c’est son effet sur le comportement du reste de l’économie, dont de grandes parties ont été “financialisées”. Les opérations financières et la mentalité qu’elles engendrent se sont infiltrées dans l’industrie. On le voit lorsque les managers préfèrent consacrer une plus grande partie de leurs profits à racheter leurs propres parts, faisant grimper les prix des actions, les stock-options et les salaires des dirigeants, au lieu d’investir dans l’avenir à long terme de l’entreprise.»
Les investisseurs recherchent désormais un rendement à court terme, ce qui réduit le réinvestissement des bénéfices, accroît le poids de la dette et rend l’industrie encore plus soumise aux diktats du court terme. Un cercle vicieux. «Dans le capitalisme moderne, “extraire de la valeur” rapporte davantage que d’en créer. Pourtant, le processus de production à l’origine d’une économie et d’une société saine repose justement sur la création de valeur. Lorsque l’on voit des entreprises gérées uniquement de manière à maximiser la valeur des parts des actionnaires ou lorsque l’on voit les prix exorbitants de certains médicaments, ce que les grands groupes pharmaceutiques justifient en invoquant la “tarification de la valeur”, on confond faire et prendre. Nous avons perdu de vue le sens véritable de la notion de valeur.»
La thèse de Mariana Mazzucato regorge de vérités puissantes qui forment l’essence de l’économie hétérodoxe moderne. Sa conception de la valeur n’échappe toutefois pas à certains sérieux écueils. Affirmer que le gouvernement «crée» de la valeur, c’est mal comprendre la loi de la valeur dans le capitalisme. Dans un système capitaliste, les biens (marchandises et services) sont produits pour être vendus et générer du profit. Ces biens doivent avoir une valeur d’usage (être utiles à quelqu’un), ainsi qu’une valeur d’échange (pouvoir être vendus pour réaliser un profit). Dans cette perspective capitaliste, le gouvernement ne crée pas de valeur. Au contraire, il est considéré comme un coût (nécessaire) réduisant la rentabilité de la production et de l’accumulation capitaliste. C’est précisément là tout le biais de la notion de produit intérieur brut (PIB), en tant qu’instrument de mesure de la valeur créée dans une économie donnée: il reflète en effet beaucoup plus les valeurs d’échange que la production de toutes les valeurs d’usage, qui comprendraient les services publics et le travail domestique (voire aussi le bonheur, le bien-être et la confiance).
Un gouvernement crée naturellement aussi de la valeur d’usage (même si elle provient souvent de sources destructrices, telles que les armes classiques et nucléaires, les produits chimiques ou encore les forces de sécurité destinées à protéger les intérêts du capital). Il ne produit cependant ni valeur ni valeur ajoutée pour le capital. Or, le capital ne croit pas à l’idée que tout aurait une valeur. La seule valeur qui compte à ses yeux, au final, c’est la valeur d’échange et non la valeur d’usage.
Mariana Mazzucato souligne très justement que le secteur financier ne crée pas de valeur. Selon les économistes marxistes, il ne sert qu’à faire circuler la valeur créée par la force de travail dans les secteurs productifs (ces secteurs qui accroissent la productivité de la force de travail et, dès lors, l’accumulation du capital). En échange d’une partie de la valeur ajoutée, les banques et le système de crédit contribuent à réduire les coûts des transferts d’argent (collecte des dépôts et octroi de prêts) afin que les entreprises puissent emprunter efficacement et assurer une circulation fluide du capital. Cependant, ce rôle central dans la circulation et, partant dans l’accumulation du capital, décroît de plus en plus par rapport à la vocation plus risquée de la finance et du crédit d’investir dans du «capital fictif» (actions et obligations).
Dans son livre, Mariana Mazzucato évoque les travaux d’Andy Haldane, actuel économiste en chef à la Banque centrale britannique, qui a calculé la valeur ajoutée, en part du PIB, apportée par le secteur financier à l’économie au sens large7. Selon ses estimations, aux États-Unis, la valeur ajoutée des intermédiaires financiers atteignait 1,2 billion de dollars en 2010, soit 8% du PIB total du pays. Au Royaume-Uni, la valeur ajoutée de la finance représentait environ 10% du PIB en 2009. Aux États-Unis, la part de la finance dans le PIB a presque quadruplé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour Andy Haldane, ces chiffres illustrent en réalité le fait que les banques consentent des prêts et des investissements à haut risque. Elles se retrouvent de ce fait extrêmement vulnérables lorsqu’éclate une bulle financière ou immobilière, et cela se produit régulièrement.
Dans la droite ligne de la théorie de la valeur de Marx, Haldane conclut: «L’acte d’investir du capital dans des actifs à risque est une caractéristique fondamentale des marchés capitalistes. Ainsi, un petit investisseur qui achète des parts d’une société prend un risque, sans pour autant contribuer d’aucune manière à l’activité économique mesurée. De même, un ménage qui décide de consacrer toutes ses liquidités à l’achat d’une maison, au lieu d’emprunter de l’argent à la banque et d’y laisser une partie de ses comptes, prend un risque de liquidité. Ces actions ne dynamisent en rien l’activité économique générale ni la productivité du secteur économique. Elles se limitent à redistribuer le risque au sein du système sans en modifier ni la taille ni la forme fondamentale.» Un document de travail du FMI a d’ailleurs démontré que, outre le fait que les banques sont régulièrement à l’origine de crises financières, le secteur financier produit sur le long terme un effet globalement négatif (sinon parasitaire) sur les secteurs productifs de l’économie capitaliste8.
La finance est un secteur clairement improductif. Mais il n’est pas le seul. L’immobilier, la publicité et les médias commerciaux, entre autres, ne sont pas des secteurs «productifs» car la main-d’œuvre qu’ils emploient ne crée pas de nouvelle valeur, mais se limite à répartir et à faire circuler la valeur et la valeur ajoutée créées par d’autres secteurs. Toute économie capitaliste repose donc sur la rentabilité des secteurs productifs et non sur la somme des valeurs d’usage produites.
Reforme ou remplacement du capitalisme ?
Si l’on en croit Mariana Mazzucato, avant l’avènement du secteur financier au lendemain des années 1970, le capitalisme ne posait pas problème. Est-ce à dire qu’avant 1970, le monde n’avait jamais connu de monopoles avides de profit ni de crises de surproduction ou d’investissement? Et qu’il avait existé, vers 1890, 1930 ou 1960, un merveilleux mode de production capitaliste productif, compétitif et équitable ?
Pourquoi le capitalisme est-il devenu de plus en plus «improductif» et «en recherche de profit»? Pourquoi la finance est-elle soudain apparue dans les années 1970, finissant par s’insinuer dans les mesures du PIB avec les modifications que cela implique? Mariana Mazzucato ne répond à aucune de ces questions. Ici encore, la théorie de la valeur de Marx nous offre quelques clés de compréhension. Entre le milieu des années 1960 et le début des années 1980, la rentabilité des secteurs productifs de toutes les grandes économies capitalistes plonge. C’est à cette période que le capitalisme est entré dans son âge dit néolibéral, synonyme de destruction de l’État-providence, de musellement des syndicats, de privatisations, de mondialisation, mais aussi de financiarisation. Et cette financiarisation (soit la quête de profit à partir de l’achat et de la vente d’actifs financiers à l’aide de nouvelles formes de produits dérivés) est devenue un moyen essentiel de contrer cet effondrement de la rentabilité. Pour le capital, réduire le coût de l’État et augmenter la rentabilité, notamment via la spéculation financière et la chasse au profit monopolistique, ne résultent pas d’un choix mais d’une nécessité.
Lors d’un entretien sur Bloomberg TV à l’occasion de la parution 9, le présentateur a demandé à Mariana Mazzucato comment convaincre les dirigeants de grandes multinationales d’innover et d’investir de manière productive au lieu de se contenter de racheter leurs parts pour en gonfler les prix et de verser des dividendes plus élevés à leurs actionnaires (par exemple dans le cadre de spéculations financières). Elle a répondu que c’était une question de choix, que certaines entreprises investissent plus productivement que d’autres. Nous devons donc apparemment ouvrir les yeux des entreprises réticentes et leur montrer qu’elles font fausse route. Pour Mariana Mazzucato, le gouvernement devrait «favoriser les secteurs innovants et ceux qui créent réellement de la valeur». Mais est-ce vraiment possible dans une économie dominée par le capital (et les monopoles)? Un gouvernement disposé à mettre en place un système de propriété commune et un contrôle démocratique pour abolir la mainmise du capital sur les décisions d’investissement et pour faire pencher la balance en faveur des «créateurs de valeur» serait pour le moins radical. Or, l’auteure ne soutient expressément pas une telle évolution.
Les économistes orthodoxes continuent de douter fortement de la capacité de l’État à produire de la valeur ajoutée pour le capitalisme. Dans sa critique de l’ouvrage de Mariana Mazzucato10, Martin Wolf, correspondant économique au Financial Times, regrette: «J’aurais préféré une étude approfondie de comment et quand les gouvernements ajoutent de la valeur. (…) Comment s’assurer que les gouvernements créent de la valeur au lieu de se contenter de l’extraire et la gaspiller? Dans son enthousiasme pour le rôle que pourrait jouer l’État, l’auteure minimise gravement les risques réels d’incompétence et de corruption au sein des gouvernements.»
Lors du lancement de son livre à la London School of Economics11, Mariana Mazzucato a évoqué l’exemple du Brésil où, lors de la crise financière mondiale, le président Lula a ordonné aux banques publiques d’investir dans des projets susceptibles de stimuler l’emploi et la technologie, même s’ils n’étaient pas rentables (tout au moins à moyen terme). Et que s’est-il passé? Les grandes entreprises et le monde de la finance (tant brésiliens que mondiaux) n’ont eu de cesse de clamer que cette politique et sa mise en œuvre par la Banque de développement du Brésil nuisaient à la rentabilité du secteur financier. Lula à peine parti, cette politique a été supprimée.
S’il est vrai que les investissements publics ont une utilité concrète, dans le mode de production capitaliste en quête de profit, ils ne créent pas de valeur.
Loin d’en appeler au remplacement du capitalisme ni même au transfert entre les mains publiques du secteur financier «parasitaire» ou des monopoles voués à la recherche du profit, Mariana Mazzucato se demande «comment le réformer» pour «remplacer le système parasitaire actuel par un capitalisme plus durable, plus symbiotique, qui nous serait à tous favorable.» Dans un entretien télévisé, elle évoque un «partenariat entre le gouvernement, les multinationales et un “troisième secteur”. » Il me semble utopique d’imaginer que les monopoles se laisseront convaincre d’abandonner leur vision à court terme pour investir dans une productivité et une innovation accrues sur le long terme, s’ils estiment de tels objectifs trop peu rentables comparés à la finance ou l’immobilier. De toute manière, si les investissements productifs étaient plus rentables que les autres, ils s’en seraient déjà emparés.
Loin d’être de simples coûts (nécessaires), la production et les investissements publics créent bien de la valeur, à savoir des produits ou des services dont nous avons besoin. Mariana Mazzucato confond valeur et valeur d’usage. Donc, s’il est vrai que les investissements publics dans les écoles, les hôpitaux, les transports, les infrastructures et la technologie ont une utilité concrète, dans le mode de production capitaliste en quête de profit, ils ne créent pas de valeur (à savoir de valeur ajoutée ou de profit). Au contraire, ils peuvent même diminuer la rentabilité générale du secteur capitaliste. Le capitalisme présente donc une contradiction intrinsèque entre l’augmentation de la valeur d’usage et la valeur.
Il est utopique d’imaginer que les monopoles se laisseront convaincre d’abandonner leur vision à court terme pour investir sur le long terme.
Mariana Mazzucato néglige totalement cet aspect dans ses travaux. Dès lors, elle estime, en tant qu’économiste, devoir montrer comment un gouvernement peut créer plus de valeur pour le capital afin de rendre le capitalisme plus efficace. Pour elle, les gouvernements peuvent aller au-delà «d’un rôle passif dans la résolution des échecs du marché» et devraient «pouvoir faire preuve d’esprit d’entreprise afin d’orienter l’innovation et la croissance économique». Elle dit vouloir que les gouvernements soient investis de missions «pour faire bouger les choses». Le monde économique et politique orthodoxe n’a donc pas de souci à se faire. Cette Mariana Mazzucato qui le fait tant trembler n’entend nullement remplacer le capitalisme par le socialisme, elle qui affirme «ne pas trouver ces mots (socialisme, par exemple) utiles… le capitalisme peut prendre d’innombrables formes… C’est là où, pour moi, il faut intervenir, au lieu de commencer à parler de socialisme.»
 Capitalisme, socialisme, après tout, ce ne sont que des mots. Peut-être, mais un mot indique où se situe la structure d’un mode de production et de relations sociales. Mariana Mazzucato appelle le capitalisme à fournir aux gens des produits et des services de meilleure qualité et en plus grand nombre, mais sans toucher à la propriété privée des moyens de production. En effet, évoquer une collectivisation des entreprises capitalistes, de la planification et une démocratie ouvrière serait une erreur, d’après elle: «Ce n’est pas en parlant de socialisme que vous obtiendrez un changement de comportement de la part des entreprises.» Mais demander aux grandes entreprises d’investir de manière productive sans plus se préoccuper de ce que toucheront les actionnaires sera-t-il plus porteur ?
Capitalisme, socialisme, après tout, ce ne sont que des mots. Peut-être, mais un mot indique où se situe la structure d’un mode de production et de relations sociales. Mariana Mazzucato appelle le capitalisme à fournir aux gens des produits et des services de meilleure qualité et en plus grand nombre, mais sans toucher à la propriété privée des moyens de production. En effet, évoquer une collectivisation des entreprises capitalistes, de la planification et une démocratie ouvrière serait une erreur, d’après elle: «Ce n’est pas en parlant de socialisme que vous obtiendrez un changement de comportement de la part des entreprises.» Mais demander aux grandes entreprises d’investir de manière productive sans plus se préoccuper de ce que toucheront les actionnaires sera-t-il plus porteur ?
Pour Mariana Mazzucato, le socialisme est une belle idée, dépourvue toutefois de sens pratique. «Indépendamment de ce que je pourrais souhaiter dans un monde idéal, je crois qu’il faut rester réalistes: c’est le capitalisme qui l’emportera.» Cette conclusion me gêne dans la mesure où c’est le fait d’être «réaliste» et d’accepter que le capitalisme dominera encore et toujours dans un avenir relativement proche, et qu’il faut dès lors tenter de l’améliorer, qui manque de réalisme. Dans un système capitaliste, peut-on éviter les crises économiques régulières et récurrentes qui génération après génération, privent des millions de gens de leur emploi, de leur logement et de leurs moyens de subsistance? Peut-on éviter les aventures impérialistes et l’exploitation? Peut-on inverser les inégalités extrêmes en termes de richesses et de revenus? Peut-on endiguer le changement et le réchauffement climatiques ?
Est-il réaliste de croire que l’on pourra faire disparaître ces horreurs en donnant la «mission» aux gouvernements et aux multinationales de «faire bouger les choses» sans toucher au système de production et d’investissement voué au profit privé? C’est cela qui n’est pas réaliste. Alors, on préfère parler de sauver le capitalisme de lui-même ou d’en améliorer le fonctionnement grâce au gouvernement. C’est imaginer le remplacer qui ferait réellement peur à l’ordre établi.
- Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State – Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, 2018.
- Mariana Mazzucato, The Value Of Everything, Allen Lane – Penguin, Londres, 2018
Footnotes
- Eshe Nelon, One of the world’s most influential economists is on a mission to save capitalism from itself (L’une des économistes les plus influentes au monde s’est donné la mission de sauver le capitalisme de lui-même). Quartz, 22 juillet 2019.
- Voir: www.economicpluralism.org/not-the-nobel-prize
- Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State – Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, 2018.
- Mariana Mazzucato, The Value Of Everything, Allen Lane – Penguin, Londres, 2018.
- Bob Hughes, The Bleeding Edge: Why Capitalism Mustn’t Get its Hands on New Technologies Ever Again, New Internationalist, 2016.
- Cf. Michael Roberts, The value-price and profit- of everything [La valeur (prix et profit) de tout], The Next Recession, 25 avril 2018.
- Andrew Haldane, «The contribution of the financial sector – miracle or mirage ?, Speech by Mr Andrew Haldane, Executive Director, Financial Stability, of the Bank of England, at the Future of Finance conference, London, 14 July 2010» (La contribution du secteur financier: miracle ou mirage ?, discours de Mr Andrew Haldane, directeur exécutif pour la stabilité financière à la Banque d’Angleterre lors de la conférence sur la finance du 14 juillet 2010 à Londres), www.bis.org/review/r100716g.pdf.
- Jean-Louis Arcand, Enrico Berkes et Ugo Panizza, Too Much Finance ?, document de travail du FMI, 2012.
- Bloomberg Markets and Finance, Rethinking Capitalism to Create Global Value, YouTube, 24 avril 2018.
- Martin Wolf, Who creates a nation’s economic value ?, (Qui crée la valeur économique d’une nation ?), Financial Times, 24 avril 2018.
- Mariana Mazzucato, The Value of Everything: making and taking in the global economy, (La valeur de tout: faire et prendre dans l’économie mondiale), The London School of Economics and Political Science, 23 avril 2018.