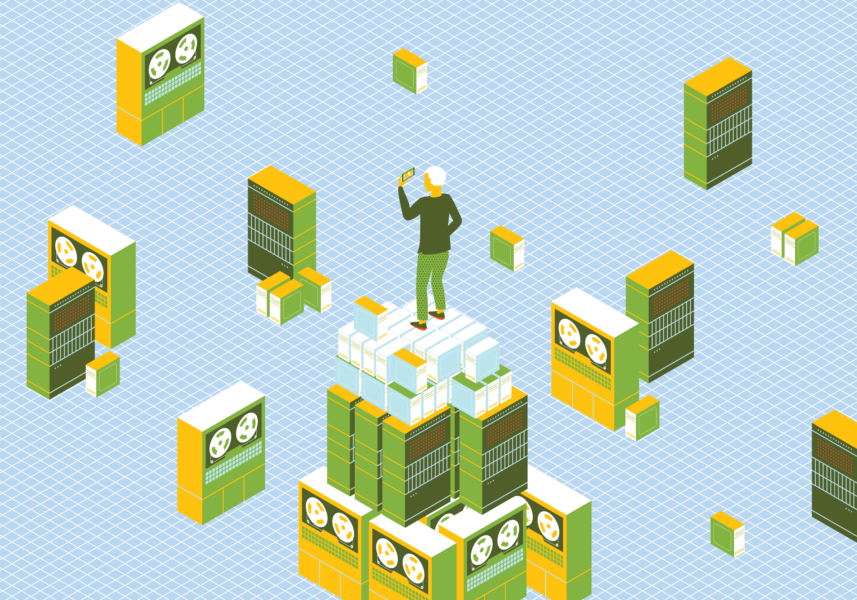L’art politique de Christoph Büchel joue les trouble-fêtes à la Biennale de Venise. Mais, après tout, l’art peut-il être totalement apolitique ?

Une fois encore, les amateurs d’arts plastiques sont à la fête du 11 mai au 24 novembre 2019, à l’occasion de la 58e Biennale de Venise. Cette édition est intitulée May You Live in Interesting Times, en référence à un faux proverbe chinois aux relents de malédiction prononcé par le ministre britannique des Affaires étrangères Austen Chamberlain dans les années 1930, qui ajoutait: «There is no doubt that the curse has fallen on us» (il ne fait aucun doute que cette malédiction nous frappe). Le commissaire de la Biennale, Ralph Rugoff, entend ainsi souligner que nous vivons aujourd’hui aussi dans un monde inquiétant, où les «faits alternatifs» et les fake news rendent suspect tout discours politique, au risque de nous priver de tout cadre de référence. Il se pose alors cette question: l’art peut-il nous aider à penser et vivre dans ces «temps intéressants»? Pour Ralph Rugoff, l’art comporte clairement un enjeu politique et l’aspect sans doute le plus intéressant de cette Biennale est de voir ce que l’on entend par «politique» et quelles réactions cela suscite. Lors de la Biennale 2019, l’art est en effet un guide mais qui, petit à petit, dévoile aussi les tréfonds de son marché.
La politique est naturellement indissociable du phénomène sociétal que constitue la Biennale en tant que grand-messe des arts plastiques. Au début du siècle passé, déjà, les puissances coloniales occidentales, Belgique en tête, à l’initiative de Léopold II, se sont mises à présenter leurs pavillons dans les Giardini. D’autres pays lui ont emboîté le pas, investissant les places vides ou louant, faute de mieux, des locaux ailleurs dans la cité des Doges. Un deuxième espace d’exposition est désormais installé dans d’antiques hangars situés sur les quais de l’Arsenal, le port militaire historique de la marine de guerre qui soutenait jadis les flottes marchandes vénitiennes et génoises. C’est le berceau de la course au profit occidentale qui déferla sur les pays du monde entier. Rien d’étonnant à ce que Christophe Colomb soit originaire de Gênes. La Biennale reste encore aujourd’hui imprégnée de cet esprit colonialiste. Ainsi, cette année, le pavillon vénézuélien est resté fermé en raison de l’imminence du coup d’État américain, amenant des artistes à se poster spontanément devant le bâtiment afin d’attirer l’attention de la presse internationale. La Biennale reste une caisse de résonance mondiale. Si l’art et la culture sont des reflets de notre société, c’est également le cas à la Biennale. Festival d’art, elle constitue aussi un festival de relations publiques et de réseautage lucratif pour beaucoup, et un peu pour les artistes aussi. Avec son lot de vernissages exclusifs, de files d’attente interminables et d’inévitables vigiles, pour ne surtout pas oublier qu’être à la Biennale ne signifie pas encore en être, loin s’en faut.
Büchel nous oblige à nous placer dans la position de témoin d’une tragédie dont nous nous évertuons collectivement à détourner les yeux.
L’art politique ne manque pas à Venise. On retiendra toutefois l’accueil hostile réservé au Barca Nostra (notre bateau) de Christoph Büchel. L’artiste islando-suisse a installé, sans explications, une épave de navire rouillée sur les quais symboliques de l’Arsenal, en plein milieu du parcours de l’exposition, à hauteur d’une terrasse design blanche où les visiteurs s’arrêtent quelques instants devant un verre de prosecco ou un café. Cette œuvre troublante est en fait un bateau de pêcheur qui, en 2015, a fait naufrage entre la Libye et Lampedusa, coûtant la vie à plus de 1 100 réfugiés qui se trouvaient à bord. L’épave apparaît comme le vestige d’un crime, d’un traumatisme, et le visiteur se sent pris au dépourvu, surpris par la confrontation directe avec ce souvenir auquel il voudrait en vain échapper. Hors de tout cadre, l’œuvre est posée là, sans socle, sans panneau explicatif, sans ce vernis artistique qui crée une distance où se réfugier en toute sécurité dans le rôle d’observateur. Ce n’est pas une image médiatique que l’on peut zapper ou faire glisser d’un doigt embarrassé. Büchel nous oblige à nous placer dans la position de témoin d’une tragédie dont nous nous évertuons collectivement à détourner les yeux. Quiconque ne s’en trouve pas un minimum touché doit sérieusement se poser des questions sur sa propre humanité.
Le Premier ministre italien Matteo Salvini a qualifié l’œuvre de Büchel de propagande.
Büchel qui, lors d’une précédente édition, avait fait ériger une mosquée temporaire dans une église désaffectée pour un autre projet artistique, notablement censuré par les autorités italiennes, entend par cette nouvelle intervention socialiser l’art. Ce faisant, il s’inscrit parfaitement dans la volonté du commissaire de la Biennale de miser cette année sur le dialogue social. L’œuvre de Büchel est également cohérente par rapport à la mission critique que s’est fixée cette manifestation à différents niveaux. En effet, elle accueille cette année un nombre important d’artistes non occidentaux, mais aussi davantage de femmes que d’hommes artistes et, enfin, beaucoup d’œuvres traitant de sujets sociopolitiques. On pense ainsi au bouleversant White Album d’Arthur Jafa, lauréat du Lion d’Or du meilleur artiste international. Ce montage vidéo de 40 minutes est une collection de messages haineux postés par des racistes blancs américains sur les réseaux sociaux. Il semble se poser en négatif de la somptueuse installation BLKNWS de Kahlil Joseph, toute proche: il s’agit d’une chaîne de télévision imaginaire qui ne dépeint pas uniquement les noirs comme des migrants, des personnes défavorisées ou des victimes de violences politiques, mais les montre, avec humour et musicalité, dans la perspective d’un monde multiculturel et bigarré où toute leur force, leur sensibilité, leur beauté et leur intelligence sont pleinement mises en avant. L’artiste a demandé aux chaînes italiennes de diffuser cette œuvre une fois par semaine, en alternative aux informations, mais elles ont refusé.
Mais c’est le bateau de Büchel qui a suscité les réactions les plus immédiates, tant dans le grand public que dans le monde politique: le président italien d’extrême droite Matteo Salvini n’a pas hésité à qualifier l’œuvre de propagande, tandis que son collègue de parti Roberto Ciambetti, président de la Vénétie, décrétait que Büchel ferait mieux de ramener le bateau dans son propre pays afin de mettre la Suisse face à sa propre politique d’accueil des «migrants économiques». Büchel surfe naturellement sur l’actualité politique italienne. Fin avril 2019, juste avant l’inauguration de la Biennale, sortait le documentaire Santiago, Italia dans les cinémas. Dans le climat de repli à droite que connaît actuellement l’Italie, le réalisateur Nanni Moretti a estimé important de donner la parole aux Chiliens qui ont fui leur pays en 1973 suite au coup d’État de Pinochet et trouvé une terre d’asile en Italie. Les témoignages de ces migrants d’alors sont d’autant plus poignants qu’ils placent le spectateur face au fait que l’Histoire pourrait bien être sur le point de se répéter en Italie. Quelques semaines plus tard, Salvini remportait les élections et la Ligue arrivait première au scrutin. Pendant ce temps, des bateaux pleins à craquer de réfugiés de guerre sombrent en Méditerranée, tandis que les politiques criminalisent les travailleurs humanitaires et interdisent aux opérations de sauvetage l’accès aux ports italiens.
Si des pétitions ont circulé pour appeler au retrait de l’installation de Büchel, les critiques sont restées étonnamment muettes par rapport à d’autres œuvres politiques. Une politique n’est pas l’autre, apparemment. Ainsi, le pavillon israélien a été transformé pour l’occasion en un hôpital de campagne artistique, destiné à soigner les «maux sociaux» de la société. Pur acte de propagande tendant à minimiser la politique d’apartheid de l’État d’Israël et à prétendre que le seul conflit à l’œuvre dans le pays serait de nature sociale. L’art, ici, veut nous faire oublier le sens même du sionisme, à savoir un régime d’occupation visant la colonisation totale de la Palestine et réservant aux Palestiniens le même sort que celui des Amérindiens aux États-Unis ou des aborigènes en Australie.
Si les réactions du grand public et de la sphère politique ne manquent pas d’interpeller, que dire de la virulence que suscite Büchel au sein du monde artistique? Ou, plus exactement, de ce qu’il fait remonter à la surface, à l’instar de son bateau? Certains de ses confrères ont qualifié son œuvre d’ « abjecte» et de «nauséabonde». Un journal flamand de qualité l’a taxée de «mauvais goût». À quand l’accusation d’art dégénéré? L’art ne supporte-t-il la réalité que jusqu’à un certain point? Un magazine d’art réputé s’en est donné à cœur joie avec des termes tels que «hypocrite», «peu profond», «cynique», «vain», «dispensable», pour conclure par le définitif «politiquement correct», bien de droite. Le contraste est fort par rapport à l’accueil réservé à Sun & Sea (Marina), présenté par la Lituanie, et mis en avant grâce à son Lion d’Or du meilleur pavillon. La performance d’opéra qui y est présentée fait intervenir une vingtaine d’acteurs-chanteurs qui interprètent, pendant des semaines, des vacanciers prenant le soleil sur une plage artificielle. Seules les interactions du quotidien y sont dépeintes, et c’est précisément cette oisiveté et cette inertie à notre époque d’urgence climatique qu’entend dénoncer Sun & Sea (Marina). Le jury a encensé cette œuvre critique, la jugeant subtile, ni moralisatrice ni apocalyptique. Et en effet, elle n’a rien de violemment contestataire, mais elle ne propose pas non plus d’analyse du problème ni de pistes de solutions. Que cette œuvre recueille un tel plébiscite du public ne surprend guère: elle emmène le spectateur sur un terrain autorisé et le laisse, sur réservation, littéralement poser sa serviette parmi les protagonistes et rester confortablement installé dans l’idée que son inertie est un problème collectif. L’œuvre a quelque chose de rassurant, une beauté nostalgique, à l’instar de Venise elle-même, en train de sombrer, ou de l’orchestre jouant sur le Titanic en plein naufrage. Elle permet de regarder le monde s’écrouler avec un sentiment privilégié de se trouver encore dans une position préservée. De prendre un rapide selfie pour pouvoir dire ensuite sur Instagram: «J’y étais.»
La faiblesse des arguments autres qu’émotionnels avancés par les critiques d’art pour torpiller le bateau de Büchel est également déconcertante. On lui reproche ainsi de se montrer avare en explications, alors que cet artiste refuse systématiquement de s’expliquer et de s’exprimer, tant sur ses œuvres que sur lui-même. Un critique d’art n’est-il pas censé tenir compte de ce choix? Duchamp, en son temps, avec son urinoir, n’a-t-il pas agi de manière similaire? Le contexte historique d’une telle épave installée sur les quais de l’Arsenal n’est-il pas suffisamment parlant? Enfin, on trouve dans le catalogue de la Biennale un texte et des explications tant au sujet de l’œuvre que de l’épave, où l’on peut lire que Büchel dédie son œuvre aux victimes de cette catastrophe. Message serein qui semble avoir échappé à la plupart des critiques d’art, notamment dans un journal néerlandais qui reprochait à l’œuvre de manquer de respect envers les proches des naufragés. Mais quel respect manifestons-nous aux migrants (climatiques, par exemple) vivants? Et combien de musées archéologiques exposent-ils des squelettes et des ossements sans aucun respect pour l’intégrité de ces corps? Contrairement à une œuvre représentant un crucifix immergé dans un pot d’urine, celle de Büchel ne joue pas sur la provocation. Par contre, il fait bien le choix stratégique de confronter le public et de jouer les trouble-fêtes. Tel un cheval de Troie, ce bateau repêché des profondeurs impose la souffrance humaine dans ce musée à ciel ouvert, peuplé de gondoles et de vaporettos romantiques, mais aussi de colossaux navires de croisière dont la violence d’un tourisme purement commercial vient se heurter aux quais anciens.
Chaque édition laisse toujours plus de place à des événements privés désireux de se payer une place dans le grand spectacle de l’art.
D’autres encore jugent scandaleux de dépenser tant d’argent à ce qu’ils considèrent comme une fanfaronnerie. Des millions que l’artiste a, au passage, gagné en exposant dans des galeries tenues et visitées par des membres de la jet-set dans le but d’exposer au grand jour et à leurs frais un drame largement minimisé. Il est évident qu’il y a des manières plus utiles de dépenser de l’argent, mais est-ce que cette réflexion ne s’applique pas à n’importe laquelle des œuvres exposées à Venise? Quel est le coût (écologique) du pavillon lituanien tant plébiscité, par exemple? Ne peut-on pas faire ce même reproche à la Biennale dans son ensemble? Les critiques ne devraient-ils pas s’intéresser à l’emprise croissante du marché de l’art, au lieu de taxer des artistes contestataires d’hypocrisie parce qu’ils parviennent de moins en moins à échapper au joug de ce marché? À chaque édition, on voit que les ultrariches dominent de plus en plus la société depuis leurs yachts et cherchent à accaparer le monde de l’art par le biais du marché. L’immixtion des galeries d’art dans l’espace public officiel est d’ores et déjà déterminante. On le constate d’ailleurs dans le pavillon belge où Jos de Gruyter & Harald Thys, connus pour leur travail vidéo sordide, proposent cette année une poupée parfaitement clean qui se négociera aisément en tant que sculpture. Chaque édition laisse toujours plus de place à des événements privés désireux de se monnayer une place dans le grand spectacle de l’art. Les critiques d’art actifs dans nos médias évoquent généralement «nos Belges à Venise», sans bien distinguer les artistes en sélection officielle de ceux qui ont été invités dans le cadre de manifestations privées, en marge de la Biennale. Ainsi, au Palazzo Grassi, propriété du milliardaire français François Pinault, Luc Tuymans présente une grande rétrospective de ses œuvres qui a, fort à propos, ouvert ses portes juste avant l’inauguration officielle de la Biennale et bénéficié ainsi d’une attention médiatique exceptionnelle. En juin, son tableau Schwarzheide, l’une de ses œuvres majeures exposée à Venise sous forme de mosaïque de marbre, s’est vendu 1,4 million d’euros lors d’une vente aux enchères à Londres. Un tel prix ne reflète en rien la valeur de l’œuvre, mais plutôt le fait que les artistes sont devenus des marques. Mais aussi que de plus en plus d’argent se concentre entre les mains d’un petit groupe de personnes, partout dans le monde, notamment grâce à la spéculation dans le domaine de l’art.
Décréter que des artistes engagés tels que Büchel devraient faire autre chose, et feraient mieux de se tenir à l’écart d’un spectacle tel que la Biennale, est plus qu’une incitation à les faire capituler. Vouloir définir d’autorité ce que l’art doit être ne peut que mener sur une pente totalitaire. Ce dont les artistes ont besoin, c’est d’un espace de liberté où laisser tout ce qu’ils ont en eux remonter à la surface. Et même si cela débouche sur des résultats réactionnaires, cela peut se révéler hautement instructif. Comme tableau clinique du capitalisme, par exemple. Büchel ne peut d’ailleurs réaliser son œuvre critique qu’au travers de la société où il vit. Une société où les touristes se bousculent pour visiter San Michele, l’île des morts, cimetière de Venise, dont Cees Nooteboom décrit amoureusement la beauté dans son dernier livre consacré à Venise1, mais préfèrent détourner le regard des morts que charrie ce bateau.
Les arts dits libres ont toujours été idéologiques.
Autre réaction courroucée, celle d’un critique qui rejette la responsabilité que fait peser Büchel sur nos épaules. Selon lui, l’œuvre ne tourne qu’autour de l’ego de l’artiste et de son privilège de blanc de pouvoir la proposer, exploitant une fois de plus la souffrance de ces victimes noires. Mais pourquoi l’un des nombreux artistes noirs exposés à la Biennale n’aurait-il pas pu réaliser cette même œuvre? Si l’on utilise ici le terme «blanc» en tant que concept philosophique et non étiquette ethnique, il y a énormément à dire au sujet de Barca Nostra. Si la notion de blancheur renvoie au capitalisme occidental qui a développé des théories racistes afin de légitimer son entreprise de pillage mondial et de monter les gens les uns contre les autres pour laisser le champ libre aux élites, alors, en effet, cette œuvre oppressante aborde une thématique importante. Elle nous met à nu, en tant qu’ « amis des arts» dont le statut découle d’une longue tradition de militarisme, de colonialisme et de pillage. Être en mesure de voir cette œuvre est le signe que nous nous trouvons sur cette rive-ci du monde. Vue sous cet angle sinistre, l’œuvre de Büchel outrepasse les frontières de la beauté pour toucher à ce que le philosophe Kant appelait «le sublime». Elle acquiert ainsi une pertinence morale, dans la mesure où il est salutaire de quitter de temps en temps sa zone de confort. Il est surprenant que cela n’ait pas effleuré les critiques d’art.
En bref, ce qui est intéressant dans les réactions au travail de Büchel, c’est qu’elles soulignent notre répulsion actuelle vis-à-vis de l’art politique dérangeant, incontestablement liée à la dépolitisation massive de notre société. L’art dit libre a pourtant de tout temps été idéologique. Le simple fait qu’on le qualifie de «libre» à une époque où les nations occidentales passent leur temps à attaquer le reste du monde au nom de la «liberté» et de la «démocratie» est particulièrement éloquent. Vouloir produire de l’art détaché de la politique revient à valider les rapports de force qui déterminent notre société, notamment en réfutant leur existence et en détournant l’attention vers autre chose. Au cours de la décennie passée, l’expansion des arts occidentaux est restée étroitement liée à celle de la mondialisation économique. Même si l’on pense que l’art doit être critique, la folie des biennales et autres happenings artistiques internationaux a commodément offert aux multinationales un terrain propice pour développer leur sponsoring et conquérir ainsi de nouveaux marchés de matières premières ou d’exportation. Et même si ce n’est pas censé être sa vocation, un art qui raconte une histoire de mélange et de transformation, de croisements et de dépassement des frontières entre nations, traditions et cultures, devient rapidement, sur le plan idéologique, un compagnon de route, voire un pionnier de la mondialisation du marché. Lorsque l’art brise le carcan des valeurs figées, cesse de se protéger pour s’ouvrir à la mobilité et présente l’autonomie de l’individu consommateur comme son but suprême, il adopte le langage du libre-échange. Comme le missionnarisme et le colonialisme, en d’autres temps, commerce de l’art et néolibéralisme vont aujourd’hui de pair, ce qui s’apparente à une hégémonie culturelle, voire un impérialisme du goût, qui ouvre, s’approprie et transforme les cultures populaires conservatrices en produits commercialisables utiles, que les touristes peuvent manger et acheter. En tant qu’artiste contemporain, Büchel n’échappe pas non plus à la confrontation avec son propre Barca Nostra, bien qu’il n’ait jamais prétendu le vouloir ni le pouvoir.