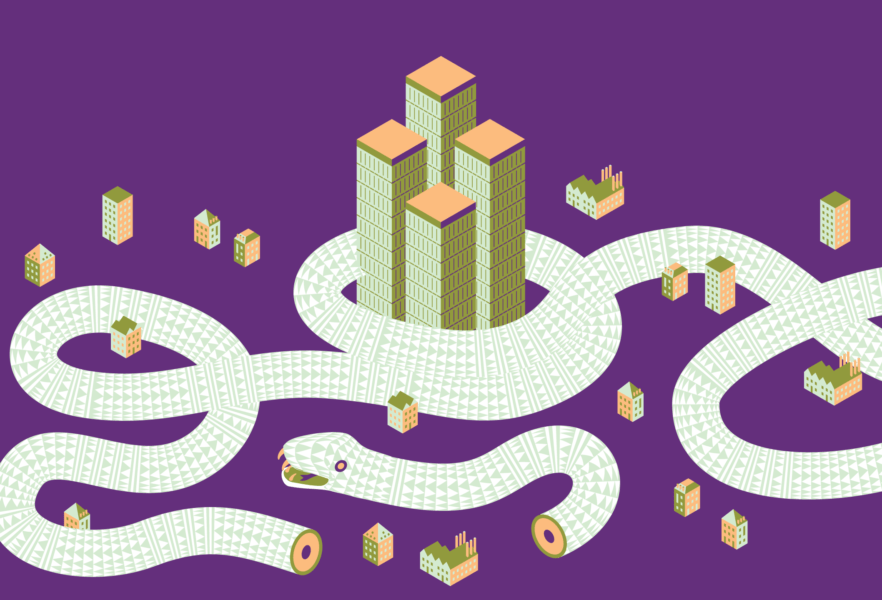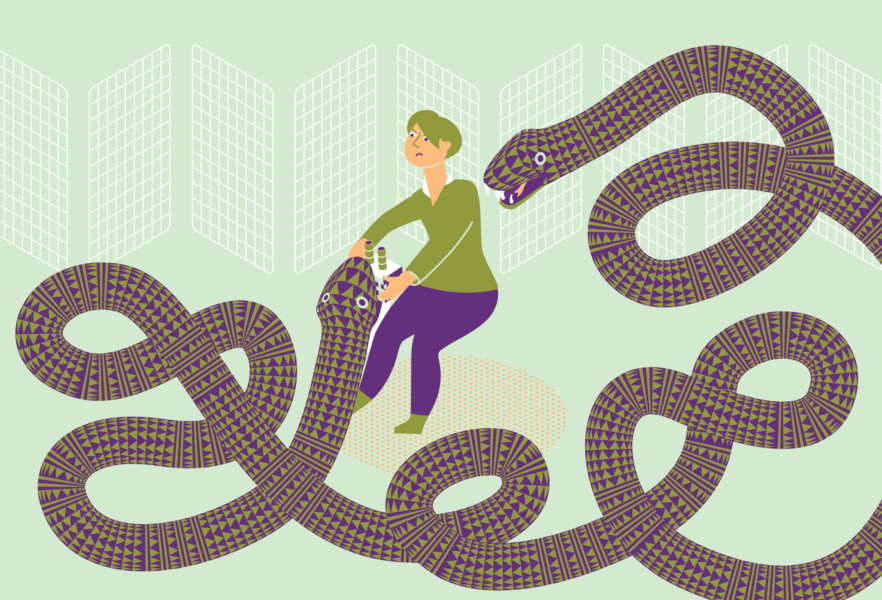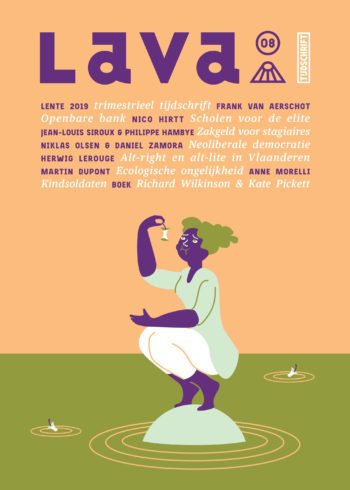Les stagiaires en entreprise ne sont vus que comme des élèves en formation. Ce qui conduit a invisibiliser leur travail et la richesse qu’ils produisent.

La différence entre les stagiaires et les salariés n’est pas liée à la nature de leurs compétences ou des tâches qu’ils exécutent. Elle résulte davantage d’une convention qui associe à ces différents statuts – stagiaire et salarié – un niveau de qualification et donc de rémunération. L’essentiel à nos yeux n’est donc pas d’affirmer que les stagiaires devraient être mieux (ou moins bien) payés au vu du travail effectif qu’ils produisent, mais bien de souligner le caractère politique de leur rémunération. Dès lors qu’on reconnait la dimension productive de leur activité en stage, il s’agit, non pas de mesurer, mais de déterminer la valeur économique qu’on lui attribue.
- Le salut par l’ alternance
Dans Le salut par l’ alternance, paru en 2018 aux éditions
La Dispute, Philippe Hambye et Jean-Louis Siroux interrogent le rôle croissant dévolu à l’ entreprise dans les dispositifs d’ éducation et de formation. En témoigne le développement de l’ enseignement en alternance qui voit des élèves de 15 ans et plus, parfois encore en âge d’ obligation scolaire, passer les deux tiers de leur temps en stage en entreprise. L’ essor de ces formations en alternance interroge ainsi les finalités même du système scolaire: qu’ enseigne-t-on, à qui, et dans quelle perspective? Dans cet extrait de l’ ouvrage, les auteurs mettent davantage l’ accent sur cet autre enjeu que sont les rapports sociaux de travail. Les stagiaires tendent en effet à n’ être perçus que comme des élèves «en formation», et non (aussi) comme des producteurs de richesses à part entière…
Philippe Hambye et Jean Louis Siroux, Le salut par l’ alternance. Sociologie du rapprochement école-entreprise, La Dispute, «L’ enjeu scolaire», Paris, 2018, p. 182-190 et 199-202
On devine aisément l’enjeu qu’il y a à ouvrir une telle discussion: reconnaître que les stagiaires ne sont pas que des «élèves» ou des «étudiants», mais aussi voire surtout des producteurs de richesse, c’est s’exposer à devoir leur reconnaître le droit à un salaire complet, accompagné en principe de cotisations sociales (dont on rappelle que les entreprises sont dispensées quand elles emploient des stagiaires du CEFA). Et contre ceux qui suggèrent que le salaire d’un travailleur devrait dépendre mécaniquement de sa productivité, il faut rappeler que, dans un système capitaliste, le salaire reste une convention résultant d’un rapport de force entre employeur et salarié, le tout plus ou moins encadré par la législation sociale. De l’état de ce rapport de force dépendra la part de la richesse produite par les travailleurs qui leur revient de plein droit (via le salaire: salaire net et salaire socialisé) et celle dévolue aux détenteurs du capital.
Une cohérence sémantique
Cette délicate question du statut des stagiaires et de leur éventuel salaire mériterait donc à nos yeux un débat public qui n’a jamais eu lieu en Belgique… sauf dans l’antichambre du débat politique où la question a déjà été tranchée. Dans les textes officiels, il n’est ainsi jamais question de salaire mais d’une «indemnité de formation» ou d’une «allocation d’apprentissage». Ici comme ailleurs, les mots ont évidemment toute leur importance. Contrairement au «salaire», des termes tels que «indemnité», «allocation» ou «revenu» renvoient à des formes de rémunération qui n’ont aucun lien intrinsèque avec la production de richesse par le travailleur. Cette déconnection entre travail productif et rémunération est d’ailleurs ce qui explique que les journées d’absence non justifiées à l’école peuvent être décomptées de la rémunération mensuelle du stagiaire, au même titre que les absences sur le lieu de stage.
«L’indemnité couvre les périodes effectuées tant dans l’entreprise que dans l’établissement d’enseignement. L’indemnité de formation est réduite prorata temporis lorsque, dans le courant d’un mois, l’élève a abandonné sa formation, en entreprise ou à l’école ou a été absent sans motif tant dans l’entreprise d’accueil que dans l’établissement scolaire.» (Extrait de la convention d’insertion socioprofessionnelle – CISP)
L’exemple est anecdotique. Ce point de législation est peu connu et, à notre connaissance, il n’est guère suivi d’effets. Mais il est révélateur d’une cohérence générale construite autour du déni de la valeur ajoutée produite par le travail des stagiaires. C’est bien parce qu’elle n’est pas pensée comme salaire délivré en échange d’un travail productif que la rémunération peut dépendre aussi bien du temps de formation à l’école que du temps – de formation ou de production? c’est toute la question… – passé en stage. D’autres chercheurs ont d’ailleurs montré combien la marginalisation de la notion de «salaire» au profit, par exemple, du terme «revenu» traduisait un basculement historique dans la manière de concevoir les rapports sociaux de travail1.
La production écrite des différents acteurs de l’alternance montre que ceux-ci prêtent peu d’attention à ces différences sémantiques, ou du moins ne s’efforcent pas de les questionner. Dans de nombreux cas, il semble indifféremment être question de «salaire», de «revenu» ou d’«indemnité», de ce que gagnent ou de ce que coûtent les stagiaires. Ces travaux entretiennent aussi la confusion lorsqu’ils utilisent une formule telle que «salaire moyen de formation des apprentis»2 qui laisse entendre que les élèves reçoivent un salaire – cela suppose qu’ils travaillent – mais qu’ils le reçoivent en échange de leur formation. Or, s’il s’agit de «récompenser» leur investissement dans la formation, pourquoi qualifier leur rémunération de salaire? Et s’il s’agit de rétribuer leur activité productive, pourquoi alors parler de formation? Dans le même esprit, ce mélange des genres se traduit par les mots employés pour désigner les stagiaires3: plutôt que par les termes «élèves» ou «travailleurs», c’est généralement à travers la notion de «jeunes» que sont qualifiés les intéressés, tant dans certains textes officiels que dans la vie de tous les jours au CEFA. Il n’est pas anodin qu’il s’agisse là d’un terme vague (spontanément, nul ne sait très bien quand commence et quand se termine «la jeunesse») et sans grande consistance politique.
Redéfinition des termes de l’échange salarial
Indépendamment de son montant, nombre de nos informateurs ne conçoivent pas la rémunération des stagiaires comme un salaire lié à une activité de production de valeur économique, mais plutôt comme une récompense accordée de manière à leur permettre d’assouvir certains désirs marchands. Il ne s’agit donc pas d’un droit déterminé dans le cadre de rapports de production, mais d’une faveur conçue comme moyen de consommation. La rémunération est dès lors logiquement perçue sous l’angle du «pouvoir d’achat», déconnecté de la valeur ajoutée produite par le stagiaire.
«C’est leur argent de poche, hein. Je n’ai jamais eu 500 euros moi.» (Accompagnatrice)4
Dans cette optique, on ne s’interrogera pas sur ce qui est dû aux élèves, mais sur ce qui les satisfait, sur ce dont ils ont besoin ou sur ce qu’ils sont en mesure de gérer. Et l’on pourra en conclure qu’il n’y pas vraiment à se préoccuper du montant de leur rémunération dans la mesure où ils s’en contentent, puisque de toute façon ils l’utilisent pour s’acheter des «gadgets» ou parce qu’une faible somme d’argent reste ce qu’il y a de plus adéquat pour leur permettre d’apprendre, petit à petit, à gérer un budget.
«Pour la plupart, les parents ne travaillent pas ou ils sont eux-mêmes ouvriers. Donc si [plus tard comme salariés] ils gagnent 1 300 euros, ils sont très, très, très contents. Mais c’est vrai que pour certains élèves, c’est le mieux que tu puisses leur souhaiter.» (Accompagnatrice)
Les élèves ne gagnent pas grand-chose mais «ils ont tous des appareils pas possibles. […] Moi je n’ai pas de gsm [de téléphone portable] et je n’en vois pas l’utilité.» (Gérant d’un salon de coiffure)
«Qu’ils gagnent un petit quelque chose, qu’ils aient un salaire, qu’ils apprennent à le gérer. Normalement, c’est les parents qui devraient apprendre tout cela mais cette socialisation primaire ne se fait plus.» (Accompagnateur)
«Je trouve que pour des gamins de 15-16 ans, heureusement qu’ils n’ont pas 600 ou 700 euros parce qu’il faut aussi préserver un peu ces gamins, on ne sait pas ce qu’ils vont faire avec cet argent.» (Accompagnatrice)
Indépendamment de la sempiternelle dénonciation de l’imprévoyance des classes populaires5, il est frappant que, dans les deux derniers extraits, la rémunération des stagiaires soit appréhendée sous l’angle d’un enjeu de formation. La faiblesse de la rémunération n’est plus vue comme une injustice en regard du travail productif des stagiaires, mais comme un moyen de «préserver» des «gamins de 15-16 ans» qui pourraient se brûler les mains au contact d’une rémunération trop élevée. Cette perception est parfois partagée par les élèves eux-mêmes, à l’image de cette apprentie coiffeuse qui considère que, pour elle, «250 euros, c’est déjà beaucoup». Il n’est pourtant pas exceptionnel que cette rémunération soit utilisée, non comme «argent de poche», mais comme revenu secondaire lorsque les apprentis apportent un soutien financier à leur famille, voire comme revenu principal pour celles et ceux qui doivent subvenir à leurs besoins. C’est par exemple le cas de Khadija, une élève en 6e année de coiffure, dont cette enseignante dresse un bref portrait.
«Elle est arrivée plus ou moins en 2009, d’après ce que je sais. Elle vit toute seule dans un petit studio mais elle n’a quasiment personne de sa famille en Belgique. Désormais, ça commence à aller mieux parce qu’elle a trouvé un stage. Mais l’année dernière, elle n’avait pas de stage. Elle dépend du CPAS [Centre public d’action sociale] mais, à force qu’elle double, le CPAS lui a mis la pression cette année en lui disant “si tu doubles, on te coupe le CPAS. C’est comme ça que je l’ai amenée tout de suite au PMS [Centre psycho-médico-social]. Il a fallu gratter, gratter, et pour finir, elle est revenue du PMS avec un sourire jusque-là parce qu’on lui a permis d’avoir un sandwich et une boisson à l’école à chaque fois qu’elle vient. Ce qui n’est quand même pas la mer à boire, sachant qu’elle ne vient que deux jours par semaine. Mais c’était… Idem, je lui demandais là comment ça allait à son stage. Ce week-end elle a reçu un pourboire de 5 euros, et ça avait l’air d’être la fête.» (Enseignante)
Argent de poche, revenu primaire ou secondaire, dans tous les cas la rémunération des stagiaires demeure associée à des désirs ou à des besoins, à du pouvoir d’achat davantage qu’à du salaire au sens fort du terme. D’ailleurs, même quand elle est plus explicitement reliée à l’activité exercée pendant les stages, la rémunération reste encore dissociée de la valeur ajoutée que produisent les stagiaires par leur travail. Il ne s’agit pas d’un dû mais d’une récompense de nature essentiellement symbolique. C’est un signal qui, au même titre finalement qu’une franche poignée de main, salue le travail bien fait, récompense le stagiaire méritant de sa bonne attitude.
«Pour moi ce n’est pas lié à une compétence, ce n’est pas lié à un travail, c’est une récompense.» (Gérant d’un salon de coiffure)
«300 euros, c’est une petite récompense, donc c’est correct. Ça doit rester une récompense, ce n’est pas un salaire. C’est pour avoir une petite motivation.» (Gérant d’un magasin d’articles de sport)
Cette idée de «récompense» revient régulièrement dans le discours des employeurs. Elle montre bien qu’il s’agit dans leur esprit d’une faveur qui, à l’inverse d’un droit inconditionnel, est discrétionnaire, aléatoire et réversible. Dans une moindre mesure, on retrouve aussi cette idée dans les propos de certains accompagnateurs. Dans l’extrait qui suit, la rémunération et le contrat de travail sont perçus comme des récompenses, octroyées a posteriori par l’employeur si celui-ci est satisfait du travail fourni.
«Dans un premier temps, elle [la stagiaire] ne sera pas rémunérée […] Quitte à ce que dans un mois le gars dise “ah je suis super content, on va la payer un petit peu”, “je suis super content, on va la payer un peu plus”, “je suis super content, on va lui faire un contrat”. C’est aussi une forme d’insertion.» (Accompagnateur)
Il faut toujours rester prudent dans le travail d’interprétation de propos oraux, enregistrés lors d’entretiens relativement informels. Le contrôle de la parole est forcément moindre que dans le cadre de discours écrits, que l’on peut prendre le temps de relire et de retravailler. Il n’en reste pas moins que ces propos, et beaucoup d’autres que nous aurions pu extraire de notre corpus, participent à redéfinir les termes mêmes de l’échange salarial: au lieu d’être inconditionnelle, la rémunération devient aléatoire; au lieu d’être conçue comme contrepartie de la production de valeur ajoutée, elle se transforme en faveur destinée à satisfaire des besoins ou des désirs; au lieu d’être exprimée sous une forme monétaire, elle prend volontiers les traits de l’expérience professionnelle, voire de la simple reconnaissance symbolique.
La rémunération, outil de socialisation
Si aux yeux de certains, la rémunération des stagiaires sert avant tout à leur envoyer un message moral, celui-ci peut prendre différentes significations. En premier lieu, une rémunération modeste enseigne la frugalité: ce qu’obtiennent les stagiaires (ou les étudiants) ne doit pas les inciter à nourrir des attentes élevées, cela devrait au contraire les habituer à se contenter de peu.
«Personnellement, je trouve que les étudiants sont trop payés par rapport à quelqu’un qui commence […] Je pense que le salaire d’un étudiant, c’est 10 euros par heure. Donc si vous faites un temps plein, vous avez 1 500 ou 1 600 euros net à la fin du mois. Et après, quand vous commencez à travailler, vous gagnez 1 100 ou 1 200 euros. Du coup, les jeunes ont une idée fausse de ce qu’on gagne après. Cela arrive souvent. Ils veulent continuer avec nous, ils disent vouloir arrêter l’école pour travailler chez nous. Ils viennent solliciter. On dit “Ok, on était content de vous”. Et puis on parle question salaire, on dit “vous allez gagner la même chose qu’un étudiant mais vous allez devoir payer les contributions.” […] Ce n’est pas réaliste, on donne aux étudiants l’idée que quand on commence à travailler on a au moins ce qu’on gagne en tant qu’étudiant. Et ça, ce n’est pas juste […] En Hollande par exemple, les étudiants ne gagnent que 3 ou 4 euros par heure. Et ça, c’est plus réaliste. C’est mieux aussi pour les étudiants pour rester sains dans leur tête. On reçoit plus que quelqu’un qui travaille ici pour un job qu’on ne sait pas faire. Alors si vous me demandez s’il faut changer quelque chose, pour moi c’est ça. Qu’ils pensent une fois aux jeunes. Parce que pour nous, engager un étudiant, cela reste de toute façon plus avantageux parce qu’on ne doit pas payer de contributions. Mais il faut penser aussi aux étudiants eux-mêmes, faire quelque chose pour qu’ils n’aient pas des idées fixes: “je vais quitter l’école et avoir 2 000 euros dans ma poche. Parce que là vous rêvez.» (Gérante d’une grande enseigne de prêt-à-porter)
La dimension socialisatrice que revêt aux yeux de certains employeurs la «modération salariale» apparait ici plus clairement que jamais. S’il s’agit de limiter le montant de la rémunération des étudiants, c’est d’abord pour ne pas alimenter leurs illusions, et accessoirement leurs revendications, quant au montant de leur futur salaire. Une rétribution plutôt modique de «3 ou 4 euros l’heure», à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres pays, paraît «réaliste» dès lors qu’elle se donne toutes les chances de produire par la suite des travailleurs heureux de gagner relativement mieux leur vie en tant que salariés. De la même manière, c’est bien la courbe ascendante de la rémunération des élèves de CEFA qui semble parfois substituer aux affects tristes des débutants les affects plus joyeux des élèves de 5e ou de 6e année, et ce en dépit du niveau encore dérisoire de leur rémunération ( «Les élèves de 5e et 6e commencent à être satisfaits, mais les 3e année, au début, sont très déçus du peu qu’ils touchent. Et alors, tu as parfois quelques grands discours sur l’exploitation» relève une enseignante). Mais, en définitive, ces mesures correspondraient moins à l’intérêt des employeurs qu’à celui des stagiaires (et des étudiants) eux-mêmes ( «Qu’ils pensent une fois aux jeunes»). Il importe de leur permettre de «rester sain dans leur tête» et de ne pas se nourrir «d’idées fixes». En somme, il s’agit de leur épargner les tourments de l’argent facile et des espoirs déçus.
Dans le même sens, la rémunération ne doit pas devenir l’ambition première qui anime les stagiaires. Parmi nos informateurs, certains estiment ainsi que la rétribution des élèves doit rester faible de manière à ce que le stage ne devienne pas un moyen mais reste une fin en soi. Une fois encore, il ne faut pas qu’une rémunération trop élevée envoie un signal «négatif» sur le plan moral.
«Le CPE [la convention de premier emploi] […] je crois que c’est un mauvais système. Ce n’est pas du tout un service qu’on leur rend en leur donnant un contrat CPE alors qu’ils sont à l’école. Je connais peu d’étudiants qui sont payés pour étudier. C’est très mauvais comme système en termes de mentalité. Ces gars-là n’iront nulle part.» (Gérant d’un magasin d’articles de sport)
La rémunération ne peut en aucun cas constituer le ciment de l’engagement des travailleurs dans leur activité professionnelle. Un maître de stage déplore ainsi de façon explicite que «le problème, c’est que la motivation, pour certains, elle est extrinsèque alors qu’elle devrait être intrinsèque». On retrouve ici, presque terme à terme, le fil conducteur de l’analyse que propose Frédéric Lordon des nouvelles formes d’enrôlement salarial suggérées par la littérature et mises en œuvre dans les pratiques managériales: «c’est donc l’activité elle-même qu’il faut reconstruire objectivement et imaginairement comme source de joie immédiate. Le désir de l’engagement salarial ne doit plus être seulement le désir médiat de biens que le salaire permet par ailleurs d’acquérir, mais le désir intrinsèque de l’activité pour elle-même»6. Cette injonction à désirer l’activité pour elle-même prend une forme tout à fait paradoxale quand on sait combien le succès du néo-libéralisme, soutenu par l’orthodoxie managériale, s’est traduit par une dégradation des conditions d’emploi et de travail7. Il s’agit, en quelque sorte, de faire plus avec moins: trouver plus de satisfactions dans des conditions moins satisfaisantes. (…)
Détricotage de la condition salariale
Comme d’autres travailleurs engagés sous des statuts dits «atypiques» (mais en réalité de plus en plus courants), le stagiaire exerce objectivement une pression sur le salarié standard, l’obligeant à revoir ses prétentions à la baisse. Les salariés se retrouvent en effet placés en situation de concurrence avec des travailleurs qui, sans bénéficier du même statut (donc des mêmes droits et d’une rémunération équivalente), sont susceptibles d’occuper les mêmes postes de travail. Un statut et une valeur économique distincts sont ainsi octroyés à des travailleurs qui, dans bien des cas, sont pourtant difficiles à distinguer du point de vue du travail concret qu’ils accomplissent.
Qu’est-ce qui justifie le fait que certains travailleurs ne bénéficient pas du même statut que leurs collègues? Dans le cas des stages en entreprise, nous l’avons vu, c’est principalement le manque de qualification et l’apport de la formation que reçoivent les stagiaires qui légitiment leur engagement sous un statut inférieur à celui des salariés ordinaires. En autorisant l’engagement de stagiaires n’ayant pas encore terminé avec succès leur formation initiale (et ne faisant parfois que la débuter), le législateur offre aux employeurs un argument en or pour ne pas les rémunérer aux standards habituels. De manière plus générale, ces statuts «atypiques» s’appuient sur la construction de catégories ad hoc (les «jeunes», les «stagiaires», les «infraqualifiés», etc.) qui participent à déqualifier la force de travail. Jugés insuffisamment formés, ces travailleurs ne sont jamais assez prêts, assez mûrs, assez compétents pour être rémunérés selon les même standards que les autres salariés, quand bien même accompliraient-ils le même travail avec la même efficacité. La proposition de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) – actuellement le premier parti en Belgique – de baisser le salaire minimum pour les jeunes de moins de 21 ans est tout à fait exemplaire de cette logique de dumping social interne8. On peut penser aussi à la représentation du stage comme une sorte de «découverte» préliminaire du monde de l’entreprise, plutôt que comme expérience réellement qualifiante, reconnue en tant qu’ancienneté professionnelle et donnant droit à une valorisation salariale par rapport à un salarié débutant. Désigner cette première expérience professionnelle en parlant de socialisation et en l’associant à l’appropriation d’attitudes et de compétences élémentaires, comme s’il s’agissait juste d’une acculturation, du redressement d’une déviance, d’un retour à une normalité présumée, c’est évidemment entériner, par les mots, une vision politique des choses et faire passer pour un simple constat ce qui relève de la construction sociale d’un statut professionnel particulier.
L’assimilation du stage à un «premier contact avec l’entreprise» perd d’ailleurs beaucoup en crédibilité lorsqu’il devient, non pas la première étape d’un parcours professionnel, mais le statut durable sous lequel travaille une part considérable de la population active. La spectaculaire recrudescence du recours au statut de stagiaire en Italie en offre une illustration presque caricaturale. En 2016, on dénombrait pas moins de 143 000 stagiaires dans le pays, soit une augmentation de 116 % par rapport aux 63 000 stagiaires recensés en 2012. Parmi eux, près de 13 000 (14,4 %) «stagiaires» de plus de 45 ans.9À titre d’exemple, le journal télévisé de France 2 du 11 avril 2017 évoque la situation de Stefano, 60 ans, ancien informaticien et «stagiaire» à la Cour de cassation. «Je m’occupe des dossiers, de l’archivage et de la préparation des audiences», explique l’intéressé. En stage depuis 7 ans, il touche 600 euros d’allocation de chômage et se voit octroyer 400 euros d’indemnité de stage. En tant que stagiaire, il ne cotise pas pour sa retraite.
L’enquête que nous avons menée auprès des employeurs et des stagiaires montre également à quel point cette logique de régression sans fin est mortifère: des salariés sont remplacés par des travailleurs sous contrats aidés, qui eux-mêmes sont mis en concurrence avec d’autres statuts «atypiques». De régression en régression, les élèves de CEFA scolarisés en 5e et 6e années finissent par perdre leur place de stage en raison de la concurrence exercée par des élèves plus jeunes.
«Normalement après 18 ans, il faut des contrats mi-temps. Mais le patron ne veut pas. […] Seules les entreprises publiques veulent bien, parce qu’elles sont subsidiées pour engager des stagiaires.» (Accompagnateur)
Jennifer vient de «perdre son salon». Elle y travaillait depuis presque deux ans. Mais désormais inscrite en 6e année, elle coûte «plus cher» que les élèves de troisième année qui débutent leur formation. Son accompagnateur fait irruption au cours de coiffure avec une proposition de contrat dans un nouveau salon qu’il vient de démarcher. Dans un premier temps, la jeune femme parait hésitante car le salon est situé loin de son domicile, à l’autre bout de la ville. Inquiète à l’idée de ne pas trouver de meilleure place, elle accepte toutefois la proposition, un peu à contrecœur.
Il est révélateur que lorsque les employeurs évoquent la possibilité d’engager un stagiaire CEFA, son coût est spontanément reporté, non pas à celui d’un salarié ordinaire, mais à celui d’un étudiant jobiste, ou à celui d’autres travailleurs sous statuts «atypiques».
Au bout du compte, le salarié ordinaire fait presque figure d’exception. Il apparaît comme un «produit de luxe» duquel est donc attendu un haut degré de satisfaction et de rentabilité. Lorsque l’on demande à cet apprenti carrossier si, au terme de sa formation, il espère être engagé dans le garage où il preste son stage, sa réponse est positive mais non dépourvue d’inquiétude.
«Oui, mais s’il m’engage il va vouloir me rentabiliser encore plus. Ça va être dur, mais on va serrer les dents.» (Elève, 6e année carrosserie)
La multiplication de ces sous-statuts est pourtant envisagée plutôt positivement par beaucoup de professionnels de l’insertion socio-professionnelle, en raison du bénéfice qu’est susceptible d’en retirer en termes d’accès à l’emploi telle catégorie sociale ou tel travailleur considéré individuellement. Les discours des accompagnateurs que nous avons interrogés ne font pas exception à la règle. La tonalité de leurs propos épouse volontiers le registre de l’assistance ou du secours. Les stages sont perçus comme autant d’«opportunités» de «venir en aide» ou de «sauver» des «jeunes en difficulté». Il suffirait pourtant d’élargir l’angle de la focale, d’embrasser en une seule prise de vue l’ensemble du monde du travail, pour modifier singulièrement le regard porté sur cette dynamique de détricotage de la condition salariale. Les diverses mesures prises en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes contribuent en réalité à la dégradation des conditions d’entrée dans l’emploi et à la déstabilisation du monde du travail dans sa globalité.
Philippe Hambye et Jean Louis Siroux, Le salut par l’ alternance. Sociologie du 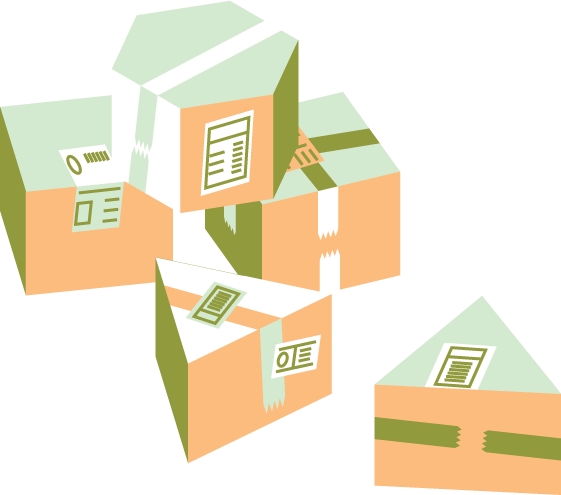 rapprochement école-entreprise, La Dispute, «L’ enjeu scolaire», Paris, 2018, p. 182-190 et 199-202.
rapprochement école-entreprise, La Dispute, «L’ enjeu scolaire», Paris, 2018, p. 182-190 et 199-202.
Footnotes
- Friot Bernard, L’enjeu du salaire, La Dispute, «Travail et salariat», Paris, 2012; Gobin Corinne, From «Wage-friendly» to «Employment-friendly» Growth. Looking Back on 44 years on European Union History (1968-2012) des éditions Clasquin Bernardette, Friot Bernard, The wage under attack. Employment policies in Europe, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2013, p. 245-272.
- Buechtemann Christoph F., Soloff Dana J., Schupp Juergen, Formation par apprentissage: Défis pour l’Allemagne et perspectives pour les États-Unis, Formation Emploi, n°45, 1994, p. 52.
- Mélange des genres qui n’a d’ailleurs pas été sans poser problème lors de la rédaction de ce livre. Dans la mesure où notre travail vise à problématiser l’usage de ces termes, et non à imposer l’un ou l’autre par une sorte de coup de force, nous nous sommes également retrouvés à naviguer d’un terme à l’autre, utilisant plutôt le qualificatif de «stagiaire» lorsqu’il est question de ce qui se passe en stage et d’«élève» lorsque nous portons attention à l’univers scolaire.
- Comme nous le montrons dans le premier chapitre du livre, la position qu’occupe les accompagnateurs/trices, à mi-chemin entre l’élève et l’entreprise, est complexe et leurs discours sont à la fois plus subtils et plus diversifiés que ne le laissent entendre ces quelques extraits.
- Voir à ce sujet l’ indémodable analyse de Richard Hoggart (La culture du pauvre, Minuit, Le sens commun, Paris, 1970/1957).
- Lordon Fréderic, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, Paris, 2010, p.76.
- Hambye Philippe, Mariscal Vincent, Siroux Jean-Louis, Le capitalisme néolibéral et la réalisation de soi par le travail dans Buclin Hadrien, Daher Jospeh, Christakis Georgiou, Raboud Pierre, Penser l’ émancipation: offensives capitalistes et résistances internationales, La Dispute, Paris, 2013, p. 87-109.
- La N-VA propose de baisser le salaire minimum des jeunes, Le Vif/L’ express, mis en ligne le 03/10/2014.
- En Italie, près de 15 % des stagiaires ont plus de 45 ans, Le Figaro, mis en ligne le 20/02/2017 et mis à jour le 22/02/2017.