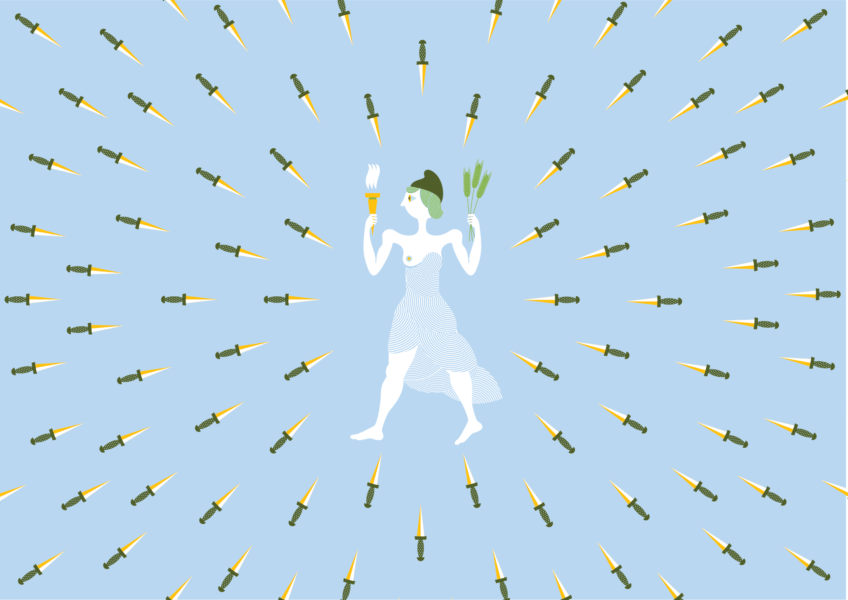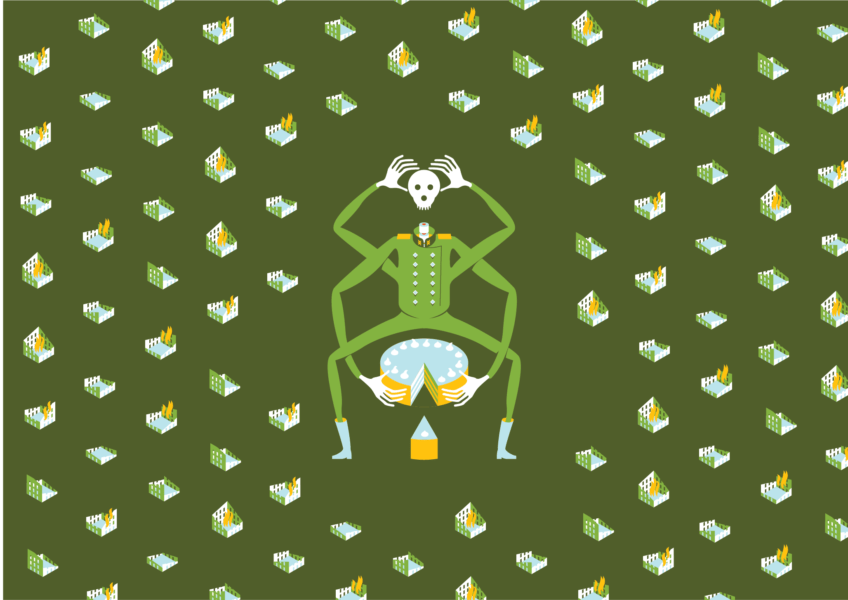Trois penseurs contemporains se demandent si le fascisme est sur le point de connaître une nouvelle ascension.
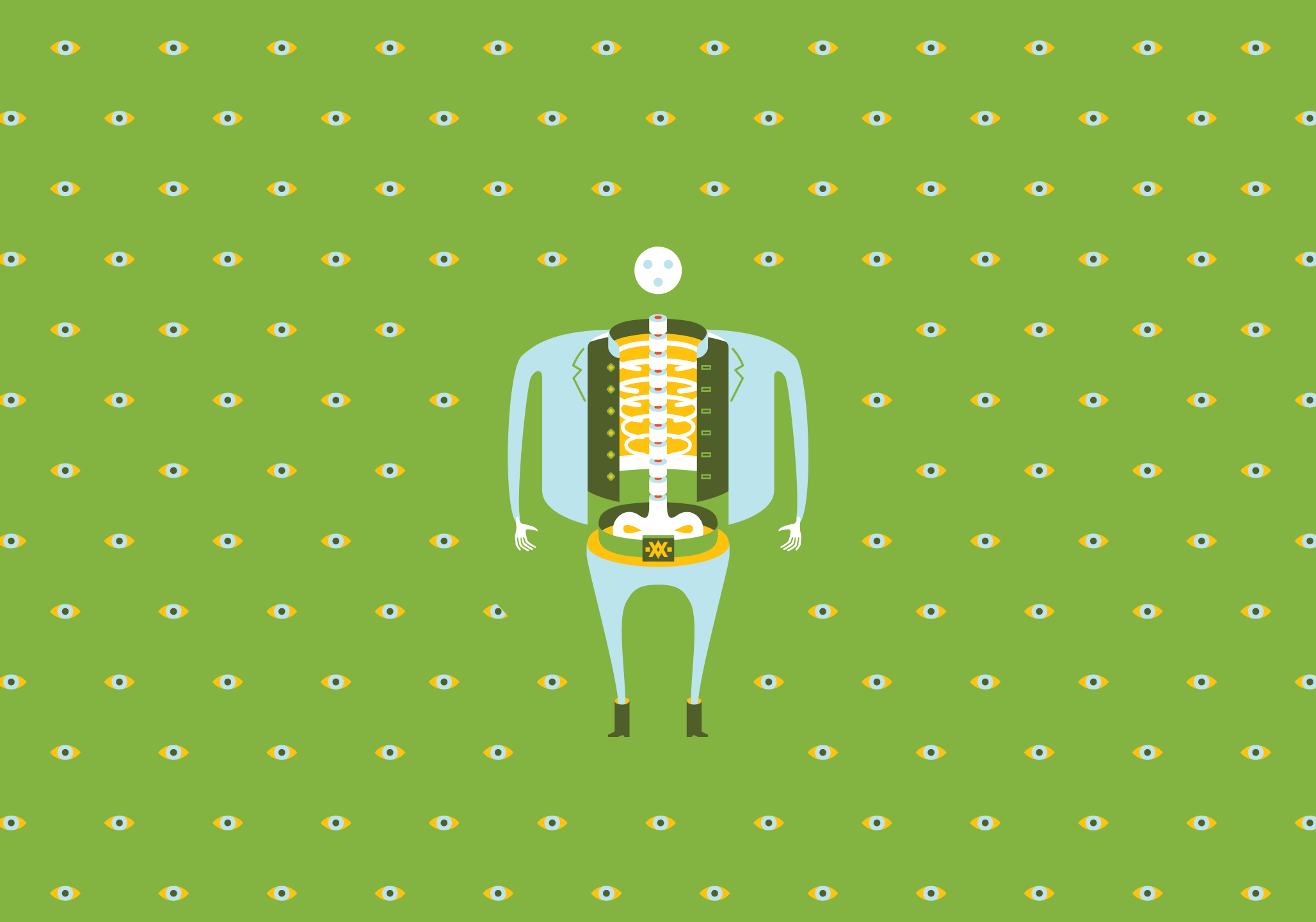
Le fascisme pourrait bien être le seul moyen pour les classes possédantes de maintenir, et même d’accélérer, les politiques de destruction néolibérale.
Ugo Palheta
Les succès électoraux récents des extrêmes droites – en Inde, au Brésil ou encore en Italie et en France – mais aussi l’élection surprise aux États-Unis d’un aventurier xénophobe, raciste et misogyne, ont ouvert à nouveau dans le débat public, du côté des gauches et au-delà, la question du fascisme et de son retour possible.

Il est vrai que, parmi ceux qui affirment le retour de la menace fasciste, certains tentent par là de faire oublier leurs bilans politiques désastreux, dont l’une des conséquences est précisément la progression des extrêmes droites, et d’apparaître comme d’improbables sauveurs. Ainsi a-t-on vu Emmanuel Macron, Hillary Clinton ou encore Matteo Renzi, s’ériger en «progressistes» et en «remparts» face à la montée des Le Pen, Trump et Salvini. Or l’extrême centre néolibéral, dont Macron & Cie, est le grand responsable de la renaissance et du développement des extrêmes droites. Et aucune alternative à ces dernières ne peut faire l’économie d’une rupture avec le capitalisme néolibéral et d’une indépendance vis-à-vis de ses représentants dans le champ politique. Mais la lucidité commande de ne pas s’arrêter en chemin: si danger il y a, il ne disparaît pas du seul fait d’être instrumentalisé par les politiciens néolibéraux; et si ces derniers profitent à l’évidence des succès des extrêmes droites pour se maintenir au pouvoir, cela ne signifie en rien que les forces ultra-nationalistes, réactionnaires et racistes, en développement un peu partout, ne constitueraient que de simples marionnettes dans les mains de l’extrême centre.
Cela dit, et si l’on s’accorde sur le fait que les extrêmes droites constituent un péril spécifique, peut-on parler d’un retour du fascisme? Peut-on user d’une catégorie aussi lourde de signification historique pour penser la situation politique actuelle et les extrêmes droites contemporaines? Répondre à cette question une fois pour toutes supposerait de disposer d’une définition consensuelle du phénomène fasciste car, à défaut, il est probable que chacun choisira une définition du fascisme lui permettant d’appuyer aisément la thèse préalablement choisie. Or, il suffit de parcourir les débats états-uniens à propos de Trump, ou français à propos du FN/RN, pour constater qu’un tel consensus n’existe pas. Il nous semble néanmoins possible d’avancer en mettant tout d’abord à distance deux écueils: une définition si restrictive qu’elle interdit toute comparaison (à la limite le fascisme serait réductible au fascisme italien des années 1920-1930); une définition si large (généralement le fascisme est considéré comme autoritarisme) qu’elle englobe une multitude de phénomènes et ne saisit plus rien spécifiquement, ni sur le plan idéologique ni sur celui des modalités de conquête et d’exercice du pouvoir.
Le fascisme est un phénomène politique protéiforme, et, dans l’entre-deux-guerres, des différences importantes existaient déjà entre les mouvements généralement qualifiés de fascistes (PNF de Mussolini, NSDAP de Hitler, Phalange espagnole, Garde de fer roumaine, PPF de Doriot, etc.). Cependant, le fait de recourir à une même catégorie pour les penser suppose qu’ils ont quelque chose de commun, au-delà d’un simple «air de famille»: à la fois une idéologie qui cherche l’oreille des masses, une stratégie pour conquérir le pouvoir politique, et une fonction du point de vue du système.
Une idéologie: la régénération d’une nation fantasmatique, mythifiée et essentialisée, par l’opération d’une double purification (ethnique et politique), ciblant notamment les minorités, les mouvements sociaux et la gauche politique. Une stratégie: la construction et le développement d’une organisation cherchant à apparaître à la population comme une alternative aussi bien aux partis bourgeois traditionnels (aux yeux des possédants) qu’aux partis ouvriers (aux yeux des dépossédés). Une fonction: le rétablissement d’un ordre politique devenu instable, par la destruction de tout espace démocratique, et le renforcement d’un ordre social contesté, par l’écrasement de tout mouvement de contestation.
Selon nous, ce n’est donc pas la constitution de bandes armées, ni même l’usage de la violence politique, qui constituent le propre du fascisme, que ce soit en tant que mouvement ou comme régime, même si ces phénomènes y occupent une place centrale. En effet, d’autres mouvements et d’autres régimes, n’appartenant nullement à la constellation des fascismes, ont eu recours à la violence pour conquérir le pouvoir ou s’y maintenir, parfois en assassinant des dizaines de milliers d’opposants (sans même parler de l’usage légitime de la violence par des mouvements de libération). Les milices extra-étatiques, qui constituent la dimension la plus visible du fascisme classique, sont en réalité un élément subordonné à la stratégie des directions fascistes: celles-ci n’en font qu’un usage tactique en fonction des exigences imposées par le développement de leurs organisations. D’autant plus que, dès l’entre-deux-guerres mais encore davantage aujourd’hui, la conquête légale du pouvoir politique suppose d’apparaître comme un tant soit peu respectable, donc de mettre à distance les formes les plus visibles de violence. La force des mouvements fascistes ou néofascistes se mesure alors à leur capacité à manier – selon la conjoncture historique – tactique légale et tactique violente, guerre de position et guerre de mouvement (pour reprendre les catégories de Gramsci).
Déterminer le caractère fasciste d’un mouvement ne revient donc pas à se demander si figurent en son sein et en bonne place des fascistes déclarés, des nostalgiques affichés de Mussolini ou d’Hitler, mais dans quelle mesure on y retrouve ces éléments fondamentaux. De ce point de vue, il nous semble que nombre de politiciens et de mouvements contemporains d’extrême droite – du BJP indien au FN/RN en passant par la Lega et Bolsonaro – doivent être qualifiés de fascistes, et non simplement de «populistes». Cette dernière catégorie ne fait qu’obscurcir les débats puisqu’elle mêle, à partir de critères flous, des mouvements de gauche et d’extrême droite.
Mais parler de danger fasciste permet également de pointer un certain type de situation politique, en l’occurrence une crise d’hégémonie généralisée, où se combinent un ébranlement de la domination politique bourgeoise et une faiblesse des mouvements d’émancipation. C’est durant ce type de crise que des organisations d’extrême droite peuvent alors parvenir au pouvoir. Plus précisément, si le fascisme est à nouveau à l’ordre du jour, c’est parce qu’en tant qu’agent de destruction de toute démocratie, même entendue dans un sens minimal, il pourrait bien être le seul moyen pour les classes possédantes de maintenir, et même d’accélérer, les politiques de destruction néolibérale.
Les nouveaux populistes d’extrême droite partagent des objectifs politiques et deviennent les compagnons de route de nombreux fascistes.
Federico Finchelstein
Nous vivons actuellement dans un contexte de renouveau de l’extrémisme, de l’autoritarisme et du racisme. Comme à l’époque du fascisme, l’attaque envers la démocratie prend la forme d’une critique de ses dimensions émancipatrices. Cela se fait au nom de l’égalité raciale et est souvent présenté en termes apocalyptiques. Les détracteurs parlent d’une manière douteuse au moyen de projections. Ils se présentent comme opposants à des tyrans (l’UE ou le Mexique) et à des agresseurs qualifiés d’envahisseurs, de remplaçants, desocialistes, d’ennemis du peuple ou de gens du voyage. En réalité, ils font de ceux qui sont différents, pensent ou agissent différemment, les victimes de leur politique tout en répétant les mensonges selon lesquels ce serait eux les victimes. Pensez au slogan des supporters de Trump: «Make America Great Again». Ils veulent revenir à une époque de profonde inégalité politique et d’inégalité tout court, à l’époque d’avant le développement des droits civiques. Partout, à l’échelle mondiale, la démocratie est attaquée par des ennemis aussi nouveaux qu’anciens qui prétendent tous parler au nom du peuple alors que, comme c’était le cas dans le fascisme, ces nouveaux adeptes de l’autoritarisme ne constituent qu’une partie de la population, celle qui est blanche et qui a une identité ou une origine chrétienne.

Cela signifie-t-il que le fascisme est de retour? L’histoire se répète-t-elle? Après l’émergence du trumpisme et autres populismes racistes extrémistes, on entend souvent dire que nous serions revenus à l’époque de Weimar ou de Munich, époque où la démocratie a été attaquée d’abord de l’intérieur et ensuite de l’extérieur par l’invasion fasciste.
Bien des choses ont changé depuis la chute du fascisme en 1945 et le monde n’est plus ce qu’il était. S’il est vrai que la situation actuelle ressemble de plus en plus au monde fasciste d’autrefois, l’Histoire n’est pas cyclique et notre réalité a peu à voir avec celle du fascisme classique. Il n’y a pas de guerres civiles et impérialistes au nom d’un dirigeant et d’une race. Il n’y a pas d’Union soviétique et des pays comme la Chine ou l’Inde sont maintenant de grands acteurs indépendants.
Pourtant, il y a de nombreux signes qui peuvent le laisser croire. Aujourd’hui, il n’y a plus de guerres fascistes, mais il y a en revanche beaucoup de mensonges xénophobes et racistes. Ces mensonges sont fabriqués par le sommet et font partie d’une désinformation planifiée, d’une propagande identique à celle qui a rendu le fascisme très puissant. La première chose à clarifier sur ces convergences entre passé et présent est que l’époque d’Adolf Hitler, de Benito Mussolini et du génocide des juifs d’Europe est très différente de la nôtre. Les droits de l’homme, la décolonisation et le renforcement de la démocratie, après les défaites du fascisme, ont été les plus belles victoires de la lutte antifasciste. Les guerres, les répressions, les dictatures et même les génocides ont persisté après 1945. Mais, s’il y a une leçon à retenir de notre difficile victoire sur Hitler, c’est que la démocratie peut être détruite si on ne la défend pas avec vigueur. Pensez à l’invasion fasciste de l’Éthiopie en 1935, à la guerre civile espagnole (1936-1939) et au pacte de Munich en 1938: il s’agissait de démocraties ayant perdu pied devant les fascistes, pensant qu’elles éviteraient une guerre plus longue si elles ne réagissaient pas aux attaques contre des pays à la périphérie des grandes puissances occidentales. Sommes-nous en train d’ignorer des situations semblables comme l’ont fait les démocraties libérales dans les années 1930? Sommes-nous en train d’ignorer le fait que les pays qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale sont gouvernés par des dirigeants autoritaires ?
Nous sommes maintenant dans une position beaucoup plus favorable que celle des démocraties qui, autrefois, ont été attaquées par le fascisme transnational. Notre connaissance de l’Histoire n’est pas la même, la technologie n’est pas la même, notre accès à l’information n’est pas le même (quand on s’y intéresse) et les nouveaux autoritarismes populistes ne sont pas non plus les mêmes.
En somme, nous vivons dans un contexte très différent de celui qu’il y avait à l’arrivée au pouvoir des fascismes et qui a donné lieu à une destruction totale. Dans l’entre-deux-guerres, la critique de la démocratie par l’extrême droite était devenue à la mode et les réponses ont été fascistes, corporatistes et dictatoriales. Et cela, à l’échelle mondiale. En Allemagne et en Italie, mais aussi en Argentine, au Brésil et dans de nombreux autres pays du monde, des gouvernements dictatoriaux se sont constitués et la démocratie a été complètement détruite. Cependant, la montée du fascisme au pouvoir, la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale ont amené un soulèvement mondial et spectaculaire de l’antifascisme.
Après 1945, le bloc soviétique et le libéralisme à l’Américaine se sont affrontés dans une guerre froide entre communisme et libéralisme, donc entre ceux qui avaient vaincu le fascisme. Mais cette période a aussi vu la création d’une nouvelle forme de régime de pouvoir: le populisme. D’abord en Amérique latine, puis à l’échelle mondiale, le populisme a tenté de créer une forme politique démocratique en dehors, ou au-delà, du libéralisme et du socialisme et de présenter une réponse à la fois démocratique et autoritaire. Après 1945, la plupart des régimes populistes ont rejeté les éléments clés du fascisme: la violence, la dictature et le racisme. Et pourtant, les nouveaux populistes d’extrême droite partagent des objectifs politiques et deviennent les compagnons de route de nombreux fascistes. De plus, Donald Trump ou Jair Bolsonaro reviennent aux méthodes et aux thèmes de prédilection des fascistes. Comme eux, ils placent la démagogie, le culte de la personnalité et la glorification de la violence au cœur de leur régime et le racisme est un élément clé de leur politique. Cependant, de nos jours, si les populistes veulent minimiser la démocratie et la diminuer, ils ne veulent pas la détruire, contrairement aux fascistes. Et, dans de nombreux pays du monde, ils réussissent bel et bien, déclarant finalement la guerre à tous ceux qui ne partagent pas leur foi dans le racisme et la dictature. Pour dire les choses simplement, les populistes actuels n’aiment pas les dictatures, ils veulent une forme de démocratie raciste et profondément inégalitaire.
Et, précisément dans ce contexte, il est important de rappeler que, même si le fascisme n’est pas de retour au pouvoir, ces formes racistes de populisme ne doivent pas être prises à la légère et considérées comme une simple continuité des autres formes d’inégalités. La mémoire des crimes fascistes fait partie de notre culture politique démocratique et nous devrions être très conscients de tout ce que l’Histoire nous enseigne à cet égard. La plupart de nos démocraties, en Europe, en Amérique latine et ailleurs, sont enracinées dans l’héritage idéologique de la victoire sur le fascisme en 1945. L’histoire du fascisme nous enseigne quel a été cet ennemi finalement vaincu, quelles ont été l’horreur et la destruction liées à ses actions et de cela nous devons nous souvenir. Mais nous devons aussi comprendre que cela a été rendu possible parce que la démocratie était moins participative, qu’elle était inégalitaire et dirigée de façon autoritaire. L’histoire des fascismes et de la guerre mondiale qu’ils ont déclenchée et celle des populismes apparus après eux au siècle dernier nous enseignent que, face à ces projets, la démocratie constitutionnelle doit se défendre en s’amplifiant, en devenant plus participative et moins inégalitaire.
Même si une menace fasciste réelle est peu probable, une érosion profonde et durable de la culture démocratique est à l’ordre du jour partout dans le monde.
Vivek Chibber
Il est très peu probable que le fascisme soit à l’ordre du jour politique en Europe et aux ÉtatsUnis. Je doute même qu’il se profile à l’horizon en Inde, le pays où il représente la plus grande menace. Mais ce n’est pas une raison pour nous reposer sur nos lauriers. Même si une menace fasciste réelle est peu probable, une érosion profonde et durable de la culture démocratique est à l’ordre du jour partout dans le monde. Notre capacité à y faire face et à reconstruire les outils nécessaires à la participation démocratique dépend d’une analyse sans complaisance de la conjoncture, sans s’adonner à l’hyperbole ou l’hystérie, ce que la gauche a tendance à faire chaque fois qu’un conservateur gagne une élection.

Le fascisme est le nom donné à la forme de gouvernance qui s’est développée dans les deux décennies qui ont suivi la Première Guerre mondiale; l’Italie et l’Allemagne étant les cas les plus connus. Il est associé à beaucoup de choses et il n’existe pas de consensus quant à son essence. Mais, la plupart des gens s’accordent à dire que l’une de ses principales caractéristiques est le démantèlement des libertés démocratiques, la suspension des droits politiques, une idéologie nationaliste féroce et une notion de communauté politique fondée sur une forte dose de racisme et de xénophobie. Certains de ces éléments se retrouvent aujourd’hui chez les partis de droite, notamment la xénophobie et le racisme. Et c’est ce qui conduit beaucoup de personnes à suggérer que ces partis sont une nouvelle incarnation du fascisme de l’entre-deux-guerres. Mais, si les similitudes sont tout à fait réelles, il y a lieu cependant d’être sceptique à l’égard des affirmations les plus enflammées.
La raison fondamentale pour laquelle ces partis ne représentent pas une menace fasciste est qu’il n’y a aucun signe indiquant que les classes dirigeantes les soutiennent. Dans toute démocratie moderne, remporter des sièges au gouvernement exige un succès électoral et il ne fait aucun doute que la droite a miné la base électorale des principaux partis, y compris celle des partis de gauche. Mais, pour réussir à gouverner le monde et à réaliser le genre de transformations politiques associées au fascisme de l’entre-deux-guerres, il faudrait obtenir l’assentiment et le soutien des groupes qui comptent vraiment, c’est-à-dire les banquiers et les industriels qui contrôlent l’économie et financent les campagnes électorales des partis. Pendant l’entre-deux-guerres, les élites économiques se sont tournées vers les fascistes en grande partie parce qu’elles considéraient la gauche comme une menace pour leur survie et que tous les autres stratagèmes destinés à détruire la gauche avaient échoué. Elles étaient prêtes à se plier à la restructuration radicale de l’État parce que cela semblait être la seule solution à un problème politique insoluble. C’était une tentative désespérée de maintenir leur pouvoir, sans doute une surestimation de la menace posée par les partis communistes, même si cette perception n’ait pas été sans fondement.
Aujourd’hui, la situation est très différente. Le succès actuel de la droite se produit dans un contexte d’implosion de la gauche et de repli massif du mouvement syndical. Il n’y a de menace ni pour les profits et la stabilité économique, ni pour l’ordre politique. Même si la croissance s’est ralentie dans tous les secteurs, la répartition entre les salaires et les bénéfices est massivement favorable à ces derniers. En effet, même le resserrement des marchés du travail ne semble pas donner d’impulsion durable aux augmentations de salaires. Pour les employeurs, la situation est donc presque aussi idéale qu’au cours du dernier demi-siècle. L’une des raisons pour lesquelles l’envol des salaires ne s’est pas produit est que l’ère néolibérale, même si elle semble maintenant s’essouffler, a légué un environnement institutionnel dans lequel tous les mécanismes traditionnels de pression des travailleurs sur les employeurs ont été abolis: syndicats, partis politiques, communautés culturelles, etc. Les travailleurs sont maintenant confrontés à leurs employeurs en tant qu’individus, en tant que porteurs atomisés de la force de travail, privés de tout soutien social et de toute solidarité de classe. Le résultat de cette érosion des institutions sociales est une chute catastrophique de la capacité d’action collective, à agréger des intérêts individuels en revendications collectives.
Fondamentalement, les pauvres jouissent de toute la gamme des droits politiques, mais sont de moins en moins en mesure de les exercer. Ils peuvent voter, mais ne peuvent avoir beaucoup d’influence sur les programmes des partis: ils peuvent choisir des députés, mais n’ont pas la capacité de les tenir pour responsables; ils ont le droit à la parole, mais le débat politique est entièrement dominé par les élites qui l’abreuvent de déclarations formelles et préfabriquées. Il en résulte une tendance croissante au cynisme et au désespoir, au sentiment que toute tentative de participation est inutile et que le système est entièrement truqué. Ils abandonnent la politique et essaient simplement d’acheter leur liberté en devenant plus individualistes dans le monde du travail.
Dans cette situation, il n’y a tout simplement aucune raison d’éradiquer les droits politiques et de démanteler la démocratie, comme l’ont fait les fascistes dans les années 1930. Ce serait contreproductif. Ce que les classes dirigeantes cherchent à faire, c’est dominer le processus politique. Mais, il n’est pas nécessaire que cela passe par l’exclusion formelle des citoyens. Cela reste bien sûr une option. Mais, si les pauvres et les classes travailleuses choisissent de quitter simplement l’arène politique ou d’aller volontairement à droite, le fascisme ne devient pas seulement inutile, il peut aussi nuire aux intérêts des élites. Comme Noam Chomsky l’a souligné à maintes reprises, enlever des droits aux gens a tendance à susciter une réaction: ils veulent les récupérer, même s’ils n’en ont fait qu’un usage intermittent. La meilleure option est de continuer avec les oripeaux formels de la démocratie, tout en érodant la capacité et la volonté des gens à les utiliser. La meilleure stratégie n’est donc pas d’éradiquer les droits, mais de les rendre inapplicables.
Cela ne veut pas dire que tout est sous contrôle pour les élites dirigeantes. L’échec économique du néolibéralisme, qui a permis le développement de ces partis de droite, a conduit dans le même temps à son effondrement idéologique. Dans un grand nombre de pays, les citoyens considèrent aujourd’hui ce modèle comme profondément illégitime. Et, faute d’autres moyens pour exprimer leur mécontentement, ils canalisent leurs frustrations dans l’arène électorale. Ils votent pour la droite parce qu’à l’heure actuelle, c’est la formation politique qui stimule le plus la demande économique, alors que la gauche traditionnelle est totalement compromise et que c’est elle qui, trop souvent, a imposé l’austérité aux travailleurs. La droite radicale, jusqu’à présent en marge du système, a su capitaliser ce mécontentement. Mais, c’est précisément parce que les banquiers et les industriels ne voient aucunement leur pouvoir profondément menacé, qu’ils n’encouragent aucune initiative visant à démanteler l’État démocratique. Ils continuent simplement à réduire la portée de la participation politique des citoyens.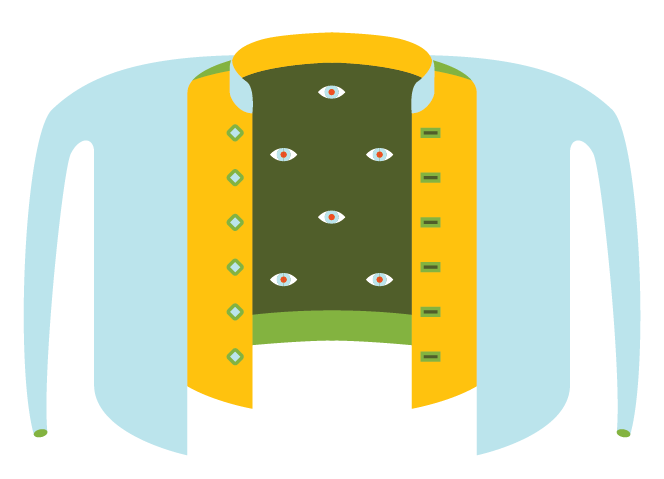
Et c’est là que réside la véritable menace. L’obsession du fascisme obscurcit la capacité de la gauche à voir que nous sommes confrontés à un développement nouveau du capitalisme, à une situation dans laquelle une forme oligarchique de gouvernement est consolidée alors même que les institutions démocratiques formelles restent en place. Ce qui cimente une exclusion politique fondée, non pas sur une répression ouverte, mais sur l’augmentation des obstacles à la participation politique, sur l’atomisation de la population par les forces du marché et sur la diabolisation des petits groupes. Cela conduit à une forme nouvelle et plus subtile de contrôle politique, où la violence est exercée de manière plus judicieuse, où les tribunaux et la loi sont utilisés pour disperser tout signe de protestation collective, où la nature même de la participation politique est réduite à la ratification de décisions déjà prises à huis clos. C’est cela qui est à l’ordre du jour de la nouvelle droite. Une situation bien différente de celle des années 1930, mais tout aussi dangereuse.