C’est le démembrement de la Belgique qui a entraîné des discours différents sur la Seconde Guerre mondiale et la résistance et pas l’inverse. La réécriture de l’histoire est devenue une astuce politique pour les séparatistes.

Le 5 mai 1940, l’armée allemande envahit à nouveau la Belgique, comme elle l’avait fait à peine 26 ans plus tôt1. Craignant que les atrocités de 1914 ne se répètent, plus d’un million et demi de citoyens belges – environ un cinquième de la population – fuirent vers le sud2. Le gouvernement belge fit de même, certain que les armées française et britannique arrêteraient l’avancée d’Hitler et permettraient à l’armée belge de poursuivre la guerre à leurs côtés. Le roi Léopold III évalua la situation différemment et décida de se rendre à l’envahisseur allemand après dix-huit jours de combat, en sa qualité de commandant en chef de l’armée belge.
Pour les patriotes, l’ennemi était l’Allemagne. Pour les antifascistes, l’ennemi était le fascisme.
Durant l’été 1940, le climat aurait été propice à la création d’un nouveau régime collaborationniste avec la bénédiction allemande. Le roi Léopold aspirait à jouer un rôle de sauveur national et de leader de la renaissance nationale, semblable à celui joué par le général Pétain en France. Dans cette optique, il pouvait compter sur le soutien et la collaboration d’hommes politiques de premier plan de l’avant-guerre, dont le plus éminent était Henri De Man, président du Partisocialiste3. Mais la bénédiction allemande n’arriva pas. Hitler n’avait pas de plan préétabli pour la constellation politique du continent européen après une victoire allemande totale4.
Pour bien comprendre la nature de la résistance contre l’occupation nazie, il est crucial de définir la nature de cette occupation. Au début de la guerre, l’armée nazie semblait invincible. De plus, elle avait reçu des instructions selon lesquelles les objectifs de la guerre à l’Ouest étaient avant tout la pacification – c’est-à-dire l’occupation et l’exploitation économique avec le moins de troupes allemandes possible – et non la Vernichtungskrieg qu’elle avait menée plus tôt en Pologne avec la brutalisation systématique des civils et des meurtres de masse. L’un des principaux objectifs de cette occupation en Europe occidentale était d’éviter de provoquer une résistance à grande échelle et cette politique fut, dans une certaine mesure, couronnée de succès5. Il n’est que normal que l’attitude expectative de l’occupant allemand en Belgique, comme aux Pays-Bas et au Danemark, ait provoqué une attitude similaire dans de larges pans de la société belge, bien plus normal en tout cas que dans un pays comme la France, par exemple, où le régime de Vichy était synonyme d’engagements idéologiques forts. En Europe de l’Est, une telle option n’a jamais existé. La résistance sur le front de l’Est était une question de survie, puisque l’extermination de la population locale était l’un des principaux objectifs de la guerre.
Face à un vide politique, les secrétaires généraux de l’administration belge acceptèrent de coopérer avec l’occupant pour éviter le chaos, aider la population et éviter leur remplacement par des sympathisants de l’Ordre nouveau nazi 6. Les élites économiques étaient confrontées à un dilemme similaire: le refus de coopérer pouvait entraîner le démantèlement de l’infrastructure économique et la déportation des travailleurs7. À la fin de la guerre, les deux groupes prétendirent que leur stratégie avait retardé la mise en œuvre de politiques nazies et permis d’éviter pire. Certains allèrent jusqu’à qualifier leur «coopération obstructive» de forme de résistance contre l’ennemi. Nous n’accepterons pas cette définition dans ce texte. Nous considérerons la résistance sous un angle plus formel, à savoir les activités contre les objectifs ennemis, interdites par l’ennemi et impliquant donc des risques réels pour leurs auteurs8.
La nature de l’occupation a changé avec le temps et c’est cette évolution qui explique l’évolution de la résistance9. À mesure que l’occupation s’est radicalisée, la résistance s’est radicalisée aussi; à mesure que l’occupation a visé de nouveaux groupes, de nouveaux groupes sont entrés en résistance. Une chronologie approximative pourrait distinguer schématiquement trois moments décisifs dans l’entrée en résistance active de trois catégories différentes d’individus: 1)la ténacité du patriotisme belge et les milieux d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale en 1940: 2)l’entrée univoque dans la résistance radicale du Parti communiste après l’invasion de l’Union soviétique en juin 1941, mobilisant un groupe antifasciste beaucoup plus important: 3)l’élargissement de la résistance fin 1942, début 1943, en raison du travail obligatoire et du tournant de la guerre à Stalingrad.
Patriotes de la première heure
Sur la scène européenne, la ténacité du patriotisme belge au lendemain de la défaite de 1940 constitue une des particularités de la Belgique. L’écho de la Grande Guerre domine ces premières formes de résistance. La défaite militaire avait entraîné des problèmes militaires d’une urgence immédiate. L’un d’eux était le problème des soldats alliés isolés qui s’étaient cachés ou avaient réussi à s’échapper dans la confusion des premières semaines, après avoir été capturés sur le champ de bataille. Pour l’armée britannique, il était essentiel de récupérer des militaires expérimentés et pas seulement en raison de l’impact psychologique majeur de leur retour. Il fallait récupérer les équipages des avions abattus lors de leur passage dans l’espace aérien belge, vu la rareté des pilotes et techniciens formés et la difficulté de les remplacer.
La logistique des lignes d’évasion a impliqué les organisations de résistance comptant le plus de femmes et a recruté dans les milieux patriotiques favorables aux Britanniques, notamment dans les milieux aristocratiques10. La ligne d’évasion la plus célèbre est Comète, dirigée par une jeune femme, Andrée De Jongh11. Férocement indépendant par rapport aux services secrets britanniques et belges, le réseau aida plus de 700 militaires alliés à s’échapper de Belgique en passant par la France et l’Espagne, grâce à l’implication active de 2.000 volontaires. Plus de 150 personnes, dont un tiers de femmes, payèrent leur engagement de leur vie.
Les réseaux de renseignement avaient un profil similaire. Ils résultaient du désir de «faire quelque chose» immédiatement après la défaite, sentiment particulièrement fort dans certains milieux militaires12. Ils étaient très favorables aux Britanniques et entretenaient souvent des liens plus forts avec les services britanniques qu’avec leur propre gouvernement en exil. Le patriotisme était à nouveau leur principale motivation et la référence à la Première Guerre mondiale était toujours présente. Au cours de la guerre, quarante-trois réseaux de renseignement furent organisés sur le territoire belge, impliquant plus de 18.000 personnes13. Outre les lignes d’évasion, le renseignement était l’activité de résistance la plus appréciée par l’armée britannique, afin d’espionner l’armée allemande, ses mouvements et sa logistique au sol, dans le but de préparer des raids aériens, de vérifier leur efficacité et de préparer un débarquement allié.
Les efforts pour recréer une armée belge clandestine sont une troisième expression du refus militaire patriotique de la défaite. Commençant dans des cercles d’officiers de carrière, ces premiers recrutements avaient un profil résolument conservateur. La conception était traditionnelle. Plutôt que d’expérimenter de nouveaux modes d’organisation adaptés à la guerre souterraine, à la guérilla et à l’action clandestine, ils tentèrent de reconstituer une hiérarchie militairesecrète14. Leur ambition militaire était limitée: il n’était pas question d’engager ces troupes dans un combat avec l’armée d’occupation. Cela s’accompagnait d’un programme politique réactionnaire: toute l’organisation visait à préparer la période après la Libération, qui ne pouvait venir que de l’étranger. Les troupes devaient garantir le respect de la loi et l’ordre après la retraite allemande et considéraient les communistes et les collaborateurs comme leurs principaux ennemis. Cette vision était complétée par une admiration inébranlable pour le roi Léopold, le mépris du «parlementarisme» et du gouvernement de Londres, ainsi qu’une conception autoritaire du futur état d’après-guerre.
L’admiration pour le roi, le mépris du gouvernement de Londres et une conception autoritaire de l’état complétaient la vision de l’armée clandestine.
Fin 1942, le gouvernement belge, le SOE et la Légion belge acceptèrent de se reconnaître mutuellement, à condition que les formations militaires se limitent à combattre l’ennemi et à contribuer à la Libération, après quoi leur tâche serait terminée. Les formations militaires prirent le nom d’«Armée secrète de Belgique», sur l’insistance du gouvernement pour souligner que l’organisation serait dissoute après la Libération et qu’une nouvelle armée régulière avec une nouvelle hiérarchie serait créée ensuite. L’Armée secrète renonça également à toutes ses ambitions de maintien de l’ordre à la Libération. De toutes les formations de résistance, l’Armée secrète est celle qui reçut le plus d’aide financière et d’armes. Même si certaines actions de sabotage ciblé furent entreprises sur ordre du SOE, son activité ne commença vraiment qu’avec le débarquement allié en juin 1944, notamment par le sabotage à grande échelle du réseau ferroviaire. Pendant les combats de libération – qui furent limités en raison du retrait rapide des troupes allemandes – des milliers de volontaires de l’Armée secrète aidèrent les troupes alliées, ce qui n’était pas sans danger15. La formation perdit près de 4.000 membres jusqu’à la fin de la guerre. Après la guerre, elle revendiqua plus de 50.000 membres, chiffre qu’il faut interpréter avec prudence, car la plupart d’entre eux ne commencèrent leur activité qu’à la toute fin de l’occupation.
Le réflexe patriotique ne se limitait pas à ces trois formes très organisées de «résistance». Les sentiments anti-allemands trouvèrent une expression individuelle et diffuse dans des actes de sabotage, dont les câbles téléphoniques allemands étaient la principalecible16. Entre mai 1940 et mars 1941, les autorités allemandes enregistrèrent en moyenne plus d’un acte de sabotage par jour, ce qui était plus une source d’irritation constante qu’un véritable obstacle17. Dans la seconde moitié de 1941, après l’entrée en résistance du Parti communiste, ce nombre tripla et les réactions allemandes s’intensifièrent. Très différent de ces premières actions individuelles non coordonnées, le sabotage opéré par le Groupe G, une équipe dirigée par des scientifiques et des ingénieurs de l’Université de Bruxelles, était bien préparé et méticuleusement mis en œuvre18.
Les quatre formes de résistance impliquaient un groupe limité de personnes travaillant dans le plus grand secret, à l’insu non seulement des autorités allemandes, mais aussi de l’écrasante majorité de leurs concitoyens. La presse clandestine fut donc l’expression la plus importante du patriotisme belge au lendemain de la défaite et tout au long des années d’occupation19.
La collecte clandestine d’informations était la forme de subversion la plus efficace contre un Ordre nouveau.
Les publications clandestines de 1940 étaient pour la plupart des initiatives artisanales de petite envergure. Cette presse ne diffusait pas de programmes politiques élaborés; leur contenu respirait le patriotisme traditionnel, anti-allemand plutôt qu’antinazi, et pro-britannique plutôt qu’en faveur du gouvernement en exil. Il y avait de nombreuses références à la Première Guerre mondiale, au roi Albert, au cardinal Mercier et à Adolphe Max, le bourgmestre héroïque de Bruxelles pendant la Grande Guerre. Provenant surtout des milieux patriotiques bourgeois, ces journaux clandestins eurent un impact considérable. Dans un contexte de censure de la presse et de propagande massive, ils constituaient un puissant antidote et une démonstration d’indépendance d’esprit. Les tracts passaient dans de nombreuses mains et la distribution de journaux clandestins favorisa la rencontre d’esprits similaires qui constituèrent souvent des embryons d’organisations de résistance.
Alors que la résistance contre l’occupation croissait, la presse clandestine prit de l’essor tant en nombre de titres qu’en tirage. On compte 567 titres et plus de 4.000 numéros différents pour toute la période d’occupation, ce qui diversifie les tendances politiques20. Le Front de l’indépendance, dont nous allons détailler l’action ci-dessous, fut l’un des principaux producteurs avec 167 titres différents. Il fut également à l’origine de l’exploit le plus célèbre des années d’occupation: le «faux» Soir du 9 novembre 1943. La presse clandestine était une activité périlleuse que les autorités nazies réprimaient impitoyablement. Plus de 2.000 imprimeurs, auteurs et distributeurs furent tués en raison de leurs actions, dont 17 des 22 membres de l’équipe du faux Soir. Grâce aux nombreux lecteurs, la collecte clandestine d’informations était la forme de subversion la plus efficace contre un Ordre nouveau qui ambitionnait de contrôler toutes les sphères de la vie publique.
Toutes ces premières formes de résistance partageaient un ancrage patriotique bourgeois et une référence aux symboles et formes d’action traditionnels (à l’exception du sabotage). Elles étaient donc le fait d’individus isolés ou de réseaux étroits, enracinés dans des cercles sociaux spécifiques: officiers de carrière, vétérans de guerre, aristocratie anglophile, patriotisme urbain. Elles résultaient toutes d’un rejet spontané de l’occupation par des groupes et individus qui ne souffraient pas personnellement de l’occupation, bien au contraire. À ce stade précoce, les cercles les plus représentés étaient les mieux préservés de la pénurie de nourriture et du chômage massif qui frappa les classes populaires la première année de l’occupation. Cet attachement s’ancrait dans le nationalisme, pas toujours le plus démocratique, mais aussi dans un attachement plus éclairé aux principes de l’État libéral que l’occupant piétinait systématiquement. Ce rejet des méthodes autoritaires ne fit que s’accentuer à mesure que les méthodes de l’occupant devinrent plus impitoyables et sanglantes. Il fut alors lié au rejet d’une idéologie, le nazisme. Lorsque le patriotisme rencontre l’antifascisme, la résistance se transforme en un mouvement de masse, où les forces de tous les secteurs de la société s’unissent dans de nouveaux moyens d’action collective.
Antifascistes, par idéologie et par nécessité
Cette typologie ne prétend certainement pas que la résistance à ses débuts n’était que la préoccupation de la bourgeoisie et que les classes populaires ont tardé à prendre conscience de la vérité, qu’une occupation était inacceptable. Nous voulions seulement souligner que certains types d’action, certains modes d’organisation et certaines références symboliques et idéologiques trouvaient une propension naturelle dans certains milieux et que la chronologie les favorisait par rapport à d’autres qui mirent plus de temps à émerger, mais qui s’avérèrent aussi plus influents et efficaces.
Pour les patriotes, l’ennemi était l’Allemagne et il y avait une longue histoire à cela. Pour les antifascistes, l’ennemi était le fascisme et plus particulièrement sa version allemande, le nazisme, avec son racisme explicite et son culte de la violence, et il y avait également une histoire à cela. L’antifascisme était une composante essentielle de l’identité de gauche dans les années 3021. La Belgique avait accueilli des réfugiés politiques d’Italie et d’Allemagne et la solidarité avec la République pendant la guerre civile espagnole avait été une expérience formatrice pour une génération de jeunes militants qui s’éveillaient à la politique pendant ces années. L’antifascisme n’était pas l’affaire marginale d’une frange radicale: il mobilisait également de nombreux membres du Parti ouvrier belge. Le mouvement de solidarité internationale favorisa un rejet viscéral des mouvements fascistes belges. Les défilés du Rex, du Dinaso, du VNV et de leurs milices ne dominèrent jamais les rues comme ceux de leurs homologues italiens et allemands et reçurent certainement plus de coups de contre-manifestants antifascistes qu’ils n’en donnèrent22. Pourtant, au moment de l’invasion allemande, le mouvement antifasciste était en crise profonde et ses principaux protagonistes paralysés.
Une partie de la crise était d’ordre international. Tout au long des années 30, le Parti communiste avait été férocement engagé dans la campagneantifasciste23. Il entretenait des contacts très étroits avec les exilés italiens, espagnols et allemands et envoya proportionnellement le plus grand nombre de volontaires belges – plus de 2.000 – pour les brigades internationales24. Ses militants occupèrent le devant des manifestations antifascistes et le parti critiqua publiquement la politique de neutralité de Léopold III, les concessions anglo-françaises à Hitler à Munich et la reconnaissance du gouvernement franquiste par le ministre socialiste des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, en mars 1939. Le parti et ses militants furent donc stupéfaits par le pacte de non-agression signé entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique le 23 août 193925. Guidé par son instructeur du Komintern, le parti improvisa alors une nouvelle ligne politique, remplaçant son antifascisme radical par le slogan «Ni Londres, ni Berlin», en soulignant sa condamnation de l’impérialisme des pays capitalistes. Ce changement soudain désorienta de nombreux militants et les isola en particulier des militants socialistes.
L’invasion ne changea pas la ligne politique du parti: il refusa de choisir son camp dans le conflit entre le nazisme et l’impérialisme capitaliste, il salua la capitulation de l’armée belge par le roi Léopold et critiqua le gouvernement de Londres. Pourtant, les contraintes de cette occupation entraînèrent bientôt des réactions différentes sur le terrain, où les militants communistes menèrent des actions sociales contre la pénurie de nourriture et le gel des salaires en organisant des manifestations de femmes au foyer et des grèves limitées, notamment dans les mines de charbon, qui paralysèrent partiellement le secteur les premiers mois de 1941. En même temps, le parti développa une presse clandestine, principalement à usage interne. L’invasion de l’Union soviétique, accompagnée d’une rafle massive de communistes belges, allait mettre brutalement fin à cette période ambiguë.
Une partie de la crise de l’antifascisme était d’ordre entièrement intérieur. Le Parti ouvrier belge n’a pas pu profiter du désarroi des communistes à la suite de l’accord Hitler-Staline. Naturellement, le parti accusa les communistes de duplicité et de servilité, en réponse à la critique incessante de ces derniers sur le manque de zèle antifasciste des socialistes, qui étaient partenaires de la coalition au gouvernement depuis 1936 et occupaient le ministère des Affaires étrangères. Cependant, la défaite de l’armée belge fut suivie par l’effondrement du Parti ouvrier belge. Son président, Henri De Man, fut le principal initiateur d’un projet de «Vichy belge», un nouveau régime autoritaire autour du roi Léopold. Pour ouvrir la voie à un nouveau mouvement politique unitaire soutenant le nouveau régime, De Man publia un manifeste le 28 juin 1940, dissolvant le Parti ouvrier belge et appelant ses membres à rejoindre le futur mouvement. Les conséquences pour le Parti ouvrier belge furent désastreuses. De plus, le parti était indissociablement lié au syndicat socialiste, qui ahéra à une réorganisation dans le sens de l’Ordre nouveau, donnant lieu à la création d’un nouveau syndicat corporatiste unitaire. Entièrement contrôlé par l’occupant, celui-ci perdit toute légitimité après moins d’un an d’existence.
Le Front de l’indépendance fut à l’origine de l’exploit le plus célèbre des années d’occupation: le «faux» Soir du 9 novembre 1943.
Il fallut des années à la famille socialiste pour sortir de ce marasme et reconstruire le parti et le syndicat sur une nouvelle génération de militants de la base26. Conséquence de la crise profonde qu’il connut pendant l’occupation, le socialisme belge concentra tous ses efforts sur sa propre régénération, sur la reconstruction de l’appareil du parti, sur sa propagande et ses syndicats. Les socialistes se sentaient trop menacés par le dynamisme du Parti communiste après l’été 1941 pour s’engager dans l’une de leurs organisations. En septembre 1941, une nouvelle organisation clandestine du parti émergea et concentra ses efforts sur la préparation de l’après-guerre, notamment par la rédaction et la diffusion de la presse clandestine du parti.
Le 22 juin 1941, Hitler envahit l’Union soviétique lors d’une attaque-surprise. L’invasion s’accompagna de rafles massives de militants communistes dans tous les pays occupés. Par rapport à la France et aux Pays-Bas, les dommages causés à l’appareil du parti belge furent limités, avec 300 arrestations sur un effectif d’avant-guerre estimé à environ 10.000 personnes, en grande partie grâce au refus de la police belge de participer aux rafles. Pourtant, l’invasion et les arrestations changèrent radicalement la situation du Parti communiste belge. Au lieu de se tenir à l’écart dans une neutralité ambiguë, la guerre devint une question de survie – survie de l’appareil du parti face aux persécutions nazies et survie de l’Union soviétique, dont la situation militaire désastreuse devait être soulagée par l’ouverture d’un «troisième» front intérieur en attendant l’ouverture d’un véritable «deuxième» front occidental. Sur les instructions du Komintern, le parti conçut alors une stratégie radicalement nouvelle qui impliquait d’une part l’organisation d’une large coalition de résistance nationale, le Front de l’indépendance, qui associait toutes les forces sociales et politiques et dont nous parlerons plus tard, et d’autre part la création d’une véritable force de guérilla appelée les «partisans» en référence aux illustres exemples yougoslaves et français.
Environ 30.000 Juifs se sont cachés et ont survécu à l’occupation en Belgique.
L’organisation, le recrutement et les moyens d’action des partisans évoluèrent considérablement au cours de la guerre27. La première génération de partisans fut recrutée dans le cercle restreint des membres de longue date du parti, des militants expérimentés et disciplinés, dont la loyauté envers l’Union soviétique était une motivation majeure pour courir les risques élevés d’une guerre clandestine. Dans la région minière du Borinage, les premières équipes de partisans réunissaient des mineurs communistes et des vétérans des Brigades internationales de la guerre civile espagnole qui avaient accès à de la dynamite et purent organiser des attentats spectaculaires contre infrastructures de l’industrie lourde. À Bruxelles, les premières équipes furent recrutées dans le milieu intellectuel des ingénieurs et des scientifiques, tous antifascistes et membres du parti d’avant-guerre. Leur principale activité consistait à organiser des incendies criminels et petites explosions visant la logistique militaire allemande (camions, trains, carburant).
Fin 1941, cette stratégie de sabotage qui évitait les cibles humaines se radicalisa en réponse à la lourde répression allemande. En décembre 1941, le leader communiste et député Georges Cordier fut torturé à mort. Dans les semaines qui suivirent, 17 communistes furent exécutés et plusieurs dizaines furent condamnés à mort ou déportés en Allemagne. Le ton de la presse clandestine communiste monta dans les premiers mois de 1942, concentrant ses sentiments de haine et de vengeance sur les collaborateurs belges qui soutenaient les efforts allemands et paradaient dans les rues pour soutenir la guerre nazie, annonçant par exemple en avril 1942: «Ils périront tous comme des chiens.»28. Au cours des premiers mois de 1942, les partisans commencèrent à exécuter des mouchards bien identifiés qui avaient causé la mort de militants communistes. Des attentats provoquèrent la panique lors de rassemblements de volontaires SS partant pour le front de l’Est. Dans la seconde moitié de 1942, l’assassinat politique de collaborateurs fit partie intégrante de la stratégie des partisans, avec 60 éliminations de dignitaires de l’Ordre nouveau belge choisis symboliquement: bourgmestres, officiers de police collaborateurs et fonctionnaires des agences pour l’emploi qui commençaient à mettre en œuvre le travail obligatoire pour l’Allemagne. La campagne culmina en novembre 1942 avec l’assassinat de trois bourgmestres de Rex dont le plus célèbre était Jean Teughels de Charleroi. Les membres des mouvements de collaboration commencèrent à se sentir menacés – ce qui était précisément l’effet recherché par les meurtres – et firent pression sur les autorités allemandes pour qu’elles ripostent, poussant ainsi le commandant militaire allemand à ordonner l’exécution de 68 otages dont la plupart étaient des partisans et des militants communistes, en décembre 1942 et janvier 1943.
L’escalade des méthodes terroristes de l’occupant entraîna brièvement une troisième phase chez les partisans, consistant à assassiner des militaires allemands. Vu les effets catastrophiques de la répression allemande, les attaques contre les soldats allemands restèrent une exception dans l’histoire de la guerre des partisans en Belgique. Cette stratégie était également impopulaire, tant dans l’opinion publique pour qui les coûts dépassaient largement les bénéfices, qu’auprès de nombreux militants du parti qui, par internationalisme, refusaient de tuer des soldats allemands ordinaires dont on ignorait l’engagement idéologique, contrairement aux collaborateurs belges.
Après le désastreux premier semestre 1943, les partisans arrêtés ou tués durent être remplacés par une nouvelle génération, à trouver à l’extérieur des rangs fortement décimés des membres du parti et des militants de longue date. Le travail obligatoire avait forcé de nombreux travailleurs à vivre dans la clandestinité. Certains rejoignirent les partisans qui avaient l’expérience nécessaire pour fournir un abri, des documents et surtout des coupons alimentaires aux clandestins. D’autres venaient des organisations patriotiques, frustrés par leur inactivité et attirés par la stratégie spectaculaire et radicale des partisans. Le vent de la guerre avait tourné et les troupes allemandes battaient en retraite sur les fronts de l’Est et de l’Afrique, créant ainsi une atmosphère d’attente impatiente de la défaite allemande. Les mouvements de collaboration furent tenus pour responsables de toutes les épreuves de l’occupation et la campagne incessante contre leurs bâtiments, leurs réunions et leurs dirigeants gagna en popularité. L’activité des partisans dépassa également les bastions communistes traditionnels.
Au cours de l’année 1944, le VNV, Rex et les SS flamands, ne se sentant plus protégés par leurs maîtres allemands, se livrèrent à des représailles meurtrières de leur propre initiative et tuèrent plusieurs centaines de personnes. Surtout dans les mois entre le débarquement allié en juin et la Libération en septembre, les assassinats politiques entrèrent dans une terrible escalade. À la fin de la guerre, les partisans affirmèrent avoir «massacré» 1.100 «traîtres» et comptaient plus de 10.000 combattants, mais il faut faire une distinction évidente entre les partisans des deux premières années, de l’été 1941 à l’été 1943, dont plus d’un tiers furent tués, et la génération suivante qui agit dans un contexte très différent.
Les partisans et, derrière eux, le Parti communiste ont été la source la plus constante et la plus radicale d’actions violentes en Belgique occupée.
Les partisans étaient l’organisation qui pratiquait le plus activement ce que les autorités allemandes appelaient du «terrorisme» et, malgré leur recrutement très hétérogène en 1943 et 1944, ils restèrent la branche armée étroitement contrôlée du Parti communiste jusqu’à la Libération. Pourtant, les partisans n’avaient pas le monopole de la stratégie consistant à tuer des collaborateurs. Les premiers assassinats politiques en août et septembre 1941, qui frappèrent respectivement deux membres dirigeants de Rex et deux soldats allemands, étaient l’œuvre de la Phalange Blanche, une petite équipe d’individus d’origines diverses. Plus tard dans la guerre, des membres de la Légion belge, du Mouvement national belge et du Groupe G lancèrent également des campagnes d’assassinats politiques et d’élimination de mouchards. Le meurtre du frère de Léon Degrelle en juillet 1944 par la Légion belge en est un exemple célèbre. Pourtant, même si leur anticommunisme les poussa parfois à attribuer erronément aux partisans des actions menées par d’autres, les autorités allemandes avaient globalement raison d’identifier les partisans et, derrière eux, le Parti communiste, comme la source la plus constante et la plus radicale d’actions violentes en Belgique occupée.
Un groupe de la première génération de partisans engagés dans les actions les plus radicales et les plus meurtrières mérite une mention spéciale: les communistes juifs. Parmi eux se trouvait une minorité active de communistes internationaux et d’antifascistes militants, qui avaient été très nombreux dans les Brigades internationales. Leur expérience de la persécution et du combat antifasciste les prédestinait à devenir une avant-garde de la résistance partisane et la première cible de la répression de l’occupant. Ils constituaient la majorité des partisans des trois bataillons du MOI (Main-d’œuvre Immigrée) qui accomplirent nombre des tâches les plus dangereuses en 1942 et au début de 1943 et subirent des pertes énormes. Ils menèrent également les premières actions concrètes contre les déportations de Juifs. En juillet 1942, les premiers convois de Juifs quittèrent la caserne Dossin à Malines pour Auschwitz. Durant les trois mois suivants, les deux tiers des plus de 25.000 Juifs déportés de Belgique furent emmenés à Auschwitz. La rapidité de l’opération avait créé la surprise et conféré une urgence extraordinaire à la mise en place d’une résistance efficace contre les départs. Le 25 juillet, une équipe de partisans juifs polonais mit le feu aux fichiers d’adresses du Conseil juif, ne détruisant tragiquement que des copies. Le 29 août, au cours des rafles les plus massives, la même équipe abattit l’«agent d’emploi» du Conseil juif à un coin de rue de Bruxelles. Les actions violentes contre les départs contribuèrent à alarmer de nombreux Juifs, à ralentir les départs et donc à leur survie. L’occupant mit deux ans de plus pour arrêter, déporter et tuer les 8000 autres victimes. Environ 30.000 Juifs se sont cachés et ont survécu à l’occupation en Belgique, avec l’aide de vastes réseaux d’assistance et de nombreux actes de solidarité individuelle.
Élargir la base avec le Front de l’indépendance
Les patriotes, les antifascistes, les communistes et les victimes de la persécution nazie constituaient tous des centres spécifiques de résistance active contre l’occupation pendant la première moitié de la guerre. Dans la seconde moitié, cette résistance trouva un terreau fertile dans la population en général. Cette évolution fut dictée par l’évolution de la situation militaire. Au cours de l’année 1942, l’économie allemande commença à connaître une pénurie de main-d’œuvre. Contrairement aux prévisions triomphales, les soldats mobilisés ne pouvaient pas rentrer dans leurs foyers, leurs usines et il fallait des millions d’hommes supplémentaires pour le front de l’Est. Par conséquent, la pression qu’exerçait l’Allemagne nazie sur les pays occupés d’Europe occidentale pour qu’ils contribuent à l’effort de guerre allemand s’accentua. En novembre 1942, l’armée africaine de Rommel subit la première grande défaite allemande à El Alamein et en janvier 1943, la défaite de Stalingrad affaiblit la Wehrmacht au point qu’elle ne put se relever.
La résistance n’était plus un choix radical et la désobéissance devint une stratégie de survie pour de grands groupes. Cela s’appliquait littéralement à la population juive qui disparut collectivement dans la clandestinité après les raffles meurtrières de l’été 1942. Le travail obligatoire entraîna un processus similaire l’année suivante, étendant ainsi la désobéissance à toutes les classes sociales et à toutes les régions. Alors que des dizaines de milliers de travailleurs étaient partis chaque mois la première année d’application du travail obligatoire en Allemagne, l’occupant ne put faire sortir de Belgique que quelques milliers de travailleurs par mois la dernière année de l’occupation, de l’été 1943 à la Libération en septembre 194429. La survie des résistants nécessita l’organisation à grande échelle de faux papiers d’identité, de complicités d’employeurs, de l’administration et de la police locale, d’argent et de coupons alimentaires pour les nourrir, obtenus par le vol, la contrefaçon ou les attaques de transports et bureaux de poste.
Ce nouveau contexte engendra une nouvelle résistance qui impliquait des agriculteurs, des églises, des couvents, des colonies scolaires, des employeurs, des policiers, des employés communaux… bref, toute personne susceptible d’offrir un logement, de la nourriture ou des complicités administratives, le plus souvent grâce à son occupation professionnelle. Cette «résistance humanitaire» ne reflétait pas toujours un engagement politique ou idéologique conscient, mais plus souvent une solidarité humaine. Or, pour coordonner cette bonne volonté générale et cette volonté de prendre le risque de la désobéissance, il fallait des mouvements et des organisations capables de mobiliser largement l’opinion publique et d’impliquer un large éventail de forces sociales et politiques dans la résistance.
À cet égard, le Front de l’indépendance a été le premier mouvement et le plus influent. Le Front de l’indépendance / Onafhankelijkheidsfront formait le deuxième volet de la double stratégie conçue par le Parti communiste à l’été 1941 – action radicale des partisans d’une part et élargissement de la base en formant des alliances avec différentes forces sociales et politiques d’autre part30. Le contexte favorisa l’initiative. Les deux principales forces politiques n’étaient pas engagées dans la résistance: l’Église catholique, le Parti catholique et les organisations affiliées, par conservatisme traditionnel et par un sens séculaire de leur propre préservation, privilégiant les intérêts et la pérennité du patrimoine catholique sur les urgences de la guerre; et la famille socialiste, en raison de la crise provoquée par son président Henri De Man.
Dans ce contexte, le Parti communiste put surmonter l’anticommunisme traditionnel largement répandu dans la plupart des milieux et devenir ainsi le catalyseur d’un vaste mouvement. Son expérience de l’action clandestine et de la subversion, les indéniables talents d’organisation, l’énergie et le dévouement total de ses militants constituèrent le point de départ d’une multitude d’organisations, de journaux clandestins et de réseaux d’aide pour cacher des personnes qui attirèrent effectivement de nombreux non-communistes qui n’auraient jamais accepté de travailler avec eux en temps de paix. En même temps, le parti essayait de présenter le mouvement comme politiquement neutre, ouvert à tous, et de maintenir un contrôle ferme, au moins de ses instances dirigeantes. La terrible décimation des rangs du parti durant la première moitié de 1943 rendit cette dernière ambition de plus en plus difficile et le Front de l’indépendance se développa en un mouvement énergique et diversifié durant la dernière année de l’occupation.
Le Front de l’indépendance avait l’ambition de créer des organisations pour mobiliser la résistance contre l’occupant dans tous les milieux sociaux: ouvriers, agriculteurs, policiers, juges, enseignants, secteur médical, organisations de jeunesse… et il publia un très grand nombre de publications clandestines dans ce but. Dans des secteurs spécifiques, le Front réussit à monter des actions concrètes. Les actions menées dans le système judiciaire belge suscitèrent une opposition réelle contre la coopération de juges belges avec les politiques répressives allemandes. Un autre réseau mobilisa les enseignants des écoles publiques contre les instructions de l’administration contrôlée par l’Ordre nouveau. Les actions les plus réussies furent menées dans le cadre de la résistance humanitaire. Le Comité de défense des Juifs cacha des Juifs, sauvant notamment la vie de 2000 enfants cachés sous de fausses identités dans diverses institutions, dont certaines écoles et certains couvents catholiques31. L’action de la branche Solidarité abrita des militants exposés et aida des familles de résistants déportés ou exécutés. Le Front de l’indépendance fut également très actif dans la lutte contre le travail obligatoire, par le biais d’une propagande destinée aux travailleurs, de l’organisation par ses cellules syndicales clandestines de quelques grèves avortées et surtout de l’aide aux travailleurs réfractaires qui se cachaient pour échapper au départ forcé vers l’Allemagne.
La «résistance humanitaire» exigeait des organisations capables de se mobiliser. À cet égard, le Front de l’indépendance a été le mouvement le plus influent.
Au début de 1944, le Front de l’indépendance commença à préparer la Libération. Dans ce but, il créa les Milices patriotiques, un groupe de volontaires pour aider les troupes alliées pendant les combats de libération, et des comités locaux de libération qui devaient organiser une insurrection populaire, remplacer les bourgmestres restés en fonction pendant l’occupation ou nommés par l’occupant et assumer l’administration locale pendant la période de transition jusqu’aux premières élections de l’après-guerre. Ces plans alarmèrent le gouvernement de Londres, car ils menaçaient à ses yeux le rétablissement de l’autorité légale et des fonctionnaires dûment élus ou nommés. Le gouvernement belge en exil avait hésité longtemps à reconnaître le Front de l’indépendance et à financer ses activités, par crainte de l’influence communiste en son sein. Des rapports positifs d’agents envoyés dans le pays occupé sur ses activités et sa composition diversifiée entraînèrent une reconnaissance officielle en novembre 1943. Les contacts s’intensifièrent au cours de l’année 1944 et le gouvernement put même convaincre le Front de l’indépendance d’abandonner ses projets d’insurrection généralisée et de création de comités locaux de libération.
Libération et héritage
Parallèlement au Front de l’indépendance, de nombreuses organisations similaires avec des activités similaires virent le jour. Une énumération exhaustive illustrerait leur diversité sociale et politique et mettrait en avant le fait qu’aucune de ces initiatives spontanées n’émanait d’importantes organisations d’avant-guerre – partis, syndicats ou églises. La nature très hétérogène des organisations de résistance belges rendait difficile leur convergence en un conseil national de la résistance. Contrairement à la France, il n’y avait ni besoin ni volonté de rassembler toutes les forces politiques de la résistance pour créer une alternative politique à Vichy: le gouvernement légitime était à l’étranger et même les scénarios le plus radicaux prévoyaient son retour aux côtés des libérateurs alliés.
Le gouvernement belge en exil avait hésité longtemps à reconnaître le Front de l’indépendance par crainte de l’influence communiste en son sein.
L’étrange composition de la résistance belge a conditionné sa postérité. Les mouvements de résistance naquirent dans des minorités militantes de patriotes et d’antifascistes. Durant la dernière année de l’occupation, ils cristallisaient un très large mouvement de désobéissance et de rejet des autorités d’occupation. Après le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, ce soutien populaire se mua en une marée d’enthousiasme et à l’approche des armées libératrices, des milliers de volontaires adhérèrent à des mouvements de résistance dont ils ne découvraient souvent l’existence qu’à cette époque. Cette combinaison de radicalisme organisationnel et de soutien des masses était un mélange explosif, d’autant plus qu’elle échappait totalement au contrôle des forces et structures traditionnelles du paysage politique belge d’avant-guerre. Dans un contexte de guerre continue, les alliés et le gouvernement revenant d’exil avaient l’intention de revenir à la politique d’avant-guerre, en rétablissant les partis politiques et les syndicats dans leur rôle modérateur.
Les mouvements de résistance avaient préparé la Libération, comme étant le point culminant de leurs activités. L’Armée secrète, les Milices patriotiques et bien d’autres mouvements avaient été créés spécialement pour ce moment. C’était une démonstration de réalisme militaire: les mouvements de résistance ne faisaient pas le poids face à la Wehrmacht lorsqu’ils agissaient seuls. Leur rôle se limitait à des actions clandestines par de petits noyaux de spécialistes jusqu’à l’arrivée des armées alliées. Pourtant, aux côtés de ces armées, de leur artillerie, de leur aviation, de leurs blindés et de leurs armes, ils entendaient jouer un rôle crucial comme force auxiliaire de milliers de volontaires. Une partie de cette préparation s’avéra appropriée: la résistance guida les troupes alliées avec des informations précises sur la présence des troupes allemandes et empêcha des destructions massives d’infrastructures préparées par les troupes allemandes lors de leur retrait. Ils empêchèrent ainsi la destruction de ponts et, plus spectaculaire encore, celle du port d’Anvers. Des groupes de résistance purent faire des prisonniers de guerre, empêcher le départ d’un dernier train de déportation, arrêter des criminels de guerre et des collaborateurs, souvent pour les sauver de la justice populaire. Une partie aussi se montra imprudente et fit preuve d’inexpérience et d’un enthousiasme inconsidéré. Des actions prématurées furent ainsi brutalement écrasées par des soldats allemands bien armés et experts.
Le gouvernement belge n’avait pas l’intention de rendre permanentes ces troupes de résistance, de peur qu’elles ne se transforment en milices politiques – du Parti communiste et des royalistes qui étaient ses principaux ennemis politiques32. Il voulait constituer une nouvelle armée belge, avec des régiments réguliers dans lesquels les bataillons de résistance seraient dissous, mais la nouvelle armée belge n’avait ni infrastructure, ni armes, ni tâche clairement définie dans la stratégie alliée. Autant la création d’une nouvelle armée fut lente et inefficace, autant le désarmement de la résistance fut brutal et immédiat. Un premier ordre de désarmer la résistance et de livrer toutes les armes au poste de police local fut donné le 2octobre 1944, à peine un mois après la Libération. Les mouvements de résistance refusèrent, tant que le gouvernement ne pouvait leur offrir de perspective concrète pour poursuivre la guerre dans la nouvelle armée belge. Le 13 novembre, le gouvernement publia un décret ordonnant le désarmement immédiat, avec de lourdes amendes et des perquisitions à domicile pour les citoyens récalcitrants. Le décret était inutilement humiliant et l’indignation de la résistance culmina avec une marche de protestation à Bruxelles le 25 novembre. Lorsque les manifestants se dirigèrent vers le parlement, la police ouvrit le feu et blessa 45 personnes. L’épisode laissa des souvenirs amers dans les différents camps.
La «Résistance » ne tenta pas de prendre le pouvoir en Belgique, car elle n’était pas et n’avait jamais été une alternative politique au gouvernement en exil. L’hostilité entre l’Armée secrète et le Front de l’indépendance était bien plus profonde que leur hostilité envers le gouvernement. Contrairement au Conseil national de la Résistance française, la résistance belge ne se considérait pas comme un contre-État avec un programme politique cohérent. Le clivage entre les «nouvelles» forces de la résistance et les «anciennes» forces de la politique des partis ne devait pas durer. Il ne pouvait se transformer en une force politique permanente que dans des pays où la résistance incarna des revendications de transformation de la société, dont l’occupation n’avait été qu’un catalyseur, comme en Yougoslavie, en Albanie, en Grèce ou en Italie. Dans les mois qui suivirent la fin de la guerre, la résistance devint surtout une référence historique.
L’héritage de la résistance en Belgique est inextricablement lié à un autre héritage de l’occupation nazie, qui a eu des conséquences durables: ce qu’on a appelé la Question royale33. Le référendum sur le retour du roi obtint une majorité nationale en faveur du retour, mais ce retour provoqua une insurrection générale dans une grande partie du pays et le roi fut finalement contraint d’abdiquer en faveur de son fils. Malgré une majorité politique mathématique, la «défaite» de la faction pro-Léopold suscita une rancœur durable dans l’opinion publique catholique. Ce ressentiment les éloigna progressivement de la nation belge. Il les éloigna également de l’identité nationale forgée par les coalitions au pouvoir dans les années 1945-1947 et 1954-1958: une forte identification avec la résistance, l’antifascisme et la laïcité. L’aile flamande du Parti catholique opéra progressivement une identification alternative avec la collaboration flamande qui, selon elle, avait été victime d’une punition trop sévère de la part de l’État belge et méritait l’amnistie, voire la réhabilitation.
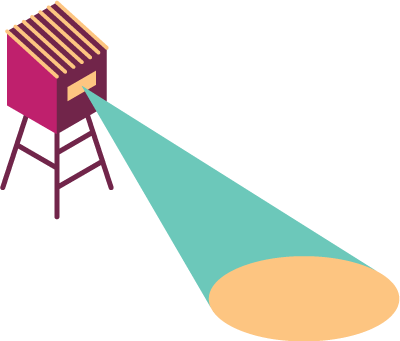
Si cette stratégie a été payante sur le plan politique, elle est une perversion sur le plan historique. Des acteurs politiques ont prétendu que la différence de réaction vis-à-vis de l’occupation entre les différentes parties de la population est à l’origine du démembrement actuel de la Belgique. Cependant, la vérité est exactement inverse: c’est le démembrement actuel de la Belgique qui a fait émerger différents discours sur cette partie du passé belge. L’histoire est devenue un stratagème politique. Cette situation a longtemps entravé l’émergence d’une historiographie critique sur la Seconde Guerre mondiale et la résistance34. Malgré des avancées décisives de nos connaissances sur les années de guerre, la Seconde Guerre mondiale, la résistance et la collaboration restent des thèmes privilégiés des propagandistes flamands et wallons jusqu’à aujourd’hui. C’est le triste sort de nombreux débats publics dans la Belgique d’aujourd’hui d’être réduits à une opposition artificielle, souvent hors de propos et parfois dangereuse entre deux groupes linguistiques.
Footnotes
- Sur le Blitzkrieg, parmi les innombrables contributions de l’historiographie militaire, voir: Jean Vanwelkenhuyzen, 1940. Pleins feux sur un désastre, Bruxelles, 1995 et Brian Bond, Britain, France, and Belgium, 1939-1940, Waterlow Publ., 1998
- Pour une brillante analyse de la société belge pendant l’année 1940, voir l’étude pionnière de l’historiographie scientifique de la guerre en Belgique: Jules Gérard-Libois et José Gotovitch, L’an 40. La Belgique occupée, Bruxelles, 1971.
- Voir Gérard-Libois et Gotovitch, L’an 40, pp.200-232.
- Voir Albert De Jonghe, Hitler en het politieke lot van België, Anvers, 1982 et Albert De Jonghe, «De strijd Himmler-Reeder om de benoeming van een HSSPF te Brussel (1942-1944)» Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 3-8, 1974-1984.
- Voir Pieter Lagrou, «L’Europe méditerranéenne dans une histoire comparative de la Résistance» dans Jean-Marie Guillon et Robert Mencherini (éd.) La Résistance et les Européens du Sud [sous presse, Paris L’Harmattan, 1999] et José Gotovitch et Pieter Lagrou «La Résistance française dans le paysage européen» Cahiers de l’Institut d’Histoire du Temps Présent 37, 1997, pp.147-162.
- Voir Mark van den Wijgaert, Tussen vijand en volk: het bestuur van de secretarissen-generaal tijdens de Duitse bezetting, 1940-1944 (Kapellen, 1990) et Gérard-Libois et Gotovitch, L’an 40, pp.185-199.
- Voir John Gillingham, Belgian business in the Nazi New Order, Gand, 1977; Mark van de Wijgaert, Nood breekt wet. Economische collaboratie of accomodatie. Het beleid van Alexandre Gallopin van de Société Générale tijdens de Duitse Bezetting, Tielt, 1990 et pour une analyse de l’évaluation de ces attitudes après la guerre: Dirk Luyten, Danny Somers et Boudewijn Bardyn, Burgers boven elke verdenking? Vervolging van economische collaboratie in België na de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, 1996.
- Pour une réflexion intéressante sur la résistance, voir Semelin, Jacques, Sans armes face à Hitler. La résistance civile en Europe, 1939-1943, Paris, 1989.
- Pour une chronique des années de guerre, voir les onze volumes de Jours de Guerre (Bruxelles, 1990-1998), basés sur une série de documentaires télévisés pour la chaîne publique belge de langue française. Plus thématiques, les neuf volumes basés sur la série de documentaires de la chaîne publique néerlandophone belge België in de Tweede Wereldoorlog (Kapellen, 1985-1990), pour notre propos, le vol.6, Het Verzet (1988), de Herman Van de Vijver, Rudi Van Doorslaer et Etienne Verhoeyen. Une excellente synthèse est celle d’Etienne Verhoeyen, België bezet. Een Synthese, Bruxelles, 1993. Il est intéressant d’observer qu’en Belgique et aux Pays-Bas (Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, De Jong), les grands reportages sur les années de guerre ont d’abord été produits pour la télévision publique, puis imprimés. Cette chronologie illustre le retard général de l’écriture académique de l’histoire sur les années de guerre. Pour un panorama classique de la résistance belge dans la tradition de l’historiographie patriotique, voir Henri Bernard, La Résistance 1940-1945, Bruxelles, 1969. Pour une série de portraits, voir H.Neuman, Avant qu’il ne soit trop tard. Portraits de Résistants, Gembloux, 1985, et pour une étude régionale détaillée, voir Fabrice Maerten, «Du murmure au grondement. La résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant la Seconde Guerre mondiale (mai1940-septembre 1944)», Analectes d’histoire du Hainaut, vol.7 (Mons, 1999).
- C’est aussi l’activité de résistance qui a le plus alimenté l’imagination des romanciers de langue anglaise. Voir, par exemple, Anita Shreve, Resistance: a Novel (Little Brown &Co, 1997) sur un pilote américain blessé en Belgique occupée.
- Voir A. Neave, Petit Cyclone, Bruxelles, 1954; Cécile Jouan, Comète, Bruxelles, s.d. et Rémy (Gilbert Renault), Réseau Comète, Paris, 1966.
- Voir F. Strubbe, Geheime Oorlog. De Inlichtings- en Actiediensten in België, Tielt, 1992. Voir également Verhoeyen, België Bezet, pp.265-278.
- Pour un récit héroïque, voir le récit d’Yvonne De Ridder, The Quest for Freedom: Belgian Resistance in World War II, Fithina Press, 1991.
- Voir Van de Vijver, Van Doorslaer et Verhoeyen, Het Verzet, pp.65-75.
- Voir l’histoire officielle de l’organisation sous la direction d’Henri Bernard, L’Armée Secrète, 1940-1944, Paris/Gembloux, 1986.
- Voir, par exemple, le récit d’Henri Bodson (édité par Richard Schmidt) Agent for the Resistance: A Belgian Saboteur in World War II. Texas A&m University Military History, 1994, p. 35.
- Verhoeyen, België Bezet, p.306.
- Voir William Ugeux, Le groupe G, Bruxelles, 1978; Verhoeyen, België Bezet, pp.307-311 et Van de Vijver, Van Doorslaer et Verhoeyen, Het Verzet, pp.85-87.
- Voir Gérard-Libois et Gotovitch, L’an 40, pp.359-367. Pour un inventaire, voir J. Dujardin, J. Gotovitch et L. Rymenans, Inventaire de la presse clandestine conservée en Belgique, Bruxelles, 1965.
- Verhoeyen, België Bezet, p.295.
- Voir Horn, European Socialists.
- Voir les excellents mémoires du commandant partisan de la région de Louvain, Louis Van Brussel, Partisanen in Vlaanderen. Met Aktieverslagen van korps 034-Leuven. Louvain, 1971, et Bert Van Hoorick, In tegenstroom. Herinneringen 1919-1956, Gand, 1982.
- Le Parti communiste est la seule formation politique en Belgique à avoir bénéficié d’une monographie historique de premier ordre pour les années de guerre: José Gotovitch, Du Rouge au Tricolore. Les Communistes Belges de 1939 à 1944, Bruxelles, 1992.
- Voir Rudi Van Doorslaer, «De Internationale Brigaden: de vrijwilligers uit België – een status questionis», Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1987, 1-2, pp.159-164.
- Voir Rudi Van Doorslaer, De Kommunistische Partij van België en het Sovjet-Duits niet-aanvalspakt, Bruxelles, 1975, et Gotovitch, Du rouge au tricolore, pp.57-82.
- Voir Nic Bal, Mijn wankele wereld. Vier jaar in het socialistisch verzet, Louvain, 1984.
- Gotovitch, Du rouge au tricolore, pp.155-193.
- Gotovitch, Du rouge au tricolore, p.172.
- Voir Pierre Potargent, Déportation. La mise au travail de la main d’œuvre Belge dans le pays et à l’étranger durant l’occupation, Bruxelles, 1946.
- Voir Gotovitch, Du rouge au tricolore, pp.195-287.
- Un certain nombre de ces enfants ont ensuite publié des mémoires, dont certains récemment en anglais: Walter Buchignani, Tell No One Who You Are, Tundra Books, 1996, sur Régine Miller, Suzanna Loebl, At the Mercy of Strangers: Growing up on the Edge of the Holocaust, Pact Publishing, 1997; Beatrice Muchman, Never to Be Forgotten: A Young Girl’s Holocaust Memoir, Ktav Publishing, 1997.
- Voir Pieter Lagrou, «U.S. politics of stabilization in Liberated Europe. The view from the American Embassy in Brussels, 1944-46» European History Quarterly 25, 1995, pp.209-246 et Gotovitch, Du rouge au tricolore, pp.367-441.
- Pour une bonne synthèse de la Question royale, voir Jules Gerard-Libois et José Gotovitch, Léopold III de l’an 40 à l’effacement, Bruxelles, 1991.
- Cette historiographie a débuté en 1971 avec la publication d’une étude sur L’an 40 de Jules Gérard-Libois et José Gotovitch. La publication du livre a plus ou moins coïncidé avec la création d’un Centre d’étude et de documentation sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à Bruxelles. Des instituts comparables sont en fonction aux Pays-Bas et en France depuis 1945. Au cours des années80 et au début des années90, d’importantes monographies ont établi un consensus scientifique sur des aspects cruciaux de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique: sur la Question royale (Stengers, 1980, Velaers et Van Goethem, 1994), la politique d’occupation (De Jonghe, 1982), le génocide (Steinberg, 1984-1986), le Parti communiste (Gotovitch, 1992), la collaboration (Conway et De Wever, tous deux en 1994). Entre-temps, la chaîne publique avait commandé depuis 1965 une série de documentaires sur les années de guerre, qui seront diffusés de nombreuses années plus tard dans le très influent programme hebdomadaire de Maurice De Wilde dans les années80. Cette initiative a permis de mieux sensibiliser le public aux années de guerre et a produit d’importants résultats scientifiques, y compris sous forme imprimée.




