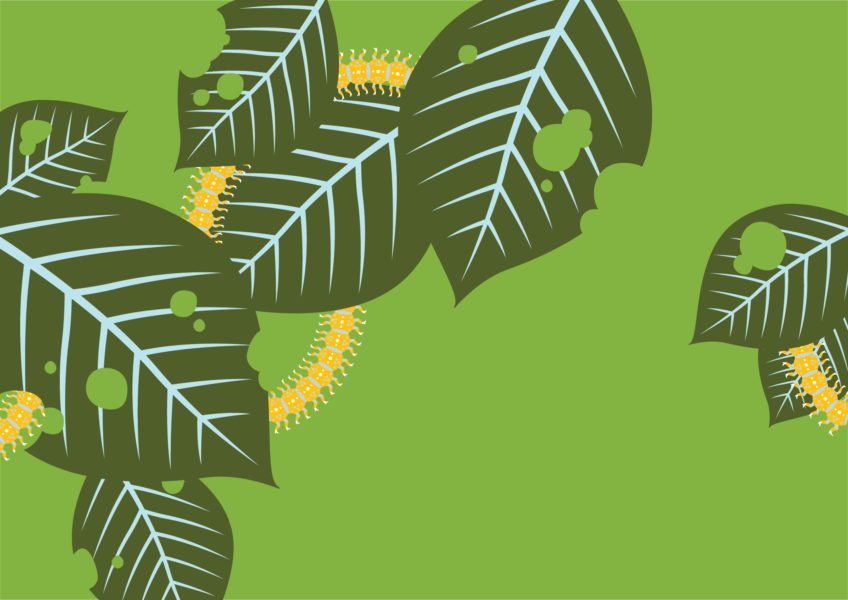La base de l’environnementalisme dans la classe professionnelle-managériale et l’accent mis sur la consommation ont peu de chances d’attirer l’appui des travailleurs, alors qu’il faut un mouvement de masse pour s’attaquer à des industries extrêmement puissantes.

La crise climatique et écologique est désastreuse et nous avons peu de temps pour y faire face. En un peu plus d’une génération (depuis 1988), nous avons émis la moitié des émissions historiques1. Le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) suggère qu’il ne nous reste que douze ans pour réduire considérablement les émissions afin d’éviter un réchauffement de 1,5 °C — un niveau qui ne fera qu’augmenter considérablement le nombre de tempêtes extrêmes, de sécheresses, de feux de forêt et de vagues de chaleur mortelles (sans parler de la montée du niveau de la mer)2. De nouvelles études montrent que l’évolution des régimes pluviométriques menacera la production de céréales comme le blé, le maïs et le riz d’ici vingt ans3. Selon une série de trois études, dès 2070, un demi-milliard de personnes « vivront des vagues de chaleur humide qui tueront même les personnes en bonne santé à l’ombre en 6 heures4 ».
Il n’est pas nécessaire d’être socialiste pour croire que le calendrier des changements requis nécessitera une sorte de révolution. Le GIEC a déclaré catégoriquement que nous devons immédiatement instaurer « des changements rapides, profonds et sans précédent dans tous les aspects de la société5 ». Le climatologue renommé Kevin Anderson a dit: « … quand on regarde vraiment les chiffres derrière le rapport, c’est-à-dire les chiffres que la science nous donne, nous parlons là d’une révolution complète dans notre système énergétique. Et cela va soulever des questions fondamentales sur la façon dont nous gérons nos économies6 ».
Seulement 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions depuis 1988.
Le mouvement radical pour le climat s’est longtemps uni autour du slogan « Oui au changement de système, non au changement climatique ». Il est clair que le capitalisme est le principal obstacle à la résolution de la crise climatique. Pourtant, la notion de « changement de système » est parfois vague quant à la façon de procéder. Le dilemme de la crise climatique ne se résume pas seulement à remplacer un système par un autre — il exige une confrontation avec les secteurs les plus riches et les plus puissants du capital de l’histoire mondiale. Soit seulement 100 entreprises responsables de 71% des émissions depuis 19887. L’industrie des combustibles fossiles et d’autres secteurs du capital à forte intensité de carbone (acier, produits chimiques, ciment, etc.) ne resteront pas les bras croisés et ne permettront pas les changements révolutionnaires qui rendent leurs modèles commerciaux obsolètes.
Comme toutes les autres batailles de ce genre, cette confrontation nécessitera un mouvement social hautement organisé, avec une base de masse derrière lui, pour forcer le capital et l’État à se plier aux changements nécessaires. L’histoire des XIXe et XXe siècles montre que la plus grande menace face à la domination du capital est venue des mouvements ouvriers organisés, fondés sur ce qu’Adaner Usmani appelle la « capacité de perturbation », en particulier les grèves et la syndicalisation8. C’est la classe ouvrière qui non seulement constitue la grande majorité de la société, mais c’est également elle qui possède le levier stratégique pour mettre un terme de l’intérieur aux profits du capital9.
Un mouvement capable d’apporter les changements nécessaires devra non seulement être massif, mais aussi avoir une base substantielle dans la classe ouvrière. Dans sa forme actuelle, cependant, la politique environnementale a peu de chances d’y parvenir. Son orientation idéologique et stratégique reflète la vision du monde de ce que Barbara et John Ehrenreich appelaient la « classe professionnelle-managériale », qui met l’accent sur les diplômes et la « connaissance » de la réalité de la crise environnementale10.
La politique environnementale de la classe moyenne est souvent directement opposée aux intérêts de la classe ouvrière. Elle fonde ses théories de la responsabilité écologique sur des idées d’empreintes « écologiques » ou « carbone » qui blâment les consommateurs (et les travailleurs) pour la dégradation écologique. Cette approche est centrée sur la notion attrayante selon laquelle il faut vivre simplement et « consommer moins » — une recommandation qui n’est guère susceptible de plaire à une classe ouvrière dont les salaires et le niveau de vie stagnent depuis presque deux générations11. Lorsqu’ils cherchent des exemples de politique environnementale émancipatrice, les universitaires radicaux imaginent la vraie politique environnementale comme une forme de luttes directes pour les moyens d’existence sur des « valeurs d’usage » naturelles comme la terre, les ressources et le corps lui-même. Alors que les luttes pour les moyens d’existence sont très importantes, l’environnementalisme de la classe moyenne-managériale contourne la façon dont une telle politique pourrait intéresser les dizaines de millions de travailleurs qui n’ont pas un accès direct à la nature sous forme de « valeur d’usage ».
Dans cet essai, je plaide pour une politique écologique de la classe ouvrière12 visant à mobiliser la masse des travailleurs pour affronter la source de la crise: le capital. Pour construire ce type de politique, il faut faire appel à la masse de la classe ouvrière qui n’a aucun moyen écologique de survie à part l’accès à l’argent et aux marchandises. Cette politique s’articule autour de deux grands axes. Tout d’abord, elle offre une histoire très différente de la responsabilité de classe dans la crise écologique. Plutôt que de nous blâmer « nous », les consommateurs et nos empreintes, elle prend pour cible la classe capitaliste. Deuxièmement, elle offre un programme politique destiné à attirer directement l’intérêt matériel de la classe ouvrière. Il est relativement simple d’insérer des politiques écologiquement bénéfiques dans les mouvements déjà existants autour de la démarchandisation des besoins de base comme « Medicare for All » ou « Housing for All ». La crise climatique en particulier est centrée sur des secteurs absolument vitaux pour la vie de la classe ouvrière: l’alimentation, l’énergie, les transports. L’objectif doit être d’utiliser cette situation d’urgence scientifiquement reconnue pour construire un mouvement visant à amener ces secteurs critiques de la propriété publique à les décarboniser et à les démarchandiser immédiatement.
Du mode de vie à la subsistance: les limites de l’environnementalisme
Le mouvement environnemental dans sa forme actuelle est dominé par la classe moyenne sous le couvert d’un « environnementalisme axé sur le style de vie », dont l’essence est de rechercher de meilleurs résultats par des choix individuels de consommation13. Pourtant, ce désir provient d’une source plus profonde d’anxiété au sujet des formes de consommation de masse de marchandises où la sécurité de la classe moyenne est assimilée à une maison, à une voiture, à la consommation de viande et à tout un ensemble de produits à forte consommation de ressources et d’énergie. En tant que tel, l’environnementalisme axé sur le style de vie considère les modes de vie modernes – ou ce qu’on appelle parfois « notre mode de vie »14 – comme le principal moteur des problèmes écologiques. Ceci, bien sûr, rend une politique de gains matériels intrinsèquement dommageable pour l’environnement. Puisque l’environnementalisme axé sur le style de vie blâme la consommation, il ne fait appel qu’à une base très restreinte de personnes riches qui non seulement mènent un train de vie de classe moyenne relativement confortable, mais se sentent en même temps coupables de le faire. Sous le néolibéralisme en particulier, la majeure partie de la population est, au contraire, entravée par des limitations sévères à l’accès aux éléments de base de la survie.
L’environnementalisme axé sur le style de vie produit également une ramification, une vision alternative distincte et apparemment plus radicale de la politique écologique qui prévaut dans la recherche universitaire. Cette forme de savoir accepte le principe de l’environnementalisme axé sur le style de vie selon lequel les « styles de vie des consommateurs » modernes sont intrinsèquement dommageables pour l’environnement. En tant que tels, les spécialistes de l’écologie radicale se tournent vers les marges de la société pour trouver une base plus authentique pour la politique environnementale. C’est ce que j’appellerai « l’environnementalisme axé sur les moyens d’existence15 » ou ce qu’on appelle parfois « l’environnementalisme des pauvres16 ». Cette forme de savoir soutient que la base appropriée pour une mobilisation environnementale est une expérience vécue directement dans l’environnement.
Je vais couvrir deux domaines essentiels. Premièrement, l’écologie politique cherche largement des exemples de luttes dans la dépendance directe de la « valeur d’usage » des terres ou des ressources pour la subsistance de communautés souvent paysannes, autochtones ou marginalisées (généralement dans le Sud). En tant que tel, ce savoir idéalise souvent ce que l’on considère comme des moyens de subsistance antimodernes en marge de la société. Deuxièmement, la justice environnementale met davantage l’accent sur les effets inégaux de la pollution et des déchets toxiques en tant que menaces mortelles pour les moyens de subsistance des communautés racisées et marginalisées (habituellement dans le Nord). Souvent critiques à l’égard de l’accent mis par l’environnementalisme dominant sur la nature sauvage ou la préservation de la faune et de la flore, les spécialistes de la justice environnementale mettent en lumière la façon dont les communautés pauvres et marginalisées sur le plan racial font de « l’environnement » une question de survie. Pourtant, encore une fois, ceux qui luttent directement contre l’empoisonnement des communautés locales sont souvent en marge de la société dans son ensemble. Des luttes comme celle-ci (par exemple, le Mouvement des travailleurs sans terre au Brésil ou la lutte pour l’eau potable à Flint dans le Michigan) sont évidemment des questions de survie importantes pour les personnes impliquées. Pourtant, la question stratégique de savoir comment traduire les préoccupations locales en matière de moyens d’existence en un mouvement environnemental de masse capable lutter efficacement contre le capital n’est pas claire.
L’environnementalisme axé sur les moyens d’existence est souvent perçu comme le contraire de l’environnementalisme axé sur le mode de vie, mais son orientation académique émerge des fondements de ce dernier. C’est la désaffection à l’égard de la société de production de masse qui pousse l’universitaire radical à s’intéresser aux marges de la société à la recherche d’une « vraie » lutte environnementale. L’environnementalisme axé sur les moyens d’existence est en effet une forme beaucoup plus attrayante de politique enracinée dans les intérêts matériels de groupes spécifiques. En fétichisant la relation directe vécue avec ce qui est considéré comme l’environnement réel (la terre, les ressources, la pollution), il esquive la manière dont nous pourrions construire une politique environnementale pour la majorité de la société déjà dépossédée de la terre et dépendante de l’argent et des marchandises pour survivre.
Les sophismes de l’écologie du « style de vie »
L’environnementalisme axé sur le style de vie prend la vie au sérieux. L’écologie est l’étude de la vie sous tous ses rapports. Pour faire remonter les problèmes environnementaux aux modes de vie des consommateurs, les écologistes ont mis au point des outils techniques sophistiqués. Ils se sont basés sur un postulat fondamental: « Chaque organisme, qu’il s’agisse d’une bactérie, d’une baleine ou d’une personne, a un impact sur la terre. […] L’impact que nous avons sur notre environnement est lié à la « quantité » de nature que nous utilisons ou que nous nous « approprions » pour entretenir nos modes de consommation17 ». Ce sont les premières lignes d’un texte d’introduction à l’analyse de l’« empreinte écologique », Sharing Nature’s Interest. Grâce à ces connaissances, les consommateurs du Nord ont appris que leur « privilège » et leur complicité étaient largement responsables d’une crise écologique globale.
L’analyse de l’empreinte écologique est façonnée par une théorie économique qui suggère que ce sont les consommateurs qui dirigent l’économie.
La citation présente bien la vision écologique du monde: l’homme est un organisme comme les autres. Chaque « organisme » a des « impacts » mesurables sur un écosystème. Les ours mangent du poisson et les humains mangent des tacos au poisson, mais les résultats sur un écosystème sont les mêmes. Il est important de noter que l’analyse de l’empreinte écologique cherche à établir un lien entre les impacts et la consommation. Cela est logique dans la vision écologique du monde. Après tout, tout écologiste sait qu’un écosystème est composé de producteurs et de consommateurs. Ce ne sont pourtant pas les mêmes producteurs et consommateurs présents dans l’économie capitaliste. Les producteurs écologiques sont les plantes qui exploitent l’énergie solaire et l’eau pour produire de la matière végétale organique à la base de tout « réseau alimentaire ». Mais la véritable action – et les « impacts » – vient des consommateurs écologiques. Ce sont les animaux et les autres espèces qui consomment les plantes, les animaux qui consomment ces animaux et ainsi de suite.
Une empreinte écologique peut mesurer le coût de vos diverses activités de consommation économique (l’énergie, la nourriture, le logement et les autres matériaux qui composent votre consommation quotidienne) et vous donner une idée de la quantité d’espace écologique – ou « zone productive biologiquement équivalente18 » – nécessaire pour entretenir cette consommation. Cela permet de comprendre l’inégalité enracinée dans les niveaux de revenu et de consommation: les États-Unis consomment 9,6 hectares par habitant, tandis que l’Inde n’en consomme qu’un seul. Cette vaste analyse de l’empreinte écologique a été récemment remplacée par l’« empreinte carbone ».
Cela peut conduire à une sorte d’analyse « progressive » de l’inégalité des empreintes entre consommateurs riches et pauvres. En 2015, Oxfam a publié un rapport intitulé « Extreme Carbon Inequality », dans lequel les 10% de la population mondiale les plus riches sont responsables de 50% des émissions, tandis que les 50% les plus pauvres ne sont responsables que de 10% 19. L’abstract annonce le projet en termes de « Comparaison des empreintes moyennes de consommation liée au style de vie des citoyens riches et pauvres dans différents pays20 ». Ici encore, les émissions sont liées au « style de vie »; notre mode de vie génère des émissions qui relèvent de notre propre responsabilité individuelle. En fait, l’étude affirme que 64% des émissions totales sont entièrement attribuables à la « consommation » alors que le reste est vaguement attribué aux « gouvernements, aux investissements (par exemple dans les infrastructures) et au transport international21 ».
Pourtant, la question qui se pose est la suivante: l’« empreinte » d’un consommateur individuel est-elle bien la sienne? La différence entre les humains et les autres organismes, c’est qu’aucun autre organisme ne monopolise les moyens de production et oblige certains de ces organismes à travailler pour de l’argent. Si nous voyions un ours privatiser les moyens de production des poissons et forcer d’autres ours à travailler pour lui, nous conclurions immédiatement que quelque chose ne va pas dans cet écosystème. Pourtant, c’est ce que font les humains aux autres organismes humains. Les humains organisent l’accès aux ressources (et à la consommation) grâce à des systèmes de classes qui contrôlent et excluent.
L’analyse de l’empreinte écologique n’est pas seulement façonnée par une vision écologique de « tous les humains sont simplement des consommateurs d’organismes » — mais aussi par une théorie économique plus hégémonique qui suggère que ce sont les consommateurs qui dirigent l’économie avec leurs choix et décisions. La théorie de la souveraineté des consommateurs suppose que les producteurs sont captifs des demandes des consommateurs, qu’ils ne font que répondre à ces derniers — alors que la réalité est toute autre: c’est la production qui limite les choix de consommation. Une grande partie de la consommation (comme la conduite automobile) n’est pas un « choix », mais une nécessité de reproduction sociale (se rendre au travail). De plus, lorsque nous choisissons des marchandises, nous ne pouvons choisir que celles qui sont avant tout rentables à produire. L’une des contradictions des marchandises « écologiquement durables » (à faible empreinte écologique) est qu’elles sont souvent plus chères.
La vraie question qu’il faut se poser est la suivante: selon nous, qui possède le véritable pouvoir sur les ressources économiques de la société? La théorie de la souveraineté des consommateurs suggère que ce sont les préférences des consommateurs qui déterminent en fin de compte les décisions de production: le pouvoir est diffus et dispersé parmi les consommateurs individuels. Pourtant, le pouvoir sur l’économie n’est pas diffus, il est concentré entre les mains de ceux qui contrôlent les ressources productives. L’idée centrale de l’analyse de l’empreinte écologique est que les choix de consommation – c’est-à-dire les modes de vie – sont à la base de la crise écologique. La conclusion est claire: une politique de moindre consommation. L’idéologie de l’empreinte écologique a rendu inadmissible une politique de gains matériels parmi ceux qui gagnaient leur vie grâce aux marchandises. Puisque les modes de vie des consommateurs étaient associés à une empreinte, plus de consommation signifiait plus de destruction écologique. Poussée à l’extrême, toute demande de classe, par exemple, pour des salaires plus élevés, signifierait nécessairement une plus grande « empreinte22 ». La politique environnementale est devenue – à dessein – une politique de limitation et de diminution. C’est ce qui explique l’essor de l’écologisme de type « Small is Beautiful » dans les années 1970, qui encourageait tout ce qui est local, à petite échelle et basé sur des relations de travail en face à face avec une technologie minimale (et « appropriée »)23. Cette forme de politique promettait ce qu’Erik Olin Wright appelait « l’évasion du capitalisme » ou des projets dont le but est de « créer notre propre micro-alternative dans laquelle vivre et prospérer24 ». Si les modes de vie des consommateurs étaient en cause, une authentique politique environnementale ne pouvait être construite que dans la séparation avec cette société de consommation massive.
L’environnementalisme axé sur les moyens d’existence et les communautés marginalisées
Beaucoup de radicaux de la Nouvelle Gauche ont vu les limites des communes « Small is Beautiful » et du « Whole Earth Catalog » en termes de politique de style de vie. Pour un ensemble d’universitaires préoccupés par la politique radicale, combiner l’intérêt pour les exigences matérielles (c’est-à-dire la classe) et l’écologie signifiait se concentrer sur les luttes en marge de la société de consommation mondiale. Ainsi, les deux approches radicales les plus populaires de la politique écologique dans le monde universitaire étaient centrées sur deux approches: l’écologie politique et la justice environnementale25.
La sous-discipline de l’écologie politique est apparue dans les années 1970 et 1980 comme une branche marxiste des études agraires. Elle visait à situer les luttes des populations rurales pauvres (paysans, peuples indigènes, etc.) pour la terre, les ressources ainsi que la dégradation de l’environnement dans un cadre politico-économique marxiste26. L’objectif était souvent de montrer que la dégradation des terres, comme la déforestation ou l’érosion des sols, ne devrait pas être imputée aux paysans eux-mêmes, mais plutôt à des processus plus vastes de marginalisation engendrés par les flux mondiaux de marchandises et les formes de contrôle étatique.
Le point central de ce travail a été centré sur le concept de moyens de subsistance27 — des communautés qui tiraient leur subsistance directement de la terre dans une certaine mesure. Compte tenu de la dynamique du capitalisme néolibéral mondial, les principales conclusions de cette approche sont axées sur la dépossession des communautés locales de leurs stratégies traditionnelles de subsistance. Marx appelait ce processus « l’accumulation primitive », mais lorsque David Harvey a inventé le terme « accumulation par dépossession », une nouvelle vague de recherches a émergé pour se concentrer sur les multiples processus de dépossession qui se produisent dans les cultures et communautés terrestres du monde entier28. Pourtant, parce que le capitalisme est lui-même défini par le fait que la majorité de la masse est déjà dépossédée de ses moyens de production, ce savoir est resté en marge et à la périphérie de l’économie mondiale.
L’autre littérature universitaire radicale extrêmement populaire est celle de la justice environnementale. La justice environnementale suggère également qu’une expérience directe et vécue de l’environnement est une base clé de la lutte environnementale — ici, l’exposition vécue aux dangers toxiques et à la pollution. Les valeurs d’usage menacées ici comprennent l’eau, l’air et, bien sûr, la valeur d’usage essentielle de la force de travail du corps. Dans une société industrielle, les infrastructures et les déchets de l’industrialisation se trouvent dans des communautés marginalisées, souvent de couleur. Ainsi, la justice environnementale examine les injustices à l’intersection de la race et de la classe et les luttes pour les surmonter29. Munie de racines implantées dans le mouvement des droits civiques, la justice environnementale a émergé pour s’attaquer à la distribution inégale de la pollution toxique déversée dans les communautés de couleur à travers les États-Unis.
L’objectif politique sous-jacent est que ce sont ces communautés marginalisées qui devraient elles-mêmes diriger les mouvements environnementaux contre les entreprises qui les empoisonnent, elles et leurs communautés. C’est leur expérience matérielle directe de la pollution et de la toxicité qui leur confère ce statut politique particulier. De même, comme les luttes pour la justice environnementale ont éclairé le mouvement pour le climat, le mouvement pour la justice climatique considère également les communautés marginalisées « en première ligne » comme les acteurs clés de la lutte pour le climat. Comme l’écologie politique, ce sont souvent les paysans, les peuples autochtones et les autres communautés qui sont les plus menacés par les changements climatiques (par exemple, les pêcheurs des littoraux, les agriculteurs sujets à la sécheresse, etc.) Mais comment la politique de justice environnementale peut-elle construire de la solidarité, alors que la majorité des gens est totalement engloutie dans la société de marchandises, sans être exposée à une menace apparente de pollution toxique?
Les limites de l’environnementalisme
La première lacune majeure tient à sa compréhension de la responsabilité de classe dans la crise écologique. La forme de politique éclairée par l’analyse de l’empreinte écologique adopte une approche politique qui blâme tous les consommateurs pour la crise écologique. Il est difficile de voir comment une stratégie politique peut l’emporter si sa solution est d’exiger une restriction supplémentaire de la consommation d’une classe qui lutte contre la stagnation salariale depuis près d’un demi-siècle. Comment envisage-t-elle d’attirer les travailleurs à sa cause si son message principal est d’accepter davantage d’austérité?
L’empreinte écologique présente une analyse où tous les impacts peuvent être retracés jusqu’aux organismes (les humains) qui tirent des propriétés utiles de ces ressources (les consommateurs). Mais c’est un point de vue qui, en ignorant le rôle du capital dans la formation et la limitation du flux des marchandises, interprète l’équation du pouvoir dans l’ordre inverse. Lorsqu’il s’agit de consommation, chaque marchandise a des utilisateurs et des profiteurs tout au long de la chaîne: nous devons placer l’essentiel de la responsabilité sur ceux qui profitent de la production — et pas seulement sur les personnes qui répondent à leurs besoins. Il ne s’agit pas tant d’un calcul moral que d’une évaluation objective de qui détient le pouvoir le long de ces chaînes de produits.
Prenons le problème du changement climatique. Les travaux de Richard Heede retracent 63% de toutes les émissions historiques de carbone depuis la révolution industrielle à quatre-vingt-dix entreprises privées et publiques — ce qu’il appelle « les grands du carbone », la classe des capitalistes qui déterrent les combustibles fossiles et les vendent avec profit30. Mais les capitalistes responsables du changement climatique sont beaucoup plus divers que cela. Il existe d’énormes quantités de capital industriel qui dépendent de la consommation de combustibles fossiles — les plus importants pour le climat sont le ciment (responsable de 7% des émissions mondiales de carbone), l’acier, les produits chimiques et d’autres formes de production à forte intensité de carbone31. Selon l’Agence d’information sur l’énergie, le secteur industriel consomme plus d’énergie dans le monde que les secteurs résidentiel, commercial et des transports réunis32. Si l’on inclut les émissions provenant de la consommation d’électricité, le secteur industriel dépasse tous les autres secteurs (y compris l’agriculture et le changement d’affectation des terres) avec 31% des émissions mondiales33.
La deuxième grande lacune est le recul académique de la politique de style de vie au profit d’un environnementalisme qui privilégie les moyens d’existence. On ne s’intéresse plus aux responsables, mais plutôt à l’endroit dans la société où l’on trouve d’authentiques luttes pour l’environnement. Ici, le problème est une focalisation politique sur la marginalité, ce qui ne produira pas un mouvement plus large. L’écologie politique est axée sur les luttes contre la dépossession dans les zones rurales, y compris la résistance indigène et paysanne. Je me demande comment de telles luttes peuvent construire une sorte de pouvoir social capable de s’opposer au capital, qui est responsable de la dépossession et de la pollution en premier lieu. La caractéristique déterminante du capitalisme est que la grande majorité est arrachée aux conditions naturelles de la vie — ceux qui ne sont pas encore dépossédés sont par définition marginaux par rapport au système dans son ensemble.
On peut aussi légitimement soulever des questions stratégiques sur le succès du mouvement en matière de justice environnementale. Il est instructif d’examiner les réflexions de certains universitaires et militants de l’intérieur sur le mouvement. Benjamin Goldman – un analyste de données pour le célèbre rapport Toxic Waste and Race de 1987 – a soutenu que le pouvoir réel du mouvement pour la justice environnementale était semblable à « une mouche sur le derrière d’un éléphant34 ». Il a mis à jour les données du rapport de 1987 pour montrer que « malgré l’attention accrue accordée à la question, les personnes de couleur aux États-Unis sont maintenant encore plus susceptibles que les Blancs de vivre dans des collectivités dotées d’installations commerciales de gestion des déchets dangereux qu’il y a une décennie35 ». Vingt-cinq ans plus tard, Pulido, Kohl et Cotton arrivent à une conclusion semblable et invoquent prudemment « l’échec » de la justice environnementale. Ils déclarent catégoriquement: « […] les communautés pauvres et les communautés de couleur sont toujours surexposées aux dommages infligés à l’environnement36 ».
Ces luttes sont extrêmement importantes et ne doivent pas être ignorées. Mais pour que la justice environnementale l’emporte, ils doivent trouver un moyen de construire un mouvement environnemental plus vaste avec une base capable de s’attaquer aux entreprises responsables de l’empoisonnement des communautés locales. Jusqu’à présent, nous avions tendance à valider la supériorité morale de ces luttes, sans nous demander stratégiquement comment elles pourraient construire le pouvoir pour surmonter leur situation. En résumé, tant pour le mode de vie que dans sa ramification, l’environnementalisme axé sur les moyens d’existence est apparu au cours de la période même où la crise environnementale n’a fait qu’empirer et où la capacité des capitaux privés à nuire à l’environnement s’est considérablement accrue. Ses stratégies politiques sont inefficaces.
« Le dépassement »: la base de classe de l’environnementalisme
Le mouvement écologiste est apparu pendant une période de crise et de restructuration dans les années 1960 et 1970. Alors que la politique anticapitaliste a historiquement dénoncé l’inégalité et la pauvreté du système, dans les années 1970, les commentateurs de gauche et de droite ont affirmé que le capitalisme était confronté à un nouveau problème: l’abondance. La profusion nous avait submergés. L’augmentation des niveaux de consommation, elle-même le produit des victoires de la classe ouvrière, est désormais un problème. Au milieu des années 1970, un certain Alan Greenspan a soutenu que la crise économique était enracinée dans des attentes sociétales trop « ambitieuses37 ». Il a poursuivi en suggérant que ce public doit s’adapter à de nouveaux « objectifs réalistes » et que « les niveaux de revenu seront plus bas et l’augmentation possible du niveau de vie sera réduite ». La société avait « dépassé » les attentes raisonnables. La solution? L’austérité ou une politique « du moins ».
Les critiques de l’abondance par Marcuse, Debord et Lasch sont survenues étrangement au cours d’une décennie pendant laquelle les travailleurs ont été attaqués.
D’un point de vue politique très différent, une grande partie de la « Nouvelle Gauche » a également tourné sa critique vers les problèmes d’une société de surconsommation. Herbert Marcuse définit « la pure domination […] comme une administration; dans les secteurs surdéveloppés de la consommation de masse, la vie administrée est la bonne vie du tout38 ». Guy Debord affirme que « le spectacle diffus accompagne l’abondance des marchandises » et que la marchandise a « réussi à coloniser totalement la vie sociale39 ». Christopher Lasch dénonce le « culte américain de la consommation » et la « propagande des marchandises ».
Ces critiques de l’abondance sont survenues étrangement au cours d’une décennie pendant laquelle les travailleurs américains ont été attaqués. Comme l’explique l’historien Daniel Horowitz, « la plupart des Américains ont vécu [les années 1970] comme une période de difficultés économiques […] la grande majorité des familles du pays ont connu une baisse de leurs revenus réels40 ». Comme les Greenspan du monde entier ont gagné, « faire plus avec moins » était devenu logique; il était temps de tout réduire: les dépenses gouvernementales, les avantages sociaux et les budgets familiaux sans distinction.
La critique de l’abondance et de la « surconsommation » se superposait parfaitement à la montée du mouvement écologiste au même moment. Tout comme Greenspan, les Limites de la croissance du Club de Rome de 1972 annonçaient une nouvelle réalité à laquelle la société devait s’adapter: « l’homme est contraint de tenir compte des dimensions limitées de sa planète41 ». Paul Ehrlich a d’abord claironné le malthusianisme le plus grossier dans La bombe P, mais quelques années plus tard, en 1974, lui et sa femme ont publié The End of Affluence, faisant valoir que la société de consommation de masse avait dépassé son fondement matériel.42 L’un des textes les plus influents est Overshoot de William Catton, qui explique comment l’utilisation des ressources humaines a « dépassé » la capacité de la Terre et comment notre disparition massive est imminente43. La politique environnementale a pris de l’ampleur et s’est développée précisément pendant une période politique prônant l’austérite. Elle adhère à ce que Leigh Phillips appelle une « écologie de l’austérité » – une politique de limitations, d’endiguement de la consommation et de réduction de notre impact – réduire, réutiliser, recycler44.
C’est dans ce contexte que s’enracine l’étrange division entre une politique « de classe » et une politique « environnementale ». En tant que « nouveau mouvement social », l’environnementalisme a rejeté une politique enracinée dans des intérêts matériels comme étant désespérément liée au matérialisme creux de la société de consommation. Alors qu’une politique de classe consistait toujours à offrir une vision de bien-être global accru, la politique écologique est devenue une politique « du moins ». André Gorz a développé un point de vue explicitement écosocialiste centré sur le moins: « La seule façon de vivre mieux est de produire moins, de consommer moins, de travailler moins et de vivre différemment45 ». Au fil des ans, la politique de classe et la politique environnementale ont été constamment en désaccord dans le débat « emplois contre environnement ». Ce sont des bûcherons de la classe ouvrière qui se sont opposés à la protection Troy Vettese, « To Freeze the Thames: Natural Geo-Engineering and Biodiversity », New Left Review 111, mai-juin 2018, 63-86. la chouette tachetée ou à la restauration de la migration des saumons dans le fleuve Columbia. Comme le raconte Richard White, l’autocollant sur les pare-chocs « Êtes-vous écologiste ou travaillez-vous pour gagner votre vie? » est devenu populaire dans les communautés ouvrières rurales46.
De nombreuses parties de la gauche écologique appellent encore aujourd’hui à une politique « du moins ». En 2018, la New Left Review a publié un article de Troy Vettese qui plaidait pour l’austérité – ou ce qu’il appelait « l’austérité écologique égalitaire » – qui vise à diviser le moins de manière égale. L’article préconise, entre autres, de rendre la moitié de la planète à la nature — une idée qu’il reprend du sociobiologiste E.O. Wilson — en faveur du véganisme universel et d’un plan abstrait pour le rationnement énergétique mondial par habitant47. L’argument qui semble le plus populaire chez la gauche écologique aujourd’hui est le programme de « décroissance », défini dans une récente compilation comme « une réduction équitable de la production et de la consommation qui réduira la production d’énergie et de matières premières des sociétés48 ». Cependant, l’expérience de la période néolibérale se caractérise généralement par la stagnation des revenus, l’augmentation des dettes, la dégradation de la sécurité de l’emploi et les heures supplémentaires. En centrant tout son programme politique sur le préfixe « dé » et en parlant de « réductions », la décroissance est peu en mesure de répondre aux besoins de la grande majorité des travailleurs ravagés par l’austérité néolibérale49. Une analyse de classe serait toujours fondée non pas sur l’ensemble de la société (et sur la question de savoir si elle doit ou non croître ou décroître), mais plutôt sur des divisions de classe conflictuelles où quelques-uns possèdent beaucoup trop et la majorité possède trop peu.
Qu’est-ce qui explique le lien entre l’écologie et une politique « du moins »? Ce qui unit ces perspectives d’austérité – d’Alan Greenspan à la décroissance –, c’est qu’elles émergent d’une formation de classe spécifique mentionnée ci-dessus, « la classe professionnelle-managériale », et ce que j’appellerai, pour simplifier, la « classe professionnelle50 » Cette formation de classe s’est rapidement développée dans l’après-guerre grâce à l’expansion spectaculaire de l’enseignement supérieur. Il s’agit des universitaires radicaux, des scientifiques, des managers d’organismes à but non lucratif, des fonctionnaires, des journalistes et d’autres professionnels qui concluent que les modes de vie modernes sont responsables de notre crise écologique. Ironiquement, c’est la relative sécurité matérielle de cette catégorie aisée qui induit cette conviction plutôt culpabilisante que « nous », les consommateurs, sommes à l’origine du problème.
En 1976, Barbara et John Ehrenreich ont tenté de tenir compte de la montée en flèche des professions dites « à cols blancs » dans une économie de la connaissance de plus en plus postindustrielle, dans le concept controversé de la « classe professionnelle-managériale51 ». Ils sont entrés dans un débat entre de nombreux marxistes sur la manière de théoriser l’emplacement de la classe de ces travailleurs du savoir52. Mais quelle que soit la façon dont nous les théorisons, un point clé est que la classe professionnelle représente une minorité de la population. Kim Moody estime que les professionnels représentent 22% de la population active aux États-Unis (14% sont classés dans les professions de « management »)53. Il affirme que la classe ouvrière représente 63%.
Un programme environnemental des travailleurs serait axé sur une politique anti-austérité.
Je n’ai pas l’intention de résoudre ces débats théoriques ici. Pour ma part, je tiens à souligner le caractère central du savoir et, de façon plus générale, des diplômes d’études dans la vie de la classe professionnelle. La centralité des diplômes signifie que la classe professionnelle adhère non seulement au mythe de la « méritocratie », mais qu’elle élève aussi la capacité individuelle d’avoir un impact sur le monde — que ce soit en termes de « carrière » ou de réduction vertueuse de votre empreinte carbone. Grâce à une éducation réservée à l’élite, beaucoup de professionnels en viennent à réfléchir profondément à la fois à l’aliénation et à la destruction inhérentes à la société de surconsommation. Cette culpabilité autocentrée est souvent à l’origine de la politique de classe professionnelle. La politique de l’écologie est issue de cette classe professionnelle.
La politique écologique des travailleurs
Pour que le mouvement environnemental s’étende au-delà de la classe professionnelle et crée sa propre base ouvrière, il ne peut compter sur les piliers de l’austérité, de la honte et des solutions individualistes. Il ne peut pas non plus mettre autant l’accent sur la connaissance de la science (croyance ou déni). Il doit se mobiliser autour de politiques bénéfiques pour l’environnement qui font appel aux intérêts matériels de la grande majorité de la classe ouvrière, enlisée dans la stagnation des salaires, la dette et la précarité de l’emploi. Un programme environnemental de la classe ouvrière serait axé sur une politique anti-austérité. Il pourrait avoir pour postulat: les humains sont des êtres écologiques qui ont des besoins fondamentaux pour reproduire leur vie (nourriture, énergie, logement, soins, amour, loisirs). Au lieu de considérer ces besoins comme une source d’« empreintes » qu’il faut réduire, nous devrions reconnaître que la majorité des gens dans la société capitaliste ont besoin d’un accès plus large et plus sûr à ces éléments de survie fondamentaux. Pour rendre ce programme politique, nous devons expliquer comment les besoins humains peuvent être satisfaits par des principes écologiques.
Alexandria Ocasio-Cortez, le Sunrise Movement et de nouveaux groupes de réflexion de gauche comme « New Consensus » se sont réunis pour exiger un « GreenNew Deal » qui, à bien des égards, tente de construire ce type de politique environnementale pour la classe ouvrière. La solution non contraignante proposée par la représentante Ocasio-Cortez et le sénateur Ed Markey se concentre sur les inégalités et les gains de la classe ouvrière. Cette solution met l’accent sur toutes les exigences techniques d’un programme de décarbonisation massive, mais offre également à « tous les habitants des États-Unis […] un emploi avec un salaire suffisant pour subvenir aux besoins de leur famille, des congés familiaux et médicaux adéquats, des congés payés et une retraite assurée ». La clé est de construire un mouvement où des masses de gens se rassemblent pour trouver des solutions à toutes nos crises du climat, des soins de santé et du logement qui exigent la construction d’un pouvoir social de masse afin de combattre les industries qui tirent profit de ces mêmes crises.
Il y a une vision politique admirable derrière le Green New Deal. Mais, pour l’instant, nous n’avons pas encore le genre de mouvement politique qui pourrait réellement y parvenir. Les revendications du Green New Deal exigent des concessions massives de la part du capital. Pour obtenir de telles concessions, nous devons considérer la classe ouvrière comme une base de masse du pouvoir social et chercher à construire ce pouvoir de deux manières. Premièrement, la source la plus évidente du pouvoir de la classe ouvrière est tout simplement le fait qu’elle représente la majorité de la population (Moody l’estime en fait à 75% si l’on inclut ceux qui prodiguent des soins sans reconnaissance officielle). La gauche est déjà en train d’apprendre qu’un moyen clé d’obtenir le soutien populaire de cette base est d’offrir des programmes basés sur la démarchandisation des besoins de base54. De nombreux écologistes radicaux s’intéressent à la résistance à la marchandisation de la nature55 — ou à la prévention de l’intégration de nouveaux environnements « frontière » dans les circuits du capital.
Une politique écologique de la classe ouvrière devrait se concentrer sur l’inverse: au lieu de seulement résister à l’entrée de la nature sur le marché, nous pouvons nous battre pour faire sortir du marché ce dont les gens ont besoin. La récente montée en flèche de la politique électorale socialiste au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays a montré que ce type d’intérêt pour les besoins fondamentaux des populations peut être extrêmement populaire dans les sociétés ravagées par les inégalités et la précarité.
Il n’y a aucune raison éthique pour laquelle nous devrions convenir que les soins de santé sont un droit humain, mais pas la nourriture et l’énergie.
Un programme de démarchandisation de type Green New Deal ne vise pas seulement à satisfaire les intérêts des travailleurs; il pourrait aussi avoir d’énormes effets écologiques. Les programmes de logements sociaux gratuits pourraient également intégrer des pratiques de construction écologique qui permettent de réduire les coûts de chauffage et d’électricité pour les résidents56. La gratuité des transports publics pourrait fondamentalement modifier la dépendance excessive à l’égard de l’automobile et d’autres modes de transport privatisés. Il n’y a aucune raison éthique pour laquelle nous devrions tous convenir que « les soins de santé sont un droit humain », mais pas la nourriture et l’énergie. C’est ainsi que nous faisons face à des industries qui sont les principales coupables de notre crise écologique. De plus, ce programme de démarchandisation n’exclut pas les mouvements écologiques traditionnels pour la préservation ou la conservation de la nature ou des « espaces ouverts ». C’est une politique de construction et d’élargissement de la zone de vie sociale où le capital n’est pas autorisé. La combinaison de la « garantie d’emploi fédérale » du Green New Deal avec la démarchandisation des besoins sociaux pourrait également inclure la demande traditionnelle de la main-d’œuvre de gauche pour une semaine de travail plus courte, puisque le nombre total d’heures de travail pourrait être réparti parmi davantage de travailleurs et les bases de la vie coûteront simplement moins cher57.
Pour le changement climatique, il y a un secteur en particulier qui pourrait devenir un site de lutte critique: l’électricité.
Un Green New Deal fondé sur la démarchandisation consiste également à transférer le pouvoir et le contrôle sur les ressources de la société. La partie de ce programme la plus bénéfique sur le plan écologique est qu’il vise à transférer ces industries du secteur privé au secteur public afin que les objectifs environnementaux puissent prévaloir sur les profits. Pour le changement climatique, il y a un secteur en particulier qui pourrait devenir un site de lutte critique: l’électricité58. Un plan rapide de décarbonisation nécessitera un programme basé sur « l’électrification de tout », y compris le transport et le chauffage résidentiel et commercial59. Dans le contexte américain, cela signifie non seulement « rendre vert » un secteur de l’énergie électrique qui est encore alimenté à 62,9% par des combustibles fossiles (principalement le gaz naturel et le charbon), mais aussi accroître massivement la production d’électricité pour répondre à la demande accrue d’électrification d’autres secteurs60. Ce programme nécessitera une lutte massive contre l’industrie des services publics privatisés appartenant à des investisseurs.
En raison de son statut de « monopole naturel » (il est logique qu’une seule entreprise gère l’approvisionnement sur un réseau unique), le secteur de l’électricité est déjà soumis à des formes intenses de réglementation et de contrôle publics. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un secteur plus ouvert que les autres à la contestation politique. De plus, comme l’électricité est absolument essentielle à la reproduction sociale – et parce qu’il existe déjà une colère sous-jacente au sein de la classe ouvrière contre les entreprises privées des services publics qui pratiquent des tarifs exorbitants et des coupures61 – il serait facile de mettre sur pied des campagnes de masse s’adressant à la classe ouvrière, fondées à la fois sur la nécessité de décarboniser rapidement l’électricité et sur la nécessité de proposer aux ménages une électricité moins chère, voire gratuite. Si la politique du changement climatique est souvent abstraite, l’électricité gratuite ne l’est pas.
Tout programme de démarchandisation et de secteur public soulèvera également la question de savoir comment le « financer ». Comme l’ancien New Deal, la réponse doit se concentrer sur les entreprises et les riches. Cela nécessitera une politique d’opposition qui explique qui est réellement responsable de la crise écologique, qui n’est pas intérieure et culpabilisante, et qui ne blâme pas la consommation de la classe ouvrière. Elle canalisera la colère de classe déjà existante contre les riches pour avoir causé la crise écologique. Contrairement à l’orthodoxie néolibérale, taxer les riches est aussi très populaire chez la classe ouvrière. En réponse à l’appel d’Alexandria Ocasio-Cortez en faveur d’une augmentation des impôts sur les riches pour financer un Green New Deal, un récent sondage a révélé que 76% des Américains et même une majorité de Républicains sont en faveur d’une augmentation des impôts pour les riches62.
La politique écologique a compris depuis longtemps le pouvoir de la perturbation, mais elle l’exerce habituellement à l’extérieur du lieu de travail.
La deuxième grande source de pouvoir de la classe ouvrière n’est pas seulement son nombre, mais aussi sa position stratégique sur le lieu de travail en tant que source de main-d’œuvre à l’origine des profits privés et de la reproduction sociale publique. La classe ouvrière a la capacité de retirer sa force de travail et de forcer le capital à accepter des concessions grâce à des grèves et à d’autres formes de politique perturbatrice. La politique écologique a compris depuis longtemps le pouvoir de la perturbation, mais elle l’exerce habituellement à l’extérieur du lieu de travail d’une manière qui paraît différente de celle des travailleurs. Aujourd’hui, ce que Naomi Klein appelle « Blockadia » décrit les nombreux activistes qui bloquent l’expansion des oléoducs et d’autres infrastructures de combustibles fossiles comme les centrales à charbon63. Ces militants reconnaissent à juste titre le pouvoir de la perturbation massive dans la victoire des revendications politiques. Pourtant, l’armée actuelle de militants de l’action directe écologique ne possède qu’une capacité perturbatrice limitée. La montée en puissance la plus inspirante, et à bien des égards la plus réussie, a été le mouvement #nodapl (opposition à l’oléoduc Dakota Access) à Standing Rock — pourtant, à la suite de l’élection de Trump, l’oléoduc Dakota Access transporte maintenant, et parfois même déverse, du brut fracturé provenant de la formation de Bakken.
La politique écologique pourrait-elle plaire aux travailleurs qui ont la capacité de faire s’effondrer le capitalisme de l’intérieur? Peut-on construire ce que Sean Sweeney appelle un « syndicalisme écologique » où les travailleurs voient leur lutte contre la direction comme une lutte environnementale64? Cela pourrait commencer par un simple lien entre la façon dont les patrons exploitent les travailleurs et l’environnement. Ce lien était beaucoup plus central dans le mouvement environnemental des années 1960. Bien qu’affaiblis, les syndicats se battent de cette manière; en 2015, les grèves à la raffinerie de pétrole du syndicat United Steelworkers se sont concentrées en grande partie sur la santé et la sécurité au travail65.
On parle beaucoup de l’anti-environnementalisme actuel au sein des syndicats de la construction et des secteurs qui font partie du complexe industriel des combustibles fossiles66. Dans les luttes environnementales, c’est souvent le travail et le capital qui s’alignent contre les activistes. Pourtant, les travailleurs des métiers de la construction et les mineurs de charbon ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble de la main-d’œuvre. Il est plus intéressant de regarder en dehors des secteurs les plus sales et les plus destructeurs pour trouver une forme de militantisme ouvrier qui peut être associée à une politique écologique plus large. Une politique écologique de la classe ouvrière pourrait également être mise en place de manière efficace au sein des industries ayant très peu d’impact sur l’environnement en premier lieu. Jane McAlevey a fait valoir de façon convaincante que les secteurs de la santé et de l’éducation devraient être la cible stratégique d’un nouveau mouvement syndical de la classe ouvrière67. Ces secteurs sont à la base même de la reproduction sociale dans de nombreuses collectivités — et contrairement aux aciéries, ils ne peuvent être délocalisés. Alyssa Battistoni soutient également que ces secteurs de « reproduction sociale » ou de « soins » sont par nature des secteurs à faibles émissions de carbone et à faible impact68. L’expansion de ces secteurs devrait être au cœur de l’écologie politique axée sur les « soins » au sens large du terme (pour inclure les écosystèmes et autres systèmes de survie). Bon nombre de ces luttes se déroulent également dans le secteur public lui-même, ce qui sera crucial pour le programme de démarchandisation mentionné ci-dessus.
La nécessité du « moins » et du « sacrifice » ne devrait être supportée que par les riches et les entreprises.
Au cours de cette année, les conseils de McAlevey sont devenus réalité avec la plus grande vague de grèves depuis 1986 — presque toutes confinées dans le secteur de l’éducation69. Conformément au programme préconisé ici, ces grèves visent essentiellement à lutter contre l’austérité et à améliorer la vie des travailleurs concernés. La grève des enseignants de Virginie-Occidentale, par exemple, a fermé l’institution centrale de la reproduction sociale (les écoles) pour satisfaire un ensemble de demandes matérielles — notamment la taxation de l’industrie des combustibles fossiles pour fournir des revenus et améliorer les écoles70. La récente grève des United Teachers of Los Angeles a non seulement exigé des écoles mieux financées, mais aussi l’augmentation des espaces verts sur le terrain de l’école71. Cette politique largement anti-austérité fondée sur le bien commun pourrait facilement être intégrée à un programme vert plus vaste fondé sur les emplois syndiqués afin de créer des infrastructures publiques vertes, des logements et des transports en commun, comme nous l’avons déjà mentionné. Les syndicats de transport en commun et les travailleurs du secteur des services publics pourraient également être organisés selon ces principes.
Construire le pouvoir écologique à travers la classe ouvrière – en tant que majorité de la société et dont le travail fait fonctionner tout le système – pourrait constituer un formidable défi à la domination du capital sur la vie et la survie planétaire. Pour gagner cette lutte, il faut commencer par mettre l’accent sur le fait que la nécessité du « moins » et du « sacrifice » ne devrait être supportée que par les riches et les entreprises; nous autres avons tant à gagner.
Conclusion
Dans la crise et les transformations de la fin des années 1960 et des années 1970, deux grands changements se sont produits. Tout d’abord, sous prétexte de crise, les forces néolibérales se sont consolidées pour faire valoir que les attentes de la société à l’égard de l’économie « riche » d’après-guerre avaient dépassé la réalité et que l’austérité était nécessaire pour contrôler les dépenses publiques et le pouvoir syndical. Deuxièmement, une grande partie de la « Nouvelle Gauche » a été inondée par les nouveaux diplômés des classes professionnelles (eux-mêmes un produit de l’expansion sans précédent de l’enseignement supérieur dans l’après-guerre). Cette gauche est également devenue très critique à l’égard de l’« abondance » et d’une société de marchandises basée sur la consommation. Ces deux facteurs ont convergé dans un mouvement écologique presque entièrement peuplé par cette classe professionnelle qui s’est servie de modèles scientifiques pour faire valoir que l’« abondance » sociétale et la consommation exigeaient une politique de limitations et d’austérité. La méthode par excellence de cette perspective réside dans l’outil de l’empreinte écologique qui, en fin de compte, soutient que ce sont les consommateurs qui déterminent les décisions économiques et la dégradation écologique. Durant cette période, il est devenu évident qu’une politique écologique était différente d’une politique de classe; pour le dire clairement, l’écologie exigeait une politique « du moins », la classe signifiait une politique « du plus » désuète. Bien que certains universitaires de la classe professionnelle aient vu une écologie plus radicale dans les intérêts matériels, on a supposé qu’une telle politique ne pourrait être formée que sur la base des communautés marginalisées ayant une relation directe avec la nature ou la pollution.
 Durant cette même période, le capital n’a fait que consolider son pouvoir et la crise écologique n’a fait qu’empirer. Pourtant, avec la campagne de Bernie Sanders, d’autres victoires électorales et une montée des grèves et du militantisme de la classe ouvrière, la gauche renaît pour la première fois depuis des décennies. Elle est finalement passée d’un langage de « résistance » à un langage de construction du pouvoir. L’élaboration d’une politique environnementale efficace n’a pas besoin d’être conçue de façon spéculative par des organismes à but non lucratif ou des groupes de réflexion militants. Nous pouvons simplement tirer des leçons du mouvement existant autour de nous. Qu’il s’agisse de syndicalisation, de contrôle des loyers, de soins de santé ou d’amélioration de l’environnement, dans tous les cas, le capital lutte pour y mettre fin. Comme l’a dit Marx, « le capital ne s’inquiète […] point de la santé et de la durée de vie du travailleur s’il n’est pas contraint par la société72 ». Le capital ne s’inquiète pas non plus de la vie en général et mène la planète au bord du gouffre. Il est nécessaire de développer une force sociale capable de l’arrêter.
Durant cette même période, le capital n’a fait que consolider son pouvoir et la crise écologique n’a fait qu’empirer. Pourtant, avec la campagne de Bernie Sanders, d’autres victoires électorales et une montée des grèves et du militantisme de la classe ouvrière, la gauche renaît pour la première fois depuis des décennies. Elle est finalement passée d’un langage de « résistance » à un langage de construction du pouvoir. L’élaboration d’une politique environnementale efficace n’a pas besoin d’être conçue de façon spéculative par des organismes à but non lucratif ou des groupes de réflexion militants. Nous pouvons simplement tirer des leçons du mouvement existant autour de nous. Qu’il s’agisse de syndicalisation, de contrôle des loyers, de soins de santé ou d’amélioration de l’environnement, dans tous les cas, le capital lutte pour y mettre fin. Comme l’a dit Marx, « le capital ne s’inquiète […] point de la santé et de la durée de vie du travailleur s’il n’est pas contraint par la société72 ». Le capital ne s’inquiète pas non plus de la vie en général et mène la planète au bord du gouffre. Il est nécessaire de développer une force sociale capable de l’arrêter.
Traduction et version raccourcie de l’article Ecological politics for the working class, Catalyst, Vol. 3, n° 1.
Footnotes
- Paul Griffin, The Carbon Majors Database: CDP Carbon Majors Report 2017 (Londres: Carbon Disclosure Project, 2017), 5.
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Réchauffement planétaire de 1,5 °C.
- Maisa Rojas, Fabrice Lambert, Julian Ramirez-Villegas et Andrew J. Challinor, « Emergence of robust precipitation changes across crop production areas in the 21st century », Proceedings of The National Academy of Sciences, 2019.
- Climate Guide Blog: « Non-survivable humid heatwaves for over 500 million people », 9 mars 2019.
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, « Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5ºC approved by governments », 8 octobre 2018.
- « Climate Scientist: As U.N. Warns of Global Catastrophe, We Need a “Marshall Plan” for Climate Change », Democracy Now, 9 octobre 2018.
- Griffin, 2017.
- Adaner Usmani, « Democracy and Class Struggle », American Journal of Sociology 124, n° 3 (2018): 664-704.
- Vivek Chibber, « Why the Working Class ? », Jacobin, 3 mars 2016.
- Barbara Ehrenreich et John Ehrenreich, « The Professional-Managerial Class » dans Between Labor and Capital de Pat Walker (Boston: South End Press, 1979), 5-45.
- Leigh Phillips, Austerity Ecology and the Collapse Porn Addicts, Londres, Zero Books, 2015.
- Pour des arguments récents, mais quelque peu différents en ce sens, voir Stefania Barca et Emanuele Leonardi, « Working-class ecology and union politics: a conceptual topology » Globalizations 15, n° 4 (2018): 487-503; Daniel Aldana Cohen, « Working-Class Environmentalism », Public Books, 16 novembre 2017.
- Andrew Szaz, Shopping Our Way to Safety: How We Changed from Protecting the Environment to Protecting Ourselves, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009.
- Je n’ai pas la place pour développer cela ici, mais le concept de la vie ici est crucial. Sous le capitalisme, la vie s’oppose au travail ou à la production. En mettant la vie en quarantaine en tant que zone de liberté, de choix et de politique, le travail reste un espace de liberté où l’intervention politique n’est pas autorisée. Je le développe dans Lifeblood: Oil, Freedom and the Forces of Capital, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013.
- Le « mode de vie » et l’« environnementalisme de subsistance » ne sont pas mes propres termes. Cet article de blog affirme également qu’ils sont profondément connectés (mais d’un point de vue très différent du mien): Mat McDermott, « Is there a difference between lifestyle & livelihood environmentalism ? » Treehugger, 6 juin 2011.
- Joan Martinez Alier, The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation, Cheltenham, Edward Elgar, 2002.
- Nicky Chambers, Craig Simmons et Mathis Wackernagel, Sharing Nature’s Interest: Ecological Footprints as an Indicator of Sustainability, Londres, Routledge, 1996, xix.
- Ibid, 60.
- Timothy Gore, « Extreme Carbon Inequality: Why the Paris climate deal must put the poorest, lowest emitting and most vulnerable people first », Oxfam International, 2 décembre 2015.
- Ibid, 1.
- Ibid, 3.
- Phillips, Austerity Ecology, 37.
- E.F. Schumacher, Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered, New York, Harper and Row, 1973.
- Erik Olin Wright, « How to Be an Anticapitalist Today », Jacobin, 2 décembre 2015.
- Je présente ici une critique très édulcorée de ces approches. Tout mon développement intellectuel y trouve encore ses origines.
- Piers Blaikie et Harold Brookfield, Land Degradation and Society, Oxford, Blackwell, 1987, 17.
- Voir, en particulier, Anthony Bebbington, « Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty », World Development 27, n° 12 1999, p. 2021-2044.
- David Harvey, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003.
- Voir Robert Bullard, Dumping in Dixie: Race, Class, And Environmental Quality, Boulder, Westview, 1990.
- Richard Heede, « Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010 », Climatic Change 122, n° 1–2, 2014, 229-241.
- Chelsea Harvey, « Cement Producers Are Developing a Plan to Reduce CO2 Emissions », E&E News, 9 juillet 2018.
- Agence d’information sur l’énergie, International Energy Outlook 2017. Tableau: Consommation d’énergie livrée par secteur d’utilisation finale et par combustible, scénario de référence | Région: monde entier.
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report, New York: Cambridge University Press, 2014, 44.
- Benjamin Goldman, « What is the future of environmental justice ? » Antipode 28, n° 2 (1995): 122–141; 130. Étant donné que ceci a été publié après la vague républicaine de Newt Gingrich en 1994, je ne peux que supposer que la métaphore était un choix conscient.
- Ibid, 127.
- Laura Pulido, Ellen Kohl et Nicole-Marie Cotton, « State Regulation and Environmental Justice: The Need for Strategy Reassessment », Capitalism, Nature, Socialism 27, n° 2 (2016): 12–31; 12.
- Alan Greenspan, « The Impact of the 1973-1974 Oil Price Increase on the United States Economy to 1980 », US Council of Economic Advisors, Alan Greenspan, Box 48, Folder 1, Gerald Ford Presidential Library, Ann Arbor, Michigan.
- Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel, Minuit, juin 2006, p. 279.
- Guy Debord, La Société du spectacle éditions Buchet/Chastel, Paris, 14 novembre 1967.
- Daniel Horowitz, Anxieties of Affluence: Critiques of American Consumer Culture, 1939–1979, Amherst, University of Massachusetts Press, 2004.
- Donella H. Meadows et al., The Limits to Growth, New York, Universe Books, 1974.
- Paul Ehrlich et Anne Ehrlich, The End of Affluence: A Blueprint for your Future, New York, Ballantine Books, 1974.
- William Catton, Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change, Urbana, University of Illinois Press, 1980.
- Leigh Phillips, Austerity Ecology and the Collapse Porn Addicts, Londres, Zero Books, 201
- André Gorz, Écologie et politique, Galilée, 1975.
- Richard White, « Are you an environmentalist or do you work for a living ? Work and nature » dans Uncommon Ground: Toward Reinventing Nature de William Cronon, New York: W. W. Norton & Company, 1996, 171–186.
- Troy Vettese, « To Freeze the Thames: Natural Geo-Engineering and Biodiversity », New Left Review 111, mai-juin 2018, 63-86.
- Giacomo D’Alisa, Federico Demaria et Giorgos Kallis, Degrowth: A Vocabulary for a New Era, Londres, Routledge, 2015, 3–4.
- Pour une critique de la décroissance et de l’article de Vettese en particulier, voir Robert Pollin, « De-Growth vs a Green New Deal », New Left Review 112, juillet – août 2018, 5-25.
- Je pense qu’il existe des clivages politico-idéologiques importants entre les professions « managériales » et « professionnelles », en particulier en ce qui concerne la politique écologique, où la première est probablement très récalcitrante et la seconde très favorable. Voir l’essai complet des Ehrenreich et un livre plein de commentaires et de critiques dans Between Capital and Labor de Pat Walker, Boston, South End Press, 1979.
- Ehrenreich et Ehrenreich, 1979.
- Voir André Gorz, Stratégie ouvrière et néocapitalisme et Serge Mallet, La nouvelle classe ouvrière, Seuil, 1963.
- Kim Moody, On New Terrain: How Capital is Reshaping the Battleground of Class War, Chicago: Haymarket, 2017, 40.
- Pour d’autres qui intègrent la démarchandisation dans la politique éco-socialiste, voir: Thea Riofrancos, Robert Shaw et Will Speck, « Eco-Socialism or Bust », Jacobin, 20 avril 2018; Greg Albo et Lilian Yap, « From the Tar Sands to ‘Green Jobs’ ? Work and Ecological Justice », Bullet, 12 juillet 2016.
- Pour un examen utile, voir Scott Prudham, « Commodification » dans A Companion to Environmental Geography de Noel Castree, David Demeritt, Diana Liverman et Bruce Rhoads, Londres, Wiley, 2009, 123-142.
- Daniel Aldana Cohen, « A Green New Deal for Housing », Jacobin, 8 février 2019.
- Kate Aronoff, « Could a Green New Deal Make Us Happier People? » Interception, 7 avril 2019.
- Johanna Bozuwa, « Public Ownership for Energy Democracy », The Next System Project, 3 septembre 2018.
- David Roberts, « The key to tackling climate change: electrify everything », Vox, 27 octobre 2017.
- US Energy Information Administration, www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427=3.
- La branche de Providence DSA s’est lancée dans une campagne sur ce terrain appelée « #NationalizeGrid ». Voir Riofrancos, Shaw et Speck, « Eco-Socialism or Bust ».
- Patricia Cohen et Maggie Astor, « For Democrats Aiming Taxes at the Superrich,’the Moment Belongs to the Bold’ » New York Times, 8 février 2019.
- Naomi Klein, This Changes Everything, 293–336.
- Sean Sweeney, « Earth to Labor: Economic Growth is No Salvation », New Labor Forum 21, n° 1 (2012): 10-13.
- Trish Kahle, « The Seeds of an Alternative », Jacobin, 19 février 2015.
- Erik Loomis, « Why labor and environmental movements split – and how they can come back together » Environmental Health News, 18 septembre 2018.
- Jane McAlevey, No Shortcuts: Organizing for Power in the New Gilded Age, New York, Oxford University Press, 2016.
- Alyssa Battistoni, « Living, Not Just Surviving », Jacobin, 15 août 2017.
- Bureau of Labor Statistics, « Work Stoppages Summary », 8 février 2019.
- Kate Aronoff, « Striking Teachers in Coal and Gas Country are Forcing States to Rethink Energy Company Giveaways », Intercept, 12 avril 2018.
- United Teachers of Los Angeles, Summary of Tentative Agreement/UTLA and LAUSD January 22, 2019.
- Karl Marx, Capital Vol. 1.