Les dynamiques de classe continuent de dicter qui a accès à une identité gay non stigmatisée — et d’exclure de nombreux membres de la classe ouvrière de la participation à une vie gay normale. Rencontre avec l’anthropologue Roger Lancaster pour en parler.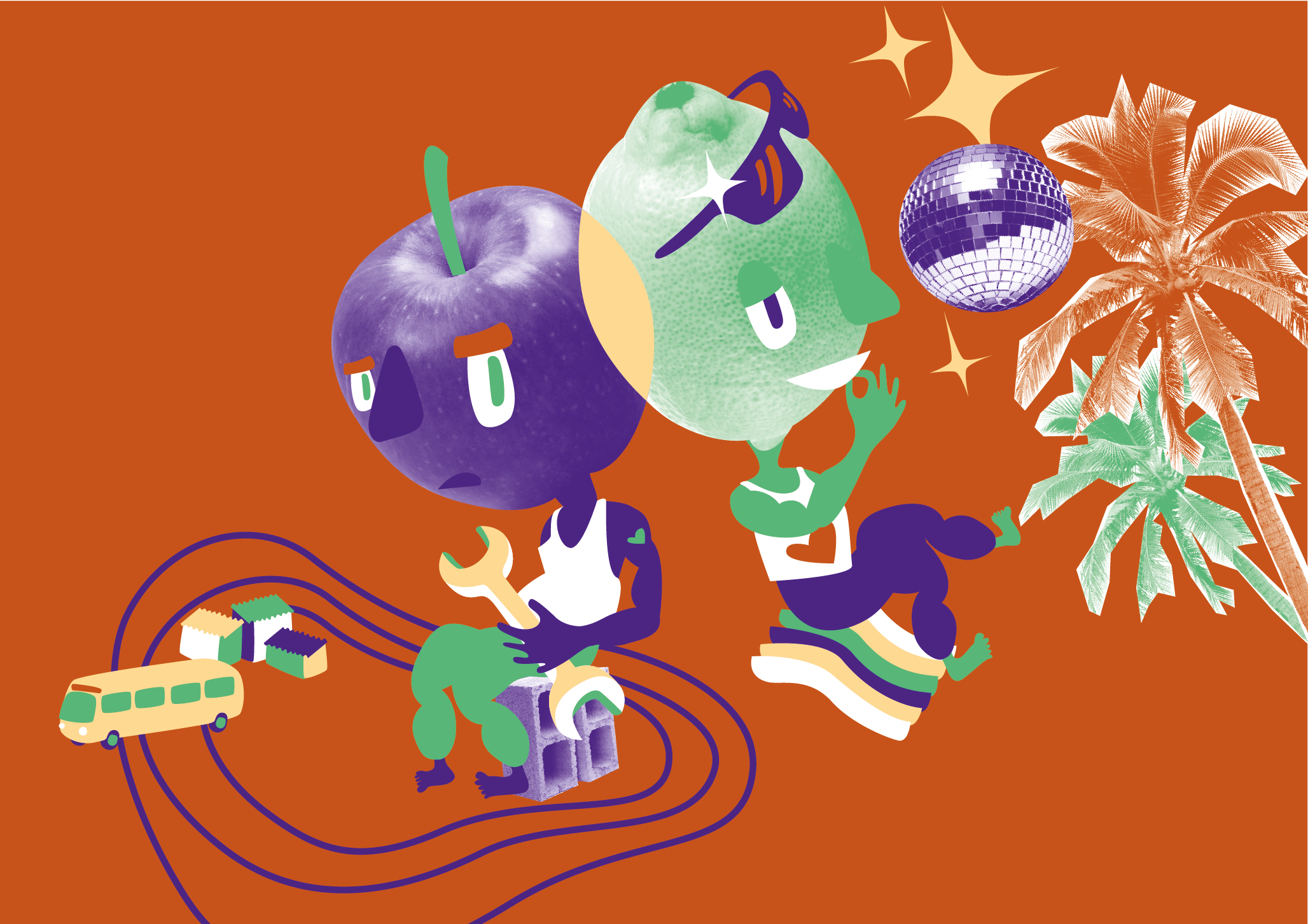
Au cours des dernières décennies, près d’un cinquième des pays du monde ont légalisé le mariage entre personnes du même sexe et, désormais, moins d’un tiers d’entre eux ont des lois qui criminalisent explicitement l’homosexualité. Cela montre indéniablement que, d’une part, de réels progrès ont été accomplis dans la lutte contre l’homophobie et que, d’autre part, d’importants bastions conservateurs restent incontestés dans une grande partie du monde.
Dans les années 1970 et 1980, les luttes de libération gay ont souvent pris des formes radicales, s’alignant sur les mouvements socialistes et pacifistes. Ce lien entre la politique gay et le radicalisme politique est aujourd’hui presque complètement rompu. Dans un entretien accordé au magazine étasunien Jacobin, Roger Lancaster, anthropologue et auteur du livre The Struggle to Be Gay — in Mexico, for Example (University of California, 2024), fait valoir que l’un des problèmes fondamentaux que pose la façon dont la vie homosexuelle est abordée dans les milieux universitaires et militants est l’absence de prise en compte de la dimension de classe.
Dans The Struggle to Be Gay — in Mexico, for Example, l’auteur propose une sociologie de la vie gay dans la classe ouvrière, en se concentrant tout particulièrement sur les Mexicains de peau foncée et les indigènes. Ce qu’il constate, c’est qu’aux États-Unis, les discussions sur la vie homosexuelle font souvent abstraction de l’influence de la classe sociale sur les espaces auxquels les gens peuvent se permettre d’avoir accès. Cette attitude a empêché de nombreux membres de la gauche de voir à quel point l’insécurité économique exclut une grande partie de la classe ouvrière de la participation à la vie gay.
DANIEL ZAMORA Pour commencer, je voulais vous demander ce qui vous a amené à écrire ce livre. Y a-t-il eu un mécontentement spécifique sur la façon dont la question de l’homosexualité sous le capitalisme a été traitée au cours des dernières décennies?
ROGER LANCASTER Il y a certainement de quoi être mécontent si l’on pense que les conditions matérielles, en particulier la dynamique de classe, devraient faire partie du cadre de référence. Cependant, l’engagement dans l’économie politique a pratiquement disparu des études LGBTQ et, dès les origines de la théorie queer, le concept de classe disparaît en tant que sujet d’intérêt pérenne aux États-Unis. Ainsi, dans l’introduction de Fear of a Queer Planet (1993), l’auteur Michael Warner a expressément exclu les perspectives de classe du champ d’étude. La «classe», écrit-il, «est ostensiblement inutile… inintelligible» pour les théorisations queer du social. Cette déclaration remarquable résumait le consensus émergeant.
L’insécurité économique exclut une grande partie de la classe ouvrière de la participation à la vie gay.

Les théories de Judith Butler sur la performativité, qui ont refaçonné le champ autour d’abstractions dans les années 1990, n’accordent pas d’attention aux réalités de l’existence des classes sociales. Par conséquent, même les ouvrages qui affichent ostensiblement leur «matérialisme» s’en tiennent à des considérations théoriques superficielles et ne semblent pas avoir grand-chose à dire sur les conditions de classe sur le terrain. Certains chercheurs américains situés à la gauche du champ des cultural studies emploient de temps à autre le mot «classe», généralement inséré comme une réflexion a posteriori dans une série de références à d’autres formes d’inégalité sociale — «race, genre, sexualité, classe».
Lorsque ces théoriciens font référence à la classe, le sens qu’ils lui donnent n’est pas toujours clair, et je suis fréquemment amené à me demander s’ils le savent eux-mêmes. En général, ils considèrent la classe essentiellement comme un résultat de la discrimination («classisme», terme introduit par Audre Lorde très tôt dans le développement des politiques identitaires) et non comme la forme que prennent inévitablement les relations sociales dans la dynamique inexorable de la production et de la circulation capitalistes. Par ailleurs, dans le style typiquement étasunien, ils associent la classe sociale à l’une de ses manifestations, la pauvreté, en alignant conceptuellement la masse des travailleurs ordinaires sur les élites dans le drame moral opposant les riches et les pauvres.
Il en résulte un corpus de travaux de plus en plus éloignés des luttes quotidiennes des gens ordinaires, et parfois même très hostiles à celles-ci. En revanche, The Struggle to Be Gay est un livre sur la classe sociale et la façon dont celle-ci façonne la vie des homosexuels, mais aussi la façon dont elle contraint leur imagination sociale de la sexualité, de la liberté et de l’identité. Partant d’un regard très personnel et intimiste, l’ouvrage relate les expériences d’hommes homosexuels issus pour la plupart de la classe ouvrière, leur expérience du rejet et de l’acceptation, de la violence et de l’amour, de leurs projets et de leurs frustrations. Le livre s’ouvre ensuite sur des perspectives plus larges: la manière dont les identités se cristallisent au sein de courants politiques et économiques changeants, et l’influence de ces évolutions historiques sur le positionnement des sujets dans le monde social d’aujourd’hui. Le cadre choisi est celui du Mexique, mais les dynamiques de classe que je décris se retrouvent dans d’autres pays, y compris ceux de l’Atlantique Nord.
Vous affirmez qu’il n’existe pas à proprement parler de politique de la vie gay. Qu’entendez-vous par là?
Si une frange du mouvement homophile de la première heure (le Scientific-Humanitarian Committee de Magnus Hirschfeld, l’activisme d’Edward Carpenter) s’est alliée au socialisme, tous les gays n’ont pas jeté leur dévolu sur les travailleurs et les opprimés. Un autre courant s’est essentiellement rallié à une ancienne vision aristocratique, selon laquelle l’homosexualité était l’une des prérogatives du pouvoir masculin (le groupe de défense des homosexuels d’Adolf Brand au début du XXe siècle, Community of the Special, par exemple) ou s’est aligné sur le mouvement de jeunesse anti-moderniste Wandervogel.
Plus récemment, les positions ont été très disparates. Dans les années fastes de la Nouvelle Gauche étasunienne, les militants homosexuels appelaient à l’abolition de la famille; plus tard, les militants des droits homosexuels se sont mobilisés pour l’égalité des droits en matière de mariage. Il est difficile de déduire une politique implicite dans les changements d’orientation, d’objectifs et de stratégies des mouvements sociaux. Par ailleurs, si l’on considère les subcultures (NDLR nous conservons ici l’appellation anglophone car la traduction littérale de ce terme pourrait avoir une connotation négative alors que ce concept fait simplement référence aux cultures partagées par un nombre limité de personnes, en opposition avec la culture dominante ou mainstream) de la vie nocturne comme distinctes des mouvements sociaux, les implications politiques nécessaires deviennent encore plus difficiles à cerner. Certes, toute subculture qui fonctionnerait telle une tribune politique sans fin ne tarderait pas à devenir une affaire terriblement fastidieuse.
Le socialisme n’est pas l’apanage des Noirs, des homosexuels, des Latinos ou de tout autre groupe spécifique. Le socialisme est pour tout le monde.
Je pars donc d’une prémisse différente, fondée sur les scènes sociales très réelles à propos desquelles j’écris. Lorsque nous nous réunissons, que nous socialisons et que nous faisons la fête, nous ne sommes pas en train de nous rebeller ou de constituer des forces politiques, ni de mettre en scène diverses formes de transgressivité destinées à choquer les mœurs conservatrices. Nous ne sommes pas engagés dans une lutte collective pour le pouvoir et sa distribution, ce qui est la définition opérationnelle de la politique. Nous sommes avant tout là pour nous amuser, pour arracher quelques rares instants de plaisir à une existence autrement monotone et oppressante.
Je m’empresserai néanmoins d’ajouter que, bien entendu, les subcultures peuvent servir de tremplin à certains types d’actions politiques de résistance. Nous ne voulons pas que les flics nous harcèlent et nous nous retrouvons parfois, nous et nos cadres de vie, dans la ligne de mire des guerres culturelles. Le VIH continue de déterminer le champ d’expérience des hommes homosexuels, et les luttes collectives pour les soins de santé ont certainement été des luttes politiques, même si elles ont pris des formes très diverses. La condition par défaut de la vie gay n’est cependant pas d’être immergée dans la politique. Ce n’est pas déshonorer les institutions créées par les hommes et les femmes homosexuels — les bars, les cafés et les boîtes de nuit, où nous nous faisons des amis et des relations amoureuses et où nous passons une bonne partie de notre vie — que de les qualifier de «sociales», par opposition à «politiques».
Il n’en reste pas moins qu’une grande partie du travail dans ce domaine se présente comme politique.
La tentation de substituer «devrait» à «est» est très forte, et une série de démarches intellectuelles au fil des ans ont tenté d’entretenir l’illusion invraisemblable que la vie homosexuelle, ou une certaine version de celle-ci, est transgressive (ce qui est ou était certainement vrai), et qu’à force de transgression, elle est en quelque sorte intrinsèquement politique (ce qui n’est pas le cas). Ainsi, vingt ans après la naissance du mouvement moderne de libération gay, lorsque les étudiants et les militants universitaires ont élaboré un lexique permettant de distinguer les gays correctement politisés et bien-pensants des autres, les militants et les universitaires nord-américains ont commencé à utiliser le mot «queer» pour distinguer les sujets sociaux qu’ils considéraient comme inassimilables de ceux (les gays) qu’ils considéraient comme étant devenus irrémédiablement conformistes.
Vingt ans plus tard, le mot «queer» avait pratiquement perdu sa connotation frondeuse — mais à ce moment-là, nous nous étions déjà lancés dans une série de nouvelles chasses au sujet transgressif exemplaire. Il s’agissait d’un sujet qui ne pourrait jamais être assimilé au cis-hétéro-patriarcat blanc et dont la résistance aux normes et aux conventions serait considérée comme instructive. Nous avons poursuivi cette idée à travers des populations et des sous-populations changeantes, produisant comme pièces à conviction une succession de groupes à intersectionnalités multiples et de sous-groupes de plus en plus petits, alors qu’un groupe démographique, puis un autre, finissent par ne plus répondre aux normes de ce que nous pourrions plausiblement entendre par «transgressif» et «politique».
Cette prétention transgressive — cristallisée dans le mot «queer» qui, contrairement au mot «gay», indique un refus d’imaginer la fin de la stigmatisation et du rejet une fois pour toutes — barre la voie aux perspectives dont nous avons besoin. Elle se dresse de plus en plus comme une accusation contre une majorité croissante de personnes LGBTQ qui ne peuvent jamais être considérées comme suffisamment «queer» pour satisfaire à des critères en constante évolution. On en vient à mettre en scène d’interminables jeux de moralité, dont la finalité est d’établir des hiérarchies de plus en plus finement délimitées dans la chaîne des oppressions. Ce type de moralisation va à l’encontre d’une analyse solide et d’une véritable solidarité. Elle nous a conduits à une série d’impasses. Aujourd’hui, ces modes de pensée ont pris des racines politico-économiques: elles sont désormais subventionnées par un vaste réseau de fondations privées bien nanties, par le clergé de la théorie queer dans les universités et par les sections DEI (diversité, équité et inclusion) des grandes entreprises.
La classe et l’identité gay
Mais si, comme vous le faites valoir, il n’existe pas de politique de classe inhérente à la vie homosexuelle, il existe bien une base de classe pour pouvoir revendiquer une identité sexuelle moderne et déstigmatisée. Vous semblez affirmer que si la société dans son ensemble est plus tolérante et plus libérale qu’il y a cinquante ans, ces effets ne se traduisent pas aisément par-delà les clivages de classe.
En effet, cette question est au cœur de la partie ethnographique du livre. Les hommes gays de la classe ouvrière dont je parle, dont certains sont indigènes ou issus de milieux indigènes, ne montrent guère de signes d’une volonté d’être des sujets politiques au sens où l’entendent les universitaires et les militants des mouvements sociaux connectés à l’échelle internationale. Ils aspirent cependant à la liberté, à l’aventure, à l’abondance, à une vie heureuse — perspectives qui se sont ouvertes au cours des cinquante dernières années — même s’ils n’ont pas les moyens de concrétiser tout cela. C’est-à-dire qu’ils se heurtent perpétuellement aux limites de leur position de classe. Il convient de noter que, du fait de leur position dans le monde social, ils ont également tendance à aspirer à des objectifs personnels que les universitaires et les militants pourraient de prime abord qualifier de «conformistes», de «normatifs» ou comme relevant de la «classe moyenne».
Qu’est-ce que cela signifie concrètement d’être homosexuel et ouvrier aujourd’hui dans un pays comme le Mexique?
Comme le titre l’indique, il s’agit d’une lutte, et il s’agit en quelque sorte d’une lutte des classes: le conflit entre l’homosexualité, en tant qu’identité moderne et cosmopolite, et la position de classe des hommes gays qui ne peuvent pas se permettre d’être gay. Si la classe sociale est un secret inavouable aux États-Unis, cette relation difficile entre l’identité sexuelle et la position de classe n’est pas un secret au Mexique, pas plus que la manière dont cette relation s’inscrit dans un récit plus large sur la tradition et la modernité.
Les gens racontent une anecdote cruelle qui résume assez bien la logique de ces relations. «Papa», commence un jeune homme sérieux des barrios (quartiers) ouvriers, «j’ai quelque chose à te dire… Je suis gay.» Le père se montre compréhensif, puis se met à poser une série de questions à son fils: «Mais dis-moi, vis-tu dans un quartier branché de la ville? Fais-tu tes achats dans des magasins branchés? Arrives-tu à fréquenter ces boîtes de nuit où ils te font payer 100 pesos l’entrée?» Ce à quoi le fils répond: «Mais bien sûr que non, papa, tu sais bien que je ne peux pas me permettre de telles choses». Vient ensuite la réponse lapidaire du père, une chute brutale: «Je t’aime beaucoup, mon fils, et je regrette d’avoir à te dire cela, mais tu fais fausse route, tu es dans l’erreur. Tu n’es pas gay, tu n’es qu’un putain de pédé [No eres gay, eres solo un pinche puto]».
«Queer», contrairement au mot «Gay», indique un refus d’imaginer la fin de la stigmatisation et du rejet une fois pour toutes.
La première fois que j’ai entendu cette histoire, j’ai sursauté. Mais beaucoup de ce que j’observais sur la scène sociale gay de Puebla commençait à prendre du sens pour moi. Et la façon même dont les caissiers, qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels, se délectent de la cruauté de la chute, nous donne une idée des frustrations plus larges. Ce que cette histoire nous apprend c’est qu’au Mexique, l’homosexualité est considérée comme une identité de la classe moyenne, associée aux accessoires d’un style de vie cosmopolite. Comme le suggère la question du père, il s’agit d’un certain style de vie, d’une manière de s’habiller, d’une soirée amusante dans les clubs, suivie peut-être d’un brunch dominical tranquille et de badinages entre amis. Or, dans un pays où le salaire minimum est de 14,50 USD par jour (et ce, après six augmentations consécutives décidées par l’actuel gouvernement de centre gauche), le prix d’entrée dans les boîtes de nuit en vogue dépasse à lui seul les moyens de beaucoup de gens. Pour les hommes de la classe ouvrière, l’homosexualité n’est donc pas une évidence; c’est un combat, une identité à laquelle on aspire. Et c’est là que l’anecdote prend tout son sens: comment les ressources limitées restreignent les options des hommes de la classe ouvrière et orientent leur vie dans certaines directions, les laissant dans le rôle d’aspirants frustrés à une identité libre et non stigmatisée, mais aussi comment la classe sociale structure les mondes aspirationnels et symboliques des gens. La cruauté de cette anecdote est essentiellement auto-réflexive: le caissier est invariablement dans la même position que le jeune protagoniste, exclu de ce qu’ils perçoivent tous deux comme la bonne vie.
La dynamique des classes divise donc le monde gay?
Oui, exactement. Et au risque de me répéter: lorsque les hommes de la classe ouvrière aspirent à l’homosexualité, à une identité non stigmatisée, à un capital culturel, à la modernité, ils aspirent en fait à une existence de classe moyenne. Comment pourrait-il en être autrement? N’importe qui peut voir que les hommes aisés ont plus de liberté que les hommes démunis; n’importe qui peut voir qu’il est préférable d’être perçu comme «gay» que comme un «puto». Or, les différentes formes de mimétisme ou de simulation — les fausses marques, par exemple — ne peuvent pas transformer une personne de la classe ouvrière en une personne de la classe moyenne, ni un «puto pinche» en un homosexuel. Et c’est bien là que réside la difficulté pour les aspirants homosexuels: ils n’ont pas les moyens matériels d’obtenir ce à quoi ils aspirent. Comme un mirage dans le désert, l’homosexualité leur échappe invariablement.

On pourrait dès lors être tenté de rejeter ces désirs en les considérant comme des erreurs, des leurres ou de l’optimisme malavisé. La théorie queer et ses dérivés offrent de nombreux modèles pour ce type de rejet; je pense en particulier à l’ouvrage de feu Lauren Berlant Cruel Optimism. Ce faisant, je m’engage peut-être sur un terrain glissant, d’autant plus que la critique socialiste a également son mot à dire à ce sujet. Les socialistes pourraient être tentés d’affirmer que ces formes d’aspiration relèvent du consumérisme et renforcent l’idéologie bourgeoise, ou qu’elles se substituent à une véritable perspective de classe ouvrière. Il y a peut-être un certain mérite à cela. Mais les gens luttent avec les ressources dont ils disposent, et non avec celles que nous pourrions souhaiter pour eux. Je ne pense pas qu’il soit utile de déployer, là encore, des théories de la fausse conscience. En réalité, les gens en savent beaucoup sur leur travail, son exploitation et leur position réelle dans le monde.
J’espère que l’on n’en conclura pas que j’encourage une contre-critique faussement populiste du type de celle associée aux années intermédiaires prosaïques des cultural studies. Les hommes à propos desquels j’écris n’aspirent pas seulement à acheter le dernier iPhone ou des vêtements de marque, bien qu’il y ait un peu de cela. Ils ne sont ni dupes des industries culturelles, ni ne réinscrivent et recodent de manière subversive les messages des annonceurs et les objets médiatiques. Leur problème est de ne pas avoir, et non de ne pas comprendre.
De manière plus fondamentale, ils aspirent à des formes de liberté qu’ils ne parviennent pas toujours à articuler de manière claire. Cette aspiration nécessite de l’argent, mais ce n’est pas qu’une question d’argent: ils aspirent à participer à un monde moderne et cosmopolite tridimensionnel où règnent la compréhension éclairée, la liberté personnelle et le confort matériel. N’est-ce pas ce que nous cherchons tous?
Je m’efforce de comprendre avec sympathie comment les gens habitent un quotidien morose et quels sont leurs ressorts pour aspirer à quelque chose d’autre. J’essaie de déterminer comment ces désirs émergent de leur situation particulière. Il est utile de garder à l’esprit l’historicité de ces développements. Si l’homosexualité est une position de sujet bourgeois libéral, héritier des traditions des Lumières, elle est aussi le véhicule d’idéaux et d’aspirations universalistes. Les luttes individuelles et collectives que je documente sont continues et ouvertes. Personne ne peut prédire où elles sont susceptibles de mener les aspirants, que ce soit individuellement ou collectivement.
Variations au sein de la classe ouvrière
Selon l’interprétation populaire, les opinions de la classe ouvrière en matière de sexualité sont généralement conservatrices. Vous semblez ne pas être d’accord avec le fait que nous devrions spontanément penser aux travailleurs de cette manière.
Depuis Max Weber, les théoriciens sociaux pensent que les conditions de classe cultivent inévitablement des dispositions socialement conservatrices au sein des classes populaires et ouvrières. Il n’est pas irrationnel de penser ainsi, surtout si l’on comprend que le sentiment de tradition est ancré dans le type de dynamique de classe décrit par Karl Polanyi et d’autres, où les classes populaires s’intéressent aux façons de faire traditionnelles et consacrées par le temps dans la mesure où elles établissent des barrières contre les innovations économiques qui accélèrent le rythme de l’exploitation.
Les observateurs modernes, y compris les élèves de Pierre Bourdieu, ont diversement étendu cette idée pour suggérer que les travailleurs ont une affinité naturelle pour le conservatisme sexuel, en particulier l’homophobie. Sans parler de la sagesse ambiante des classes moyennes éduquées, qui considèrent invariablement les classes populaires comme «arriérées», certainement sur la question de la tolérance sexuelle, certainement à l’ère de Donald Trump et d’autres démagogues de droite.
Mais il y a tout simplement trop de variations historiques et géographiques pour que nous puissions dire que la classe ouvrière, ou, si vous voulez, les classes populaires au sens large, sont homophobes en raison de quelque chose d’intrinsèque à la structure de la classe. Historiquement, l’on observe de longues périodes pendant lesquelles les classes inférieures semblent avoir été indifférentes à l’interdiction des activités homosexuelles: elles ont détourné le regard; elles ont pratiqué des activités homosexuelles de manière peu discrète ou cachée.
Carlos Monsiváis souligne qu’au Mexique, au XIXe siècle, les histoires d’hommes (en particulier ceux de la classe ouvrière) couchant ensemble pouvaient être racontées sans sourciller. Aujourd’hui, les conceptions de la sexualité varient fortement d’un secteur ouvrier à l’autre, d’une région à l’autre et, au Mexique, d’un village à l’autre. On trouve ici une acceptation relative, là un rejet violent; ici une célébration publique de la diversité sexuelle et de genre, là une condamnation et une mise à l’écart.
Si la religion organisée agit souvent comme un puissant vecteur d’homophobie, dans la pratique, la tradition religieuse n’a pas la même signification pour tout le monde. Quoi qu’en disent les prêtres, il n’y a pas de lien évident entre, par exemple, la vénération de la Vierge de Guadalupe et l’homophobie. Nombreux sont ceux qui nient l’existence d’un lien. (Même les bars et les bains publics gays disposent parfois à l’entrée de sanctuaires ou d’autels consacrés à des saints populaires).
Pourtant, dans l’ensemble, les jeunes des classes populaires et ouvrières du Mexique (et d’autres pays) semblent être particulièrement vulnérables aux pires formes d’homophobie, y compris le rejet de la famille et des actes d’une violence atroce. Je suggère que, plutôt que de naturaliser cette vulnérabilité ou de l’inscrire dans une vision statique de la culture de classe, nous la considérions à la convergence des tendances politico-économiques et sociales.
Il existe un conflit entre l’homosexualité en tant qu’identité cosmopolite et la position de classe des hommes homosexuels qui ne peuvent pas se l’offrir.
Tout d’abord, quatre décennies de néolibéralisme ont rendu plus précaire et plus instable la vie dans les barrios ouvriers et les pueblos (villages) à faibles revenus. La situation s’est considérablement aggravée lorsque Felipe Calderón a tenté de consolider sa présidence après une élection douteuse en 2006 en déclarant la guerre aux narcotrafiquants, déclenchant des vagues de violence qui ne se sont toujours pas calmées. De nouvelles formes de ferveur religieuse — protestantisme évangélique, sectes millénaristes comme les Témoins de Jéhovah, mouvements charismatiques, catholicisme aux valeurs familiales — se sont engouffrées dans la brèche sociale, apportant un semblant de stabilité à des vies déstabilisées, mais aussi un regain d’homophobie et d’intolérance.
De plus, l’enseignement supérieur est associé à des visions du monde socialement libérales, qui offrent une certaine protection contre les pires formes d’homophobie, mais les classes populaires des barrios et des pueblos n’ont au mieux qu’un accès limité aux universités. Pour tenter de rassembler ces facteurs, je m’appuie sur des éléments suggérés par d’autres chercheurs, en particulier par Vivek Chibber: avec la destruction des grandes institutions de la classe ouvrière, telles que les syndicats militants et un pacte social-démocrate-populiste global, qui protégeaient la classe ouvrière des pires tempêtes du développement capitaliste, les travailleurs ont tendance à se replier sur des institutions conservatrices et stabilisatrices telles que la famille, les liens de parenté et la religion. Il n’y a rien de surprenant à cela, mais il ne faut pas non plus y voir une fatalité.
Pour toutes les raisons que j’ai exposées, nous devrions considérer l’intolérance de la classe ouvrière comme une tendance et non comme une règle, un problème qui apparaît dans certaines circonstances et disparaît dans d’autres.
D’une certaine manière, votre livre est une tentative de remettre la classe à l’honneur. Mais pas dans une perspective intersectionnelle. Pourquoi? Ce faisant, n’êtes-vous pas en train d’ajouter la classe sociale au lot, comme une catégorie d’identité de plus parmi tant d’autres?
Il est vrai que j’essaie de réfléchir aux dimensions de l’inégalité qui se chevauchent. Les personnes sur lesquelles j’écris sont homosexuelles, de sexe masculin, à la peau foncée, indigènes ou depuis peu, d’ascendance mixte; certaines viennent de zones rurales ou de petites villes. Elles sont aussi majoritairement issues de la classe ouvrière. Je m’efforce d’être attentif à la spécificité de ces facteurs, en les prenant tous en compte et en décrivant leurs effets sur les expériences des sujets. J’analyse également certaines des façons dont l’interdiction sexuelle, la race/l’ethnicité, etc. s’imbriquent dans des systèmes sociaux plus larges. Les conditions sembleraient réunies pour un traitement identitaire, a fortiori intersectionnel.
Cependant, les différents éléments en jeu ici n’ont pas le même poids, chacun contribuant pour une force égale dans une somme calculable de la position de chaque personne dans un système d’inégalité sociale, et ils ne sont pas non plus tous de la même substance. Et surtout, l’un d’entre eux n’est pas comme les autres. La classe n’est pas une identité: elle ne dépend aucunement de l’«ascription», pour reprendre le terme d’Adolph Reed Jr. Il ne s’agit pas d’un statut civique ou d’un produit idéologique, mais d’une relation de production, d’une situation objective inéluctablement structurée par les forces productives. Contrairement aux autres formes d’inégalité en jeu, la classe est donc une caractéristique nécessaire, et non contingente, du système capitaliste, qui divise le monde en propriétaires et en travailleurs.
Des notions telles que le capitalisme racial font invariablement une (mauvaise) lecture de la notion d’ascription dans la dynamique du système capitaliste, y retrouvant ce qu’elles ont déjà postulé. Cette erreur de diagnostic oblige à conclure que le capitalisme requiert forcément le racisme et l’inégalité raciale. Les théoriciens queer, lorsqu’ils abordent ces questions, procèdent de la même manière, en associant le mode de production (les lois de la production économique sous le capitalisme) au mode de reproduction sociale (l’évolution des institutions du mariage, de la famille, de la parenté) afin d’affirmer que le capitalisme requiert l’homophobie.
Il s’agit là aussi d’un postulat erroné, rendu évident à une époque où la «diversité» représente le visage humain du néolibéralisme, comme l’ont montré Nancy Fraser et Walter Benn Michaels. L’intersectionnalité et la critique «queer-of-color» s’appuient sur ces fondements théoriques précaires. Les ouvrages qui ont donné naissance à ces concepts ne m’ont pas beaucoup aidé à comprendre les difficultés de mes sujets, alors qu’ils luttent contre diverses formes d’inégalité dans le cadre des contraintes de classe, et encore moins l’architectonique de l’inégalité dans des formations sociales en pleine évolution.
Aussi me suis-je efforcé d’apporter à ce matériel un sens plus profond de l’historicité que ce qui est modélisé dans la plupart des approches intersectionnelles, qui ressemblent trop souvent à des tabulations mécanistes, à l’addition d’une identité prédéfinie avec une autre dans des cadres inessentiellement statiques. La meilleure approche, telle que je la conçois, consiste à faire preuve d’une grande fluidité dans nos analyses, à essayer de comprendre comment les identités apparaissent ou disparaissent au gré de l’évolution des horizons politico-économiques.
J’écris donc sur la manière dont l’homosexualité moderne a vu le jour au Mexique au début du vingtième siècle dans des conditions de lutte des classes et de nervosité quant à la stabilité de l’ordre social, ainsi que sur la manière dont les identités homosexuelles ultérieures ont été façonnées et refaçonnées dans des conditions politico-économiques changeantes, depuis le déclin de la dictature de centre gauche jusqu’à l’avènement de la démocratie néolibérale.
Mais comment aborder la politique sexuelle dans une perspective socialiste?
J’essaie de garder à l’esprit la phrase d’Eric Hobsbawm dans son essai de 1996 sur le socialisme et la politique de l’identité: le socialisme n’est pas l’apanage des Noirs, des homosexuels, des Latinos ou de tout autre secteur ou groupe spécifique. Le socialisme est pour tous. Il n’est même pas l’apanage des travailleurs. Bien que les partis et mouvements socialistes soient historiquement basés sur la classe ouvrière, l’attrait du socialisme, à son apogée, était plus large. Les revendications de la classe ouvrière ont pris des formes très larges qui ont également bénéficié du soutien des chômeurs et des personnes économiquement marginales, des petits vendeurs, des professionnels de la classe moyenne et d’autres secteurs sociaux.
Au Mexique, l’homosexualité est considérée comme une identité de la classe moyenne, associée au style de vie cosmopolite.
Par contraste avec cette approche universaliste, voilà maintenant cinquante ans que nous essayons de construire une politique socialiste sous la forme d’une coalition ad hoc de mouvements minoritaires qui font de l’identité le fondement de la lutte. Les résultats n’ont pas été impressionnants. Les revendications particularistes ne débouchent jamais sur des principes universalistes; elles ne prennent jamais la forme de revendications susceptibles d’endiguer le creusement des inégalités. Elles ne répondent donc que rarement aux besoins réels de la majorité des personnes que les mouvements sociaux prétendent représenter.
En définitive, le libéralisme militant — que beaucoup confondent aujourd’hui avec le socialisme — se révèle incontestablement plus efficace dans le domaine de la politique des groupes d’intérêt. Reconnaissons que cette approche a permis d’obtenir certains résultats concrets, notamment en démantelant des formes de discrimination sanctionnées par la loi. Mais au-delà de ces réformes importantes, les droits accordés au coup par coup au nom de l’identité ont eu des résultats mitigés.
Le droit au mariage, par exemple, est universel en principe, mais dans la pratique, la jouissance de ce droit par les homosexuels se concentre au sein des classes moyennes et supérieures — étant donné que les circonstances matérielles des classes populaires les empêchent de l’exercer. Cela fait partie d’une vieille histoire d’égalité formelle, de droits libéraux — en quelque sorte, la toile de fond de tout le livre.
Là encore, je pense qu’il est important de rompre avec les habitudes de pensée acquises par les universitaires et les militants des ONG, qui se sont alignés sur les principes libéraux et non socialistes. Si le «tout le monde» du socialisme est universel et inclusif, alors l’approche de la sexualité — et de la race, de l’ethnicité et d’autres questions identifiées avec la politique de l’identité — devrait consister à rechercher des intérêts partagés et des besoins communs dans tous les secteurs des classes ouvrières et populaires. Nous devons poursuivre, autant que possible, une vision du bien commun.
Par exemple, si les personnes à la peau plus foncée sont entassées au bas de l’échelle économique, la solution consiste à augmenter les salaires des travailleurs non qualifiés, à relever le plancher social, à fournir un accès sans entrave aux soins de santé et à l’éducation, notamment. De même, si les homosexuels d’aujourd’hui ne peuvent se construire une vie décente en raison des mêmes conditions d’impuissance et de pénurie artificielle qui affectent les classes populaires et ouvrières en général, la voie à suivre ne consiste pas à formuler de nouvelles revendications particularistes, mais à étendre les droits universels aux soins de santé, au logement, à des salaires décents, à l’éducation et aux avantages sociaux, et à donner aux travailleurs plus de pouvoir sur leur lieu de travail et au sein de la société dans son ensemble.
Certains se demanderont si cette approche tient réellement compte de la spécificité des expériences homosexuelles. Je répondrai de la manière suivante: je crois en la créativité humaine et je suis donc optimiste par rapport au fait que si ces conditions nous étaient données, nous pourrions construire des vies meilleures, plus heureuses, plus intégrées et plus gaies pour nous-mêmes et pour les autres. Nous pourrions alors décider, sans présupposé ni contrainte, si le mariage ou un autre arrangement institutionnel répond le mieux à nos besoins et à nos désirs. Nous disposerions aussi d’armes plus efficaces pour lutter contre les formes résiduelles de préjugés (racisme et homophobie).
homophobie).
Il ne fait aucun doute que mes propos seront sujets à controverses. Aucune approche ne répondra précisément à tous les problèmes ou à toutes les revendications imaginables. Une approche socialiste universaliste s’avérera toutefois plus inclusive — et en définitive plus efficace — que les droits particularistes libéraux fondés sur l’identité.




