Le véritable coupable est la diminution de la capacité de production, causée par quatre décennies de politiques néolibérales. Cette diminution est le revers de la médaille de la financiarisation croissante.

Le récent discours du président de la Réserve fédérale1 Jerome Powell à la conférence de Jackson Hole, prononcé devant un public de banquiers du monde entier, était un événement très attendu. Il s’y est présenté la queue entre les jambes, ayant précédemment affirmé que l’inflation américaine était un phénomène transitoire, tout en mettant en œuvre les politiques monétaires laxistes2 qui, aux yeux de beaucoup, l’ont récemment accrue. Va-t-il maintenant réussir un « atterrissage en douceur », en ramenant l’inflation de son niveau le plus élevé depuis quarante ans, à savoir 9,1 %, au niveau souhaité de 2 %, sans provoquer de récession ?
Les banques centrales disposent de plusieurs outils pour gérer l’inflation : des taux plus élevés, un resserrement quantitatif (c’est-à-dire la vente d’actifs pour réduire les liquidités dans le système) et la gestion des attentes concernant la politique monétaire future, par le biais de « forward guidance » [ndlt : outil utilisé par les banques centrales afin d’influer sur les anticipations des agents économiques]. Powell a commencé à relever le taux directeur en mars, le faisant passer du niveau le plus bas, soit 0,25 %, qui avait été fixé pendant la pandémie, à 3,25 % au moment de son arrivée à Jackson Hole, fin août, par une série de hausses progressives.
Les faucons ont tort de considérer l’inflation comme un problème monétaire. Les colombes se trompent en considérant l’augmentation des prix comme un facteur déterminant.
Pourtant, ces augmentations ont laissé le taux global bien en dessous de l’inflation, rendant les taux réels négatifs. Pendant ce temps, le débat sur la politique monétaire s’est intensifié. Larry Summers, le faucon3 de l’inflation, a accusé Powell de sous-estimer le problème et d’agir trop peu et trop tard. Un autre faucon, Henry Kaufman, lui a conseillé de choquer les marchés – de leur « mettre une bonne gifle » comme l’avait fait Paul Volcker, alors président de la Réserve fédérale, en 1980, en relevant les taux d’intérêt à 20 %.
En provoquant une récession profonde et prolongée, la décision de Volcker a suscité une réaction négative de la part des économistes progressistes. L’économiste Robert Solow l’a même comparée à l’explosion d’une bombe pour tuer une mouche. Aujourd’hui, la perspective d’une hausse similaire a suscité une nouvelle critique de la perspective monétariste qui considère l’inflation comme le résultat d’une augmentation de la masse monétaire par rapport à la production.
Pour les colombes de l’inflation, comme l’ancien secrétaire d’État au travail de Clinton, Robert Reich, la période actuelle d’inflation n’a pas été causée par les stimuli fiscaux et monétaires de la pandémie, même s’ils étaient sans précédent. Elle n’est pas non plus le résultat d’une envolée au niveau des salaires et des prix, puisque la hausse de l’activité syndicale reste relativement modeste d’un point de vue historique4. Les colombes affirment que l’inflation est plutôt le résultat de facteurs qui échappent au contrôle de la Réserve fédérale : la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants provoquée par la guerre en Ukraine, ainsi que les prix abusifs pratiqués par les grandes entreprises. Elle ne peut donc pas être résolue par une hausse des taux d’intérêt ; elle nécessite des solutions comme celles énoncées dans l’Emergency Price Stabilization Act : la surveillance et la régulation des prix à la consomma- tion, parallèlement à des mesures visant à préserver l’approvisionnement en biens et services essentiels5.
Les faucons ont évidemment tort de considérer l’inflation comme un problème purement monétaire. En effet, une très faible partie des mesures de relance liées à la pandémie, qu’elles soient fiscales ou monétaires, a atterri dans les poches des citoyens ordinaires. Et quand cela a été le cas, cet argent a été consacré en grande partie au remboursement de la dette et a eu un impact limité sur la demande. Pourtant, les colombes se trompent également en considérant les prix des denrées alimentaires et des carburants induits par la guerre comme un facteur déterminant. Aux États-Unis, le taux d’inflation de 8,3 % en août 2022 a peut-être été stimulé par ces facteurs ; mais le chiffre de l’inflation de base de 6,3 % — bien plus élevé que la moyenne européenne — reflète un mal structurel.
Le véritable coupable
Le véritable coupable est la diminution de la capacité de production des États-Unis, causée par quatre décennies de politiques néolibérales (de désinvestissement, déréglementation, externalisation) qui ont rendu l’économie extrêmement vulnérable aux perturbations de la chaîne d’approvisionne- ment et empêché toute mesure visant à faire baisser les prix.
Cette diminution est le revers de la médaille de l’activité financière en croissance constante depuis le début des années 1980. Ce processus est généralement appelé « financiarisation », même si le pluriel « financiarisations » serait plus exact. Chaque expansion historique du secteur financier a en effet impliqué des structures, des pratiques, des régimes réglementaires et des actifs différents. Au cours des dernières décennies, la financiarisation s’est appuyée sur des bulles d’actifs soutenues par une politique monétaire laxiste. Cela a créé les conditions de l’augmentation des prix d’aujourd’hui, tout en empêchant le seul type de politique anti-inflationniste dont le système actuel est capable. Pourtant, cette dynamique cruciale est négligée par les économistes de tout le spectre politique.
À première vue, les faucons et les colombes se situent aux deux extrémités du « double mandat » que la Réserve fédérale a acquis en 1977, lorsque la loi Humphrey-Hawkins a ajouté des niveaux d’emploi élevés à son mandat initial de stabilité des prix. Certains économistes progressistes considèrent aujourd’hui le mandat du président Alan Greenspan dans les années 1990 comme « un modèle instructif de ce que peut être une économie de plein emploi », ce qui implique que la direction actuelle de la Réserve fédérale peut et doit revenir à ce paradigme6.
Pourtant, le mandat de plein emploi – un dernier souffle de keynésianisme dans un environnement politique de plus en plus hostile – n’a jamais été pris au sérieux. En effet, Volcker a commencé à le piétiner presque immédiatement avec ses hausses de taux historiques. Depuis lors, la Réserve fédérale a constamment freiné l’emploi et les salaires, même si cela a souvent été masqué par le gonflement statistique des chiffres de l’emploi (par exemple, en comptant les personnes travaillant à temps partiel tout en ignorant la baisse de la participation à la population active)7.
La Réserve fédérale se retrouve à une intersection de taille : les deux voies mènent à une baisse des revenus et du bien-être de la classe travailleuse.
Greenspan a pris la terrible décision d’augmenter les taux d’intérêt malgré un niveau d’inflation modeste. Pour justifier cette mesure, il a cité le partisan du néolibéralisme Milton Friedman qui se plaignait que la Réserve fédérale relevait toujours les taux d’intérêt trop tard, et insistait plutôt pour « prendre de l’avance », en anticipant l’inflation plutôt qu’en y répondant. Greenspan a ainsi mis fin à la relance naissante du secteur manufacturier qui, comme l’écrit Robert Brenner, laissait entrevoir la possibilité d’une « sortie de la stagnation »8. Lorsque Greenspan a finalement décidé d’assouplir la politique monétaire, ce n’était pas pour soutenir l’expansion de la production et de l’emploi, mais pour gonfler les bulles d’actifs, à commencer par le fameux « Greenspan put » : une injection de liquidités dans le système financier en réponse au krach boursier de 1987.
Cette politique (poursuivie par les successeurs de Greenspan) a généré une spéculation sans limites pour le secteur financier en pleine déréglementation. Cela a fourni des liquidités en abondance après chaque crash qui était inévitable. Elle a été critiquée à juste titre pour avoir créé un danger moral systémique en incitant les institutions financières à augmenter leur exposition au risque.
Dans les années 2000, les bulles d’actifs ont atteint de nouveaux sommets et la politique monétaire souple est devenue une stratégie permanente plutôt qu’une solution épisodique. Pourtant, comme seule une faible partie de cet argent s’est retrouvée dans des investissements productifs ou a engendré une hausse de la demande, son effet sur l’inflation a été négligeable. En outre, d’autres tendances récurrentes ont maintenu l’inflation à un faible niveau : les travailleurs étaient trop peu confiants pour se battre et obtenir des augmentations de salaire, même dans un contexte d’emploi relativement élevé ; les chaînes d’approvisionnement manufacturières se sont étendues à des producteurs situés dans des endroits où les salaires sont plus bas ; l’immigration a rendu les services moins chers ; et la déflation des revenus dans le tiers monde a réduit la demande mondiale et les prix des produits de base9.
La surévaluation du dollar était également profondément liée aux bulles de la Réserve fédérale. En détournant les fonds investis de l’investissement productif vers l’investissement financier, ces bulles – les valeurs boursières des années 1990, l’immobilier et le crédit des années 2000, l’« Everything Bubble » des années 2010 – ont attiré suffisamment de fonds étrangers vers les actifs libellés en dollars pour contrer la pression à la baisse des déficits courants américains sur le dollar. Cela a également contribué à contenir l’inflation.
Depuis que Greenspan a abaissé les taux d’intérêt pour faire face à la bulle Internet de 2000, ils n’ont jamais retrouvé leur niveau record des années 1990. Pendant ce temps, l’assouplissement quantitatif – c’est-à-dire les achats d’actifs de la Réserve fédérale – est devenu un impératif systémique pour maintenir les marchés d’actifs et le dollar à un niveau élevé. La politique budgétaire étant largement absente (hormis les réductions d’impôts pour les riches), cette politique monétaire a créé une économie politique très particulière. Grâce au déclin de l’industrie, à la faiblesse des investissements et à l’austérité budgétaire, la consommation d’une couche aisée de plus en plus restreinte, facilitée par les « effets de richesse » des bulles d’actifs, est devenue le principal moteur économique du pays. C’est ainsi que le capita- lisme américain contemporain se retrouve uniquement capable de gérer une croissance anémique et des inégalités extrêmes.
Si les colombes soulignent à juste titre la nécessité d’accroître la production, elles ne mesurent pas l’ampleur de l’intervention de l’État que cela impliquerait.
Dans ce contexte, la priorité de Powell est d’éviter les hausses de taux à la Volcker, qui pour- raient se greffer sur les légères augmentations de taux, et de compter sur la « forward guidance ». Pourquoi ? Parce qu’une hausse des taux – la seule arme efficace contre l’inflation du point de vue de la politique monétaire — ferait éclater les bulles d’actifs dont dépendent le secteur financier et les ultra-riches américains. À la fin des années 1970, Volcker n’avait pas à s’inquiéter de ce risque, mais au début des années 2020, Powell doit bel et bien s’en préoccuper. Les taux d’intérêt directeurs
de 5 % ont déclenché l’effondrement des bulles du logement et du crédit en 2007 ; le taux actuel de 3,25 % a frappé l’immobilier et le capital-risque, tandis que les actions ont subi la pire série de pertes trimestrielles depuis 2008. Compte tenu de la fragilité de l’économie américaine, les hausses de taux constituent un risque réel, ce qui signifie que la Réserve fédérale est devenue complètement impuissante. Pas étonnant qu’elle soit décrite dans les pages du Financial Times comme « la Fed la moins crédible dans l’estimation des marchés depuis les années 1970 ».
Un programme mené par l’État
Le manque de confiance des marchés reflète un dilemme structurel. Si Powell augmente les taux aux niveaux requis, les États-Unis peuvent s’attendre à une récession qui fera passer celle des années 1980 pour un boom. Mais si, comme je le pense, il refuse de le faire, les États-Unis peuvent s’attendre à une inflation chronique qui trouve son origine dans la faiblesse productive de l’économie américaine, récemment exacerbée par la rupture de la chaîne d’approvisionnement, les guerres commerciales et technologiques avec la Chine et les sanctions autodestructrices contre la Russie. La Réserve fédérale se retrouve à une intersection de taille : les deux voies mènent à une baisse des revenus et du bien-être de la classe travailleuse.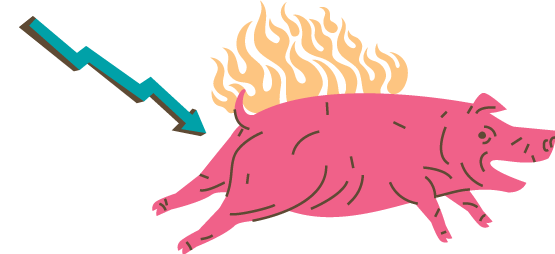
En ce sens, les faucons comme les colombes se voilent la face devant les financiarisations soutenues par l’argent facile. La dynamique de la financiarisation contribue à l’inflation en augmentant la valeur des logements et des produits de base tout en permettant aux riches de maintenir leurs dépenses à des prix gonflés. Si les colombes soulignent à juste titre la nécessité d’accroître la production pour réduire l’inflation, elles ne mesurent pas l’ampleur de l’intervention de l’État que cela impliquerait.
Pendant quatre longues décennies, les politiques néolibérales ont bien établi un long ralentissement, renversant le vieil adage de Janos Kornai selon lequel le socialisme est un système où l’offre est limitée alors que le capitalisme est un système où la demande est limitée. Rendre le capitalisme américain contemporain à nouveau productif impliquerait non seulement de renverser la logique de la financiarisation, mais aussi de mettre en place un programme étatique visant à lever les contraintes d’approvisionnement, ce qui est presque impensable dans le cadre des paramètres du système actuel10.
Traduction du texte de Radhika Desai, « Vectors of Inflation », New Left Review, 6 octobre 2022.
Footnotes
- La Federal Reserve Bank of the United States, ou Fed en abrégé, est la banque centrale des États-Unis.
- Une politique monétaire laxe tente d’accroître la demande et la volonté d’investir en augmentant le volume d’argent en circulation et en abaissant les taux d’intérêt.
- Pour un «faucon», la principale responsabilité de la banque centrale est la stabilité des prix et donc la prévention de l’inflation. D’autres objectifs sociétaux, comme le maintien des niveaux d’emploi et des salaires, doivent lui être subordonnés. Les «colombes» adoptent la position inverse.
- Gabriel Winant, « Strike Wave », Sidecar, 25 novembre 2021.
- « NEWS: Rep. Jamaal Bowman Introduces Emergency Price Stabilization Act », Jamaal Bowman Press Releases, 4 août 2022.
- Dean Baker, Sarah Rawlins et David Stein, « The Full Employment Mandate of the Federal Reserve: Its Origins and Importance », Center for Economic and Policy Research, 11 juillet 2017.
- Voyez Stephen Kent, « The problem with our employment stats », The Hill, 11 décembre 2021, et Michael R. Strain, « What’s Hollowing Out the US Workforce? », Project Syndicate, 22 août 2022.
- Zie Robert Brenner, « What is good for Goldman Sachs is good for America: the origins of the current crisis », Verso, 13 novembre 2018.
- Utsa Patnaik et Prabhat Patnaik, A Theory of Imperialism, Columbia University Press, 2016.
- Robert Brenner, « Introducing Catalyst », Catalyst, Vol. 1, nr 1, 2017.




