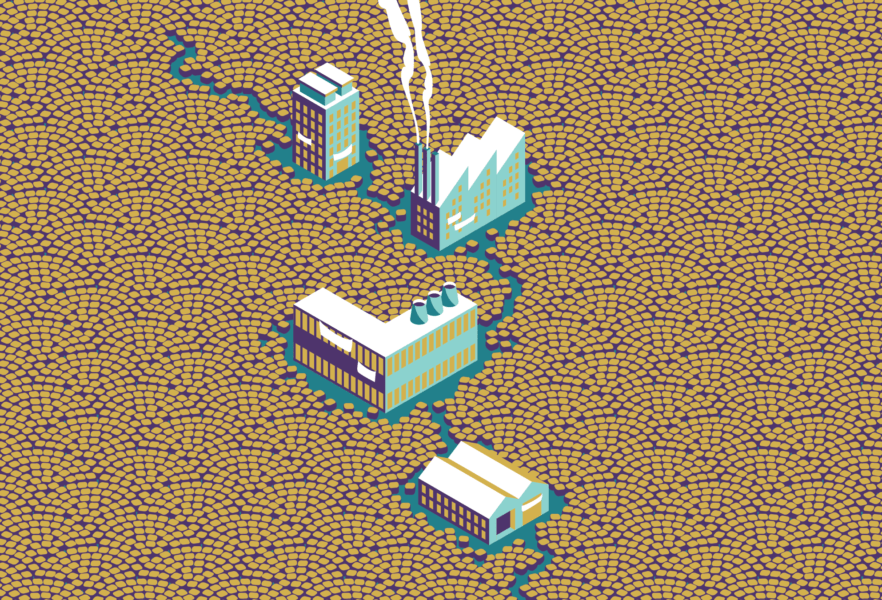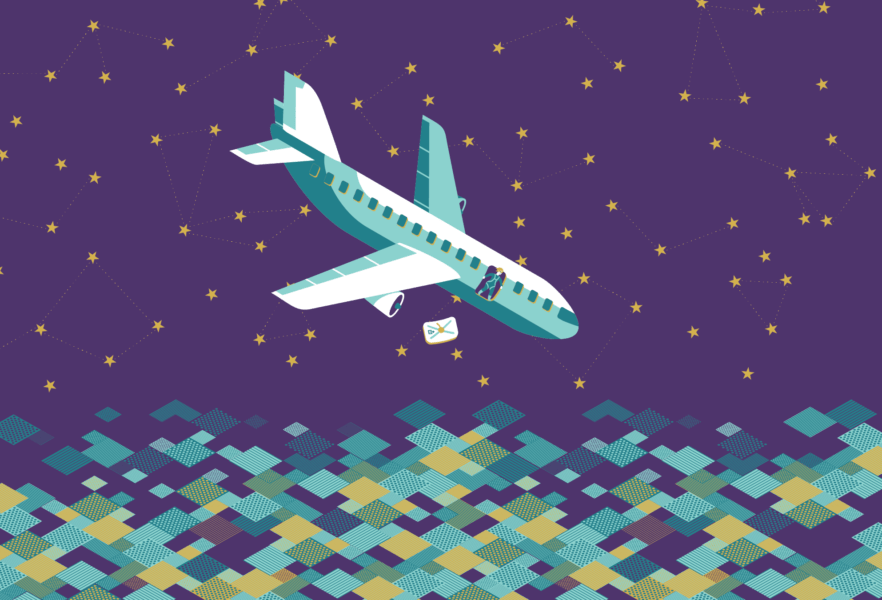Dans Contre les élections, David Van Reybrouck préconise le tirage au sort en guise de solution à ce qu’il appelle le « syndrome de fatigue démocratique ». Mais sa solution pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

« Nous sommes en train de détruire notre démocratie en la limitant aux élections, et ce, alors que ces mêmes élections n’ont jamais été conçues comme un instrument démocratique », explique David Van Reybrouck. Son essai, Contre les élections1, a été traduit en plus de vingt langues. Successivement, l’auteur commente les symptômes, le diagnostic et la genèse de la crise que traverse la démocratie, pour proposer finalement une alternative osée : le tirage au sort.

Il a reçu de nombreux prix littéraires.
« Il se passe une chose bizarre avec la démocratie : tout le monde semble y aspirer, mais plus personne n’y croit. »2 C’est ainsi que commence l’essai. Il y mentionne notamment l’enquête du World Values Survey. Dans 57 pays, plus de 90 % de la population estime que la démocratie est la meilleure manière de diriger un pays, mais la confiance dans les démocraties régresse à vue d’œil. La confiance dans les partis politiques, gouvernements et parlements est à un niveau historiquement bas ; la participation électorale est en chute libre et le désintérêt des électeurs augmente ; de moins en moins de gens sont membres d’un parti politique. De même, la formation d’un gouvernement requiert de plus en plus de temps et les partis politiques sont de plus en plus sanctionnés lors des élections suivantes et gouverner devient de plus en plus difficile. En outre, en ces temps de globalisation, l’État-nation est de plus en plus impuissant face à des problèmes tels que le changement climatique, la migration ou la crise économique.
Afin de camoufler cette impuissance, les hommes politiques préfèrent alors se tourner vers la mise en lumière de dossiers symboliques triviaux. Cet « incidentalisme » va de pair avec une fièvre électorale chronique. En recourant au terme « syndrome de fatigue démocratique », Van Reybrouck donne un nom à une réalité reconnaissable pour beaucoup. Des auteurs comme Anthony Barnett, Luc Huyse, Cas Mudde et Colin Crouch ont fait des constatations similaires »3. Avec quelques légères différences, ces auteurs pointent du doigt la globalisation, l’évolution des médias, l’intégration européenne ou la disparition des piliers. Colin Crouch parle de « post-démocratie ». Vu la confusion d’intérêts entre la politique et la vie des entreprises et le consensus néolibéral, la démocratie s’érode.
Ce n’est pas l’approche adoptée par David Van Reybrouck. Pour lui, la démocratie est la moins mauvaise de toutes les formes de gouvernement, parce qu’elle maintient un équilibre dynamique entre la légitimité et l’efficience. La crise des démocraties occidentales consiste, selon lui, en ce qu’elles sont actuellement confrontées à une crise de légitimité ainsi qu’à une crise d’efficience. Cette thèse suscite déjà davantage de questions qu’elle n’offre de réponses. « L’efficacité » rend elle les hommes politiques légitimes ? Ce qui, pour un groupe de la société, est très efficient ou légitime, peut s’avérer néfaste pour un autre groupe.
Plus important que ce qui est dit, ici, c’est le non-dit. Le regard de Van Reybrouck sur la démocratie est étonnamment formel et apolitique. Il se tourne de façon unilatérale sur la gestion et la procédure. Pas un mot sur le pouvoir du peuple, rule by the demos, la souveraineté populaire. Partis politiques et organisations du monde associatif sont absents de son analyse. De sa façon de poser le problème est également absent le contexte socioéconomique. Il ne se penche aucunement sur le fait que la démocratie prend fin aux portes des entreprises, que l’inégalité croissante est également un problème démocratique ou qu’il existe un lien entre la crise démocratique et la crise économique. Van Reybrouck a le grand mérite de problématiser le système parlementaire et de rendre cette donnée discutable, mais sa définition formaliste de la démocratie aura un grand impact sur le reste de son analyse.
En quête d’un diagnostic
Après que Van Reybrouck a rassemblé les symptômes du « syndrome de fatigue démocratique », il se met en quête d’un diagnostic. Il distingue en gros trois analyses et en ajoute une quatrième, la sienne.
Le premier diagnostic est celui du populisme. Il situe la cause dans la légitimité. Les hommes politiques sont des profiteurs, des gens qui se remplissent les poches en restant étrangers au monde. La solution est aussi simple que la cause : d’autres hommes politiques, meilleurs. Mais le peuple monolithique que prétendent représenter des hommes politiques populistes comme Geert Wilders, Nigel Farage ou Beppe Grillo n’existe pas et le bon sens rassis qu’ils prétendent traduire n’est rien moins qu’une idéologie qui refuse de voir leur propre idéologie.
Le deuxième diagnostic est celui des technocrates. Ceux-ci situent le problème du côté de l’efficience. Le pouvoir doit être repris par des experts comme Mario Monti en Italie ou par des institutions internationales comme le Fonds monétaire international ( FMI ) et la Banque centrale européenne ( BCE ). Les technocrates font le contraire des populistes, estime Van Reybrouck. Ils essaient de remédier au syndrome de fatigue démocratique en faisant passer l’efficience devant la légitimité.
Au lieu de remettre en question le cadre dominant, le G1000 a surtout abouti à une reconfirmation du bon sens raisonné néolibéral.
Le troisième diagnostic vient des partisans de la démocratie directe. Ces derniers perçoivent la démocratie représentative comme constituant le problème. En Espagne, il y a eu les Indignados. « Nos représentants ne nous représentent pas », pouvait-on entendre de New York à Bruxelles. Mais la démocratie directe devenait un but en soi. « Le processus est le message », disaient les protestataires d’Occupy Wall Street. Occupy mettait le doigt sur le malaise, mais n’apportait aucun remède.
Aucun de ces diagnostics ne propose de perspective claire. Un nouveau diagnostic est donc nécessaire. Selon Van Reybrouck, le problème se situe dans les élections mêmes : « Nous sommes tous devenus des fondamentalistes des élections. »4 Nous partons du principe que nos dogmes ont toujours prévalu et que, de ce fait, ils prévaudront éternellement. Eh bien, non. Selon Van Reybrouck, voilà 3 000 ans déjà que nous faisons l’expérience de la démocratie, alors que les élections n’ont fait leur apparition que voici deux siècles environ. Les élections ne sont pas adaptées au nouveau contexte dans lequel nous évoluons vers une société horizontale, alors que les élections sont toujours un modèle vertical.
Le tirage au sort en guise de solution
Pour la solution, Van Reybrouck s’inspire des travaux du politologue et spécialiste de la communication américain James Fishkin. D’après ce dernier, au lieu d’être un consommateur passif de slogans politiques commercialisés, le citoyen doit de nouveau recevoir une place centrale dans la démocratie. Il doit pouvoir entrer en débat avec d’autres citoyens et experts. Et une façon d’organiser un tel débat consiste à recourir à un tirage au sort. Et Fishkin a été suivi. En divers endroits, on s’est mis à expérimenter au moyen de panels citoyens tirés au sort et de formes alternatives de participation. Dans les provinces canadiennes de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, de même qu’aux Pays-Bas, on a tiré au sort des citoyens en vue de la réforme du système électoral. En Irlande et en Islande, ce sont des citoyens tirés au sort qui se sont penchés sur la constitution.
Ce qui rend la volonté générale n’est pas selon Rousseau le nombre de voix, mais l’intérêt commun qui les unit.
En Belgique, Van Reybrouck lui-même a organisé une tentative de renouveau démocratique au moyen d’une expérimentation censée faciliter la participation directe des citoyens : le G10005. Durant la plus longue formation de gouvernement de l’histoire de Belgique, il a rassemblé des citoyens tirés au sort afin qu’ils élaborent des propositions autour d’un certain nombre de sujets. Les résultats de cette expérience suscitent de sérieuses questions. Au lieu de remettre en question le cadre dominant, le G1000 a surtout abouti à une reconfirmation du bon sens raisonné néolibéral. Ainsi, le G1000 proposait de réduire les coûts salariaux parce que cette réduction améliorerait la compétitivité des entreprises. En outre, il estime que « l’essentiel est d’accroître la flexibilité du marché de l’emploi, de façon que les forces de travail puissent se mouvoir avec plus de souplesse entre diverses entreprises et organisations ». Et, plus loin : « Pour éviter que seule l’actuelle génération active doive porter les lourdes charges du vieillissement, le marché de l’emploi doit être plus ouvert aux pensionnés. » Le résultat, en d’autres termes, est une proposition de faire travailler tout le monde meilleur marché, de façon plus flexible et plus longtemps. Cela explique clairement, du coup, pourquoi la Commission européenne a estimé excellente l’idée de mettre sur pied un projet similaire, Europe 1000. Elle dispose en même temps d’une réponse aux questions sur le manque de légitimité démocratique.
Que de tels projets aient abouti à une reconfirmation des vieux clichés néolibéraux n’est pas un hasard. Cela ressemble bien à un exemple-école de ce que Karl Marx résumait déjà par sa phrase clé : « Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. »6 Outre le fait que la classe dirigeante règle la production et la distribution des marchandises économiques, elle se charge également de l’organisation et de la diffusion des idées. « Autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du même coup, des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l’un dans l’autre, les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du même coup à cette classe dominante. »
Le marxiste italien Antonio Gramsci a poursuivi l’élaboration de ce qui précède. La conception du monde des classes opprimées est fragmentée. D’une part, on a des conceptions implicites qui s’expriment dans la façon dont on agit. Tant dans le travail que dans la lutte, la population laborieuse est renvoyée à elle-même, elle doit être solidaire. La conscience qui est comprise dans l’action est ce que Gramsci qualifie de « bon sens »7. Par ailleurs, pour expliciter ces conceptions, on doit souvent faire appel à des concepts de la classe dirigeante. C’est ce que Gramsci appelle « la pensée quotidienne ». Dans son récent ouvrage, Let op je woorden8 ( Faites attention aux termes que vous utilisez ), Jan Blommaert insiste sur le fait que des termes comme pression fiscale, position concurrentielle ou coût salarial ne sont pas neutres. Pour qui le salaire est-il un coût ? Pour le patron. C’est l’ouvrier qui fournit le travail. Pourtant, c’est lui que nous appelons le travailleur ( werknemer en néerlandais = preneur de travail ) alors que nous appelons le capitaliste l’employeur ( werkgever en néerlandais = le donneur d’emploi ).
Ce n’est selon Gramsci que par l’approfondissement et l’explicitation du « bon sens » que l’émancipation est possible. Cela se fait en premier lieu dans la lutte. L’histoire a déjà montré à maintes reprises que la lutte est la meilleure garantie, pour la création d’institutions démocratiques. Les syndicats – les plus importants représentants démocratiques de la population laborieuse – ne sont pas nés du néant, mais se sont constitués dans la lutte sociale pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Le monde associatif social ne s’est uni en Tout Autre Chose/Hart Boven Hard qu’en guise de réaction à la politique d’économies annoncée par le gouvernement flamand et il est issu de la conscience qu’ensemble, ces mêmes associations seraient plus fortes dans la lutte contre ces mesures.
Le « bon sens » est toutefois toujours partagé et, partant, elle va à l’encontre du regard individualiste de Van Reybrouck dans lequel les individus choisis doivent discuter leurs idées et préférences individuelles. Il y a une grande différence entre un projet partagé activement et une répartition des préférences individuelles d’autre part. Le premier est ce que Rousseau appelle la volonté générale. Le second est la volonté de tous, la volonté des individus9. Ce qui rend la volonté générale n’est pas selon Rousseau le nombre de voix, mais l’intérêt commun qui les unit. Les acquis sociaux et démocratiques comme la sécurité sociale ou le droit d’association sont issus d’une lutte qui s’appuyait sur un intérêt commun. Ils ne sont pas apparus suite à des élections et ne seraient pas apparus non plus par le biais d’un tirage au sort.
Une démocratie formelle ou substantielle
Qu’élections et démocratie ne sont pas des synonymes, l’histoire d’Athènes dans l’Antiquité le prouve, selon Van Reybrouck. Dans ce qu’il appelle le berceau de la démocratie, on ne travaillait en effet pas avec des élections, mais bien avec un tirage au sort. Aristote disait même que le tirage au sort était démocratique, alors que les élections étaient oligarchiques. Dans le tirage au sort, d’ailleurs, il n’y a pas de distinction entre dirigeants et dirigés. L’une des caractéristiques de la liberté est, entre autres, que tour à tour on est gouverneur et gouverné soi-même. Les Grecs n’étaient pas les seuls à avoir ces idées. À Venise ( 1268 ) et Florence ( 1328 ), on a opéré selon un tirage au sort. Van Reybrouck est naturellement bien conscient que, de la sorte, seul un petit groupe très limité entrait en ligne de compte pour être tiré au sort, mais ce qui l’intéresse, une fois de plus, c’est uniquement la procédure. Même les philosophes des Lumières, comme Montesquieu et Rousseau, ont répété l’analyse d’Aristote : le tirage au sort ressortit à la démocratie, les élections à l’aristocratie.
Il ne suffit pas de remplacer l’actuelle caste élue d’hommes politiques par une nouvelle caste tirée au sort.
« Les leaders révolutionnaires en France et aux États-Unis n’avaient aucun attrait pour le tirage au sort parce qu’ils n’en avaient pas pour la démocratie »10, déclare Van Reybrouck de façon assez étonnante. Après la révolution, la nouvelle élite bourgeoise entendait surtout assurer ses propres intérêts. Aussi ce ne fut pas un hasard si la majeure partie de la population dut encore attendre très longtemps le droit de vote.
Van Reybrouck insiste sur le fait qu’il s’en faut de beaucoup que tous les changements aillent dans une direction plus égalitaire. Mais, en réalité cela n’a rien à voir avec la procédure en première instance. La démocratie signifie littéralement le pouvoir au peuple ( demos ). Dans sa signification d’origine, le terme démocratie avait donc un contenu de classe. C’est aussi la principale raison pour laquelle l’élite n’a jamais été une grande partisane de la démocratie. Dans le néolibéralisme, nous remarquons toutefois un glissement de sens. La marxiste américaine, Ellen Meiksins Wood, distingue deux traditions démocratiques11. La tradition qui se rattache au demos de la Grèce antique et la tradition libérale, entre autres, de Locke et Montesquieu. Il est assez paradoxal que Van Reybrouck, qui tire son inspiration du tirage au sort dans la Grèce antique, rejoigne plutôt la tradition libérale, dans sa conception formaliste de la démocratie.
À Athènes, la citoyenneté démocratique signifiait que les petits producteurs, en particulier les paysans, étaient libres de toute exploitation « extra-économique ». Leur participation politique limitait leur exploitation économique. D’où le fait également que les esclaves ne pouvaient avoir de droits politiques. La liberté politique et la liberté économique étaient indissociables et le demos était en même temps un statut politique et une classe sociale. En ce sens, selon Wood, « la démocratie à Athènes n’était pas “ formelle ”, mais “ substantielle ” ». Aristote définissait la démocratie comme un consensus dans lequel « les gens nés libres et les pauvres contrôlaient le gouvernement – en même temps qu’ils constituaient une majorité ». Jusqu’à la fin du 18e siècle, ce sens littéral resta dominant. La démocratie comme « direction par le demos, le “ peuple ”, en son sens double en tant que statut civil et catégorie sociale ».
Jean-Claude Juncker au moment de la crise grecque :
« Il ne peut y avoir de choix démocratique allant à l’encontre des traités européens.»
Sous le capitalisme, la relation entre travail et capitale suppose des individus formellement libres et égaux. Mais le contenu de cet échange libre entre des égaux est une relation sociale d’inégalité et de dominance. L’appropriation de l’excédent de travail n’est pas dépendante d’un statut politique, mais repose sur l’absence de propriété du travailleur qui l’oblige à vendre sa force de travail. Cela rendait possible une redéfinition de la démocratie pour laquelle la fondation des États-Unis d’Amérique fut un moment critique. La citation suivante d’Alexander Hamilton, montre clairement le contraste avec la conception aristotélicienne de la démocratie : « C’est pourquoi nous devons considérer les marchands comme les représentants naturels de toutes ces classes de la communauté. »12
La vision libérale de la démocratie est totalement complémentaire au capitalisme dans lequel les relations de liberté et égalité formelles maintiennent en place l’inégalité sociale et la dominance. Généralement, c’est comme si la population – que cela se passe par des élections ou par un tirage au sort – choisissait librement la politique menée, tout comme il semble qu’avec son contrat, le travailleur est de son plein gré d’accord avec ses conditions de travail. Mais derrière ce libre consentement se dissimulent sous le capitalisme des relations de dominance. En présentant la démocratie comme une procédure formelle entre des individus libres et égaux, cette oppression est rendue invisible. Cela nécessite qu’essentiellement soit ajoutée une séparation stricte entre la politique et l’économie, qui fera que les rapports de production oppresseurs ne seront jamais compromis. La démocratie s’arrête aux portes de l’entreprise. Nous pouvons noircir une petite case toutes les quelques années, mais, sur ce que nous produisons, sur les quantités de la production et sur la manière de produire, nous n’avons rien à dire. La démocratie libérale cesse là où le pouvoir de l’élite économique se retrouve en danger.
« La manière subtile de tenir les gens passifs et dociles consiste à limiter strictement le spectre de l’opinion acceptable, mais à l’intérieur de ce spectre, de permettre un débat très animé »13, dit Noam Chomsky. Les traités de l’Union européenne sont un bon exemple de ce cadre qui limite fortement le spectre des opinions acceptables. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, le résumait ainsi, au moment de la crise grecque : « Il ne peut y avoir de choix démocratique allant à l’encontre des traités européens. » La crise grecque a rendu visible la contradiction entre égalité formelle et liberté et les relations d’oppression que cette crise a maintenues en place.
On ne peut par conséquent limiter la démocratie à l’aspect formel comme le fait Van Reybrouck. Le tirage au sort pourrait avoir comme avantage que ceux qui sont tirés au sort soient impliqués plus intensivement dans le processus démocratique. Mais, pour ceux qui n’ont pas été tirés au sort, le processus démocratique reste bel et bien une boîte noire. C’est ce que dit également Stefan Rummens dans son livre Wat een theater ! ( Quel théâtre ! )14. Il n’existe aucune possibilité de demander des comptes aux détenteurs de l’autorité ou de voter pour qu’ils s’en aillent. En outre, cela ne change absolument rien aux problèmes fondamentaux. L’inégalité économique et l’influence de la vie des entreprises sur la politique ne disparaissent pas. Un parlement tiré au sort sera lui aussi mis sous pression pour accepter le cadre européen de la libéralisation et des restrictions. Les personnes, les partis, les procédur]es ou les institutions peuvent changer. Le pouvoir du capital, lui, reste intact.
L’alliance entre le gouvernement et la bourse
Selon Friedrich Engels, dans la « République démocratique », « la richesse y exerce son pouvoir d’une façon indirecte, mais d’autant plus sûre. D’une part, sous forme de corruption directe des fonctionnaires, ce dont l’Amérique offre un exemple classique, d’autre part, sous forme d’alliance entre le gouvernement et la Bourse »15. Cette assertion datant du 19e siècle est toujours actuelle elle aussi. Aux États-Unis, les 429 candidats dont les caisses de campagne sont les mieux garnies ont pris les 429 premières places au Congrès américain. « Quand on contrôle les préférences de l’élite économique et des groupes d’intérêt organisés, il s’avère que ceux de l’Américain moyen n’ont qu’un impact minuscule, statistiquement insignifiant sur la politique. » Telle est la conclusion d’une grande enquête effectuée en 2014 par les spécialistes politiques américains Martin Gilens et Benjamin Page et qui comparait les préférences des Américains moyens à la politique menée16.
Au sein de l’Union européenne, il n’en va pas autrement. Les négociations à huis clos et le tourniquet entre la politique et le monde des entreprises sont la chose la plus normale du monde. Un tiers des commissaires européens de la commission sortante siègent aujourd’hui dans une grande entreprise. Ainsi, José Manuel Barroso a reçu un poste au conseil d’administration de Goldman Sachs et Karel De Gucht est allé travailler à ArcelorMittal. Inversement, depuis 2014, Miguel Arias Cañete est commissaire européen au Climat et à l’Énergie. L’homme vient en droite ligne du monde du pétrole. Quelque 10 500 lobbyistes d’entreprise sont quotidiennement sur la brèche pour influencer le Parlement européen et la Commission européenne à Bruxelles.
Selon Oxfam, huit personnes dans le monde possèdent actuellement autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale17. Ce n’est pas uniquement un problème économique et social. C’est aussi un problème démocratique. Du fait de leur richesse, ces huit personnes ont un énorme pouvoir sur notre économie et sur la société en général. C’est une occasion manquée que Van Reybrouck ne prenne pas ce contexte en considération dans son diagnostic. La démocratie ne se limite pas à la procédure ni à une évaluation entre la légitimité et l’efficience. Le débat sur la démocratie est surtout aussi un débat sur le contenu, sur la société dans laquelle nous voulons vivre.
En situant la cause des problèmes dans la procédure des élections, la question de société, le débat sur le contenu reste en grande partie hors de vue. L’exemple de la crise grecque laisse présumer que nous devons creuser plus profondément pour trouver les causes réelles du « syndrome de fatigue démocratique ». La crise démocratique y coïncide clairement avec une crise économique et sociale. « Il y avait des gens très puissants qui vous regardaient dans les yeux et qui vous disaient alors sans rougir : “ Vous avez raison dans ce que vous dites, mais, quoi qu’il en soit, nous allons vous écraser ”»18, a raconté Yanis Varoufakis à propos de ses négociations avec la Commission européenne. Clairement, le problème ici n’est pas que Varoufakis soit venu au pouvoir par des élections ou pas. Le problème, c’est que, dans les faits, qu’il ait été élu ou pas, il n’était absolument pas au pouvoir.
Pour un vrai changement démocratique, il ne suffit donc pas de remplacer l’actuelle caste élue d’hommes politiques par une nouvelle caste tirée au sort. Les recommandations finales du G1000 nous enseignent que les tentatives de renouveau démocratique qui ne s’appuient pas sur un mouvement de lutte émancipatoire et organisé contre l’élite ont tendance à aboutir à une reconfirmation du sens commun néolibérale. Ceux qui veulent donner plus de pouvoir au peuple devront arracher ce pouvoir dans une lutte avec les actuels détenteurs du pouvoir. Ainsi, on n’en restera pas à un changement formel de procédure qui laissera intact les actuels rapports de pouvoir. On ne peut en effet dissocier la revendication de pouvoir par le peuple de la lutte contre son oppression.
En première instance, des revendications comme un cadastre des fortunes, le fait de rendre publics les avoirs et tous les revenus des hommes politiques, l’instauration d’un salaire maximal, de cloisons entre la politique et le monde des entreprises ou le fait de rendre contraignants les référendums, peut jouer un rôle important. Une vraie démocratie dans laquelle le peuple a le pouvoir en main n’est en fin de compte possible que si le peuple tout entier peut également avoir un pouvoir décisionnel dans toutes les grandes questions économiques.
David Van Reybrouck, Contre les élections, Arles, Actes Sud, coll. Babel/essai, n° 1231, 2014, 1e éd., 219 p.
Footnotes
- David Van Reybrouck, Contre les élections, Arles, Actes Sud, coll. Babel/essai, no 1231, 2014, 1e éd., p. 187.
- David Van Reybrouck, op. cit., p. 11.
- Voir par exemple Anthony Barnett, This Time : Our Constitutional Revolution, Londres, Vintage, 1997 ; Colin Leys, Market Driven Politics, Londres, Verso, 2001 ; Joop van Holsteyn & Cas Mudde, Democratie in verval, Boom, Uitgeverij Boom, 2002 ; Luc Huyse, De democratie voorbij, Kessel-lo, Van Halewijck, 2014 ; Colin Crouch, Coping with post-democracy, London, Fabian society, 2000.
- David Van Reybrouck, op. cit., p. 52.
- G1000 ( 2012 ). Democratische innovatie in de praktijk ( rapport final ). Voir : www.g1000.org.
- Karl Marx & Friederich Engels, L’idéologie allemande, p. 39. En lecture libre sur Atramenta.net.
- Antonio Gramsci, Marxisme als filosofie van de praxis, édité et traduit en néerlandais par Yvotte Schols, Van Gennep, Amsterdam 1972.
- Jan Blommaert, Let op je woorden, Antwerpen, EPO, 2017.
- Étienne Balibar, The Brexit Crisis : A Verso Report, Verso, 2016.
- David Van Reybrouck, op. cit., p. 100.
- Ellen Meiksin Wood, Demcracy against capitalism. Renewing historical materialism, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Alexander Hamilton, Federalist, no 35, 5 januari 1788. Voir : Text of The Federalist No. 35 : congress.gov.
- Noam Chomsky, The common good, 1998, p. 43.
- Stefaan Rummens, Wat een theater ! Politiek in tijden van populisme en technocratie, Pelckmans Pro, 2016.
- Friedrich Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, [ mai 1884]. La signification du mot fonctionnaire n’est plus la même aujourd’hui qu’au 19e siècle. Engels ne parlait manifestement pas des enseignants ou des pompiers, mais de la caste des hommes politiques importants et des hauts fonctionnaires.
- Martin Gilens & Benjamin I. Page, “ Testing Theories of American Politics : Elites, Interest Groups, and Average Citizens ”, Perspectives on Politics, jg. 12 no 3, 2014, p. 564-581.
- Oxfam, An economy for the 1 %, 2017.
- NewStatesmen, Transcription intégrale de Yanis Varoufakis : Our battle to save Greece, 13 juillet 2015.