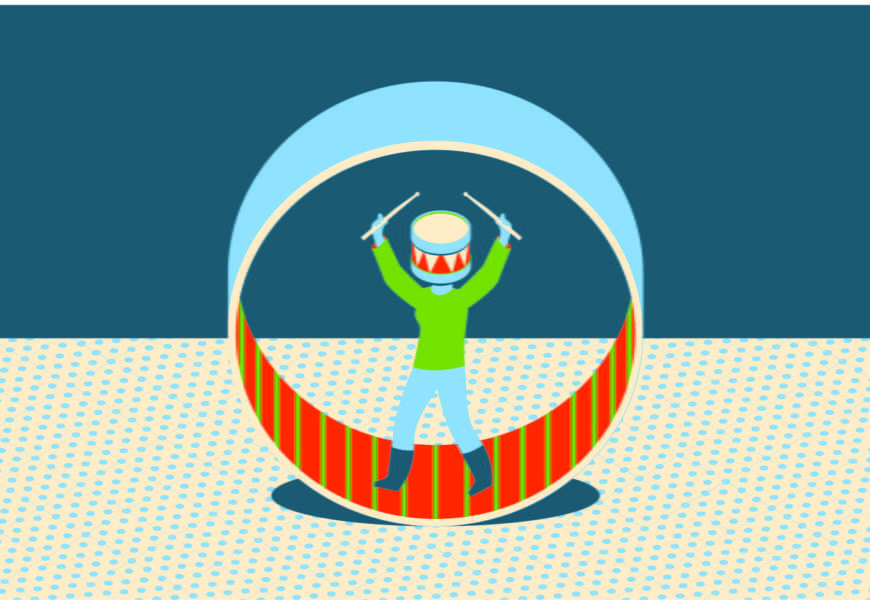Depuis vingt-cinq ans, en Europe, des partis de gauche se sont joints à de larges coalitions gouvernementales et en sont sortis, sans rien de positif.

Peut-on parler d’un raccourci quand il n’y a qu’un seul chemin qui se présente ? Aujourd’hui, de nombreux partis européens de gauche voient la participation à des coalitions de centre gauche comme la seule façon réaliste de mettre en place certaines réformes. Souvent, ils justifient leur choix de participer au gouvernement en disant que la présence d’un parti de gauche bloquera au moins les politiques les plus régressives et empêchera des formations plus réactionnaires de prendre le pouvoir. Ces partis pensent également qu’une participation au gouvernement accroîtra leur crédibilité aux yeux des électeurs et de leurs membres, ce qui renforcera finalement leurs perspectives de gouverner par eux-mêmes. Vingt-cinq ans d’histoire suggèrent néanmoins que ces attentes sont rarement satisfaites.
Italie
Au début des années 2000, Rifondazione Comunista a été une importante pierre de touche de la gauche européenne. Bien ancrée dans la longue tradition communiste du pays, critique envers sa propre histoire, pluraliste avec assez bien de diversité interne, ouverte à de nouvelles idées et profondément ancrée dans les mouvements sociaux, Rifondazione apparaissait à beaucoup comme un modèle pour d’autres jeunes formations radicales de gauche à travers le continent. Elle joua un rôle majeur en 2001 lors des protestations antimondialisation à Gênes et contribua largement au mouvement contre la guerre, qui rassembla trois millions de personnes dans les rues de Rome en février 2003.
De 2006 à 2008, Rifondazione se résigna cependant à des politiques du moindre mal, se joignant à une coalition gouvernementale de centre gauche pour empêcher Silvio Berlusconi de revenir au pouvoir. Une fois au gouvernement, le parti ne fut pas seulement forcé de défendre les coupes budgétaires auxquelles il s’était opposé jusque là, mais il dut également voter en faveur des interventions militaires au Liban et en Afghanistan.
Rifondazione expulsa deux sénateurs qui persistaient à voter contre le déploiement de troupes en Afghanistan. La participation gouvernementale transforma le « parti des mouvements » en une organisation qui a souvent donné l’impression de leur être opposée ; le « parti des alternatives » fut ainsi forcé de mettre en œuvre une politique du « pas d’alternative ». Ses maigres efforts pour faire passer des réformes sociales et progressistes passèrent largement inaperçus.
Les retombées ont été catastrophiques : deux années plus tard seulement, Berlusconi est revenu au pouvoir et Rifondazione n’a pas obtenu un seul siège parlementaire : pour la première fois depuis 1945, aucune force communiste n’était présente au parlement.
La participation gouvernementale transforma le « parti des mouvements » en une organisation qui a souvent donné l’impression de leur être opposée.
Depuis, le score de Rifondazione empire à chaque élection. Le parti et les mouvements sociaux sont tombés dans une dépression politique de proportion historique. Voir d’anciens alliés passer de l’autre côté des barricades a créé une atmosphère de défiance et de sectarisme.
De larges parts de la société se sont par conséquent éloignées du système politique ; c’est surtout le parti de protestation de Beppe Grillo, le Mouvement cinq étoiles, qui en a profité, même s’il n’est pas le seul ; le bref épisode gouvernemental de Rifondazione l’a tellement discrédité qu’il n’est plus capable d’exprimer le large mécontentement des électeurs.
France
Un autre parti majeur de la gauche de l’Europe occidentale, le Parti communiste français (PCF), a connu des revers semblables après avoir participé à un gouvernement. Aux élections législatives de 1997, le PCF remporta 9,9 % des voix et rejoignit la Gauche plurielle, une coalition rouge-verte menée par Lionel Jospin.
Ce gouvernement a d’abord joui d’un certain succès, en réussissant notamment à faire passer plusieurs réformes importantes (comme la semaine des 35 heures) et en refusant de se soumettre à la stratégie de la troisième voie dont Blair et Schröder se faisaient les promoteurs.
Ceci ne pouvait néanmoins rompre avec le cadre néolibéral. La coalition finit par mettre en œuvre le plus large programme de privatisation de l’histoire récente et approuva la participation à la guerre de l’OTAN en Serbie.
Lors des élections de 2002, le PCF s’effondra et remporta seulement 4,8 % des suffrages. Deux ans plus tard, ce ne furent plus que 4,3 %. L’alliance avec le Parti de gauche de Mélenchon lui permit de se refaire une petite santé en 2012 (le PCF affirma alors avoir remporté 6,9 %), un score certes meilleur qu’en 2002, mais bien loin de ses résultats d’avant gouvernement.
La plus grande force de gauche de France s’est ainsi discréditée en participant à un gouvernement néolibéral, une situation qui a permis au Front national (FN) de devenir un des partis les plus forts du pays. Le FN obtient ainsi certains de ses meilleurs résultats dans d’anciens bastions du PCF.
Surfant sur une vague d’indignation publique au moment de la crise financière, le Mouvement des verts et de gauche (VG) remporta spectaculairement 21,7 % des suffrages lors des élections de 2009 en Islande et dirigea donc le gouvernement du pays. Bien que l’Islande ait organisé le sauvetage de ses banques autrement que le reste de l’Europe, elle a conservé un paradigme néolibéral général. Et alors que le VG s’était toujours opposé à rejoindre l’OTAN et l’Union européenne, le parti a finalement conduit le gouvernement à demander l’adhésion à l’UE.
En 2013, les résultats du parti diminuèrent de moitié : 10,9 %. Après les Panama Papers, qui ravivèrent la crise des systèmes politiques, les Verts de gauche, alors dans l’opposition, regagnèrent 5 % des voix ce qui les mena à 15,9 % lors des dernières élections législatives. Le tout jeune Parti Pirate, pas encore entaché par une participation gouvernementale, les talonnait de près avec 14,5 %.
On observe des trajectoires similaires chez d’autres partis scandinaves de gauche : en Norvège, le soutien au Parti socialiste de gauche (SV) s’effondra de 8,8 % à 4,1 % lors de sa participation au gouvernement (2005-2013). Ce fut également le cas en Suède pour le Parti de gauche (V) : alors qu’en 1998 une campagne de gauche radicale, critique de l’Union européenne, lui avait permis de remporter 12 % des voix, il décida d’adoucir son image radicale et de rejoindre une coalition rouge-verte. En 2014, seuls 5,6 % des électeurs lui accordèrent leur confiance.
En 2007 au Danemark, le Parti populaire socialiste (SF) mena une campagne similaire, à gauche et critique de l’Union européenne, gagnant 13 % des suffrages. En 2011, après une campagne plus modérée dans l’espoir de participer au gouvernement, il ne récolta plus que 9,2 %. Sa participation ultérieure à une coalition de centre gauche abaissa encore plus sa popularité : en 2015, il n’était plus qu’à 4,2 % des voix.
La situation fut quelque peu moins dramatique en Finlande : en 1995, l’Alliance de gauche (VAS) a participé à une coalition « arc-en-ciel » après avoir obtenu 11,2 % des suffrages. En 2003, le parti n’était plus qu’à 9,9 % et se joignit au gouvernement en 2011 avec seulement 8,1 %. La décision du parti de quitter la coalition avant la fin de son mandat l’a sûrement sauvé d’un déclin plus dramatique : il conserva 7,1 % des suffrages en 2015.
Sur le siège du conducteur ?
Certains pourraient dire que la situation change lorsqu’un parti de gauche prend la tête d’un gouvernement plutôt que de servir comme partenaire minoritaire. L’expérience grecque montre que ce n’est pas forcément le cas. Le pouvoir institutionnel de la Troïka a forcé Syriza à mettre en œuvre et même à développer des politiques néolibérales. En conséquence, le parti a perdu toute une couche de ses membres, dont de nombreuses personnalités connues. Après seulement six mois au gouvernement, il avait déjà perdu plusieurs centaines de milliers de votes. Selon les sondages, cette tendance se poursuit.
Le pouvoir institutionnel de la Troïka a forcé Syriza à mettre en oeuvre et même à développer des politiques néolibérales.
Les événements à Chypre sont tout aussi peu inspirants. En 2008, un communiste a remporté l’élection présidentielle pour la première fois dans l’histoire du pays. Son parti, le Parti progressiste des travailleurs (AKEL), bénéficiait du soutien massif de la population ; mais le gouvernement a néanmoins fini par céder sous la pression des institutions européennes et a mis en place des mesures draconiennes d’austérité. Aux élections présidentielles suivantes, il perdit 10 % des voix.
Les mêmes développements s’observent au Groenland : en 2009, le parti social-démocrate Inuit Ataqatigiit obtint 43,7 % des voix. Il prit le pouvoir mais échoua à répondre aux attentes de la population : ses résultats chutèrent à 34,4 % en 2013 et il quitta le gouvernement.
Les racines de la défaite
Cette étude montre qu’aucune participation de la gauche à des gouvernements n’a permis de rompre avec le néolibéralisme au cours des vingt-cinq dernières années. La stratégie du moindre mal n’a tout simplement pas fonctionné, même selon ses propres critères. Ces échecs ont déçu les électeurs, qui espéraient des réformes de grande ampleur, et ont contribué au sentiment général que la gauche fait partie de l’establishment. Dans de nombreux pays, ceci a nourri la montée des partis populistes de droite et fascistes.
Pourquoi tant de gouvernements de gauche ont-ils échoué ? Nous pourrions dire que tous les chefs de parti à travers l’Europe sont des loups néolibéraux vêtus de peaux de mouton teintes en rouge, qui trahissent volontairement les principes de leur parti une fois au pouvoir. Nous pourrions aussi supposer que ces dirigeants ont de bonnes intentions mais se font manipuler par leurs partenaires néolibéraux à la table des négociations. Si une de ces deux hypothèses était justes, il nous suffirait de remplacer ces leaders corrompus et inefficaces par une autre aile du parti.
Admettons qu’on trouve des exemples de ces deux scénarios dans l’histoire récente ; cela ne fournit pas une explication générale satisfaisante de ces échecs répétés. Les traditions, compositions et orientations respectives des partis diffèrent trop pour qu’il soit possible de réduire leurs échecs à un problème de dirigeants.
Il faut plutôt en trouver la cause dans l’équilibre des forces sociales. Le Capital est devenu si fort que non seulement il peut résister aux tentatives de réforme de gouvernements de gauche, mais il parvient à transformer ces gouvernements en instruments au service de ses propres intérêts. Les exemples ci-dessus montrent que le réformisme de gauche en Europe ne peut ni produire une véritable rupture avec le néolibéralisme ni renforcer les forces de gauche.
Penser la stratégie au-delà du gouvernement
 Les partis de gauche européens devraient reconnaître que la voie vers une transformation sociale à travers des gouvernements de centre gauche est actuellement bloquée. À la place, ils devraient développer des stratégies alternatives et travailler à modifier l’équilibre des forces, grâce à une construction patiente de partis de gauche, mouvements de masse et syndicats militants, forts, interconnectés et bien organisés.
Les partis de gauche européens devraient reconnaître que la voie vers une transformation sociale à travers des gouvernements de centre gauche est actuellement bloquée. À la place, ils devraient développer des stratégies alternatives et travailler à modifier l’équilibre des forces, grâce à une construction patiente de partis de gauche, mouvements de masse et syndicats militants, forts, interconnectés et bien organisés.
La Gauche ne sera capable d’arracher des concessions substantielles au Capital que lorsque nous l’aurons poussé à la défensive, en renforçant les luttes sociales et faisant craindre aux capitalistes pour leur avenir. Il restera toujours la question de savoir si les gouvernements de gauche représentent une stratégie adéquate pour une transformation socialiste ; mais au moins, cela offrira aux partis de gauche, s’ils gouvernent, la possibilité de faire mieux que de répéter les vieilles défaites.
Ce texte est une traduction de l’article Winning Power, Not Government paru dans Jacobin le 18 avril 2017.