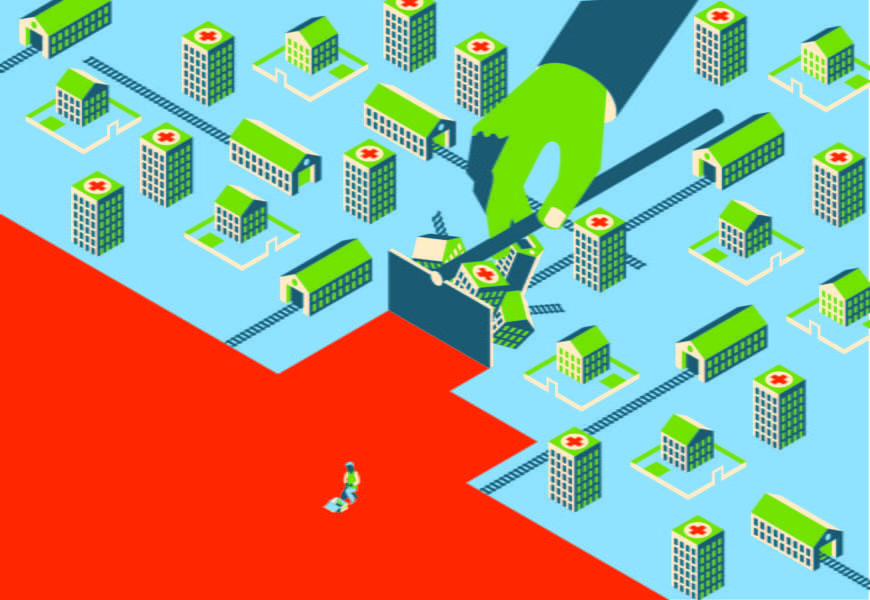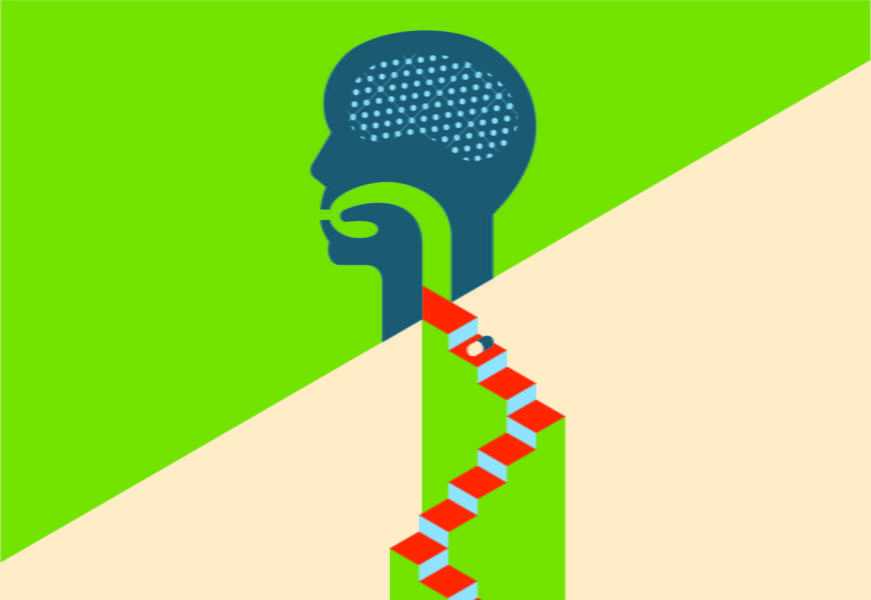Alors que les populismes du sud de l’Europe semblent être à la recherche d’un second souffle, il est crucial de soumettre le bilan de ces
expériences politiques à un examen critique.

Malgré la multiplication prometteuse de mouvements altermondialistes à l’aube du nouveau millénaire, les années 2000 se sont révélées bien décevantes du point de vue de la contestation sociale. Le projet politique néolibéral battait son plein, encouragé par une période de croissance de l’économie mondiale et par le ralliement de plus en plus affirmé de la gauche réformiste à ses principes, de la France à l’Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie.
La crise économique de 2008 a sensiblement modifié la donne. Celle-ci a influencé l’évolution de la configuration politique générale dans les démocraties européennes par deux voies indirectes. D’une part, le ralentissement de l’activité économique qu’elle a provoqué, couplé à des politiques économiques combinant austérité budgétaire et réformes structurelles, a considérablement détérioré les conditions matérielles d’une grande partie de la population ( en particulier des classes moyennes, brusquement vulnérabilisées ) et, avec elles, les bases de la cohésion sociale. D’autre part, la convergence de l’ensemble des acteurs politiques traditionnels vers les mêmes politiques d’austérité budgétaire sous la pression des institutions européennes et du FMI1 a révélé à la fois le degré de connivence idéologique des élites politiques et le degré de confiscation technocratique des instruments de politique économique.
La frustration d’un grand nombre de demandes sociales et l’impossibilité de les satisfaire par les canaux politiques existants a jeté les bases d’un renouveau de la contestation
Cette double dimension de la crise — la frustration d’un grand nombre de demandes sociales et l’impossibilité de les satisfaire par les canaux politiques existants — a jeté les bases d’un renouveau important de la contestation sociale et d’une reconfiguration profonde de la confrontation politique. D’une part, les mouvements sociaux se sont multipliés pour protester contre les réformes économiques ; citons, parmi les plus significatifs, le mouvement Aganaktismenoi en Grèce, le Movimiento 15-M en Espagne et Nuit debout en France. D’autre part, les lignes traditionnelles d’affrontement politique ( en particulier, l’alternance d’un centre gauche social-démocrate et d’un centre droit libéral ou conservateur), sans disparaître complètement, semblent s’estomper progressivement au profit d’une nouvelle configuration. Celle-ci voit l’émergence d’une nouvelle ligne de démarcation entre un « centre radical2 », dont la caractéristique principale est de défendre le programme néolibéral à travers une image de réformisme pragmatique et de modernisme prétendument apolitique, et des « populismes » aux inspirations idéologiques variées, mais dont le point commun réside dans la dualisation de l’espace social entre le peuple et les élites.
Un potentiel subversif
Cette nouvelle dynamique est perceptible dans de nombreux cas nationaux ( en particulier dans le sud de l’Europe, en raison de la virulence de la crise et de l’intensité des réformes économiques), où elle s’est manifestée de différentes manières. La Grèce a vu la chute spectaculaire de la social-démocratie ( Pasok ) et la montée en puissance d’un parti populiste de gauche capable d’exercer le pouvoir ( Syriza). En Espagne, le déclin du parti social-démocrate ( PSOE ) ayant été moins spectaculaire, la nouvelle configuration correspond à l’opposition triangulaire entre le centre droit ( PP), un populisme de gauche ( Podemos ) et le parti social-démocrate, tiraillé entre les deux premiers. En Italie, la confrontation entre pro et antiberlusconiens qui avait structuré la vie politique au cours des vingt dernières années a cédé sa place là aussi à un schéma triangulaire, entre une droite fragmentée, un centre gauche ( PD ) entièrement « blairisé » sous la houlette de Matteo Renzi, et un parti populiste aux contours idéologiques particulièrement flous et ambigus ( Movimento Cinque Stelle). En France aussi, cette dynamique est à l’œuvre et s’incarne dans l’espèce de fusion que le mouvement En Marche réalise entre le centre gauche et le centre droit, laissant comme seules oppositions potentielles les populismes concurrents du Front national et de la France insoumise.
Dans une perspective radicale et émancipatrice, ces développements ne manquent pas d’intérêt. L’émergence des populismes de gauche en Europe, qui s’est manifestée soit par la naissance de nouveaux partis ou coalitions d’acteurs ( Podemos, Syriza), soit par une certaine inflexion stratégique apportée à des mouvements déjà existants ( Labour, PTB, France insoumise), a ouvert quelques perspectives prometteuses. La première et la plus importante, c’est qu’elle a permis de rompre avec le sectarisme, le recours à des symboles éculés et les professions de foi idéologique qui condamnaient la gauche radicale à une marginalité politique devenue presque confortable. La deuxième, c’est qu’elle a fourni un canal d’expression au cœur des institutions politiques à des mouvements sociaux dont l’énergie aurait fini par s’épuiser sans cette forme de « verticalisation » politique qui, au-delà des problématiques qu’elle soulève, a garanti une forme de pérennisation de cet élan initial. Enfin, le troisième et dernier point positif, c’est que sa force d’interpellation a permis de mettre au cœur de l’agenda politique toute une série d’enjeux qui en étaient exclus, en même temps qu’elle contribuait à un renouvellement du personnel et des pratiques politiques au sein des institutions.
Par ailleurs, à qui douterait encore du potentiel subversif de ces mouvements, il suffit de rappeler les réactions affolées de l’establishment européen qu’ils ont suscitées : de Mario Monti à Herman Van Rompuy, de François Hollande à Jean-Claude Juncker, la levée de boucliers contre « les dangereux excès du populisme » a été unanime. Alors que ces nouvelles expériences politiques ont, pour certaines, quelques années d’existence et connaissent déjà une forme d’essoufflement — l’échec patent de Syriza et la stagnation actuelle de Podemos en témoignent —, le moment semble venu de tenter un bilan critique de ces expériences, de leurs limites et de leurs perspectives.
Toute réflexion de ce type ne saurait faire l’impasse d’un examen de la tradition intellectuelle dont ces expériences politiques procèdent, voire dont elles se réclament parfois explicitement ( en particulier dans le cas de Podemos). C’est que les obstacles rencontrés par le populisme de gauche dans sa praxis signalent souvent des écueils au sein de son armature théorique elle-même. Quel que soit le degré d’affinité qui nous lie à cette mouvance politique et à cette tradition de pensée, il faut donc les soumettre toutes deux à un examen critique qui puisse comprendre les impasses de la première à partir des points aveugles de la seconde.
Laclau et Mouffe
Le populisme de gauche doit bien sûr énormément à la pensée d’Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe. L’inverse est également vrai. Auparavant réservée à des spécialistes ( minoritaires ) au sein des facultés de philosophie et de sciences sociales, leur théorie du populisme et de la démocratie radicale a été propulsée sur le devant de la scène par l’actualité récente, à tel point qu’il n’est plus rare de voir leurs noms mentionnés dans les médias grand public3. Largement inspirée de Gramsci, cette théorie est définie et revendiquée comme « post-marxiste4 » par ses auteurs eux-mêmes, en raison de sa prise de distance avec le déterminisme économique et l’essentialisme de classe qu’ils attribuent à la pensée de Marx. À travers le recours à trois concepts clefs ( discours, antagonisme et hégémonie), Laclau et Mouffe construisent une théorie de l’émancipation sociale qui prive la classe ouvrière du statut historique privilégié dont elle jouissait dans la théorie marxiste. Les luttes politiques ne sont plus conçues comme l’expression de conflits objectifs se nouant au niveau de l’infrastructure, dans les rapports de production ; elles sont le produit d’une articulation contingente de demandes hétérogènes dans un discours5.
C’est sur ce socle théorique que se fonde leur conception de la démocratie radicale et du populisme6. Parler de démocratie radicale, c’est imaginer un horizon qui reconnaîtrait l’irréductibilité du conflit dans l’arène démocratique. Pratique plutôt que régime ou dispositif institutionnel, la démocratie radicale désigne « un processus infini de déconstruction/reconstruction de la substance, des formes et des limites de l’existence collective7 » ; elle indique la possibilité permanente d’une réinstitutionnalisation du social à travers de pratiques émancipatoires ou réactionnaires. C’est dans ce cadre que les auteurs proposent de repenser le populisme, que les théories libérales de la démocratie ont l’habitude d’agiter comme un épouvantail8.
Le populisme n’est rien d’autre, d’après eux, qu’une logique inhérente à la politique. Il s’agit d’un mode de construction des identités politiques fonctionnant par l’agrégation de demandes hétérogènes, dont l’unité ne résulte pas de l’existence de caractéristiques positives, réelles, mais bien de leur opposition à un ennemi/adversaire tenu pour responsable de la frustration de ces demandes et qui permet d’établir un lien d’équivalence entre elles. Le populisme simplifie donc l’espace social à l’extrême, en réduisant l’ensemble des différences et oppositions à l’affrontement entre un « nous » ( le peuple ) et un « eux » ( l’establishment), qui ne correspondent pas à des identités politiques préétablies, mais sont constituées en tant que sujets politiques à travers cette opération de simplification.
Enfin, parce que le populisme n’est en aucun cas l’expression d’un contenu social et idéologique spécifique, mais une pratique visant à articuler des demandes particulières, il peut prendre des contours très différents en fonction du contenu qu’il articule : les mouvements contemporains qualifiés de « populistes » peuvent incarner des projets politiques xénophobes et réactionnaires ( Front national), émancipateurs et progressistes ( Podemos), voire des projets politiques foncièrement ambigus ( Movimento Cinque Stelle).
Forme et contenu politique
Que nous indiquent les échecs récents et/ou la stagnation des mouvements populistes qui ont émergé dans le sud de l’Europe à la faveur de la crise ? Quels enseignements théoriques et pratiques en tirer ? J’aimerais m’arrêter sur un élément en particulier de la théorie laclauienne du populisme, le problème de l’articulation entre forme et contenu, et sur les tensions qu’il génère dans la pratique — en particulier, les difficultés qu’il pose en matière d’exercice du pouvoir, de construction d’un projet politique contre-hégémonique convaincant, et de conception d’un horizon commun d’émancipation par-delà les frontières nationales.
Si je me concentre sur cet aspect, c’est en raison à la fois de sa centralité dans la théorie et du nombre de difficultés qui en découlent ; il est cependant certain que pour faire un bilan exhaustif du moment populiste, d’autres éléments mériteraient aussi d’être abordés, en particulier la verticalité excessive de ces mouvements9 ( le rôle central du leader, le caractère plébiscitaire et peu démocratique des procédures internes, la difficulté de maintenir le lien avec les mouvements sociaux et les corps intermédiaires, etc. ) et les enseignements apportés par les expériences de gouvernement local à Madrid et à Barcelone10.
L’hyperformalisme de la théorie de Laclau — la volonté de définir le populisme comme une logique politique, indépendamment du contenu qu’il articule — malgré sa pertinence sur le plan théorique, pose de nombreux problèmes pour la praxis politique. Comme le soulignent Álvaro Oleart et Juan Domingo Sánchez Estop : « Le populisme […] est une forme, pas un contenu. Pour cette raison, le populisme, en tant que discours, n’est pas nécessairement lié à une idéologie, un projet politique ou un intérêt social défini. Dans ce sens, c’est une méthode optimale pour le remplacement des élites, mais qui se révèle insuffisante pour une stratégie de changement social effectif11. »
En d’autres termes, le populisme n’est porteur de perspectives prometteuses que s’il s’articule avec un projet contre-hégémonique ambitieux et clair. Or, la focalisation des mouvements populistes sur la forme de leur discours — pour des raisons stratégiques évidentes et compréhensibles — laisse souvent la question du contenu du projet politique en suspens, quitte à ce que les tensions potentielles resurgissent sous une forme explosive et dans des moments décisifs du développement de ces mouvements. Examinons comment ces tensions se sont manifestées dans les cas grec, italien et espagnol.
L’échec cuisant de Syriza dans ses négociations avec les créanciers est sans doute le plus significatif et le plus inquiétant coup d’arrêt subi par ces mouvements politiques. Le formalisme laclauien n’y est probablement pas totalement étranger. Puisque le populisme est conçu comme une logique particulière de construction des identités politiques, capable d’articuler différentes demandes et « contenus », il s’ensuit qu’il doit nécessairement adopter une forme suffisamment vague et ambiguë pour pouvoir agréger ces demandes hétérogènes dans une même chaîne d’équivalence. En termes pratiques, cela signifie que la capacité à fédérer différentes tendances dans un même mouvement — Syriza, ne l’oublions pas, est une coalition — ne peut se faire qu’au détriment de la clarté idéologique.
C’est à ce prix que les populismes de gauche ( Podemos et Syriza ) sont parvenus à réunir sous une même bannière des éléments pouvant aller de la gauche radicale anticapitaliste à une gauche modérée prônant une politique de relance keynésienne. Malgré l’intérêt manifeste d’une telle stratégie pour le développement d’un mouvement à court terme et la conquête d’une position électorale avantageuse, celle-ci n’est pas sans risque pour la pérennité de ces mouvements et la concrétisation de politiques progressistes lorsqu’ils sont en position de gouverner. L’analyse approfondie des structures du capitalisme et l’adoption d’une position claire sur le meilleur moyen de les subvertir ont cruellement fait défaut à Syriza au moment clef des négociations. Les structures de l’Union européenne ( et de la zone euro en particulier ) sont-elles irrémédiablement marquées du sceau néolibéral ? Faut-il en infléchir la teneur, en sortir unilatéralement, ou démocratiser les processus de décision européens ? Ce qui fait la force du populisme de gauche en détermine également la principale faiblesse : le rejet résolu de tout dogmatisme économique, s’il favorise une certaine transversalité, laisse ces mouvements sans programme politique précis.
Dilemmes d’une stratégie populiste
Le meilleur exemple de cette tension problématique entre forme et contenu est sans doute donné par le Movimento Cinque Stelle : là où Podemos et Syriza s’inscrivent malgré tout dans une culture politique de gauche qui fournit à leurs diverses composantes un dénominateur commun, le Mouvement cinq étoiles est orphelin d’un tel héritage. À bien des égards, il incarne la version quintessentielle de la logique populiste, puisqu’il réunit des éléments complètement hétérogènes et sans véritable culture politique commune, allant de la gauche à la droite de l’échiquier politique traditionnel. On pourrait y voir une version italienne du péronisme argentin, dont la figure du leader constituait le seul ciment entre des militants provenant des deux pôles opposés de l’axe gauche-droite12.
Le risque pour de tels mouvements est de se désagréger totalement dès lors que l’exercice du pouvoir ne permet plus de laisser en suspens les différences internes et la question du contenu du projet politique. Si rien n’indique que l’issue d’un tel processus puisse prendre chez les grillini les contours sanglants des affrontements entre péronistes d’extrême droite et d’extrême gauche, les difficultés rencontrées dès les premières expériences de gouvernement local, à Rome et à Turin, sont très révélatrices des limites d’une stratégie populiste vidée de tout contenu propre et de toute culture politique assumée.
Le rejet résolu de tout dogmatisme économique, s’il favorise une certaine transversalité, laisse ces mouvements sans programme politique précis
Les dilemmes auxquels Podemos s’est trouvé confronté dernièrement sont eux aussi révélateurs d’une telle tension. Les dissensions internes qui se sont manifestées à l’approche du dernier congrès national du parti ont — au-delà de la lutte d’égos qu’elles reflétaient entre Pablo Iglesias et Iñigo Errejón — mis en évidence le décalage entre deux stratégies disponibles pour le parti, après des résultats électoraux décevants lors des dernières élections. La première, défendue par le désormais ex-numéro deux de Podemos, prônait une forme de modération et d’institutionnalisation du parti. Afin d’être en mesure d’exercer le pouvoir, Errejón considérait en effet que le parti devait faire preuve d’une plus grande ouverture, notamment vis-à-vis d’une alliance potentielle avec les socialistes, et d’une attitude moins offensive et contestataire, susceptible de lui aliéner une partie importante de l’électorat de centre gauche. Dans les termes utilisés jusqu’à présent, une telle dynamique se serait apparentée à une certaine prise de distance vis-à-vis du noyau du parti et de ses positions de gauche radicale, afin d’accentuer la stratégie populiste du parti et d’étendre sa chaîne d’équivalence jusqu’au centre de l’échiquier politique.
Potentiellement avantageuse électoralement, une telle stratégie n’était toutefois pas sans risque : au-delà de celui, mentionné plus haut, du resurgissement des dissensions internes lors de l’exercice du pouvoir, le danger le plus important était qu’en se modérant et en se « normalisant », le parti risquait de perdre son extériorité par rapport au système. En d’autres termes, un tel processus aurait pu conduire à la cooptation progressive de ce parti par l’establishment politique espagnol, le privant de son identité singulière, et partant, de son potentiel de transformation de la société.
La seconde ligne stratégique, portée par Iglesias et entérinée par la nette victoire de ce dernier lors du congrès, prônait au contraire la radicalisation du mouvement et de son antagonisme vis-à-vis de l’ensemble du système politique, la confirmation de son alliance avec le parti de gauche radicale Izquierda Unida, et une stratégie de maintien d’un contact constant avec « la rue » ( la calle ) pour lutter contre l’institutionnalisation du parti et la réduction de son champ d’action à la seule activité parlementaire. Le risque ici est évidemment inverse : à travers cette radicalisation, le parti pourrait renouer avec la marginalité politique que l’extrême gauche connaît depuis des années, et se cantonner à un rôle strictement contestataire, sans perspective réaliste d’accès au pouvoir au niveau national. Le tassement de Podemos dans les derniers sondages et le rebond des socialistes sous la houlette de Pedro Sanchez pourraient bel et bien sanctionner l’échec définitif d’une telle stratégie : le PSOE n’a pas connu l’effondrement spectaculaire du Pasok en Grèce, et l’adoption par celui-ci d’une ligne d’opposition frontale au gouvernement de Mariano Rajoy pourrait lui permettre de concurrencer Podemos sur son propre terrain, tout en bénéficiant de la crédibilité d’un parti de gouvernement aux assises stables.
Un populisme transnational
Ces hésitations et écueils ne sont pas les seuls problèmes induits par le formalisme du populisme d’inspiration laclauienne. Une autre question cruciale que celui-ci soulève — mais qui pourtant reste relativement peu débattue au sein de ces formations politiques et des intellectuels qui gravitent autour13 — est celle de l’horizon des luttes menées au nom du peuple. Là où l’idéal socialiste s’inscrivait d’emblée dans un horizon dépassant le cadre national, l’absence de contenu nécessaire au populisme et de corpus idéologique propre ne définit aucun rapport privilégié a priori vis-à-vis d’une échelle d’action spécifique. Si, contrairement à ce que comportait le projet socialiste, cela implique que le populisme n’incarne en aucun cas automatiquement un projet d’émancipation adressé à l’humanité dans son ensemble, cela signifie également que, contrairement à ce que prétendent certains libéraux à la critique facile, le populisme n’est pas intrinsèquement nationaliste. Il n’y a aucun obstacle théorique à la constitution d’un populisme transnational : si le populisme est affaire de construction d’un peuple à partir de demandes hétérogènes, alors il doit être possible de construire un peuple transnational opposé aux élites politiques et économiques transnationales14.
Cependant, toute initiative de ce type se heurterait à nouveau à la même question lancinante, cette fois décuplée par l’échelle à laquelle elle serait posée : autour de quel projet politique constituer ce mouvement populiste transnational ? Sans compter que les obstacles pratiques à la constitution d’un tel mouvement ( dans sa dimension formelle, cette fois ) ne manquent pas non plus : à travers quels symboles et canaux de communication constituer l’unité d’un peuple transnational ? Comment en organiser la représentation et en exercer le pouvoir ? Quid, dans le contexte européen, des différences culturelles et linguistiques susceptibles de résister à toute tentative d’unification ?
L’émancipation ne sera jamais l’objet d’une pure tekhnè, mais indiquera toujours un projet politique en devenir
En d’autres termes, si « théoriquement il est certainement possible d’avoir un véritable populisme transnational, la question est de savoir quelle relation un tel populisme transnational entretiendrait avec l’organisation toujours fortement nationale de nos sociétés en termes de représentation démocratique tout comme, pour beaucoup, en termes d’identité15 ». L’expérience du mouvement DiEM25, lancé par l’ex-ministre grec des Finances Yanis Varoufakis, est représentative des difficultés et des ambiguïtés rencontrées par une telle entreprise dans le cadre européen. Le mot d’ordre de la « démocratisation des institutions européennes » constitue-t-il un projet politique à lui seul ? Faut-il considérer que le cadre national est tout à fait obsolète lorsqu’il s’agit de lutter contre un capital financier globalisé, ou faut-il agir de concert au niveau national et supranational ? Le langage de la foi en un esprit européen cosmopolite et le rejet du niveau national comme un espace de retranchement passéiste ne courent-ils pas le risque de « ne pas être entendus précisément par ceux qui souffrent le plus du déficit démocratique et auxquels cette initiative [DiEM25] devrait être capable de parler16 ? »
Une telle initiative transnationale pose au moins autant de nouvelles questions qu’elle n’en résout d’anciennes. Faut-il pour autant alors privilégier une alliance inter-nationale de populismes, comme un ensemble de liens établis entre des mouvements populistes organisés prioritairement à l’échelle nationale17 ? L’exemple généralement apporté pour soutenir une telle stratégie est celui de la « vague rose » en Amérique latine et de la façon dont les populismes de gauche y ont émergé comme des forces politiques au niveau national, établissant des mécanismes de convergence et de coopération uniquement dans un second temps. Toutefois, outre le reflux récent de cette vague qui a contribué à en relativiser la pertinence en tant qu’exemple de succès durable, il est permis de douter que la transposition de ce modèle soit possible dans un contexte européen où les populismes de gauche restent peu nombreux et peinent déjà considérablement à émerger comme des acteurs de pouvoir à leur échelle nationale.
Conclusion
 Le bilan provisoire des expériences populistes de gauche dans le sud de l’Europe est donc globalement contrasté. La déception générée par l’échec de Syriza, ainsi que par les derniers résultats électoraux de Podemos et l’évolution de ses pratiques internes, est à la mesure de l’espoir qu’avaient suscité ces mouvements dans leur élan initial. Pour une bonne part, ces coups d’arrêt peuvent être expliqués par des tensions inhérentes au populisme lui-même, en lien avec certains écueils persistants dans la théorie qui l’inspire. Habiles à construire de nouvelles formes d’identification politique et à transformer le rapport de force électoral dans leurs contextes nationaux respectifs, ces mouvements sont à la peine lorsqu’il s’agit de choisir et de mettre en œuvre un projet politique cohérent capable de transformer la société en profondeur, a fortiori si un tel projet est amené à dépasser le cadre national.
Le bilan provisoire des expériences populistes de gauche dans le sud de l’Europe est donc globalement contrasté. La déception générée par l’échec de Syriza, ainsi que par les derniers résultats électoraux de Podemos et l’évolution de ses pratiques internes, est à la mesure de l’espoir qu’avaient suscité ces mouvements dans leur élan initial. Pour une bonne part, ces coups d’arrêt peuvent être expliqués par des tensions inhérentes au populisme lui-même, en lien avec certains écueils persistants dans la théorie qui l’inspire. Habiles à construire de nouvelles formes d’identification politique et à transformer le rapport de force électoral dans leurs contextes nationaux respectifs, ces mouvements sont à la peine lorsqu’il s’agit de choisir et de mettre en œuvre un projet politique cohérent capable de transformer la société en profondeur, a fortiori si un tel projet est amené à dépasser le cadre national.
Il y a donc urgence à penser ces difficultés, à faire dialoguer la réflexion théorique avec les expériences pratiques, à l’heure où ces mouvements sont à la recherche d’un second souffle. Il y a urgence à le faire, à l’heure où le populisme de droite rencontre des succès retentissants, pour ne pas accorder à des projets politiques racistes et réactionnaires le monopole de l’opposition à la mondialisation néolibérale. La question lancinante de l’articulation entre forme et contenu dans le populisme ne trouvera probablement pas de réponse globale et définitive, mais mérite d’être approfondie si l’on veut pouvoir trouver des solutions partielles et temporaires en phase avec les nécessités du moment. Du reste, l’émancipation ne sera jamais l’objet d’une pure tekhnè, mais indiquera toujours un projet politique en devenir ; qui prétendrait détenir la clef de sa réalisation finale en deviendrait automatiquement le premier adversaire.
Footnotes
- Du nord au sud de l’Europe, du centre gauche au centre droit de l’échiquier politique en passant par les gouvernements dits « techniques », l’austérité budgétaire ( accomplie principalement à travers la baisse des dépenses publiques ) et les réformes structurelles ( c’est-à-dire essentiellement les politiques de modération salariale et de dérégulation du travail ) ont systématiquement prévalu sur toute forme de politique économique alternative.
- Chantal Mouffe ( 1998 ) « The radical centre : A politics without adversary », Soundings, 9, p. 11-23.
- Voir notamment : Alexandre Delvecchio, Chantal Mouffe, la philosophe qui inspire Mélenchon, se livre en exclusivité , Figaro Vox, 11 avril 2017 et Chantal Mouffe, Mélenchon ne veut pas de régime autoritaire, mais mettre fin au régime oligarchique, Le Monde, 15 avril 2017.
- Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, « Post-marxism without apologies », New Left Review I/166, novembre- – décembre 1987, p. 79-106.
- Il n’est pas possible de développer ici à leur juste valeur la définition du discours de Laclau et Mouffe, et l’innovation théorique qu’elle représente par rapport au marxisme classique. Il faut tout de même écarter d’emblée une critique qui leur est souvent adressée et qui repose sur une mécompréhension de leur conception du discours : celle selon laquelle ces auteurs réduiraient l’ensemble du réel et du social à sa dimension linguistique. Leur concept de discours ne se réduit pas à la dimension textuelle du social. Bien au contraire, il désigne l’articulation d’éléments linguistiques et non-linguistiques, il renvoie au fait que la nature d’un objet ne provient pas de sa simple existence, mais bien de son inscription dans une matrice discursive ( faite du système de relations que cet objet entretient avec d’autres objets, système qui est socialement construit). C’est notamment sur la base d’une telle conception du discours ( qui emprunte de nombreux éléments à la notion de « jeux de langage » de Wittgenstein ) qu’ils critiquent la notion d’intérêt « objectif » dans la théorie marxiste, c’est-à-dire d’intérêts qui seraient déterminés objectivement en dehors de tout processus historique de construction, dissolution et redéfinition.
- Voir en particulier les deux ouvrages clefs : Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy : Towards a radical democratic politics, Verso, Londres, 1985 ; Ernesto Laclau, On populist reason, Verso, Londres, 2005.
- Audric Vitiello, « L’itinéraire de la démocratie radicale », Raisons politiques 2009/3 ( no 35), p. 207-220.
- On peut trouver une version récente et caricaturale de la critique libérale du populisme dans l’ouvrage de Jan-Werner Müller, Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, Premier Parallèle, Paris, 2016.
- De nombreux auteurs ont récemment critiqué, à partir d’une position progressiste, les tendances verticales, antidémocratiques et plébiscitaires dans le populisme de gauche en général ( Pierre Dardot, « L’urgence démocratique », Mediapart, 25 mars 2017 ) et sur Podemos en particulier ( Emmanuel Rodríguez, « Vistalegre II tiene la marca de lo peor de Podemos », Saltamos.net, 10 février 2017).
- Voir notamment : Pauline Perrenot & Vladimir Slonska-Malvaud, « De la rue à l’exercice du pouvoir. Dans les villes rebelles espagnoles », Le Monde diplomatique, février 2017.
- Álvaro Oleart & Juan Domingo Sánchez Estop, Las brechas de la máquina de guerra electoral, Público, 12 janvier 2016.
- Samuele Mazzolini & Arthur Borriello ( à paraître ) « Southern European populisms as counter-hegemonic discourses? Podemos and M5S in comparative perspective », dans Marco Briziarelli & Oscar Garcia Augustin ( dir. ) Podemos and the New Political Cycle, Palgrave.
- À l’exception notable du groupe de recherche Transnational populist politics, qui réunit des chercheurs et professeurs d’Europe et d’Amérique latine désireux de réfléchir aux perspectives transnationales du populisme, mais qui reste pour l’instant limité à des cercles académiques restreints.
- C’est l’argument que défendent Benjamin De Cleen et Antonis Galanopoulos dans une interview intitulée Populism, nationalism and transnationalism, openDemocracy, 25 octobre 2016.
- Benjamin de Cleen & Antonis Galanopoulos, Populism, nationalism and transnationalism, openDemocracy, 25 octobre 2016.
- George Souvlis & Samuele Mazzolini, An open letter to Yanis Varoufakis , Lefteast, 29 mars 2016.
- Benjamin de Cleen & Antonis Galanopoulos, Populism, nationalism and transnationalism , openDemocracy, 25 octobre 2016.