On ne peut confier au marché les décisions les plus importantes relatives à notre vie quotidienne, et de la société en général, sans porter atteinte à l’idée même de démocratie.

Dans sa célèbre conférence Citizenship and Social Class, donnée à l’Université de Cambridge en 1949, le sociologue britannique T.H. Marshall a tenté d’historiciser ce qu’il a appelé «l’élan moderne vers l’égalité sociale». La conférence elle-même visait à rendre hommage à l’économiste Alfred Marshall, dont les Principes d’économie politique de 1890 ont façonné la discipline pendant des décennies et ont profondément influencé des personnalités telles qu’Arthur Pigou et John Maynard Keynes. Si T.H. Marshall a lui-même été inspiré par cette tradition, son expérience de la guerre et sa rencontre avec la classe ouvrière, à travers son adhésion au parti travailliste, a eu impact profond sur ses idées. Alors que Marshall, l’économiste, pensait que nous pouvions aborder la question sociale tout en préservant «la liberté du marché concurrentiel», Marshall, le sociologue, était moins optimiste.
«Est-il encore vrai» s’interrogeait-il de manière rhétorique, «que l’égalité fondamentale peut être créée et préservée sans envahir la liberté du marché concurrentiel?» La réponse, avançait Marshall, est «évidemment» non. Il estimait que «la citoyenneté et le système de classe capitaliste» avaient été «en guerre» tout au long du 20e siècle. Ce qu’il avait nommé une «citoyenneté sociale» ne visait pas simplement à «réduire la nuisance évidente de l’indigence dans les rangs les plus bas de la société», mais impliquait de «modifier l’ensemble du modèle d’inégalité sociale». Une telle citoyenneté ne se contenterait pas «d’élever le niveau du sol dans le sous-sol de l’édifice social en laissant la superstructure intacte», mais viserait à «remodeler l’ensemble du bâtiment».
Cette opinion n’était pas rare à l’époque. Même parmi les économistes de tendance néoclassique comme Pigou, on partait du principe que l’État allait devoir jouer un rôle croissant dans l’économie pour répondre aux besoins sociaux que le marché n’avait pas pu satisfaire et permettre à chacun de développer pleinement ses facultés. L’idée de redistribution s’insère alors dans un cadre plus large qui doit englober non seulement l’accès aux biens de consommation, mais aussi à la culture, à la connaissance, à un travail décent ou encore, écrivait Pigou, à «des besoins non matériels tels que le besoin de participer à la société».
Des services collectifs, plutôt que de l’argent
Si Pigou a fait valoir que «tout transfert de revenu d’un homme relativement riche à un homme relativement pauvre» devait logiquement «augmenter la somme globale de satisfaction», une telle augmentation ne pouvait se faire simplement au travers de transferts d’argent. Dans ce cadre, l’augmentation du bien-être public ne dépend pas seulement de la répartition des revenus, mais aussi, selon lui, de «la manière dont les revenus sont dépensés». Ainsi, pour Pigou, il semblait évident que du point de vue de la satisfaction globale, «l’effet de musées publics ou même des bains municipaux sur les gens est très différent de l’effet d’un bar public».
Il n’y a peut-être pas de meilleur défenseur de cette ligne d’argumentation que l’économiste socialiste Richard H. Tawney. Dans son livre de 1931, Equality, Tawney avait soutenu que «la répartition égale du revenu par tête n’est pas un moyen satisfaisant d’accroître l’égalité». L’argument reposait essentiellement sur le constat qu’une société guidée par l’investissement et la consommation privés n’était pas en mesure de satisfaire la plupart des besoins sociaux. «Des revenus individuels élevés, écrit Tawney, ne permettront pas à la masse de l’humanité d’être immunisée contre le choléra, le typhus et l’ignorance, et encore moins de bénéficier des avantages positifs de l’éducation et de la sécurité économique».
Ce n’est que lorsque «la société commencera à pourvoir collectivement aux besoins qu’aucun individu ordinaire ne peut satisfaire lui-même, même en faisant des heures supplémentaires toute sa vie», qu’elle pourra «rendre accessibles à tous, quels que soient leur revenu, leur profession ou leur position sociale, les conditions de civilisation dont seuls les riches peuvent jouir en l’absence de telles mesures». Le but d’une politique égalitaire ne consistait dès lors pas à égaliser les revenus de consommation privés, mais à réorganiser la société sur une base telle que la logique du marché ne prédomine plus.
Socialistes de marché et néolibéraux partageaient l’idée que seul le système des prix pouvait aboutir à une organisation économique optimale.
Dans sa forme la plus radicale, une telle vision impliquait que la division du travail elle-même ne serait plus uniquement guidée par des choix des consommation et d’investissement privés. «L’argent dépensé dans l’alcool», écrivait le père de la sécurité sociale anglaise William Beveridge en 1944, «ne donne pas d’emploi au mineur, mais au brasseur ; l’argent dépensé pour le lait ne contribue pas à résoudre le problème de l’ingénieur au chômage». En ce sens, si l’on accepte que ce sont les choix de consommation privés qui doivent guider l’investissement, il serait alors logique, poursuit Beveridge que «le mineur doit devenir un brasseur et l’ingénieur un producteur de lait.». Bien sûr une telle transition ne s’opère jamais dans la réalité et se traduit généralement par des ajustements brutaux, laissant des zones géographiques entières dévastées par les mouvements du capital au niveau global. Bien que la vision de politisation du travail que Beveridge proposait ne verra jamais le jour dans le Royaume-Uni d’après-guerre, elle a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une société façonnée par la délibération collective plutôt qu’individuelle.
Planification et prix
Cette conception de l’égalité doit être comprise dans un contexte où la gauche avait l’ambition du plein emploi et n’hésitait pas, à cet effet, à mobiliser la puissance publique pour coordonner l’activité économique et diriger l’investissement et la production. Cette approche est très différente des théories sociales de marché, qui visent simplement une redistribution plus équitable des revenus et des richesses. Pour la gauche qui a construit l’État social en Europe, aucune agrégation décentralisée de choix de consommateurs atomisés ne pourra réaliser, en matière de bien-être collectif, ce que peut un État qui socialise la richesse pour le bien collectif et pour répartir équitablement le travail.
«La question de savoir si nous pouvons y parvenir», notait Beveridge, dépend de la mesure dans laquelle la «conscience sociale» peut devenir «la force motrice de notre vie nationale». À la place d’un système de prix, cette «conscience sociale» demandait qu’un «État contrôlé démocratiquement» soit habilité à garantir l’allocation des biens «conformément aux souhaits des citoyens». Sans surprise, le régime de protection sociale issu de la Seconde Guerre mondiale s’est appuyé sur une forte politisation des besoins et sur une vision normative de la «bonne société». S’attaquer aux causes de la misère humaine impliquait l’existence d’une société civile vivante et d’un réseau d’institutions telles que des syndicats, des partis ou des associations qui organiseraient les citoyens afin de traduire leurs besoins en demandes concrètes et collectives.
Si ce point de vue est resté dominant au sein de la social-démocratie au sens large jusqu’à la fin des années 50, il a toutefois été fortement contesté par les économistes. Le débat sur le socialisme de l’entre-deux-guerres avait érodé la légitimité de l’État en tant qu’allocateur de l’investissement. Le débat opposait les points de vue de l’économiste néolibéral Friedrich Hayek aux «socialistes de marché» tels qu’Oskar Lange et Abba P. Lerner. Même s’ils s’opposaient à propos de la propriété privée, socialistes de marché et néolibéraux partageaient l’idée que seul le système des prix pouvait aboutir à une organisation économique optimale. L’investissement ne devait pas être le résultat d’une délibération politique, mais résulter de l’agrégation de nos choix privés de consommation. Planning and the Price Mechanism de James Meade (1948) et ce qu’il appelait «la solution libérale-socialiste» constituera probablement la version la plus claire de cette perspective, soutenant que le système de prix était «parmi les plus grandes inventions sociales de l’humanité». Si l’égalité peut valoir la peine d’être poursuivie, les moyens d’y parvenir doivent être en accord avec les principes du marché. La planification et le contrôle du marché par l’État étaient, selon Meade, «voués à être maladroits, inefficaces et inutiles par rapport à un système de prix fonctionnant correctement».
Pour Meade, la meilleure façon de s’attaquer à la pauvreté passait alors par «une extension de l’utilisation du mécanisme des prix pour promouvoir une utilisation plus efficace des ressources associée à une redistribution socialement souhaitable des revenus». En d’autres termes, en disqualifiant toute définition politique des «besoins», seule une politique étroitement axée sur la redistribution des revenus pouvait garantir une allocation efficace des richesses en fonction de la grande variété de ce que les économistes appellent désormais les «préférences individuelles». Les besoins, au lieu d’être «constitués» par un processus démocratique, seraient «révélés» comme des choix sur un marché.
Socialisme de marché
C’est cette philosophie — l’idéal du socialisme de marché — qui a remplacé celle de la social-démocratie d’après-guerre. La fonction de l’État qui évalue les besoins a priori a été lentement remplacée par un ajustement a posteriori de la production résultant des échanges sur le marché. Cette approche permettrait de réaliser ce que l’économiste néolibéral Arthur Kemp avait appelé un «État social sans social». On diminue les écarts de revenus sans rien socialiser.
En termes de politique, cette évolution du marché, comme l’a montré Peter Sloman, a alimenté la croissance d’un «transfer state», un État qui limite son rôle à des transferts monétaires. Il y a eu moins de programmes d’emplois publics, de logements et de services publics et plus de réductions d’impôts, de crédits d’impôt et d’allocations sociales. Aux États-Unis, ce «keynésianisme modernisé» a fait une arrivée spectaculaire avec l’élection de John F. Kennedy en 1961. Le keynésianisme fiscal de son Council of Economic Advisers a poussé le président à rompre avec l’équilibre budgétaire, mais au lieu de lourdes interventions de l’État, il a été préconisé des réductions d’impôts afin de stimuler l’investissement privé et la consommation.
Le «keynésianisme réactionnaire» consiste à emprunter de l’argent au secteur privé et à le redonner aux entreprises et aux ménages pour qu’ils le dépensent.
Leur conception a marqué une rupture importante avec l’accent traditionnellement mis par les keynésiens sur l’augmentation des dépenses publiques. Si «des emplois, des écoles plus nombreuses et de meilleure qualité sont certainement les solutions les plus attrayantes», écrivait l’économiste James Tobin, «les employeurs privés et les marchés libres font une grande partie du travail […] sans dépense publique et sans bureaucratie gouvernementale». Le principe central de ce que John Kenneth Galbraith a appelé un «keynésianisme réactionnaire» consistait à emprunter de l’argent au secteur privé et à le redonner aux entreprises et aux ménages pour qu’ils le dépensent.
Même pendant les deux administrations Reagan, les programmes d’aide au revenu, les allocations de chômage et les coupons alimentaires ont été plus ou moins épargnés par les coupes d’austérité — alors que la construction de logements publics a été décimée. Reagan a considérablement réduit le budget du ministère du Logement et de l’urbanisme et a introduit à la place un nouveau système de primes au logement. Comme l’a fait remarquer Paul Pierson, il est passé de la subvention de briques à la subvention de personnes. Il a réduit de 80% le nombre de nouveaux projets et a fortement encouragé la privatisation des projets existants, en donnant de l’argent à des individus pauvres ciblés au lieu d’adopter une approche systémique de la pauvreté. Au Royaume-Uni, cette tendance a été encore plus radicale avec la loi sur le logement de 1980 qui permettait aux locataires de logements sociaux d’acheter leur maison à l’autorité locale tout en arrêtant toute nouvelle construction de logements publics au profit d’allocations de logement. Le résultat a été une pénurie dramatique de logements abordables, avec des millions de personnes inscrites sur des listes d’attente interminables.
Cette «révolution fiscale» a marqué une évolution significative dans le domaine de l’économie, qui allait peu à peu rendre moins importante la distinction entre keynésiens et non-keynésiens. C’est le point de départ de ce que l’économiste britannique John Kay a appelé le «libéralisme de marché redistributif». Cette approche a rapidement cimenté, au sein d’une social-démocratie modernisée, une conception de la politique sociale dans laquelle «l’État doit avoir un rôle dominant en matière de distribution des revenus, mais doit s’acquitter de cette responsabilité en interférant le moins possible dans le fonctionnement du libre marché». Elle a marqué, en somme, la consolidation d’un centre autour duquel un large consensus économique a pu être établi.
L’internationale de la Troisième voie
Dans cette nouvelle conception, l’État n’a pas vocation à être un véritable agent économique. Il s’agit plutôt d’établir les règles de la concurrence méritocratique. Il doit s’occuper d’ajuster les règles du jeu sans pour autant y prendre part. «Le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour soutenir l’entreprise», écrivaient Tony Blair et Gerhard Schröder dans leur manifeste, «mais il ne doit jamais se substituer à elle». Dans les années 90, cette «troisième voie» a pris d’assaut les partis socialistes en Europe et le parti démocrate aux États-Unis, tout en réformant radicalement l’administration par le biais du «New Public Management». Les privatisations, les cadeaux fiscaux, et la sous-traitance des services publics à des entrepreneurs privés ont créé un «Léviathan par procuration», dépensant plus, mais employant de moins en moins de fonctionnaires.
La pauvreté est réduite à un manque d’argent plutôt qu’à un manque de services auxquels l’État pourrait répondre.
Aux États-Unis, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y avait environ 200000 fonctionnaires fédéraux de plus lorsque Ronald Reagan a entamé son second mandat en 1984 que lorsque Obama a quitté le sien en 2016, alors que les dépenses publiques ont considérablement augmenté au cours de la même période. Au Royaume-Uni, la situation est encore plus dramatique: l’emploi dans le secteur public a culminé à 7 millions juste avant Thatcher, pour tomber à moins de 5,5 millions aujourd’hui, alors que la population active s’est considérablement accrue.
Cette «forme antiétatiste de gouvernement», comme l’a appelée le politologue John Dilulio, a fortement accéléré la méfiance du public envers l’État. Comme l’a montré Wolfgang Streeck, les attentes à l’égard de ce que la politique pouvait accomplir se sont lentement «érodées» et les «structures organisationnelles nécessaires pour développer une demande publique efficace» se sont «atrophiées sans retour en arrière possible». Ce déclin d’une conception politique de l’égalité impliquait aussi, et peut-être plus dramatiquement, comme le note Streeck, «une démobilisation sur le front le plus large possible de tout le mécanisme de participation et de redistribution démocratique de l’après-guerre». Dans ce que l’on a appelé la «post-démocratie», la participation massive des partis, des syndicats et des organisations de la société civile a cédé la place à la frustration, à l’apathie politique et à une conception anémique de ce que T.H. Marshall avait autrefois appelé la «citoyenneté sociale».
Le virage idéologique vers le marché a eu des résultats économiques spectaculaires, mais aussi de graves conséquences politiques. Alors que les institutions sociales et les services publics envisagés par des personnes telles que Marshall étaient soumis à la délibération publique et représentaient un moyen pour la société de façonner son propre destin, la réduction de la politique sociale à la distribution des revenus a «vidé» l’idée d’égalité de tout contenu démocratique. On ne peut confier au marché les décisions les plus importantes relatives à notre vie quotidienne, et de la société en général, sans porter atteinte à l’idée même de démocratie. «La souveraineté du marché», comme l’écrivait l’historien Éric Hobsbawm, «n’est pas un complément à la démocratie libérale: c’est une alternative à celle-ci». En fait, ajoutait-il, il s’agit d’une «alternative à tout type de politique, car elle nie la nécessité des décisions politiques», «la participation au marché remplace la participation à la politique. Le consommateur prend la place du citoyen».
La fin de la fin de l’histoire
Ce déplacement du rapport entre la politique et l’économie est également ce qui explique, plus récemment, le succès croissant d’idées telles que l’allocation universelle. Dans une société atomisée, il est plus facile de répondre à la détresse sociale de manière abstraite, au travers de transferts monétaires, qu’en politisant les besoins sur une base collective. La pauvreté est alors réduite à un manque d’argent plutôt qu’à un manque de services auxquels l’État pourrait répondre. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que le succès des partis populistes qui a suivi la crise de 2008 ait accéléré ce processus. S’opposant aux organes intermédiaires ainsi qu’à la «bureaucratie» de l’État social classique afin de s’adresser à un peuple abstrait, ces formations ont toutes surfé sur la popularité du «cash». Dans une société où les demandes sont de plus en plus hétérogènes, la politique sociale privilégiée se fait sous le signe d’une privatisation du débat sur les besoins.
«La souveraineté du marché», comme l’écrivait Éric Hobsbawm, «n’est pas un complément à la démocratie libérale: c’est une alternative à celle-ci».
Cette question est d’autant plus pressante aujourd’hui que la crise sanitaire à laquelle le monde a été confronté depuis début 2020 a mis en relief toutes les carences en matière d’investissements publics. Et si les larges transferts monétaires qui sont promus des États-Unis à l’Europe peuvent sans aucun doute éviter le pire, ils ne sont pas à même de nous fournir les emplois nécessaires pour faire face à la crise tant sanitaire qu’économique. Aucune agrégation spontanée des désirs individuels ne nous offrira les maisons de repos modernisées requises pour faire face au vieillissement de la population, les aides-soignants supplémentaires pour étendre les soins à domicile, ou les investissements requis pour une transition écologique. Ces questions nécessitent un choix politique conscient, délivré des illusions d’un consommateur souverain omnipotent.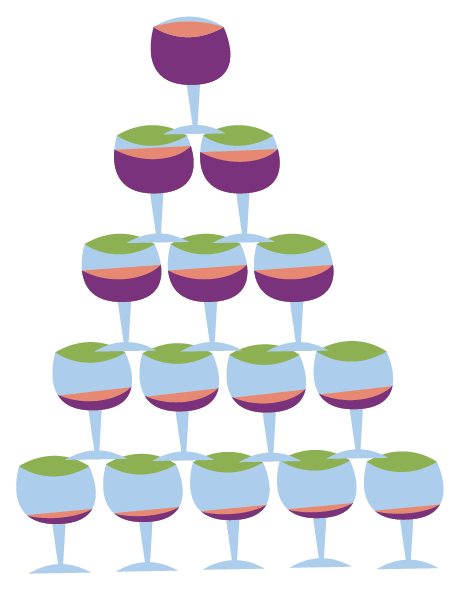
En effet, le temps des citoyens apathiques, plus concentrés sur leur vie privée que sur les affaires publiques, pourrait bien toucher à sa fin. Le «détrônement» du demos prôné par les néolibéraux semble s’éloigner et avec lui, une conception technocratique de l’égalité. À l’ère de Trump et du Brexit, une simple augmentation du pouvoir d’achat ne permettra pas un retour à la «normale». Ce n’est qu’en réinvestissant politiquement l’idéal égalitaire et, comme Beveridge l’avait soutenu, en limitant la force de «l’entreprise privée» en tant que «pouvoir souverain indépendant de l’État» que le socialisme peut offrir une véritable fin à la fin de l’histoire.




