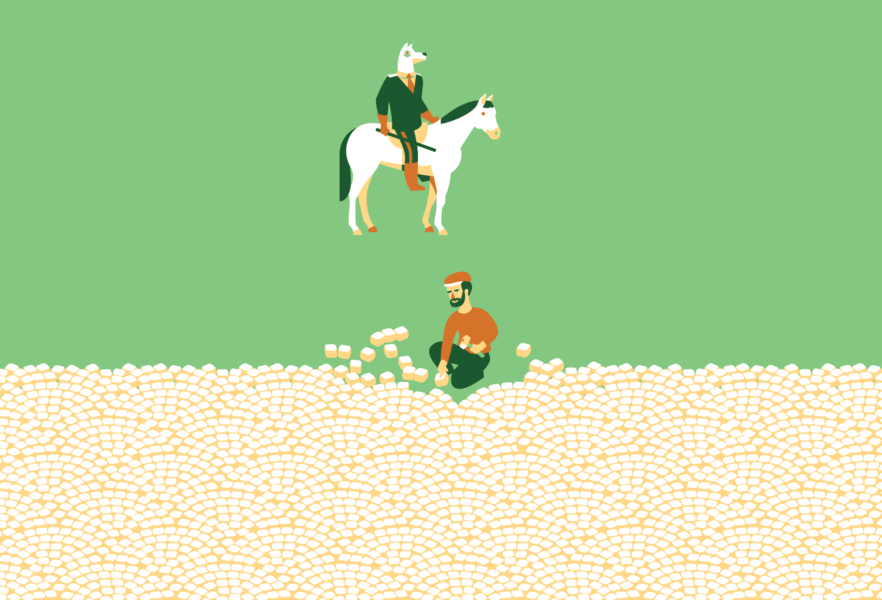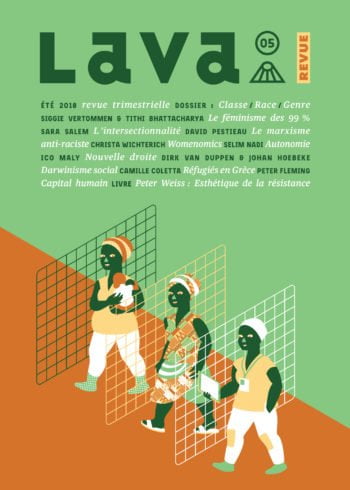Alors que la crise des migrants ne fait plus l’actualité, ils sont des milliers, bloqués sur les îles grecques, dans l’incertitude la plus totale.
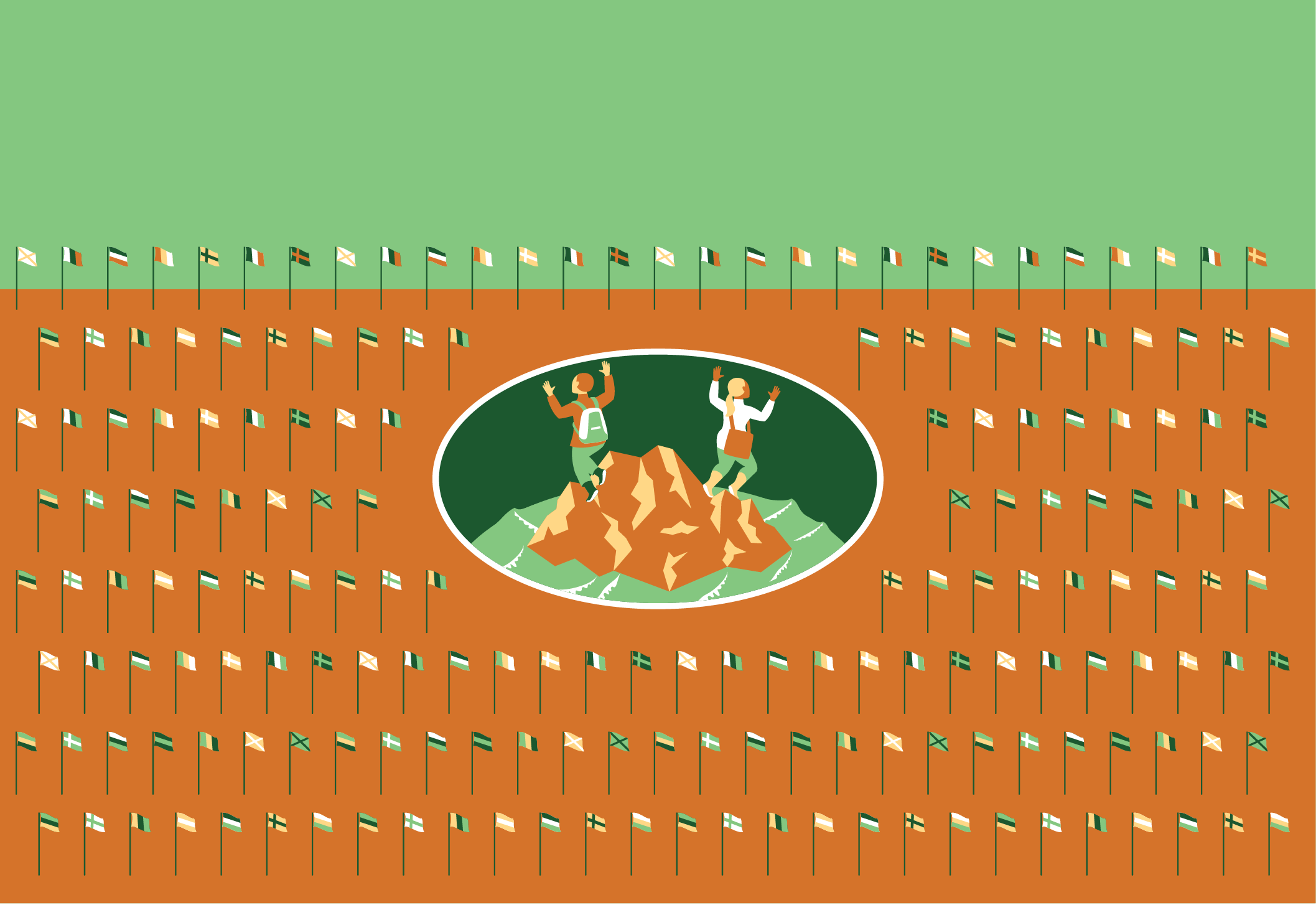
L’exil forcé d’Ulysse, roi d’Ithaque, hors de son île et loin des siens constitue probablement l’un des récits les plus emblématiques de la littérature occidentale. Il sera l’une des formulations les plus profondes du sentiment d’exil et de la nostalgie qui l’accompagne, de la douleur causée par l’impossibilité du retour. Si cette épopée a tant retenti dans l’esprit des peuples européens c’est peut-être aussi parce que son continent a été le théâtre d’immenses guerres et de conflits ayant fait de cet exil une expérience collective qu’il est difficile d’effacer des mémoires. Pourtant, si le récit d’Homère nous parle encore aujourd’hui, c’est peut-être désormais moins pour ceux qui habitent en Europe que pour ceux qui s’y échouent. Les images d’exil qui nous viennent à l’esprit sont moins celles des milliers d’opposants, de juifs, de résistants fuyant sur les routes l’extension de « l’espace vital » allemand que celles de l’arrivée, sans répit, des milliers de réfugiés sur les îles grecques à bord de frêles bateaux gonflables. On s’imagine également très clairement l’amoncellement des gilets de sauvetage – que l’on pouvait « visiter » près du petit village de Molyvos – évoquant paradoxalement plus une œuvre d’art contemporaine qu’un drame en cours. Pourtant, ces images qui sont passées en boucle sur les écrans de télévision, ont désormais laissé place à un silence, une attente qui n’en finit pas de se prolonger. Si auparavant ces îles n’étaient qu’un lieu de transit lors des arrivées massives de demandeurs d’asile, elles sont devenues l’endroit où ils restent « coincés » pendant leur procédure depuis que l’accord entre l’Union Européenne et la Turquie a été signé.
Ces images, qui sont passées en boucle sur les écrans de télévision, ont désormais laissé la place à un silence, une attente qui n’en finit pas de se prolonger.
Cette déclaration a été signée le 18 mars 2016. L’objectif était très clair : stopper les arrivées des migrants de la Turquie1 vers la Grèce. La Turquie, qui accueille déjà trois millions de réfugiés, est considérée comme un pays sûr et l’UE a déboursé trois milliards d’euros afin qu’elle puisse gérer l’aide humanitaire. La Turquie peut également, en contrepartie, renégocier son adhésion à l’UE et bénéficier d’un allègement des obligations pour les citoyens turcs qui voudraient séjourner en Europe. Au cœur de l’acte, on trouve que tout demandeur d’asile dont la demande est jugée irrecevable en Grèce se verra renvoyé en Turquie. Ainsi, si les demandeurs d’asile sont coincés sur les îles, c’est parce que, si on les bouge vers le continent, ils ne pourront plus être envoyés en Turquie par la suite. Il faut que leur enregistrement, mais aussi leur admission (et l’éventuel renvoi vers la Turquie pour ceux qui ne sont pas admis) se fasse sur l’île où ils sont arrivés par bateau.
La « détention » de l’asile
Cette situation, dans des conditions de vie extrêmement pénibles, est d’autant plus difficile que l’incertitude est totale : les demandeurs d’asile n’ont aucune maîtrise sur leur futur. En effet, le plus difficile pour certains d’entre eux est de ne pas savoir combien de temps ils passeront à Moria, le principal camp sur l’île de Lesvos. Et ce temps est un temps « perdu », un temps d’incertitude et d’attente. En effet, ces espaces légaux où les migrants sont bloqués sont des lieux d’incertitude, où l’information est toujours entourée d’indétermination quant à l’avenir, rapprochant l’expérience du temps à celle des espaces pénitentiaires. En effet, si les demandeurs d’asile ne sont pas des « détenus » au sens propre du terme, le régime de leur immobilisation en a quasiment toutes les caractéristiques. Sur un plan légal, il est fréquent de rencontrer des réfugiés ne sachant pas qu’ils ont droit à une assistance légale gratuite ou qu’après leur deuxième refus, ils ont 10 jours pour faire appel. Les organisations légales venant en aide aux demandeurs d’asile sont complètement dépassées et puisque la plupart d’entre elles dépendent de volontaires, elles ne peuvent pas faire un suivi à long terme des dossiers. Certains demandeurs d’asile voient leur avocat changer après quelques semaines ou ne savent même plus qui est en charge leur dossier. Chaque semaine, les leaders des différentes communautés soulignent ces nombreux problèmes connus des autorités… mais sans changement en vue.

Cependant, si Moria est régulièrement dépeint en termes pénitentiaires, c’est un pénitencier d’un genre particulier. Ancienne base militaire de l’île de Lesbos, elle s’est transformée en zone d’accueil provisoire pour demandeurs d’asile en 2015. Le camp a une capacité de 2.300 places mais, en décembre 2017, ce sont plus de 7.000 personnes (dont deux tiers de femmes et d’enfants principalement venus de Syrie et Irak) qui vivaient entre des fils barbelés et d’énormes grilles telles que celles qu’on peut voir à l’entrée de prisons. Pourtant, dans ce cas, on n’empêche pas tant ceux qui sont à l’intérieur d’en sortir que le regard extérieur d’y pénétrer. Si les réfugiés ont le droit de déambuler librement sur l’île, il est presque impossible pour un citoyen d’observer le camp de l’intérieur. Au fond, le dispositif semble dans une grande partie être dirigé contre ce regard extérieur. La police est à chaque entrée et un contrôle d’identité a systématiquement lieu. Cette entrée est dès lors impossible pour un simple bénévole. Quant à la presse ou aux organisations humanitaires reconnues, elles n’y ont éventuellement accès – arbitraire oblige – qu’après avoir préalablement demandé une autorisation spéciale aux autorités du camp. Cette difficulté ne trouve aucune justification raisonnable hormis celle, bien moins reluisante, de limiter l’exposition au grand jour des conditions de vie épouvantables que cachent ces camps. L’existence même de ceux-ci, ainsi que leur ampleur à l’intérieur de l’Union Européenne, gêne visiblement.
Des conditions de vie épouvantables
Dans la convention de Genève, la dignité de tout demandeur d’asile est censée être respectée. Vu le surpeuplement au sein du camp, 3.000 personnes, n’ayant pas de place dans les containers, dorment dans de petites tentes d’été que la pluie transperce rapidement, rendant les personnes vivant dans ces conditions incapables de se protéger de l’hiver.
Les espaces légaux où les migrants sont bloqués sont des lieux d’incertitude rapprochant l’expérience du temps à celle des espaces pénitentiaires.
Chaque nuit à Moria, des affrontements ont lieu entre différents groupes. Les familles ont peur pour leurs enfants, ils ne peuvent pas dormir et n’osent pas sortir par crainte de se retrouver au milieu d’une rixe. Les toilettes sont dans un état difficilement descriptible, il n’y a pas d’eau courante, elles ne sont pas nettoyées régulièrement et surtout, il n’y en a pas assez (elles ne sont prévues que pour 2.300 personnes). Les femmes ont peur de s’y rendre lorsqu’il fait noir. « J’ai peur d’être violée » confiait une femme d’origine Afghane. En effet, aucune lumière n’éclaire les structures sanitaires et c’est souvent près d’elles que les violences sexuelles se déroulent. Dès lors, une organisation a décidé de distribuer des langes afin que les femmes n’aient pas à sortir de leur tente la nuit. Cette mesure, qui semble pour le moins indigne et inadaptée, reflète pourtant l’économie du bricolage qui règne dans le camp et la souffrance totalement inutile qu’elle génère. En effet, pourquoi ne pas augmenter le nombre de toilettes et de douches et mobiliser des gardes ou la police auprès des sanitaires plutôt qu’à l’entrée des camps ? Si l’incertitude, l’arbitraire des procédures et la crainte d’une déportation constituent le cœur de ce qui caractérise ce régime particulier de détention, ce sont pourtant ces petites humiliations invisibles qui en façonnent l’expérience quotidienne.
En se promenant dans le camp, on peut entendre régulièrement grommeler « Moria no good ». Les habitants doivent se battre pour tout : obtenir de l’eau potable, de la nourriture, des vêtements chauds, trouver un avocat, dormir autre part que dans des tentes, et puis par après, sortir de Moria pour rejoindre, à pied, les petites villes environnantes. Consulter un médecin est un parcours du combattant pour les adultes, des files se forment à partir de 5 heures du matin et seulement certains cas graves sont pris en charge. Il n’y a pas suffisamment de nourriture pour les demandeurs d’asile qui doivent en moyenne faire une heure de file pour leurs repas. L’eau est un bien rare : il n’y a d’eau courante que deux à trois heures par jour. Lorsqu’elles doivent aller aux toilettes les personnes doivent se munir de bouteilles d’eau afin de manuellement « tirer la chasse ». A côté des toilettes, on peut trouver d’énormes tas de bouteilles d’eau vides, vestiges des conditions déplorables dans lesquelles les habitants sont plongés. Le ramassage des poubelles est bancal, la puanteur et la saleté règnent dès que l’on approche du camp. Ces derniers mois, plus de 40 % des arrivées étaient des familles avec enfants qui n’ont même pas accès à la scolarité (ce qui est contraire à la Déclaration des Droits de l’Enfant).
« Moria me rend malade » relatait un demandeur d’asile. « Je suis arrivé pour demander une protection internationale et j’étais en bonne santé. Mais, déjà après quelques jours, tu commences à te sentir mal ici. Ce camp, c’est l’enfer. Ce camp te rend fou ». Les problèmes de santé mentale sont ici non seulement le produit de parcours parfois difficiles et traumatisants, mais également des conditions du camp lui-même. La précarité dans laquelle sont plongées ces personnes a forcément des conséquences sur leur santé mentale (stress, fatigue, etc.) et physique (dormir par terre dans le froid sans vêtements adaptés en hiver). Le fait qu’elles ne se sentent pas en sécurité, qu’elles ne disposent d’aucune activité, qu’elles ne voient aucun futur proche, les rend encore plus vulnérables.
Les vulnérabilités, seuls moyens d’accès au reste de la Grèce
Tout demandeur d’asile arrivant en Grèce doit, après avoir été enregistré par la police, passer un entretien médical au cours duquel il peut être reconnu comme « vulnérable2 ». Les critères de vulnérabilité sont au nombre de sept3, mais ce screening est bancal et de nombreuses personnes ne sont pas reconnues comme telles alors qu’en réalité elles le sont. « Cet entretien a été très rapide et je n’ai pas osé parler de la torture que j’ai subi au pays » confiait un Congolais. « J’ai pensé qu’il valait mieux cacher le fait que j’étais malade, j’avais peur d’être renvoyé chez moi » relatait un homme venant d’Irak. « J’ai été victime de plusieurs viols au Cameroun, mais aussi en Turquie où j’ai passé plusieurs mois, comment confier cela lors de cette visite médicale devant un médecin homme ? » nous expliquait une jeune femme. Médecins Sans Frontières annonçait, dans son dernier rapport sur la santé mentale des demandeurs d’asile à Lesvos, que seulement un tiers des survivants de violences sexuelles avaient été identifiés en tant que vulnérables. l’incertitude sur les conditions, les critères ou les démarches participe dès lors à une volonté de limiter les réponses positives.

Par ailleurs, on peut également s’interroger sur l’usage du critère de « vulnérabilité ». Ce sont les institutions qui, en identifiant arbitrairement ces vulnérabilités en tant que « moyen d’atteindre le continent grec », leur ont donné une existence dans l’espace public. Ici encore, on met en avant la « raison humanitaire4 » et on refoule le droit d’asile au second plan. Ceux qui « souffrent » d’une des sept vulnérabilités sont donc « plus importants » que ceux dont la vie est menacée dans leur pays d’origine. Pour accéder au continent européen, il est indispensable de montrer que l’on est souffrant ; la douleur doit ressortir dans son récit. Le « bon » réfugié est en effet celui qui a « vraiment » souffert. Il doit dès lors se mettre en scène et « vendre » son histoire qui doit être la plus « terrible » possible. Ces procédures faussent dès lors toute interaction entre le demandeur d’asile, qui doit faire l’aveu de sa souffrance et l’institution, qui doit évaluer la sincérité de celui-ci. Ainsi, comme Didier Fassin le remarque, une logique « liée à la reconnaissance de l’autre par la souffrance, le malheur, le corps, la survie, supplante un droit du citoyen5 ». Plutôt que droits de l’Homme, on devrait plutôt parler de droit du souffrant. Ceci assigne les réfugiés à une position de « victime », de « requérant » devant montrer leurs stigmates afin de pouvoir accéder au continent. Si les humains ont une capacité gigantesque à pouvoir survivre et se remettre d’évènements traumatisants, il n’est cependant pas inutile de se poser la question de la conséquence que peut avoir l’injonction constante faite aux demandeurs d’asile de se présenter en tant que victimes. Quelle image d’eux-mêmes peuvent avoir des femmes et hommes qui supplient et doivent exhiber chaque part de leurs souffrances comme témoignage de leur sincérité ? On est très loin de la convention de Genève et de la justice pour les demandeurs d’asile.
La privatisation de l’action publique
Enfin, l’une des questions les plus évidentes qu’on est en droit de se poser, réside dans les causes d’une telle faillite de l’action publique. Comment est-il possible de ne pas arriver à gérer 8.500 demandeurs d’asile ? Ce ne sont désormais plus 5.000 personnes arrivant chaque jour mais plutôt une centaine d’arrivées hebdomadaires en moyenne depuis quelques mois. Est-il vraiment impossible d’accueillir ces demandeurs d’asile dans des conditions dignes de ce nom ?
Le ramassage des poubelles est bancal, la puanteur et la saleté règnent dès que l’on approche du camp.
A Moria, de nombreuses organisations tentent de panser les besoins des demandeurs d’asile. Si auparavant elles recevaient des fonds de l’Union Européenne (ECHO), ces fonds se sont épuisés et de nombreuses ONG ont dû quitter l’île ou réduire leurs effectifs. Au sein du camp, les habitants ne savent pas « qui fait quoi ». Les organisations elles-mêmes sont débordées et essayent d’envoyer leurs bénéficiaires d’une organisation à l’autre en espérant que ceux-ci trouveront ce qu’ils veulent quelque part, toujours plus résignés, fatigués et cernés. Fin décembre 2017, l’État grec était supposé, via les fonds qui lui ont été octroyés par l’Europe, reprendre toutes les responsabilités et être opérationnel sur les îles. Malheureusement, aujourd’hui, de nombreuses organisations y sont toujours présentes et continuent à pallier l’absence de l’État. Mais ne serait-ce pas à la Grèce et à l’Union Européenne de gérer l’accueil des demandeurs d’asile ? Sur place, on voit que le système de santé national (KEELPNO), qui est financé et devrait gérer totalement la prise en charge des réfugiés, est débordé et incapable de répondre aux besoins. Cette confusion et cette difficulté de pointer des responsables (qui est responsable de quoi ?) rend non seulement la contestation et l’action des réfugiés plus complexes, mais rend également le travail des organisations de terrain très difficile. Chaque organe renvoie la faute à l’autre dans une symphonie bureaucratique. Vous entendez dire de la part des fonctionnaires grecs que c’est « l’UNHCR qui est en charge pour tel problème » et l’UNHCR vous répondre l’inverse.
Pour une politique de droits
Cela fait bientôt plus de trois ans que cette crise a commencé, selon les données officielles de l’UNHCR, 1.294 personnes ont été transférées de l’île depuis début 20186. Afin de permettre des conditions de vie dignes, la solution la plus évidente serait d’envoyer tous les demandeurs d’asile sur le continent afin qu’ils aient accès à des soins de santé, à une aide juridique et à un logement. Cette situation n’est dès lors pas le fruit du hasard, la volonté cachée de nos institutions est de faire comprendre de manière détournée aux réfugiés qu’ils ne sont pas les bienvenus. qu’avoir traversé la mer, au péril de leur vie et de celles de leurs enfants, ne suffira pas à leur octroyer un accueil digne. Ici encore, les politiques croient qu’en bafouant le droit à l’asile, les réfugiés transmettront le message à leurs proches de ne pas se rendre en Europe. C’est sans compter sur le fait que leur pays sont détruits (pour certains par des interventions enclenchées par des pays de l’Union), que fuir est leur seule solution pour survivre. Ainsi, ces politiques, aussi inhumaines et fermes soient-elles, n’empêcheront jamais ces familles de rejoindre les terres européennes.

Une vraie politique de relocalisation devrait être appliquée à tous les pays européens. En effet, le flux de demandeurs d’asile ne devrait pas être pris en charge par la Grèce (et l’Italie) seule, mais des quotas conséquents devraient être implémentés pour chaque pays. À la question de « comment sensibiliser à la problématique », il est désormais fondamental de ne plus se focaliser sur la compassion. Depuis la photo du petit Aylan, plus rien ne peut « choquer » les citoyens européens. Comme Didier Fassin le souligne, la « fatigue compassionnelle » mène à une indifférence à l’égard de la situation des demandeurs d’asile. Celle-ci, et la tendance plus générale depuis quelques décennies à traduire les politiques sociales dans les termes de la compassion, fait en réalité partie du problème. Comme le précisait l’historien et sociologue Gérard Noiriel, « ce n’est pas parce que les gens pleurent le soir parce qu’ils ont vu un enfant réfugié abattu ou tué que le lendemain ils vont ouvrir leur porte à des réfugiés. Le droit d’asile est une notion éminemment politique qui engage la souveraineté de l’État7 ». C’est de sa dépolitisation qu’il est nécessairement question. Si les réfugiés sont désormais assignés au statut de victimes, ce sont les états qui restreignent le débat public à sa dimension humanitaire, plutôt que d’en faire un enjeu de citoyenneté.
Footnotes
- La Turquie a signé la Convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés mais uniquement pour les citoyens de l’Union Européenne.
- Selon l’Article 60 paragraphe 4 de la loi 4375/2016, les personnes étant reconnues vulnérables sont exemptées des border procedures. Procédures administratives à la frontière ?
- Selon l’Article 14 paragraphe 8 de la loi 4375/2016, les personnes doivent être reconnues comme vulnérables si elles sont : mineurs non accompagnés ; personnes ayant un handicap ou souffrant d’une maladie sérieuse ou incurable ; les personnes âgées (plus de 65 ans) ; les femmes enceintes ou ayant des enfants de moins de 6 mois ; les parents célibataires avec des enfants mineurs ; les victimes de torture, de viol ou d’autres sérieuses forme de violence psychologique, physique, sexuelle ou d’exploitation ; les personnes avec syndrome post traumatique, en particulier les survivants et proches des victimes de naufrage ; les victimes de la traite des êtres humains. En décembre 2017 les autorités ont décidé de supprimer le critère de personnes avec syndrome post traumatique.
- Didier Fassin, « La souffrance du monde. Considérations anthropologiques sur les politiques contemporaines de la compassion », l’Evolution psychiatrique, 67/4, 2002, p.677.
- Ibid., p.687.
- http://blog.refugee.info/transfers-from-the-islands-fr/
- Interview de Gérard Noiriel, « Pour une histoire populaire », Lava, 21 avril 2017.