Au fil des commémorations, la dimension ouvrière de Mai 68 tend à s’effacer. Pourtant, dans les exemples français et italien, cette composante fut essentielle.
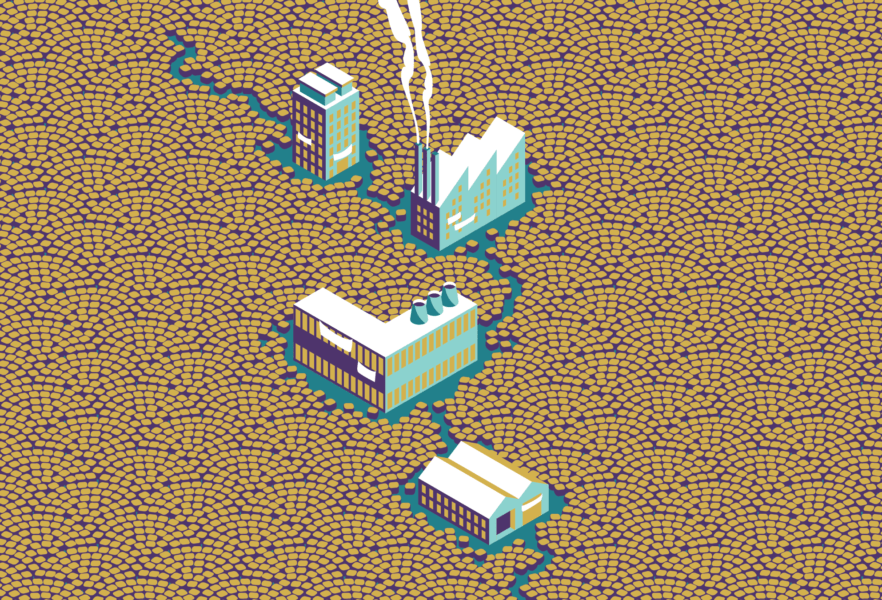
La comparaison entre les mouvements de grèves en Italie et en France apparaît dès le début des années 70, quand les militants français, notamment d’extrême gauche, s’intéressent à la situation italienne. Cette comparaison traditionnelle s’est, depuis, figée dans une opposition entre un « Mai 68 » français ( court, essentiellement étudiant, plutôt pacifique ), et un « mai rampant » italien ( long, plus ouvrier et marqué par la violence puis le terrorisme ). L’introduction depuis une vingtaine d’années dans l’historiographie française de la notion d’ « années 681 », qui fait de 1968 un pivot dans une chronologie plus ample, invite cependant à reconsidérer une telle opposition. Loin de constituer un éphémère feu de paille, les grèves ouvrières de mai-juin 1968 en France ouvrent en effet au plan national un cycle d’insubordination qui court jusqu’en 1979. C’est cette thèse que nous entendons défendre au travers de l’analyse des grèves ouvrières de mai-juin 1968 en France2.
Un mouvement de grèves exceptionnel
Le caractère exceptionnel du mouvement tient à son ampleur, laquelle se décline selon trois modalités principales. La plus manifeste est sa durée.
Le mouvement de grèves commence avec la journée de grève générale du 13 mai, appelée par l’ensemble des organisations syndicales pour protester contre la répression policière à l’encontre des étudiants lors de la « nuit des barricades » du 10 au 11. Le lundi 13 donc se déroulent plus de 450 manifestations dans tout le pays, avec des effectifs fournis dans les villes ouvrières. Mais la mobilisation se traduit d’abord par la grève. Faute d’évaluation nationale, des éclairages locaux témoignent d’une grève bien suivie dans le Nord et la région parisienne, à la différence de l’Est. De nombreux ouvriers se sont mobilisés pour une journée qui fonctionne comme un coup d’envoi.
À partir du 13 mai en effet grossit une vague de grèves sans précédent qui gagne tout le pays et la grève devient généralisée. Le mois de juin est marqué par un lent reflux de la grève qui s’étire dans la métallurgie, et ce, en dépit des consignes syndicales, d’une mise en scène de la reprise du travail et d’interventions répétées des forces de l’ordre. Ainsi, les grèves ouvrières s’étirent sur près de deux mois. Il faut donc bien appeler ce mouvement « mai-juin 1968 ».
Le caractère clairement national du mouvement contribue également à sa durée, et participe à son ampleur. Nulle région française ne demeure à l’écart de la grève, même si la mobilisation peut varier ici ou là. Cette large diffusion géographique du mouvement constitue l’un des effets paradoxaux de la décentralisation industrielle initiée à partir de 1955. Le mouvement concerne cependant au premier chef les grands bastions industriels, le Nord et le Pas-de-Calais par exemple, ou la banlieue parisienne entièrement paralysée par la grève. Mais la nouveauté est l’éclosion du mouvement dans des régions plus improbables, comme à Cannes, dans la zone industrielle de La Bocca.
Cette mobilisation nationale implique l’ensemble des branches industrielles, par-delà les grandes corporations masculines, comme la métallurgie ou les mines. La chimie comme le textile, l’électronique comme l’alimentation sont touchées par le mouvement, qui saisit par conséquent aussi de nouveaux ouvriers et ouvrières, en ces années d’industrialisation soutenue. Au total, sept millions de salariés sans doute se mobilisent par la grève dans ces semaines fiévreuses, dont la moitié d’ouvriers, ce qui fait de 1968 la vague de grève la plus puissante de l’histoire du pays.
Le mouvement de mai-juin 1968 se singularise également par son répertoire d’actions, qui présente deux éléments caractéristiques. Les ouvriers occupent tout d’abord leur usine. Mais, l’occupation des locaux de travail, comme violation de domicile, demeure interdite. Elle constitue une prise de contrôle d’un territoire sans et contre une direction d’entreprise. Au départ, dans une logique de « grève éclair », l’occupation vise à empêcher un lock-out ou la poursuite du travail par les « jaunes ». Mais, avec la généralisation du mouvement, son « sens » s’infléchit : elle s’inscrit alors dans la constitution d’un rapport de forces au plan national qui vise à obtenir des concessions patronales majeures dans les négociations interprofessionnelles ou de branche. Mieux, l’occupation encourage les rêves éveillés d’instauration d’un pouvoir ouvrier dans les usines, d’autant qu’elle autorise des expériences limitées de poursuite ou de reprise de l’activité, comme à l’usine Perrier de Montigny-le-Bretonneux en région parisienne.
Les occupations s’accompagnent, dans un premier temps, de séquestrations. Le 14 mai en effet, les ouvriers de Sud-Aviation poursuivent la grève, séquestrent le directeur de l’usine et cinq de ses collaborateurs, pendant quinze jours. Dès le lendemain, lorsque les métallurgistes de Cléon débrayent, ils recourent au même moyen d’action. La séquestration semble ainsi se diffuser et constituer le corollaire de l’occupation. C’est particulièrement le cas en Seine-Maritime, mais aussi à Orléans ou dans l’Aisne ou le Nord. Ainsi, le mouvement dans sa composante ouvrière est radicalisé. Il faut en prendre la mesure, tout en l’inscrivant dans la longue histoire du mouvement ouvrier.
Un mouvement dans la tradition ?
L’inscription de 1968 dans la tradition se marque d’abord par le poids d’un fonctionnement délégataire qui connaît une triple déclinaison en 1968. Les délégués du personnel jouent un rôle crucial : élus, ils ont aussi conquis leur légitimité dans des affrontements antérieurs de la sorte. Tout naturellement, il leur appartient de rédiger des cahiers de revendications. De même, il échoit au comité de grève d’organiser l’occupation, c’est-à-dire tout à la fois de surveiller l’usine mais aussi d’occuper les occupants, y compris par des activités sportives ou artistiques. Il prend en charge la liaison avec les usines voisines, la bourse du travail, l’union locale, etc. Il appartient enfin aux organisations syndicales de négocier d’abord à l’échelon national et sur un plan interprofessionnel, puis par branches.
En mai-juin 1968, ce fonctionnement délégataire est hégémonique. La grève demeure largement sous la conduite des spécialistes, même si leur profil sociologique ne correspond qu’approximativement, voire difficilement, par leur âge, leur sexe, leur qualification, leur nationalité, avec la masse des ouvriers et des ouvrières. Cette mainmise syndicale sanctionne une certaine désertion des ouvriers, en même temps qu’elle l’amplifie probablement. De fait, la présence ouvrière au cœur des occupations se fait parfois évanescente. Certains fuient l’usine, parce qu’ils ne la supportent pas ; d’autres en profitent pour prendre des vacances ou pour découvrir d’autres lieux ou d’autres occupations. Les ouvriers paysans enfin consacrent la grève à travailler sur leurs exploitations. À Peugeot-Sochaux, de nombreux ouvriers continuent de vivre loin de l’usine automobile et conservent une petite exploitation. Une telle situation explique que les effectifs occupant l’usine fondent à… 37 lors du week-end de l’Ascension, et ne rassemblent guère au-delà de 300 militants alors que les usines rassemblent près de 17 000 ouvriers.
La prégnance de cette tradition délégataire confère une importance particulière aux négociations tripartites qui s’engagent au ministère des Affaires sociales du 24 au 27 mai, entre les représentants de l’État et les délégations syndicales et patronales. Le compromis est en demi-teinte. Parmi les acquis les plus importants figurent un fort relèvement du salaire minimal dont la hausse est portée à 35 % et la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise. Pour le reste, le gain est des plus mesurés : il n’y a guère de diminution de la durée hebdomadaire du travail et l’augmentation des salaires ( 7 % en juin et 3 % en octobre ) s’avère très modérée si on la compare aux 6 à 7 % obtenus les années précédentes. Surtout, les négociations n’envisagent jamais la plus minime transformation des rapports sociaux ou de l’organisation du travail.
Malgré ces résultats modérés et face à un mouvement qui tend à lui échapper, Georges Séguy présente le constat de Grenelle comme significatif et pèse à l’instar d’autres dirigeants de la CGT en faveur d’une reprise du travail3. Cette pression se confirme et s’accentue sitôt la dissolution de l’Assemblée nationale décrétée par le général de Gaulle le 30 mai. De fait, la CGT et la CFDT encouragent la reprise du travail. Ces pressions récurrentes nourrissent le constat, parfois accusatoire, d’avoir bridé le mouvement en mai, puis bradé en juin pour mieux préparer les élections. Cette accusation nourrit ensuite une certaine contestation interne. La modération des centrales syndicales conduit ainsi à souligner un second paradoxe : le mouvement de grève le plus puissant en France n’a en rien transformé la condition ouvrière.
Cette modération a partie liée avec une autre tradition du mouvement ouvrier, qui concerne le partage entre syndicalisme et politique. Héritée de la Charte d’Amiens, elle interdit une immixtion des centrales syndicales sur le terrain proprement politique et délègue aux partis la gestion du pays. Dans une telle conception, qui recoupe et conforte le consensus républicain sur l’élection comme instance décisoire, les syndicats doivent en quelque manière s’effacer. De ce fait, le déplacement gaullien opéré par la dissolution est ratifié par les organisations syndicales. D’un côté, la CGT renforce son appel à la formation d’un gouvernement populaire. De l’autre, la CFDT s’en remet à Pierre Mendès-France le 29 mai alors que semble se profiler une crise de régime puis, au cours de la campagne, appelle les électeurs à porter leur suffrage vers la gauche non communiste. Ces traditions délégataires n’épuisent cependant pas la réalité ouvrière du mouvement de mai-juin. À côté de cette inscription dans la tradition et en partie contre elle figurent des ferments de nouveauté qui confèrent aussi au mouvement son caractère d’événement inaugural.
Les prémisses d’une insubordination prolongée
68, entendu comme contestation et prise de parole, secoue aussi le monde ouvrier qui entre dans une séquence décennale d’insubordination. La pétulance a partie liée avec une bigarrure plus forte de la scène ouvrière. Jusqu’alors essentiellement occupée par une figure de l’ouvrier viril, qualifié, français et adulte, d’autres figures ouvrières jaillissent : des femmes, des immigrés, souvent classés manœuvres ou ouvriers spécialisés ; des jeunes également. Cette irruption des fractions dominées de la classe ouvrière correspond pour partie à une évolution structurelle : croissance de l’emploi féminin, développement de l’immigration en métropole, rajeunissement démographique lié à la persistance d’une forte natalité depuis l’après-guerre.
Trois points cristallisent à la fois les ferments de nouveauté et les heurts qu’ils peuvent susciter : l’occupation des usines par les femmes pendant la nuit suscite des ragots sur la bonne moralité des grévistes. Surtout, les organisations syndicales entendent maintenir leurs prérogatives : la formulation des revendications et la conduite des négociations. À l’usine Renault de Billancourt, des ouvriers immigrés rédigent une plate-forme revendicative spécifique que la CGT refuse mais dont la CFDT assure la diffusion. Dès lors, si la direction de la grève demeure l’apanage de la fraction dominante de la classe ouvrière, les fractions dominées bousculent cette hégémonie que les grèves de 1968 sapent imperceptiblement.
Cette bigarrure plus grande de la scène ouvrière a partie liée avec les rencontres improbables que le mouvement favorise. À la faveur de la grève, l’affaissement transitoire des barrières sociales autorise les ouvriers à quelques échappées belles. Quand la tutelle syndicale s’avère trop pesante ou rigoriste, les jeunes ouvriers rejoignent les universités : si la Sorbonne ou Censier aimantent les ouvriers parisiens, leurs camarades de Renault-Cléon se rendent sur le campus de Rouen. Inversement, des étudiants se rendent aux portes des usines pour y rencontrer « la classe ouvrière ». La meilleure preuve de ces rencontres et de ces alliances fugaces se trouve dans la jonction qui s’opère entre étudiants d’extrême gauche et ouvriers contre les forces de l’ordre après l’intervention des forces de l’ordre à l’usine Renault-Flins le 6 juin 1968. Pendant plusieurs jours en effet, des étudiants parisiens affluent vers l’usine pour prêter main-forte aux ouvriers. Or, dans la mesure où cette solidarité s’est nouée malgré les condamnations du Parti communiste et de la CGT, elle participe à la reconfiguration de la scène gréviste. L’exemple parisien vaut pour la France : parce que la CGT s’est acharnée à contrecarrer ces rencontres, leur réalisation effective traduit un désaveu et une remise en cause de sa mainmise.
La contestation ouvrière se nourrit également d’une critique croissante de l’organisation du travail. Une telle remise en cause est favorisée par l’ampleur du mouvement et l’intense circulation de la parole. L’occupation suscite en effet de multiples réunions ou des discussions informelles dans les ateliers au cours desquelles sont rédigés des cahiers de revendications. Les ouvriers dénoncent les chronométrages, les cadences, les conditions de travail ou le système de salaire. C’est la boîte de Pandore que les ouvriers ouvrent, avec une dénonciation tantôt larvée, tantôt ouverte, de l’usine rationalisée. À Flins par exemple, le système de salaire cristallise le mécontentement, car il peut aboutir à un déclassement des ouvriers et donc à des pertes de salaires. Or précisément le compromis de Grenelle, qui concède des augmentations de salaire, omet la réalité du travail ouvrier. Une telle omission explique que les reprises du travail s’avèrent difficiles en juin 1968, mais surtout rend compte de la prolongation de l’insubordination ouvrière pendant toute la séquence sous la forme d’une conflictualité ouverte.
Enfin, la pertinence de l’outil syndical est interrogée, surtout pendant le mois de juin, alors que le mouvement s’essouffle ou retombe. Cette interrogation porte en premier lieu sur la stratégie des organisations, et notamment de la CGT. Une des critiques les plus répandues porte sur la primauté accordée au cadre revendicatif traditionnel ou une éventuelle coupure entre directions syndicales et base. Pendant ces semaines de grève toutefois, il semble que certains ouvriers radicalisent cette critique et participent à la création de structures ouvrières non syndicales. En s’attaquant en priorité au pouvoir de la maîtrise qui pèse sur les ouvriers, en prétendant revoir l’ensemble de l’organisation du travail ainsi que la politique salariale, les comités d’action ou de base qui éclosent montrent qu’ils se veulent l’instrument d’une transformation complète des usines. De telles aspirations supposent donc de pérenniser la révolte et de transformer l’usine en lieu de contestation ininterrompue.
Conclusions
Au terme de cette étude, l’on voit combien une entrée par les organisations du mouvement ouvrier déforme la réalité des grèves ouvrières et risque au final de déboucher sur le partage sommaire ouvriers/étudiants. Les grèves ouvrières de 1968 constituent, tout à l’inverse, une illustration admirable des tensions et contradictions inévitables entre un mouvement et des organisations, et de la manière dont l’événement heurte et bouscule l’institué et les institutions, même syndicales. Ces grèves se prolongent ensuite par une intense insubordination ouvrière jusque vers 1979 et les grèves de la sidérurgie. Nous désignons par là une contestation multiple, tantôt larvée, tantôt ouverte, qui se nourrit d’un refus de l’organisation du travail dans les ateliers, et qui débouche sur des formes de politisation spécifiques dans les usines. Celle-ci se déploie autour de quatre caractéristiques :
Un monde syndical peu revigoré
Le monde syndical connaît un large renouvellement à la suite de mai-juin 1968 et, plus encore, par sa fragmentation et sa division. C’est pourquoi, en dépit du mouvement de mai-juin ou du renforcement de son assise institutionnelle avec la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise, le syndicalisme industriel en France ne bénéficie alors d’aucun âge d’or dans les années 68, ce qui le distingue fortement de ses voisins européens. Les deux confédérations principales, la CGT et la CFDT, connaissent une situation très contrastée. La première connaît dès cette période, c’est-à-dire avant l’irruption de la crise économique, des difficultés qui se traduisent par une stagnation puis un déclin de ses effectifs, phénomène que rencontre la CFDT à la fin de la séquence.
Surtout les difficultés de la CGT ressortissent au modérantisme qu’elle promeut, qui tend à limiter, voire à contrecarrer, les initiatives ouvrières qu’elle ne contrôle pas totalement. C’est la raison pour laquelle la CGT combat les « gauchistes » en n’hésitant pas à s’appuyer sur les forces de police. Cette évolution est presque strictement opposée à celle que connaît la CFDT. Celle-ci contribue en effet puissamment à relayer l’insubordination ouvrière, car la décentralisation industrielle recoupe en partie son implantation : elle peut ainsi compter sur des adhérents plus nombreux dans le Grand Ouest, mais aussi en Alsace ou dans une large partie du Massif central. Cette diffusion « géographique » de la contestation s’accompagne d’une attention soutenue aux fractions dominées de la classe ouvrière ( immigrés ou ouvrières ). La grève des Lip en 1973 à Besançon constitue l’acmé de cette phase « mouvementiste » mais aussi son moment de bascule vers un « recentrage », d’abord imperceptible puis confirmé avec le congrès de 1979.
Ces hésitations et volte-faces des syndicats, souvent brocardés par des groupes d’extrême gauche, favorisent la multiplication, après leur éclosion ponctuelle en mai-juin, d’organisations a-syndicales souvent éphémères, comités d’action, de grève, de lutte, etc. Elles fonctionnent comme des interfaces entre les groupuscules « gauchistes » et la base ouvrière dont elles sont l’incarnation supposée.
Des groupes « gauchistes » aussi faibles qu’influents
Malgré la panique du ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin après 1968, les organisations d’extrême gauche, qui affluent vers les usines au nom de la centralité ouvrière et tentent d’y recruter, demeurent largement minoritaires. Pour autant, les maigres effectifs ne doivent pas faire minorer leur rôle, souvent décisif, de catalyseurs et de diffuseurs de l’insubordination. De fait, si les affiliations organisationnelles trotskystes ou maoïstes hésitent et fluctuent, l’existence prolongée des organisations « gauchistes » manifeste la présence pérenne de fractions ouvrières radicalisées, qui contestent l’ordre usinier et travaillent à le subvertir. Ces fractions sont les meilleures promotrices de la contestation.
Une conflictualité ouverte et nationale
Loin d’être l’apanage des bastions ouvriers, la contestation essaime sur tout le territoire et gagne les périphéries plus ou moins récemment industrialisées. La Bretagne, notamment les Côtes-du-Nord et l’Ille-et-Vilaine, redécouvre ainsi l’insubordination ouvrière avec des conflits à la résonance nationale, notamment celui du Joint français à Saint-Brieuc du 13 mars au 9 mai 1972. En parallèle, le répertoire d’actions s’élargit : la morphologie de la grève connaît en particulier un double élargissement avec les grèves d’ateliers d’une part, les grèves productives d’autre part. C’est l’essor de la « grève bouchon » que la Direction générale du Travail et de l’Emploi définit ainsi à l’automne 1969 : « grève dans une entreprise donnée par fraction limitée du personnel dont la place dans le processus de fabrication entraîne très rapidement des répercussions graves sur la production de l’ensemble de l’usine ». La grève bouchon présente la particularité de pouvoir être menée par de petits groupes d’ouvriers, et d’entraîner pourtant des répercussions considérables sur l’ensemble de l’entreprise. La division du travail, mais plus encore la rationalisation, ont ainsi offert aux ouvriers une arme qu’ils retournent, pendant la séquence, contre leur employeur4.
L’insubordination ouvrière a également recours à la grève productive, après son invention par les Lip à Besançon en juin 1973. L’ampleur de l’illégalité — qui suppose à la fois l’occupation, le détournement d’un stock de montres et l’utilisation des outils de travail — traduit également celle de la contestation. Jusqu’en 1977, on recense une petite vingtaine de grèves productives sur l’ensemble du territoire. Par là, les ouvriers peuvent résister à un patronat ultra-autoritaire ou attendre l’arrivée d’un repreneur après un dépôt de bilan grâce au produit des ventes sauvages. Ces grèves productives aussi célèbres que rares attestent que les illégalités se multiplient dans les années 68. C’est par là également que le répertoire d’actions s’élargit.
La contestation de l’organisation du travail
Les grèves continuent de contester l’organisation du travail : une vague de grèves contre le rendement déferle par exemple entre 1972 et 1973. La question du salaire traduit à la fois l’aspiration à bénéficier d’un salaire régulier dans la continuité de la mensualisation acquise en juillet 1970 et la défiance vis-à-vis des chronométreurs accusés d’être à la solde du patron et des « chefs » soupçonnés de gérer l’attribution des postes de manière clientéliste. Enfin, les ouvriers récusent la logique même du rendement qui encourage une parcellisation croissante du travail, donc la monotonie, et oblige à gâcher le travail.
Comme dans toutes les grèves qui tentent d’améliorer les conditions de travail, les conflits sur le rendement portent également sur la santé : « notre santé n’est pas à vendre », entend-on à Penarroya-Lyon en 1972 en écho à un énoncé italien. C’est l’indice que le compromis fordien, qui avait réglé les relations sociales depuis la Libération, se défait. Cette insubordination, qui met à jour la réalité du travail ouvrier et traduit une violente dénonciation de l’organisation rationalisée, montre au passage tout le décalage avec le discours contemporain enchanté sur les « Trente glorieuses ».
Un lecteur familier de la situation italienne trouvera sans doute dans ces analyses un écho des luttes ouvrières de la péninsule. Assurément, la France et l’Italie connaissent deux séquences parallèles d’une contestation ouvrière qui les singularise en regard de leurs homologues européens. Car le 68 français comme l’automne chaud italien n’étaient en vérité que des débuts, comme le répétaient les protagonistes de la contestation, désireux qu’ils furent de continuer le combat dans les usines pour transformer la condition ouvrière.
Footnotes
- Michelle Zancarini-Fournel, Le moment 68 : Une histoire contestée, Le Seuil, Paris, 2008.
- Cf. notre ouvrage, L’insubordination ouvrière dans les années 68 : Essai d’histoire politique des usines, PUR, Rennes, 2007.
- Michelle Zancarini-Fournel : « Retour sur “ Grenelle ” : la cogestion de la crise », dans Geneviève Dreyfus-Armand et al. ( dir. ), Les années 68 : Le temps de la contestation, Complexe, Bruxelles, 2000, p. 443-460.
- Nicolas Hatzfeld, Les gens d’usine : 50 ans d’histoire à Peugeot-Sochaux, L’Atelier, Paris, 2002.




