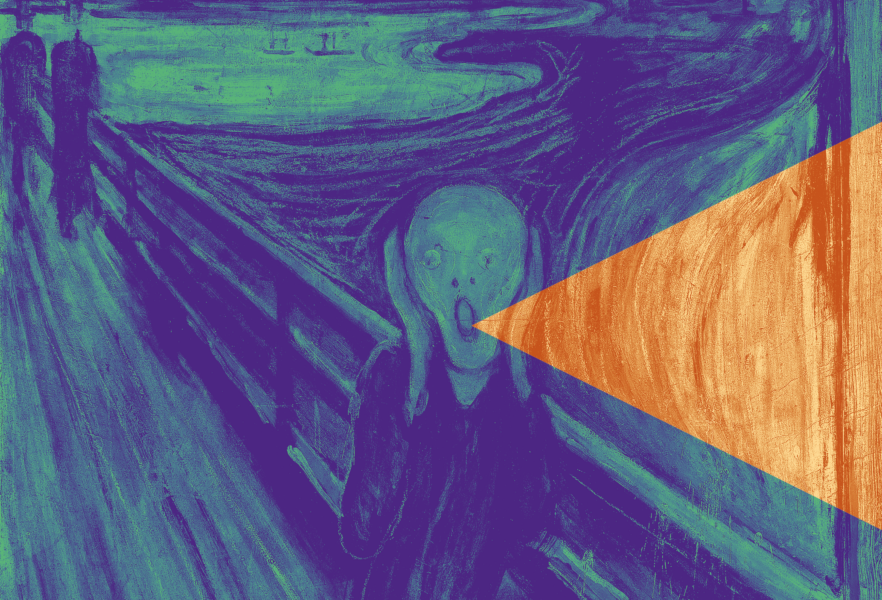Dans L’ère de la pénurie, Vincent Ortiz retrace l’histoire cachée d’un compagnonnage souterrain : depuis cinquante ans, les milieux économiques instrumentalisent une fraction de l’écologie politique, profitant de la confusion entre sobriété et austérité.

« Ne subsista devant l’homme que la limite toujours repoussée de l’horizon, l’espace et, au-delà de l’espace, les étoiles présentes dans un ciel qui se mesure en valeurs d’infini – peut-être le premier mot inventé, après ceux qui commençaient à peine à définir la douleur, la peur et la faim. »
Alejo Carpentier
Devant des spectateurs affamés, des tonnes d’oranges sont brûlées. Au plus fort de la Grande Dépression, alors que des millions d’Américains sombrent dans la sous-nutrition, on procède à ce massacre méthodique. Les flammes s’élèvent jusqu’au ciel, masqué par un écran de fumée noire. Certains hésitent à intervenir, mais se ravisent : des hommes en armes veillent sur l’incendie. Cet épisode, décrit par John Steinbeck dans Les raisins de la colère, a suscité l’indwignation de ses contemporains. « C’est là une abomination qui dépasse toutes les autres », écrit-il. Aucun sadisme ne motivait pourtant les auteurs de cet incendie ; simplement la volonté d’enrayer une chute des prix : « Le travail de l’homme et de la nature, le produit des arbres, doit être détruit pour que se maintiennent les cours. » En effet, « pourquoi les gens achèteraient-ils des oranges à vingt centimes la douzaine s’il leur suffit d’aller en ramasser pour rien ? »
L’épisode, spectaculaire, est d’une grande banalité dans le mode de production contemporain. Nul besoin de brûler des denrées au grand jour : dans l’ombre, on restreint leur production. De temps à autre, un scandale éclate : l’opinion affolée découvre qu’un cartel maintenait des prix artificiellement élevés, ou se livrait à la destruction en règle d’une marchandise. Elle exige la tête des spéculateurs qui thésaurisent sur le malheur d’autrui. L’indignation détourne pourtant de l’essentiel : la restriction volontaire de la production fait partie intégrante du business as usual.
À l’orée du XXème siècle, le grand économiste Thorstein Veblen nommait ce procédé « sabotage stratégique ». Il n’est pas un accident du système mais son essence même. Un monde d’abondance serait un monde sans profits, lesquels nécessitent une frustration continuelle des besoins de la population. Pessimiste, Veblen estimait que la domination de l’économie par quelques firmes allait mener le capitalisme vers un régime de stagnation absolue, où quelques oligopoles prévaricateurs allaient rationner ressources énergétiques et matières premières. L’histoire immédiate lui a donné tort, mais la récession qui frappe les pays occidentaux depuis quelques décennies a suscité un regain d’intérêt pour sa pensée. Si l’accroissement de la production fut le moteur du capitalisme du XXème siècle, le « sabotage stratégique » sera-t-il celui du XXIème ?
Bien sûr, ces pratiques de « sabotage » demeurent inavouables par les tenants du système dominant : les rentiers ne sont-ils pas d’un autre temps ? Il faut donc, écrit Veblen, procéder à une naturalisation de la pénurie. Les justifications idéologiques varient, la conclusion demeure : il faut que les individus adaptent leur consommation à la rareté des ressources en présence – plutôt que de rêver à on ne sait quelle corne d’abondance et chercher à boule‑ verser le système productif.
La fin de l’abondance
La fin de l’abondance : avec cette assertion banale, Emmanuel Macron effectuait une énième variation sur ce thème. Les raisons qu’il donne à ce changement d’époque méritent cependant que l’on y prête attention : nous vivons « la fin de l’abondance de terres, de matières, de l’eau ». En d’autres termes, nous ne connaissons pas seulement une pénurie de marchandises, mais aussi de ressources naturelles ; ou plutôt, les deux ne sont pas dissociables. Ainsi, les arguments traditionnels en faveur de la rigueur budgétaire se mêlent à des considérations écologiques. Incongruité ? À vrai dire, c’était loin d’être la première fois que l’imaginaire de la finitude des ressources se confondait avec des prescriptions libérales.
« C’est la fin de l’abondance », « nous avons vécu au- dessus de nos moyens », « il faut revenir à un mode de vie plus austère » : l’espace médiatique est saturé de tels slogans. S’ils émanent généralement d’économistes libéraux, leurs affinités électives avec une fraction bien particulière de l’écologie ne cessent de s’accroître. Les deux ne vivant pas en vase clos, des hybridations multiples se sont produites. De ces accouplements contre nature, un embryon d’idéologie est né. Balbutiante, contradictoire, elle se limite souvent à des expressions creuses. Mais la montée des préoccupations environnementales aidant, elle a pris une importance croissante.
« Il faut que la population accepte de faire des efforts pour les générations futures », « il faut s’adapter aux limites (du marché ou de la planète) imposées à l’économie », « il faut que la volonté politique se plie à l’avis des experts et non au bon vouloir de l’opinion » : ces injonctions sont- elles écologistes ou néolibérales ? Imposition de sacrifices contre insouciance consumériste. Adaptation aux limites contre irrationalité économique. Expertise technocratique contre souveraineté sans bornes. La proximité des imaginaires interroge.
D’un certain point de vue, l’intérêt pour la finitude des ressources est tombé à point nommé. Il a émergé dans les années 1970, alors que le capitalisme entamait sa mue néolibérale. Les groupes économiques dominants retrouvaient leur puissance perdue, tandis que les pétroliers se livraient à un « sabotage » intense, restreignant leur production pour faire grimper les prix. Mais dans « l’esprit du temps », cette pénurie artificielle se confondait avec une autre : la raréfaction géologique du pétrole dont le pic de production commençait à être mis en évidence.
Plus largement, une fraction élitaire et médiatique de la mouvance écologiste, structurée autour du Club de Rome, soulevait la thématique des « limites de la croissance » : à trop piller la terre, on l’évidait de ses ressources. Ces « limites de la croissance », les sociétés occidentales allaient les expérimenter dans la douleur, sous la forme de la récession générée par leur conversion au néolibéralisme 1. Le Club de Rome portait une critique du consumérisme – que la stagnation du niveau de vie allait se charger de brider. Il portait une critique du productivisme – quand la désindustrialisation qui frappait le « premier monde » mettait à mal son appareil productif. Ruse de la raison néolibérale ? Une partie de la critique écologiste du capitalisme semblait justifier son évolution vers un régime plus favorable encore aux classes supérieures.
Le néolibéralisme face à l’écologie : répression , récupération , incorporation
Toute la mouvance écologiste ne se laissait pas instrumentaliser de cette manière. Lorsqu’elle émerge, elle représente une menace frontale pour les pouvoirs institués. L’ampleur de la dévastation des écosystèmes, de la déprédation des sols et de la dégradation climatique qu’elle met en évidence semble établir la nocivité du système dominant. En 1974, dans la ville mexicaine de Cocoyoc, une conférence de l’ONU condamne le libre-échange et l’impérialisme pour leur impact environnemental sous la pression des pays du Sud. Le Nord n’allait pas tarder à répondre. Mais au Nord même, l’écologie ouvrait la voie à des contestations multiformes.
Pour endiguer cette vague, deux stratégies étaient déployées par les élites dirigeantes : la répression et la récupération. D’importants moyens étaient alloués à la promotion de thèses climato-sceptiques et à la lutte policière et judiciaire contre les mouvements écologistes. Dans le même temps, on s’affairait à nuancer leur radicalité, à euphémiser leurs constats et à adoucir leurs revendications politiques ; en d’autres termes, on tentait de les récupérer pour faire exister une « écologie de marché », où le greenwashing était roi.
Non sans succès. Le contexte de la chute du Mur de Berlin aidant, les écologistes qui contestaient frontalement le cadre néolibéral étaient cantonnés à la marginalité. Ceux qui l’acceptaient et multipliaient les participations aux gouvernements étaient utilisés par ceux-ci pour ripoliner de vert leur inaction climatique. Les entreprises de répression et de récupération portaient leurs fruits.
C’est à une troisième réaction élitaire que l’on s’intéressera, plus diffuse que les deux précédentes, et largement inconsciente : l’incorporation de l’écologie politique. Elle a consisté non pas à édulcorer l’écologie pour l’acclimater à l’ordre néolibéral émergent, mais au contraire à utiliser sa radicalité comme matrice de transition vers ce nouveau régime. Non pas à minimiser les effets de la catastrophe environnementale, mais à les brandir pour s’attaquer au vieux modèle keynésien, étatiste, productiviste. Le néolibéralisme allait s’appuyer sur l’imaginaire de pénurie qu’il trouvait dans une certaine écologie pour naturaliser celle qu’il générait.

Aussi les gagnants de cette nouvelle donne économique ont-ils entretenu un rapport ambivalent à l’écologie. Les mêmes multinationales pétrolières qui ont déployé des efforts colossaux pour nier leur rôle dans le réchauffement climatique ont pu contribuer à propager l’idée d’une pénurie imminente de pétrole. Les pouvoirs économiques, qui ferment les yeux sur le franchissement des frontières planétaires (accroissement des émissions de CO2 , acidification des océans, destruction de la biodiversité, etc.), ne rechignent pas à alerter sur le dépassement des limites planétaires (c’est-à-dire sur l’épuisement du stock disponible de matières premières). Répression et incorporation des revendications écologistes pouvaient parfaitement coexister.
Pour comprendre ce dernier processus, il faut se pencher sur cette frange de l’écologie politique issue du Club de Rome. Influente dans les années 1970, elle devient plus souterraine par la suite, avant de connaître un retour en force plus récent – via la « collapsologie », certains courants « décroissants » ou du simple fait de la sensibilité accrue à l’épuisement des ressources.
Sans volonté polémique, on qualifiera cette frange de néo-malthusienne en ce qu’elle est l’héritière lointaine de Thomas Malthus (1766‑1834) et de sa conception de la finitude des ressources, supposée se heurter au mirage d’une croissance infinie, tant économique que démographique2. Ses présupposés sont physicalistes : prenant pour acquis que tous les acteurs cherchent à maximiser la production, celle-ci est réduite à un ensemble de caractéristiques énergétiques et physiques, dont les limites naturelles sont pointées du doigt. Les limites artificielles de la production, imposées par le « sabotage » veblénien, d’ordre économique et social, sont ignorées. Pourtant crucial, le degré intermédiaire entre la disponibilité physique des ressources et leur mise sur le marché est déconsidéré. L’environnement se substitue aux rapports sociaux comme acteur central. Ainsi, la hausse du prix des matières premières est interprétée à travers le prisme de leur raréfaction physique, et non du rationnement imposé par ses détenteurs.
Les implications de cette écologie néo-malthusienne sont adaptationnistes : confrontée à une nouvelle donne environnementale, la société doit s’y adapter en bloc – sa survie en dépend. Les antagonismes qui la fracturent sont gommés ou édulcorés, lorsqu’ils ne sont pas interprétés de travers : tout le monde n’est-il pas concerné par la crise écologique ? Que certains groupes puissent profiter de la dévastation environnementale et générer des pénuries artificielles est étranger à l’écologie néo-malthusienne.
Aussi la radicalité théorique de cette frange de l’écologie ne se double-t-elle pas nécessairement d’une radicalité politique à due proportion. Bien au contraire. Et c’est ce paradoxe que l’on cherchera à élucider.
Limites planétaires et limites du système productif
Comprendre la fonction idéologique de cette écologie néo- malthusienne implique de garder à l’esprit l’appartenance sociale de ses promoteurs et de ses destinataires. La « classe professionnelle », constituée de la frange supérieure du salariat, y est surreprésentée3. Plus diplômés que la moyenne, ses membres mesurent toute l’ampleur de la crise environnementale. Mais à l’écart des moyens de production et du travail collectif – cantonnés à des rôles de gestion, de supervision ou de conception –, étrangers aux moyens d’action syndicaux, ils sont peu enclins à un bouleversement des structures productives. Du fait de leur capital économique élevé et de leur train de vie dispendieux, ils sont au contraire disposés à penser les enjeux écologiques par le prisme éthique de la (sur)consommation. Et du fait de leur capital culturel, à les penser par le prisme de la connaissance, estimant que l’inaction climatique découle d’une mauvaise appréhension des enjeux par la société ou ses dirigeants.
Sensibles aux limites physiques de la planète, ils sont aveugles aux limites que le système économique dominant impose à la production. Or, la fraction la plus modeste de la population souffre autant des secondes que des premières. Et, par principe, les secondes sont toujours atteintes avant les premières. Si la critique du « consumérisme », du « productivisme » et de la « croissance » vise souvent juste, elle est muette quant aux implications sociales d’un capitalisme où la consommation est bridée et où la production tourne au ralenti avec une croissance en berne. Ce qui est refoulé, avec cette écologie néo-malthusienne, c’est la question des rapports de pouvoir entre groupes sociaux.
Aussi la radicalisation écologique de la « classe professionnelle » ne la conduit-elle pas nécessairement à prendre pour cible le système responsable de la crise climatique. L’effroi que ses membres ressentent face aux désastres environnementaux les mène à formuler des demandes de conservation, de restriction, de limitation, de sobriété. Celles-ci ne rencontrent que trop spontanément les promesses du néolibéralisme : celle d’une gestion raisonnée de ressources rares. Et elles ne font que trop écho au néolibéralisme réellement existant, dont le « sabotage » constitue la matrice. Ce livre a pour objet ce paradoxe, et cet impensé.
Pour en comprendre les ressorts il faut remonter aux années 1970. Au « choc pétrolier » imposé par les multinationales occidentales et l’OPEP. Au « rapport Meadows » Halte à la croissance ?, et au Club de Rome lui-même. Cette organisation élitaire, qui a contribué à populariser la thématique de l’épuisement des ressources, a alors trouvé une caisse de résonnance dans les entreprises pétrolières – trop heureuses que le débat public se polarise autour des « limites » géologiques de l’or noir plutôt qu’autour de celles qu’elles imposaient artificiellement à son extraction. Ce sera l’objet du premier chapitre, dédié à l’analyse des premières politiques d’austérité d’après- guerre aux États-Unis, concomitantes à la montée en puissance des préoccupations environnementales.
Le « choc pétrolier » inaugure un nouveau régime d’accumulation où le « sabotage » veblénien règne en maître, qui est moins fondé sur la production effrénée que sur sa restriction artificielle. Une stagnation s’ensuit, que certains estiment, à tort, être incompatible avec le capitalisme. Du point de vue des bénéficiaires de ce système, les profits absolus comptent moins que les profits relatifs au reste de la société – en d’autres termes, que l’« accumulation différentielle ». Dans cette perspective, le néolibéralisme n’est pas un régime de croissance mais de récession systémique où la rente occupe une place majeure. Le discours écologiste néo-malthusien, fondé sur la dénonciation de la « croissance », devient ainsi aussi politiquement confus qu’inapte à décrire le réel. Ce sera l’objet du second chapitre.
Les sensibilités similaires que touchent ce discours écologiste et le dogme libéral ne devraient guère surprendre si l’on remonte aux sources de la science économique occidentale. Le révérend Thomas Malthus ne fondait-il pas sa défense du libre marché sur une conception pessimiste des ressources de la terre, conçues comme devant croître à un rythme structurellement inférieur à celui de la population ? À sa suite, d’autres n’ont-ils pas justifié leur libéralisme économique par la finitude des ressources énergétiques ? Que Malthus soit tenu en haute estime par le Club de Rome et ses héritiers n’a donc rien que de très logique. D’une certaine manière, leur écologie renoue avec les fondements malthusiens de l’économie – ce sera l’objet du troisième chapitre.
Il sera beaucoup question des États-Unis, mais il faudra terminer cet ouvrage par un tour d’horizon de la périphérie européenne, où les procédés traditionnels de « sabotage » se sont mêlés à la construction fédérale issue du traité de Maastricht. Celle-ci s’est bâtie sur des promesses de préservation des ressources, de protection des écosystèmes et de lutte contre les émissions de CO2 . Mais la transition écologique qu’elle tente d’impulser, par les instruments du droit et du marché, a surtout eu un effet notable : la consolidation des géants fossiles privés.
Footnotes
- On entendra par « néolibéralisme » un régime d’accumulation reposant sur trois piliers : compression salariale, libéralisation des prix et austérité budgétaire ciblée. Il implique une intervention politique et juridique constante, visant supposément à instituer une économie concurrentielle de marché et accouchant en réalité, nous le verrons, d’un capitalisme de rente.
- Nulle volonté de disqualification dans la mobilisation de l’adjectif « néo-malthusien » : l’auteur de l’Essai sur le principe de population était prisé par les chercheurs du Club de Rome et de nombreux représentants contemporains de cette frange de l’écologie. Comme nous le verrons, le néo-malthusianisme ne renvoie pas uniquement à une hantise de l’accroissement démographique mais à une certaine conception de la finitude des ressources.
- Matthew T. Huber , Climate Change as Class War. Building Socialism on a Warming Planet, Londres, Éd. Verso, 2022.