Toute l’histoire humaine est traversée par la lutte pour l’égalité. Cette aspiration doit fonctionner comme un horizon pour l’avenir mais aussi comme un présupposé politique, ici et maintenant.
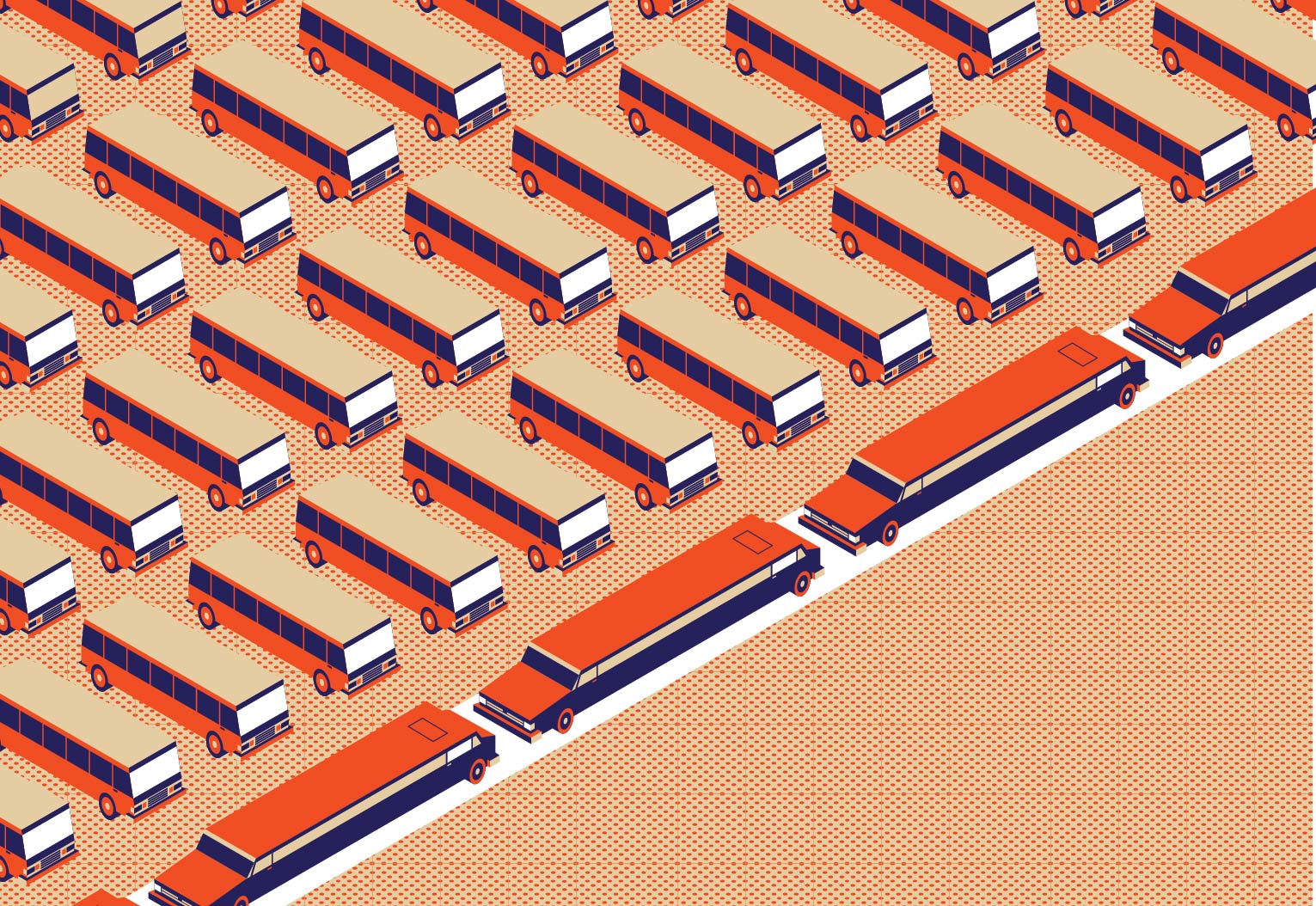
La pensée égalitaire est irrésistible. Nous entretenons une résistance profondément enracinée contre l’inégalité. Les critiques pleuvent contre « le 1 % », contre les banquiers cupides ou contre les spécialistes médicaux en général. Nous nourrissons une aversion spontanée à l’égard des rémunérations aberrantes et des grands managers qui s’octroient ces revenus faramineux. Aucun argument ne pourrait chasser cette aversion. De même, bien des gens estiment inadmissible que certains aient plus de droits que d’autres. Et l’on peut s’attendre à une indignation générale chaque fois que des hommes politiques se hissent au-dessus de la normalité et se servent à l’avenant.
Nous vivons pourtant dans une société où règne l’inégalité. Aussi, ses défenseurs emploient-ils tout leur zèle à justifier cette inégalité et son bien-fondé moral. Cela se traduit parfois par d’épais volumes, tel le livre du directeur d’Itinera, Marc De Vos : Ongelijk maar fair1. Notre « obsession » de l’inégalité dégénère, estime De Vos. L’inégalité est inévitable en raison de la nature humaine, de la diversité, du développement technologique, de la répartition naturelle des talents,… et Marc De Vos de passer en revue toute une kyrielle d’arguments. « Le succès émane d’un triangle d’or de gènes forts, de formation solide et de personnalité adéquate. L’échec est un triangle des Bermudes de gènes faibles, de formation déficiente et de personnalité inadéquate. » Une pointe de théorie de l’évolution, l’incontournable fonctionnement du marché et la responsabilité individuelle : tels sont les ingrédients typiques utilisés pour rationaliser l’inégalité. De l’encadrement sociétal, De Vos ne dit pratiquement rien. Que le système capitaliste de production ait provoqué un accroissement gigantesque de l’inégalité dans le monde n’entre pas dans son propos.
Pas de démocratie sans égalité
Liberté, égalité, fraternité. La Révolution française a mis un terme aux privilèges de la noblesse et du clergé, aux privilèges de naissance, et a élevé l’égalité des droits au rang de principe clé. Dans les années de la révolution, les Enragés ont mis tout en œuvre pour traduire cette pensée égalitaire en termes socioéconomiques. Babeuf et ses partisans de la Conjuration des Égaux plaidèrent ensuite en faveur du droit de chacun à une part égale dans toute propriété. Une fois cette pensée égalitaire lancée, il s’avéra que rien n’allait plus l’arrêter.
La lutte pour l’égalité est-elle en même temps une lutte pour la liberté ?
Le philosophe libéral Alexis de Tocqueville (1805-1859) le comprit comme nul autre. Comme résultat de la révolution, il voyait bien plus qu’un simple changement de régime politique. Il discernait une nouvelle forme de société sous l’emprise de la pensée égalitaire. Bien sûr, de grandes inégalités s’étaient maintenues et, avec le développement du capitalisme, elles allaient encore s’accroître, mais, selon la conviction de Tocqueville, la mentalité et l’image de soi de cette société étaient fondamentalement égalitaires, ce qui engendrait une dynamique dès lors malaisée à enrayer. Un demi-siècle après la révolution, il posa la question rhétorique : « Pense-t-on qu’après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la Démocratie reculera devant les bourgeois et les riches2 ? » Et, un peu plus loin : « Il est impossible de comprendre que l’égalité ne finisse pas par pénétrer dans le monde politique comme ailleurs. On ne saurait concevoir les hommes éternellement inégaux entre eux sur un seul point, égaux sur les autres ; ils arriveront donc, dans un temps donné, à l’être sur tous3. » En effet, de tout temps, de nouveaux groupes ont revendiqué leurs droits au nom de cette irrésistible pensée égalitaire : esclaves, travailleurs, femmes, peuples coloniaux, minorités, holebis, etc. « Après chaque concession nouvelle, les forces de la démocratie augmentent », écrivait Tocqueville4. Le socialisme est un produit de cette dynamique.
Tocqueville a analysé ce processus avec étonnement et admiration, mais, en même temps, avec la crainte d’un aristocrate libéral obligé de s’adapter à un processus historique irrésistible que personne ne semblait en mesure de maîtriser. Il craignait que ce processus n’augmente encore le rôle de l’État. Quand les gens réclament l’égalité, pensait-il, ils font appel à l’État ; cela se traduit par un nivellement néfaste. Il écrivit à ce propos : « Je ne sais que deux manières de faire régner l’égalité dans le monde politique : il faut donner des droits à chaque citoyen, ou n’en donner à personne5. » Selon Tocqueville, les gens du monde moderne préfèrent encore que personne n’ait de droit plutôt que l’un ait plus de droits que l’autre. Il en résulte le danger de voir apparaître un régime sans liberté dans lequel une masse d’individus égaux, mais sans pouvoir, se retrouveront face à un pouvoir étatique central. Pour empêcher cela, le droit d’association est important, car toutes sortes d’associations de la société civile peuvent alors constituer un tampon entre les individus sans pouvoir et l’État.
La pulsion égalitaire menace de saper la société libérale : Tocqueville a été l’un des premiers à développer cet argument libéral. Mais il sous-estimait à quel point, dans cette lutte pour l’égalité, les gens allaient s’organiser et combien ces organes de lutte, associations, partis et syndicats allaient constituer un contre-pouvoir. Ils peuvent empêcher que l’État devienne tout-puissant. Ainsi la lutte pour l’égalité est-elle en même temps une lutte pour la liberté.
Le philosophe français Étienne Balibar s’oppose résolument à l’idée libérale qu’une tension existerait entre la liberté et l’égalité. Chaque fois que des gens entament un combat pour l’égalité, argumente-t-il, ils le font également au nom de la liberté et inversement. Pour désigner cela, il avance un néologisme : l’égaliberté. Les révolutionnaires français combattaient tout autant l’absence de liberté de l’Ancien Régime que l’inégalité des privilèges de la noblesse. Depuis, chaque grand mouvement de lutte, du mouvement ouvrier au féminisme, de la décolonisation à l’antiracisme, s’est réclamé des principes d’égalité et de liberté.
Balibar inverse également son argument : l’oppression de la liberté va de pair avec des formes d’inégalité et, dans une situation où l’égalité n’existe pas, la liberté n’existe pas non plus. La bourgeoisie défend souvent son pouvoir et sa richesse contre les protestations des travailleurs en s’en prenant aux libertés : le droit de grève, la liberté d’expression ou la liberté d’association. Balibar explique que, même sous certains régimes du socialisme réellement existant au vingtième siècle, la négation des droits et des libertés est allée de pair avec des inégalités sociales et politiques. Les deux vont toujours ensemble : « Il n’y a pas d’exemples de limitation ou de suppression des libertés sans inégalités sociales, ni d’inégalités sans limitations ou suppression des libertés6. »
La pensée sous-jacente de Balibar est que la liberté ou l’égalité ne sont pas des principes qui tombent simplement du ciel. Ils sont le résultat d’un combat politique. Les gens n’ont pas de droits sans mener un combat politique permanent en vue de les obtenir et de les garder. La logique de ce combat est toujours une logique d’égaliberté. C’est pourquoi Balibar fait du droit de chacun de faire de la politique le plus important des droits. Cela comporte également le droit de s’organiser collectivement. Aussi, la lutte pour l’égaliberté n’a absolument rien à voir avec le régime de non-liberté ses individus atomisés et passifs contre lequel Tocqueville mettait en garde. En même temps, l’égaliberté n’est pas non plus une chose que l’on réalise un jour et qui reste définitivement acquise. Il subsiste en permanence un écart entre idéal et réalité, surtout dans le système capitaliste, qui alimente continuellement l’inégalité des classes. C’est pourquoi la lutte pour l’égaliberté doit sans cesse se renouveler et s’approfondir.
Rawls et sa défense d’une répartition inégale
Dans Ongelijk maar fair, Marc De Vos tend à adhérer aux vues du philosophe américain John Rawls (1921-2002) et ce n’est pas un hasard. La théorie de la justice de Rawls constitue en gros le cadre de la philosophie politique anglo-américaine des décennies écoulées7. Rawls tente une expérience de pensée typique de la philosophie néolibérale : il représente la société comme le produit d’un contrat entre les individus de cette société. Et d’ajouter que nous devons imaginer que nous concluons ce contrat derrière un « voile d’ignorance » : nous esquissons les contours économiques, juridiques et politiques de la société sans savoir quelle position nous allons y assumer. En d’autres termes, nous devons faire abstraction du sexe, de l’origine, des talents, de la couleur de peau et de toutes sortes d’autres hasards qui influencent notre destinée. La situation dans laquelle les gens délibèrent du cadre sociétal derrière le voile de l’ignorance, Rawls l’appelle « la position originelle ».
Imaginez qu’il n’y a pas encore de société et qu’un certain nombre d’individus sont assis autour d’une table afin de profiler leur société future sans savoir quelle position ils vont occuper dans cette société. Que savent-ils toutefois ? Ils disposent d’un savoir économique, psychologique et sociologique général. Ils partent du principe qu’il y aura pénurie : en cas d’abondance, le problème d’une répartition équitable ne se pose d’ailleurs pas, car tout le monde peut prendre autant qu’il le souhaite. Ici, Rawls émet la supposition libérale typique que, dans leur position originelle, les individus ne sont intéressés que par leur propre sort et ne vont pas le comparer en permanence avec celui des autres. Ils vont faire en sorte que, dans la société à venir, eux-mêmes s’en tireront du mieux qu’ils pourront. Seulement ils ne savent pas encore où ils vont se retrouver. De ce fait, ils en arrivent à une logique dans laquelle l’intérêt personnel va coïncider avec l’intérêt général. Quand on ignore dans quelle position on va se retrouver, il vaut mieux faire en sorte que toutes les positions soient les meilleures possible. Aussi personne n’ira prôner une dictature puisque la possibilité de devenir un sujet opprimé sera bien plus élevée que celle d’assumer le rôle du dictateur. Les arguments racistes ou sexistes sont également exclus : dans la position originelle, personne ne prétendra que les hommes doivent gagner plus que les femmes parce qu’ils sont plus forts physiquement ou plus rationnels, car on ne sait pas encore de quel sexe on sera soi-même.
Dans cette situation, nous devons réfléchir à la répartition de ce que Rawls appelle les « biens sociaux primaires », les choses dont tout le monde a besoin, quelle que soit la position sociale qu’on occupe : droits et libertés, opportunités, pouvoir, revenus et bien-être, respect de soi, sa propre valeur… Dans cette position originelle, selon Rawls, les individus rationnels vont opter pour une série la plus complète possible de droits égaux et de libertés pour tous. Un choix inverse, dans lequel certaines classes sociales, comme dans l’Ancien Régime, ont des privilèges et privent de droits d’autres classes sociales, saperait en effet le respect de soi et le sentiment de sa propre valeur, toujours selon Rawls.
Les individus en position originelle acceptent toutefois, d’après Rawls, qu’il puisse exister une certaine inégalité, du fait qu’il y a toutes sortes d’emplois, mais à la condition stricte que tout le monde dispose de chances égales de s’approprier ces emplois. D’une simple égalité formelle des chances, ils ne se satisferaient pas. Que chacun ait une chance égale de postuler un emploi au sommet devient formel et dénué de contenu quand celui qui n’a pas bénéficié d’un enseignement supérieur peut concourir, mais n’a, quoi qu’il en soit, pas l’ombre d’une chance d’y arriver. Dans la position originelle, les gens optent pour une égalité réelle des chances et donc aussi pour un enseignement public aux fondations solides qui peut compenser le fait que certaines personnes sont nées dans un environnement moins stimulant sur le plan intellectuel.
Comment , partant de points de départ égalitaires, peut-on arriver à des conclusions inégalitaires ?
Le discours de Rawls prête à la controverse quand il s’agit de la répartition de la richesse et des revenus. Selon lui, les individus en position originelle ne choisissent pas une répartition égale de cette richesse quand ils savent que certaines personnes sont nées avec plus de talents que d’autres. Donner à ces personnes un stimulant financier, pour tirer parti de leurs talents au maximum, peut se traduire par une croissance économique plus grande au profit de tous. Car, lorsque le gâteau à partager devient plus grand, le revenu de chacun peut s’améliorer. Selon Rawls, les gens en position originelle prendraient surtout en considération les moins nantis. Dans une société totalement égalitaire, le gâteau produit risque d’être plus petit, car les gens talentueux ne reçoivent alors pas de stimulant pour faire plus d’efforts et le niveau général de revenus reste bas, estime Rawls. Il vaut donc mieux tolérer l’inégalité puisque le sort des moins nantis s’en trouve amélioré.
Pourquoi des individus en position originelle se concentreraient-ils sur le sort des moins nantis ? Ne pourrait-on pas prendre des risques, derrière le voile de l’ignorance, favoriser la position des mieux nantis et espérer pouvoir faire partie de ce groupe ? Ce ne serait pas rationnel, répond Rawls, car c’est toute votre destinée qui est en jeu, et il n’est pas rationnel de jouer avec elle. Dans une telle situation, les gens sont d’ailleurs réticents au risque et font en sorte que le pire des scénarios puisse encore dépasser malgré tout les attentes. L’argument de Rawls est proche de celui de « l’économie du ruissellement » (trickle-down economics) : lorsque les riches s’enrichissent, des miettes tombent de la table pour les autres. Mais son argument est plus fort : il ne suffit pas que les pauvres reçoivent des miettes, il faut choisir la forme de répartition inégale qui conviendra le mieux aux moins nantis. La condition de l’enrichissement des nantis n’est pas seulement, chez lui, que les pauvres progressent aussi, mais qu’ils progressent au maximum. Pas mal de gens qui utilisent l’argumentation de Rawls pour approuver l’inégalité négligent cet aspect et se retrouvent en fin de compte dans l’économie du ruissellement. Marc De Vos est l’un d’eux.
De Vos et bien d’autres s’empressent aussi d’écarter la conviction de Rawls selon laquelle les individus en position originelle n’opteraient pas pour le capitalisme courant8. Ils garantiraient cependant le droit de propriété, car chacun a besoin de toutes sortes de choses pour assurer ses propres besoins. Mais ils ne choisiraient jamais de faire en sorte que les moyens de production deviennent la propriété d’une classe restreinte. Rawls suggère qu’ils opteraient pour une forme de capitalisme du peuple, avec un actionnariat très vaste ou pour un socialisme libéral, comme dans un socialisme de marché où des entreprises coopératives produisent pour un marché concurrentiel9. Mais là n’est pas le point central de Rawls. L’argument central qui lui a valu la célébrité est sa défense d’une inégalité de revenus potentiellement significative en partant d’une position de départ égalitaire.
 La grève de l’investissement
La grève de l’investissement
L’argument de Rawls est ingénieux et pas mal de sociaux-démocrates et de socialistes n’y trouvent rien à redire10. Mais sa vision de la répartition des revenus se heurte naturellement aussi à des résistances : comment, partant de points de départ égalitaires, peut-on malgré tout en arriver à des conclusions fort inégalitaires ? Ainsi, il y a la virulente critique du marxiste Jerry Cohen (1941-2009). If you’re an egalitarian, how come you’re so rich ? dit sans confusion possible le titre d’un de ses ouvrages : si tu es pour l’égalité, pourquoi es-tu si riche11 ? Cohen donne l’exemple du gouvernement Thatcher qui, en 1988, avait ramené le taux d’imposition des plus riches de 60 à 40 %12. Pour justifier la mesure, on avait prétendu que les riches avaient gagné eux-mêmes leur richesse et que, pour cette raison, il n’aurait pas été loyal de leur appliquer des tarifs d’imposition élevés. On peut également défendre la mesure en s’appuyant sur le travail de Rawls, en partant du raisonnement que les moins nantis peuvent aller mieux quand, grâce à des réductions fiscales, les plus productifs peuvent devenir plus productifs encore. Mais, selon Cohen, ce raisonnement pose problème. Un argument n’est convaincant que lorsqu’on peut l’utiliser ouvertement, et ce n’est pas le cas ici. Or, les riches ne peuvent utiliser l’argument parce que cela revient à dire : « Nous exigeons des gains plus élevés, sinon nous refusons d’engager nos talents ou nos capacités. » Pour les riches, l’argument réel est donc implicitement une menace de se mettre « en grève » s’ils ne sont pas très bien payés, un ultimatum : ils exigent une plus grosse part du gâteau, sinon ils feront en sorte que le gâteau devienne plus petit. Mais, si les mieux nantis adoptaient une attitude plus égalitaire, ils n’exigeraient pas un revenu plus élevé pour fournir leur contribution et la position des moins nantis pourrait être alors bien meilleure.
Rawls se concentre sur la distinction entre moins et mieux nantis ou entre les gens très peu et hautement spécialisés et il parle là de répartition inégale des talents et compétences à la naissance. Personne n’a « mérité » ses talents, estime-t-il : ils sont les résultats du hasard, de la chance. C’est pourquoi la société doit considérer les talents et leurs fruits comme un bien commun dont la gestion doit profiter le plus possible aux moins nantis. Mais bien sûr les choses ne marchent pas comme cela dans le monde réel : on y entend ce genre d’argument, mais plutôt pour justifier le comportement des détenteurs de capitaux. Il n’est plus question, dès lors, de gens talentueux qui n’investiront plus leurs talents, mais de possédants qui retireront leur capital : nous assisterions donc non pas à une grève des talents, mais à une grève des investissements ? Eh oui, c’est aussi ce qui se joue quand les auteurs néolibéraux défendent l’inégalité : les impôts doivent diminuer sinon, le capital se retire.
Cohen compare cela à une prise d’otage. On pourrait argumenter : les enfants doivent être auprès de leurs parents ; si on ne paie pas le kidnappeur, il ne libérera pas l’enfant ; en cas d’enlèvement, il vaut donc mieux payer une rançon. Mais ce raisonnement sonne autrement dans la bouche d’un kidnappeur : « Si vous ne payez pas, vous ne reverrez plus votre enfant. » Avec ce discours, le kidnappeur se place hors de tout cadre moral. Le kidnappeur « devrait être honteux d’utiliser cet argument, parce qu’il en a créé lui-même la prémisse », écrit Cohen13. Le fait est, d’ailleurs, qu’il n’énonce plus simplement une vérité générale ou un principe moral, mais fait en sorte que son discours soit logique et qu’il porte.
Il en va de même des réductions d’impôt. Le kidnappeur dit : « Tu acceptes de payer ou je tue ton enfant. » Le nanti dit : « Tu acceptes l’inégalité, où je refuse d’engager mes talents (ou mon capital). » Quand un riche dit qu’une imposition plus lourde opère au détriment des moins nantis, il dit en fait qu’il va fermer le robinet de son talent (non mérité, en dernière instance) ou de son capital. C’est une mystification de présenter cela comme une loi économique générale. À l’instar du kidnappeur, par son comportement, le riche fait en sorte que son discours se mue en vérité. Ce faisant, il se discrédite moralement, estime Cohen. Le riche ne peut recourir à l’argument des incitatifs, car « pourquoi travaillerait-on moins dur quand l’impôt est de 60 au lieu de 40 %14 ? »
Pour qu’un argument en faveur de l’inégalité soit convaincant, tout le monde doit pouvoir l’utiliser face à n’importe qui. Cela n’est pas possible ici de façon crédible. Dans Why not socialism ?, Cohen cite l’exemple du gros salaire qui, chaque jour, se rend à son travail dans sa voiture rapide et dépasse chaque fois l’autobus. Un jour, le gros salaire doit lui-même prendre le bus. Il peut s’en plaindre auprès d’un autre automobiliste, mais il ne peut dire à aucun passager de l’autobus : « C’est quand même terrible : je suis contraint de prendre l’autobus, aujourd’hui15 ! » Car ses joues se couvriraient du rouge de la honte et, avec de tels propos, il s’aliénerait complètement la communauté des passagers du bus.
Un exemple parallèle est celui des spécialistes médicaux qui se plaignent, malgré des salaires faramineux, de ne pas gagner assez et vont jusqu’à refuser de soigner des patients qui, refusant de prendre une chambre individuelle, empêchent du même coup le spécialiste de facturer des suppléments d’honoraires.
Cohen conclut que l’argument de Rawls en faveur de l’inégalité débouche sur une société qui n’a plus rien d’un « vivre ensemble » ni d’une communauté, mais qui s’est muée en un univers d’hypocrisie généralisée. Dans une position originelle, n’opterions-nous pas plutôt pour une société dans laquelle il serait agréable de vivre ensemble et où une communication et une argumentation honnêtes seraient possibles ?
L’égalité comme point de départ
Nous parlions de Babeuf et de sa Conjuration des Égaux, dans le contexte de la Révolution française. Quelques décennies plus tard, des groupes français s’inspirant du socialisme utopique de Saint-Simon allaient développer toutes sortes de rituels égalitaires. Au cours de rassemblements, ces groupes, souvent composés de gens de tous bords, échangeaient leurs vêtements afin d’effacer les différences de classes16, pour tenter d’en arriver à l’égalité dans l’instant même, et non pas dans un lointain avenir.
Dès lors, les socialistes et les communistes n’ont plus cessé de se demander quelle attitude prendre face à toutes les formes existantes et bien réelles d’inégalité. Aux yeux du dirigeant communiste italien Antonio Gramsci (1891-1937), il est « un fait qu’il existe des dominants et des dominés, des dirigeants et des dirigés ». La question clé est : « Le but est-il qu’il y ait toujours des dominants et des dominés ou s’agit-il plutôt de créer les conditions dans lesquelles cette distinction ne serait plus nécessaire17 ? » Nous vivons dans une société au sein de laquelle certains, plus que d’autres, sont en état de prendre l’initiative et la direction des luttes, des syndicats et des partis : de par leur formation, leur contexte, leurs capacités. Nous devons organiser la lutte de telle sorte, écrit Gramsci, qu’en y participant chacun puisse acquérir les compétences et les idées pour prendre soi-même l’initiative politique, de sorte que la distinction entre dirigeants et dirigés disparaîtra. C’est même, selon Gramsci, un but crucial du socialisme. En d’autres termes, l’égalité est un but, mais on ne peut atteindre ce but qu’en partant déjà de la pensée égalitaire dans la lutte actuelle.
Nous devons organiser la lutte de telle sorte qu’en y participant chacun puisse acquérir les compétences et les idées pour prendre soi-même l’initiative politique.
Le philosophe français Jacques Rancière va encore plus loin. Son idée de base est que l’égalité n’est pas le but que nous devons rechercher, mais un postulat dont nous devons partir. Sa source d’inspiration est Joseph Jacotot (1770-1840), un révolutionnaire français qui, après la chute de Napoléon, avait gagné la Belgique.18 Il alla enseigner le français dans ce qui était à l’époque l’Université d’État de Louvain et se servit à cet effet d’une méthode révolutionnaire. Sans pouvoir parler lui-même le néerlandais, il enseignait le français à de jeunes Flamands, et avec succès. Jacotot refusait d’adopter la position omnisciente du professeur donnant des explications à ses élèves et pratiquant ainsi un transfert de savoir. Il donnait à ses élèves une édition bilingue d’un texte et les défiait ensuite d’en retrouver eux-mêmes la signification et la construction des phrases. Plus tard, il alla même donner des cours de piano alors que lui-même ne pouvait jouer de cet instrument. Son point de départ était simple : chacun a la capacité de se servir de son intelligence et a, par conséquent, la possibilité de s’instruire lui-même.
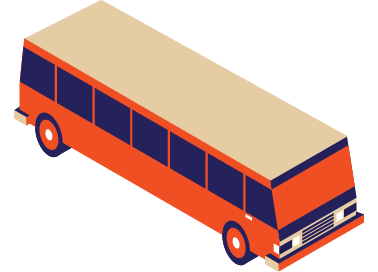 Rancière en fait le point de départ de sa philosophie politique. Chaque ordre social ou politique est inégalitaire. Dans chaque société, les gens assument toutes sortes de rôles et de positions entre lesquels existent des relations hiérarchiques. Mais, à l’arrière-plan de ces relations inégales fonctionne subtilement une égalité plus fondamentale. Cela semble paradoxal, mais l’égalité est la supposition cachée des relations inégales, hiérarchiques et, sans elle, ces dernières ne fonctionneraient pas.
Rancière en fait le point de départ de sa philosophie politique. Chaque ordre social ou politique est inégalitaire. Dans chaque société, les gens assument toutes sortes de rôles et de positions entre lesquels existent des relations hiérarchiques. Mais, à l’arrière-plan de ces relations inégales fonctionne subtilement une égalité plus fondamentale. Cela semble paradoxal, mais l’égalité est la supposition cachée des relations inégales, hiérarchiques et, sans elle, ces dernières ne fonctionneraient pas.
Imaginez qu’un directeur donne un ordre à un ouvrier et lui demande ensuite : « Tu as compris ? »19 Il s’agit d’une question étrange, car, naturellement, la question n’est pas de savoir si l’ouvrier a bien compris l’ordre. Cela veut seulement dire : « Tu dois faire ce que je t’ai commandé. » Avec sa question, le directeur entend surtout affirmer la hiérarchie : il y a des gens qui prennent la parole, et d’autres qui doivent se taire et exécuter ce qu’on leur a ordonné. Mais celui qui donne un ordre suppose que la personne qui le reçoit peut l’interpréter et le comprendre. En d’autres termes, il présume que la personne qui reçoit l’ordre dispose de la même capacité que lui de se servir de son intelligence. L’ordre suppose en ce sens une égalité. Que se passe-t-il quand l’ouvrier proteste ? En prenant la parole, il montre qu’il peut lui aussi parler et penser et qu’en ce sens, lui et la personne qui le commande sont égaux. Ils partagent une langue et un monde communs et la discussion est donc possible. Le directeur, de son côté, affirmera qu’il n’y a pas lieu de discuter mais uniquement de travailler. Le paradoxe est alors : le directeur nie la discussion, le conflit et prétend qu’il y a consensus, mais, en même temps, il déclare qu’il n’y a pas d’espace pour la discussion. De son côté, l’ouvrier affirme qu’il y a bel et bien un conflit et montre en même temps qu’il existe une langue et un monde communs dans lesquels tous deux peuvent entamer la discussion.
Il se passe donc quelque chose d’intéressant quand les ouvriers entrent en conflit, protestent, occupent l’usine, adressent une réponse au directeur. Ils agissent alors comme s’ils étaient les égaux du directeur, comme s’ils avaient, tout autant que lui, le droit de s’exprimer. Ce qu’ils font donc, c’est amener à la surface une supposition cachée : la hiérarchie de l’ordre ne peut exister sans une égalité fondamentale sous-jacente. Mais, quand on fait monter cette égalité à la surface et qu’on la rend visible, cela a un effet des plus subversifs.
Les travailleurs qui protestent ne revendiquent pas simplement l’égalité dans un lointain avenir. Ils mènent leur action à partir de la supposition qu’ils sont déjà égaux ici et maintenant. Chaque fois que des gens agissent politiquement, explique Rancière, ils le font à partir du postulat d’égalité : ils font comme s’ils étaient les égaux des puissants, même s’il existe de facto toutes sortes de formes d’inégalités économique, politique ou autre. Agir à partir du postulat de l’égalité a toujours un effet très révélateur. Une grande partie de la philosophie de Rancière s’appuie sur ses recherches historiques sur les débuts du mouvement ouvrier français dans les années 1820-183020. Mais il donne également des illustrations plus récentes. Ainsi, il y a Rosa Parks, la femme de couleur qui, en 1955, à Montgomery, avait refusé de céder sa place dans le bus à un passager blanc et était devenue un symbole du mouvement des droits civils. Rosa Parks ne revendiquait pas l’égalité dans le futur, mais agissait comme si elle était l’égale du blanc. Ainsi, elle rendait visible quelque chose que l’ordre existant aurait préféré tenir invisible.
L’action politique démocratique, argumente Rancière, part toujours de l’égalité. On ne va pas demander aux politiciens d’assurer plus d’égalité à l’avenir : on va montrer dans ses actions que l’on est égal et qu’on peut faire de la politique soi-même. Chaque fois que des travailleurs font grève, que des mouvements sociaux manifestent, que des militants bloquent les rues, que des femmes ou des minorités prennent la parole dans des endroits où l’on ne s’y attendrait pas, il se produit quelque chose de similaire. C’est un concept important pour la politique socialiste. L’égalité n’est pas seulement un idéal lointain, elle est enracinée dans la lutte même. C’est pour cela que des militants et élus socialistes choisissent de vivre avec un salaire modeste d’ouvrier : eux aussi partent du postulat d’égalité, ici et maintenant. Cela semble un acte symbolique innocent, mais ça ne l’est pas. Ses effets sont très subversifs : on rend ainsi visible le fait que des formes existantes d’inégalité, par exemple entre hommes politiques et citoyens, ne sont absolument pas normales ou naturelles. En même temps, l’on crée ainsi les conditions pour faire de la politique d’une façon tout à fait différente, démocratique et socialiste.
Footnotes
- Marc De Vos, Ongelijk maar fair : Waarom onze samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we hopen, Louvain, LannooCampus, 2015.
- Alexis De Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, Paris, Laffont, 1986, p. 39.
- Ibid., p. 80.
- Ibid., p. 83.
- Ibid., p. 81.
- Étienne Balibar, Les frontières de la démocratie, Paris, La Découverte, 1992, p. 137.
- John Rawls, Théorie de la justice (1971), Paris, Seuil, 1987.
- C’est également le centre d’intérêt du travail de Frank Vandenbroucke sur Rawls. Voir Frank Vandenbroucke, Social Justice and Individual Ethics in an Open Society. Equality, Responsibility, and Incentives, Berlin, Springer, 2001.
- John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid, p. 40.
- Alex Callinicos, Equality, Cambridge, Polity, 2000 ; Jacques Bidet, John Rawls et la théorie de la justice, Paris, PUF, 1995.
- Gerald Allan Cohen, If you’re an egalitarian, how come you’re so rich ? Harvard, Harvard University Press, 2001. Sur Cohen, voir également Nicholas Vrousalis, The Political Philosophy of G.A. Cohen. Back to Socialist Basics, Londres, Bloomsbury, 2015.
- Gerald Allan Cohen, Rescuing Justice and Equality, Londres, Harvard University Press, 2008, p. 27.
- Ibid., p. 40.
- Ibid., p. 42.
- Gerald Allan Cohen, Why Not Socialism ?, Princeton, Princeton University Press, 2009, p. 36.
- Oliver Davis, Jacques Rancière, Cambridge, Polity Press, 2010, p. 56.
- Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, Londres, Lawrence & Wishart, 1998, 483, p. 144.
- Jacques Rancière, Le maître ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Fayard, 2009.
- Jacques Rancière, La mésentente : Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, p. 73.
- Jacques Rancière, La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 1981 ; Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 1998.

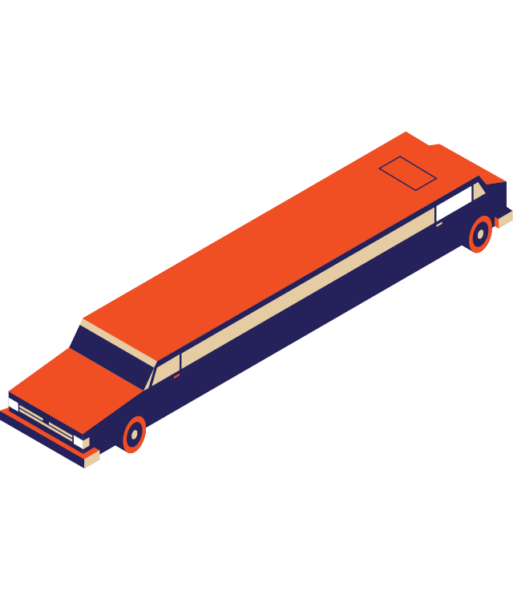 La grève de l’investissement
La grève de l’investissement


