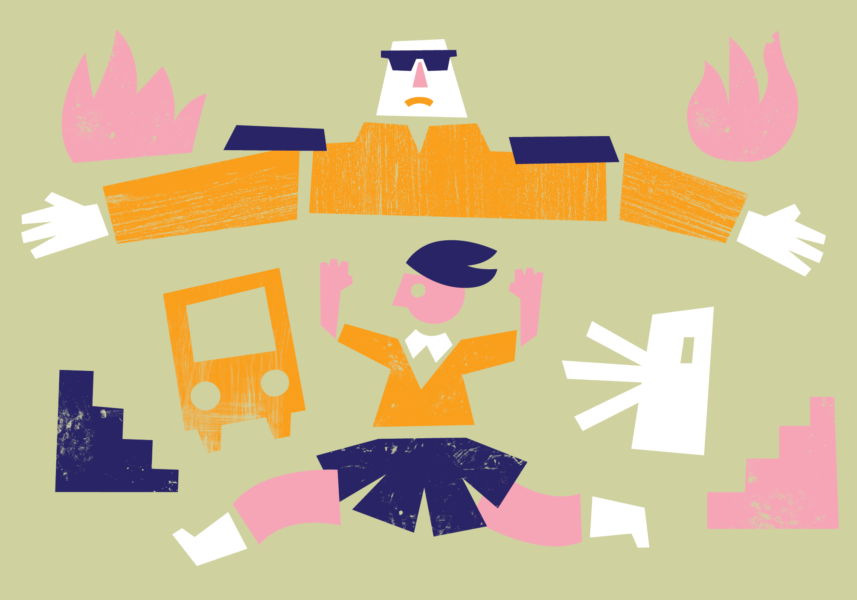Au Yémen, en 2011, on a pu rêver de voir un mouvement de protestation naître lors du printemps arabe. Bien vite, il a fait place à une guerre civile et à une invasion brutale menée par l’Arabie saoudite.

Des milliers de personnes ont été tuées, et des millions sont au bord de la famine. Un accord de paix pourrait raviver les espoirs déçus du soulèvement de 2011, pour autant que l’Arabie saoudite cesse d’exiger la victoire pour ses alliés.
Daniel Finn. Ces trente dernières années, le Yémen a été formellement uni sous la houlette d’un État unique bien que, dans la pratique, le conflit des dix ans écoulés ait brisé cette unité politique. Auparavant, cependant, le Yémen était divisé en deux États. D’où venait cette division ?
Helen Lackner. Au Yémen, le coup d’État militaire est qualifié de révolution plutôt que de coup d’État même si, objectivement, c’est bien de cela qu’il s’agissait. La plupart des habitants du pays l’ont décrit et le perçoivent encore aujourd’hui comme le renversement de l’imamat et le début d’une république. Il est intervenu après des décennies de mécontentement vis-à-vis de l’imam.
Les imams gouvernaient de manière très despotique et violente, surtout l’avant-dernier, Ahmed ben Yahya. De nombreux soulèvements ont eu lieu, les plus célèbres étant ceux de 1948 et 1955, lorsque des groupes de l’élite instruite se sont opposés à l’imam et ont tenté de le renverser militairement. La répression a été particulièrement sévère ; un nombre incalculable de gens ont été décapités, leurs têtes exposées au public en divers endroits.
Ce régime est souvent décrit comme rétrograde et comparable à celui en vigueur à Oman avant 1970. Il était marqué par une fiscalité lourde dans tout le pays, rendant la vie dure à l’immense majorité de la population, couplée à un manque d’investissements dans tous les aspects modernes de la vie intéressant les gens, comme la santé et l’éducation. L’imam avait également envoyé plusieurs officiers en formation en Irak. Ils en étaient revenus gorgés d’idéologie nationaliste arabe et, donc, de tendances anti-monarchiques qui les ont convaincus de vouloir se débarrasser de l’imam.
Ahmed ben Yahya est mort dans son lit. Son successeur, son fils Mohammed al-Badr, était assez progressiste à certains égards. On s’attendait à ce qu’il agisse beaucoup plus dans un cadre nationaliste arabe, mais il n’est resté au pouvoir que dix jours avant d’être renversé. Les choses ont tourné à la guerre civile parce que les révolutionnaires n’ont pas réussi à le tuer. Il s’est enfui pour se rendre au nord, où il a rallié des tribus. Le régime saoudien et d’autres l’ont aidé à riposter.
Les révolutionnaires ont immédiatement obtenu le soutien du dirigeant égyptien Gamal Abdel Nasser qui a envoyé un nombre important de soldats au Yémen. Il y a ainsi pu y avoir jusqu’à 70 000 Égyptiens dans le pays par moments, ainsi que de nombreux administrateurs et conseillers politiques (qui étaient en réalité bien plus que des conseillers). C’était une guerre civile, mais fortement teintée d’ingérences internationales, tout comme celle qui sévit actuellement.
Les Égyptiens soutenaient le camp républicain, tandis que les Saoudiens et les Britanniques soutenaient le camp monarchiste. Si les Britanniques se montraient un peu plus discrets par rapport à leur implication, personne n’était dupe. Ils ont envoyé quelques unités du Special Air Service (SAS). Les Israéliens ont même soutenu les monarchistes dans une certaine mesure.
Fin 1967 ou début 1968, la guerre civile se trouvait pour ainsi dire dans l’impasse. Après le retrait des troupes de Nasser, les royalistes ont tenté de s’emparer de la ville de Sanaa, à laquelle ils ont infligé un siège de 70 jours, ancré dans la mémoire des Yéménites. Ce siège n’a toutefois pas suffi à évincer les républicains. De 1967 à 1969, on a assisté à tout un processus qui a vu les royalistes les plus extrêmes vaincus ou marginalisés. L’aile gauche du mouvement républicain n’a toutefois pas non plus échappé à cette marginalisation. Des gens ont été tués.
Lors de la guerre civile yéménite de 1962, l’Égypte de Nasser soutenait le camp républicain, tandis que les Saoudiens, les Britanniques et même les Israéliens soutenaient le camp monarchiste.
Tout cela a rendu possible l’accord conclu en 1970, dont les signataires ont accepté de maintenir la république. Il s’agissait cependant d’une « république » composée de républicains de droite et des partisans les moins extrêmes de l’imamat. Si aucun membre de la famille de l’imam n’a été autorisé à revenir, l’aile gauche du mouvement a également été balayée.
Comment Ali Abdallah Saleh s’est-il mis à diriger le Yémen du Nord à la fin des années 1970 ?
Ali Abdallah Saleh était un officier de l’armée issu d’une petite tribu appelée les Sanhan, une branche mineure de la plus importante confédération tribale du Yémen, les Hashid. En 1977-78, trois présidents yéménites ont été assassinés, dont deux dans le Nord. Le premier était Ibrahim al-Hamdi, dont tout le pays se souvient avec admiration comme le grand espoir des Yéménites. Il a été assassiné en octobre 1977, alors qu’il s’apprêtait à se rendre à Aden pour signer un accord d’unité avec le président du Sud, Salim Rubai Ali, dit Salmine.
Après l’assassinat d’al-Hamdi, un autre officier, Ahmed al-Ghachmi, est devenu président à Sanaa, avant d’être assassiné à son tour en juin 1978, apparemment par un envoyé de Salmine. Est-ce que cela a réellement été le cas ? Cela fait débat. L’identité de son assassin ne fait aucun doute car ils sont morts ensemble, mais le meurtre avait-il été commandité par Salmine ? C’est une tout autre question. Quoi qu’il en soit, les dirigeants du Sud y ont trouvé un prétexte idéal pour tuer Salmine, et c’est ainsi qu’à la fin du mois de juin 1978, le Yémen avait perdu trois présidents.
À ce moment-là, plusieurs manœuvres ont eu lieu à Sanaa. Je soupçonne que Saleh ait été nommé président dans l’idée qu’il serait un simple exécutant. Lorsque je me suis rendue pour la première fois à Sanaa en 1980, tout au long de cette période et pendant de nombreuses années par la suite, nous pensions tous qu’il y aurait un coup d’État un jour ou l’autre. Nous nous attendions à nous réveiller un matin pour découvrir que Saleh avait été assassiné.
On disait que personne ne lui aurait vendu une assurance-vie, même pour un million de dollars, parce qu’il aurait fallu la payer immédiatement. Bien sûr, l’histoire nous apprend que nous nous trompions à l’époque puisqu’il est finalement resté président pendant 33 ans.
De quelle nature était la lutte contre la domination coloniale britannique à Aden dans les années 1960 ? Et quelle en a été l’issue ?
La situation était différente à Aden. La révolution de Sanaa en 1962 avait incité les nationalistes du Sud à défier sérieusement le pouvoir colonial britannique. Tout au long de cette période, la domination britannique a été plusieurs fois contestée, plus ou moins vigoureusement, mais de manière très localisée, la société sud-yéménite étant déjà très fragmentée à cette époque.
Après 1962, il y a eu l’influence du nassérisme d’une part, ainsi que l’essor du mouvement syndical à Aden d’autre part. Les syndicats étaient un élément clé de la politique de gauche dans cette région, émergente depuis le début ou le milieu des années 50. Depuis la construction de la raffinerie, il existait un solide mouvement syndical à Aden.
Parmi les personnes qui avaient été envoyées étudier à l’Université américaine de Beyrouth, nombreuses étaient revenues fortement influencées par le Mouvement nationaliste arabe (MAN), créé en 1958. Le MAN était le précurseur de nombreux mouvements de gauche dans le monde arabe, comme les deux principales organisations de gauche palestiniennes, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP), ainsi que, à Oman, le Front de libération du Dhofar et du Golfe arabe (FLDGA).
Deux mouvements étaient à l’œuvre, l’un essentiellement rural, lié au MAN, et l’autre urbain, issu du mouvement syndical. Ces deux mouvements de libération rivaux, autant en lutte entre eux que contre les Britanniques, étaient le Front de libération du Yémen du Sud occupé (FLYSO), aligné sur les syndicats et très nassérien dans son orientation politique, et le Front de libération nationale (FLN). Le FLN comprenait des partisans du MAN, ainsi que des personnes qui avaient une idéologie de gauche encore plus marquée et d’autres dont l’approche était plus tribale. C’était un mouvement beaucoup plus diversifié que le FLYSO.
Avant que la Grande-Bretagne ne quitte le pays, à l’été 1967, ces deux groupes combattaient davantage l’un contre l’autre que contre les Britanniques. Le FLN a effectivement vaincu le FLYSO en août de cette année-là, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les Britanniques ont négocié l’indépendance du Yemen du Sud avec le FLN plutôt qu’avec le FLYSO.
Une autre raison était que le FLYSO était, aux yeux des Britanniques (mais en réalité aussi) étroitement lié au nassérisme, et les Britanniques, à cette époque, voyaient Nasser d’un très mauvais œil. Enfin, ils connaissaient extrêmement mal le FLN. Lorsqu’on lit les documents ou les mémoires de fonctionnaires britanniques au sujet de cette période, ils admettent souvent qu’ils n’avaient, en gros, aucune idée de ce qu’était le FLN.
Après le retrait des Britanniques, pourquoi le Yémen du Sud est-il passé sous la coupe du FLN, avant de devenir le seul pays arabe à prendre officiellement la voie du marxisme de type soviétique ? Derrière la rhétorique, que signifiait réellement ce système pour les gens qui en dépendaient ?
La deuxième partie de votre question est la plus facile. Pour la population, cela signifiait un niveau de vie très raisonnable qui, en fait, était largement supérieur aux capacités financières de l’État, compte tenu de sa situation économique et de ses ressources naturelles limitées. Il faut rappeler que les deux principales ressources économiques de cette partie du Yémen étaient le port d’Aden, dont les activités se sont effondrées lors de la fermeture du canal de Suez suite à la guerre israélo-arabe de 1967, et la base britannique, qui a évidemment disparu avec le départ des Britanniques.
L’un des principaux atouts du régime de la République démocratique populaire du Yémen (RDPY) était sa capacité à fournir un enseignement, des soins de santé, des infrastructures et des emplois de qualité dans tout le pays. La plupart des gens touchaient des revenus qui, sans être exceptionnels, leur suffisaient à pourvoir aux besoins de leur famille, grâce aux subventions alimentaires et autres aides de base.
C’est l’aspect du régime que les gens considèrent aujourd’hui encore comme le « bon vieux temps » alors que, pour d’autres, ce serait plutôt la période coloniale britannique. Mais ceux qui se souviennent de la RDPY, ainsi que leurs enfants, et maintenant petits-enfants, gardent un souvenir positif de ce régime, qui leur a permis de disposer d’un niveau de vie adéquat, sans corruption et sans disparités sociales majeures. Cela valait tant dans les zones urbaines que rurales (la majorité des gens étaient des ruraux, même à cette époque), malgré le fait que la réforme agraire et les systèmes ruraux laissaient à désirer, à tous les niveaux.
On se souvient positivement de la République démocratique populaire du Yémen pour avoir permis des niveaux de vie adéquats, sans corruption et sans disparités sociales majeures.
Pour ce qui est de la première partie de votre question : pourquoi est-il devenu le seul pays engagé dans le marxisme, sous quelque forme que ce soit ? D’ailleurs, ils n’appelaient pas cela du marxisme, mais bien du « socialisme scientifique ». Il faut tenir compte de l’ensemble de la période historique à laquelle nous avons affaire. On parle des années 1970 et 1980, après la fin officielle du conflit sinosoviétique. Il y a aussi les répercussions de l’impact de la révolution culturelle en Chine. Il y a eu très tôt une forte influence de la Chine, comme l’ont reflété les débats au sein du Parti socialiste yéménite (PSY).
Je pense que c’est en grande partie grâce à la situation internationale globale que cela a été possible. À partir de 1967, le nassérisme et le nationalisme arabe ont perdu du terrain, à une époque où le baasisme en Irak et en Syrie était également largement discrédité aux yeux de quiconque connaissait ces régimes. Par conséquent, les formes de socialisme qui semblaient offrir un avenir possible ou raisonnable au Moyen-Orient venaient d’Europe de l’Est, de Chine ou de Cuba. Il y avait une importante mission médicale cubaine à Aden, car Cuba y avait formé et développé une école de médecine. Cela a eu un impact marquant sur le plan idéologique.
Il faut également se rappeler que, dans ce contexte de guerre froide, l’Union soviétique jugeait très pratique d’avoir accès à Aden comme position navale et d’avoir en quelque sorte un pied dans la région, d’autant plus que le reste de la péninsule arabique était dirigé par des monarchies totalitaires, comme c’est toujours le cas aujourd’hui. Bien que ce ne soit pas la réponse complète, je pense que ces facteurs y ont largement contribué.
Pourquoi le parti au pouvoir au Yémen du Sud a-t-il ensuite sombré dans des luttes de pouvoir assez sanglantes entre factions rivales dans les années 1970 et 1980 ?
Pour tout vous dire, je serais curieuse de le savoir ! J’y ai vécu pendant cinq ans, soit une part importante de la durée d’existence du régime. C’est l’une des choses que je demandais aux dirigeants lorsque je les croisais. La principale question que je leur posais, et à laquelle je n’ai jamais obtenu de réponse, était la suivante : pourquoi utilisaient-ils des modèles externes au lieu de développer leur propre analyse marxiste basée sur les réalités sociales et économiques du pays ?
Ce que je viens d’évoquer est clairement lié à leur factionnalisme précoce. Par exemple, parmi les principaux dirigeants, Salmine était considéré comme un populiste suivant la ligne chinoise, tandis qu’Abdul Fattah Ismail était considéré comme une sorte de bureaucrate suivant une approche bureaucratique soviétique très directe. Ali Nasser Mohamed était considéré comme un pragmatique à la croisée de ces deux chemins. On pourrait dire que ces différences entre eux étaient un élément de réponse.
Beaucoup de gens disent qu’il s’agissait simplement d’une lutte tribale. Je ne suis pas d’accord avec cette interprétation. Les événements de 1986, les plus sanglants de tous, ont dégénéré pour se muer en une lutte tribale. Après les premiers combats du 13 janvier, certaines personnes ont été agressées et tuées sur base de leur carte d’identité et de leur origine. Cela a tourné à la lutte tribale, ou régionale, mais ce n’en était pas une au départ.
Pour moi, la lutte de 1986 n’était à la base rien d’autre qu’une lutte de pouvoir, de gens qui voulaient prendre la place d’autres personnes. Quelques mois après ces événements, je suis retournée au Yémen. J’avais publié mon livre sur la RDPY quelques mois auparavant, en octobre 1985, et de nombreuses personnes souhaitaient que je rédige une analyse des événements de 1986 pour une édition arabe, mais cela ne s’est jamais fait. J’ai passé un mois à voyager dans la région de la RDPY et à Sanaa, où la faction vaincue s’était réfugiée, à interviewer autant de dirigeants que possible et à prendre un paquet de notes, que j’ai toujours.
J’avais plusieurs questions à leur poser : qu’est-ce qui vous différencie en matière de politique étrangère ? Qu’est-ce qui vous différencie en matière de politiques sociales, de politiques économiques, et, en particulier, de politiques rurales ? Leurs réponses ont fini par former un récit sans queue ni tête. J’en ai conclu que la seule chose pour laquelle ils se battaient, c’était la place du chef. En tout cas en 1986.
En 1969, la lutte pour le pouvoir avait été un affrontement gauche-droite beaucoup plus direct sur des politiques différentes. Celle de 1978 a été principalement perçue comme un mouvement anti-populiste, contre les pro-chinois, dont le camp plus directement pro-soviétique est sorti vainqueur. Je ne sais pas dans quelle mesure cela répond à la question, mais je pensais évidemment à l’époque (et je le pense toujours aujourd’hui) que ces luttes étaient très contre-productives.
Un autre élément à prendre en compte est le soutien et le financement de l’opposition au régime de la RDPY par les Saoudiens, les Britanniques et d’autres sources encore, qui l’encourageaient clairement. Le régime a dû faire face à des incursions armées et combattre des ennemis de tous bords, y compris ceux qui avaient été vaincus à la fin du colonialisme britannique, puis plus tard, après les luttes de 1969, 1978 et 1986.
Ils avaient bel et bien des ennemis, et il était évident que ces ennemis utiliseraient des moyens directs et indirects pour favoriser la division et la dissidence parmi les dirigeants. Mais ils auraient pu répondre à ces provocations en présentant un front plus uni, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait.
Comment les deux parties du Yémen se sont-elles unifiées au début des années 1990 ? Quel type de système a pris forme dans le nouvel État après l’unification ?
L’unification a eu lieu en 1990, suite à la conjonction de plusieurs facteurs. L’unité du Yémen a longtemps été le plus populaire de tous les slogans officiels dans les deux parties du pays. Dans les écoles yéménites, chaque matin, les enfants se levaient et récitaient les slogans nationaux standard. De trois éléments, l’unité yéménite était le plus populaire ; les deux autres étant la « défense de la révolution yéménite » et la « mise en œuvre du plan quinquennal ». C’était très ancré.
Les formes de socialisme semblant offrir un avenir possible ou raisonnable au Moyen-Orient venaient d’Europe de l’Est, de Chine ou de Cuba qui avait envoyé une importante mission médicale à Aden.
Les gens avaient également souvent des parents dans l’autre partie du pays. Un nombre considérable de Yéménites du Sud ont migré vers l’Arabie saoudite et les États du Golfe pour y travailler en passant par le nord, car la République arabe du Yémen (RAY) avait un accord spécial avec les Saoudiens, ce qui signifiait que ses citoyens n’étaient pas soumis aux réglementations habituelles applicables aux travailleurs étrangers et qu’ils pouvaient aller et venir à leur guise et travailler sans devoir nécessairement être invités par un employeur. Il était très pratique pour tout le monde d’entrer avec un passeport du Yémen du Nord, si bien que de nombreux habitants du Sud se rendaient à Sanaa pour demander un passeport de la RAY, ce qui était autorisé.
Je pense qu’il existe bien une nation yéménite, même s’il y a des différences entre quelqu’un de l’extrême Est et quelqu’un de l’extrême Nord. La plupart des Yéménites ont des caractéristiques en commun. Pendant des dizaines d’années, lorsque les gens parlaient d’unité arabe, je ne les prenais pas au sérieux (je ne pensais pas que cela pouvait arriver), alors que j’ai toujours pensé que l’unité yéménite était une possibilité réelle, parce qu’il y avait ce lien culturel et historique entre les gens au sein et d’un bout à l’autre du pays, en ce compris quelques régions qui n’en font pas partie actuellement.
Bien sûr, il y avait divers éléments politiques. D’une part, sur le plan interne, tant la RDPY que la RAY étaient en crise. À cette époque, Ali Abdallah Saleh était au pouvoir depuis dix ans. Son régime se renforçait, ce qui provoquait un mécontentement considérable au sein de la population. Les revenus provenant du pétrole n’avaient commencé à rentrer qu’en 1986-1987. Une région centrale s’était rebellée contre son régime. Saleh avait ses propres problèmes à régler.
Le régime de la RDPY après 1986 était fondamentalement discrédité aux yeux de la population, car tout le monde avait perçu les événements du 13 janvier comme une lutte de pouvoir meurtrière, qu’au moins 5 000 personnes avaient payée de leur vie. Il y avait eu une émigration massive parmi les factions vaincues depuis 1969. Ce régime a été incapable de rétablir sa crédibilité auprès de la population, malgré les efforts très positifs qu’il a déployés, par exemple, en autorisant une plus grande liberté d’expression et en permettant à d’autres partis d’exister.
Le pays s’est unifié, entre autres, suite à la découverte de pétrole à un endroit précis situé à la frontière entre les États yéménites et l’Arabie saoudite. On pensait (à juste titre, à mon avis) que, si les deux Yémen se mettaient à s’affronter à ce sujet, les Saoudiens s’empareraient tout simplement de l’ensemble. Constituer un État unifié était bien sûr une meilleure solution.
Saleh y était favorable. Il pensait (et il me semble que l’histoire lui a donné raison) qu’il allait s’en servir et en ressortir plus fort. Au moment de l’unification, il y avait environ neuf millions de Yéménites de la région autonome du Yémen et environ deux millions de la région autonome du Pakistan, de sorte que l’équilibre de la population penchait largement en faveur de la région du Nord.
La nature de l’accord d’unité reste encore controversé aujourd’hui, car le parti socialiste yéménite pensait avoir marqué son accord sur un système fédéral et que son dirigeant de l’époque, Ali Salem al-Beidh, avait été trompé par Saleh qui l’avait poussé à opter pour l’unité totale. C’est l’histoire la plus répandue et elle est peut-être vraie, je n’en sais rien.
À l’époque, tous les Yéménites ont accueilli l’unité avec grand enthousiasme, car ils aspiraient à pouvoir voyager librement et à ce que les habitants du Sud aient accès aux biens matériels disponibles dans le Nord. L’unité suscitait chez beaucoup de gens deux grands espoirs qui méritent d’être rappelés.
Le qat, comme vous le savez peut-être, est une drogue douce très consommée au Yémen. Dans la RDPY, il y avait des règlements selon lesquels on ne pouvait en consommer que les week-ends et les jours fériés. Dans la RAY, il était autorisé en permanence et s’était énormément répandu et il n’a cessé de se répandre depuis. Dans les deux parties du Yémen, beaucoup de gens espéraient que les règles du Sud par rapport au qat seraient imposées dans tout le pays.
Par ailleurs, beaucoup de femmes espéraient que le droit de la famille de la RDPY prévale car il améliorait considérablement la situation des femmes. Il leur accordait officiellement les pleins droits, contrairement aux règles en vigueur dans la RAY.
Bien sûr, c’est le contraire qui s’est produit. Les lois sur le qat de Sanaa se sont étendues à l’ensemble du Yémen et l’on voit maintenant des gens en mâcher l’après-midi et la nuit, partout dans le pays. Le droit familial du Nord a été imposé. Les femmes du Sud, ou plutôt les femmes de tout le Yémen, ont vu leur situation se détériorer considérablement par la suite.
Une brève guerre civile a éclaté en 1994, lorsque certains habitants du Sud ont tenté de réaffirmer leur indépendance. Ils ont été militairement vaincus par les forces de Saleh avec le soutien, non seulement d’un certain nombre d’islamistes et d’« Afghans », comme on les appelait (des gens revenus du djihad en Afghanistan), mais aussi de ceux qui avaient été vaincus en 1986. Cet aspect est pertinent aujourd’hui si l’on considère la situation du Conseil de transition du Sud et le séparatisme du Sud, car les forces pro-Saleh comprenaient l’homme qui a succédé à Saleh à la présidence, Abdrabbo Mansour Hadi, qui avait été dans le camp des perdants en 1986.
Le pays s’est unifié, entre autres, suite à la découverte de pétrole à la frontière entre les États yéménites et l’Arabie saoudite.
Après 1994, le régime que Saleh avait mis en place dans la région autonome du Yémen s’est étendu à l’ensemble du pays. Si le régime présentait bien une démocratie formelle et d’autres partis, les décisions étaient surtout prises par une petite clique militaire et les avantages revenaient à une clique de kleptocrates tout aussi restreinte. Cela a bien sûr causé un grand mécontentement dans le Sud. Le Nord n’a pas particulièrement apprécié non plus, mais ils y étaient habitués.
Selon vous, quels ont été les principaux facteurs à l’origine du soulèvement qui a finalement chassé Saleh à partir de 2011 ? À votre avis, quels sont les points communs entre le Yémen et les autres pays arabes qui ont chassé leurs dirigeants à la même époque ?
Ces motifs de frustration suscités par le mode de gouverner de Saleh ont certainement majoritairement contribué au soulèvement. Et cette frustration était notamment due à l’accroissement de la pauvreté dans tout le pays.
Au début des années 2000, j’ai vu au Yémen une pauvreté que j’avais rencontrée dans des endroits comme le Pakistan ou l’Afrique de l’Ouest, à laquelle je ne me serais jamais attendue au Yémen. En effet, il n’y avait pas d’emplois, la population augmentait de 3 % par an, contrairement aux ressources, et les kleptocrates raflaient tout ce qu’ils pouvaient, ne laissant que des miettes derrière eux. Chaque année, on voyait de plus en plus de gens sombrer dans la pauvreté, mendiant dans les rues.
Les tensions politiques s’exacerbaient. Saleh était partisan du diviser pour mieux régner. Une politique qu’il appliquait à tout le monde, mais qui s’est surtout concentrée sur l’extrême Nord, d’où est parti le mouvement houthi. Entre 2004 et 2010, six guerres ont opposé les Houthis et le régime de Saleh. Dans le sud, la mobilisation a commencé fin 2006, au sein du mouvement séparatiste sudiste. Celui-ci rassemblait des milliers d’officiers militaires et d’agents de sécurité licenciés après 1994, qui se retrouvaient sans aucun revenu.
La corruption a mis les gens en colère partout. Les jeunes faisaient des études, certes, mais ne trouvaient pas d’emploi. En 2009-2010, Saleh a tenté de modifier la constitution afin de pouvoir se présenter une nouvelle fois aux élections, tout en préparant son fils à hériter de la présidence.
Cela nous amène à la seconde partie de votre question. Saleh espérait aboutir à une « monarchie républicaine », suivant le modèle que Hafez el-Assad avait réussi à mettre en œuvre en Syrie (contrairement à Hosni Moubarak en Égypte), consistant à transmettre le pouvoir à son fils. Sur d’autres aspects également, la frustration au Yémen reposait sur des problèmes très similaires à ceux rencontrés dans d’autres pays : les problèmes économiques, la pauvreté, le manque de démocratie et de liberté.
La liberté d’expression était beaucoup plus présente au Yémen qu’ailleurs dans la région. Saleh avait bien compris que l’on pouvait laisser les gens dire ce qu’ils voulaient, tant qu’ils n’avaient pas d’influence. Ce n’était pas le cas en Syrie, par exemple, et encore moins en Égypte et en Tunisie. Mais, en termes de revendications économiques, sociales et politiques, je pense que c’était la même chose partout. Des exigences similaires ont également été formulées en Algérie et au Soudan dix ans plus tard.
Après ce moment d’ouverture ou d’espoir, aussi timide qu’il ait pu être, en 2011 et 2012, comment le pays a-t-il ensuite sombré dans la guerre civile ? Quel rôle les puissances extérieures ont-elles joué dans la suite des événements ?
En 2011, Saleh a été contraint de quitter le pouvoir. L’armée yéménite s’est divisée. Un certain nombre de partisans de Saleh ont rejoint le mouvement de contestation, y compris une unité militaire clé. S’en est suivie une série d’affrontements militaires entre les loyalistes de Saleh et les supposés partisans de la révolution.
C’est ce qui a mené à une intervention internationale. Il existait un groupe d’États appelé Friends of Yemen, composé de la plupart des grands États du monde et comprenant les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Ils ont soutenu ce que l’on a appelé l’initiative du CCG, devenue plus tard, après novembre 2011, l’accord du CCG.
Cet accord prévoyait notamment que Saleh quitte la présidence. Cependant, Saleh est resté politiquement fort, de sorte qu’il n’a pas été forcé de quitter le pays ni de se retirer de la politique. Il a conservé la main sur le Congrès général du peuple, qu’il avait créé et qui reste aujourd’hui encore l’un des principaux partis ou institutions politiques du pays.
Au début des années 2000, les emplois étaient rares, la population augmentait de 3 % par an, contrairement aux ressources qui n’évoluaient pas, et les kleptocrates raflaient tout ce qu’ils pouvaient.
L’accord du CCG a créé un État transitoire qui était censé durer deux ans. Son président était Abdrabbo Mansour Hadi, qui avait été le vice-président de Saleh. Il a été élu à l’issue d’un scrutin sans opposition ni contestation. Hadi est issu de la RDPY. Il était l’un des principaux membres de la faction vaincue lors du conflit de 1986. C’est ainsi qu’il est devenu le premier président sudiste du Yémen.
De 2012 à 2014, il était censé y avoir un État transitoire, fondé sur divers éléments : un gouvernement d’unité nationale, une réforme du secteur de la sécurité, et ce qu’on appelle la Conférence de dialogue national, qui a été conçue pour rédiger une nouvelle constitution, si nécessaire, et résoudre les problèmes politiques fondamentaux du pays. Ces initiatives ont toutes échoué.
Les partisans de Saleh étaient représentés à 50 % au sein du gouvernement d’unité nationale. Les 50 % restants devaient être partagés entre l’opposition politique officielle au Parlement, composée du parti Islah, qui regroupe des tribus du Nord et des islamistes, et de toute une série d’autres partis, dont les baasistes, les socialistes et les nasséristes, ainsi que ce que l’on appelait les nouvelles forces issues du soulèvement : les jeunes, les femmes et la société civile.
Ce gouvernement a acquis la réputation d’être le plus corrompu qui ait jamais existé au Yémen. Il était paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. La réforme du secteur de la sécurité a échoué pour de nombreuses raisons, mais surtout parce qu’elle n’a pas réussi à détourner la loyauté des principales unités de sécurité de Saleh vers l’État. La Conférence de dialogue national a échoué pour d’autres raisons. Elle a été mal gérée par les Nations Unies. Elle comptait neuf groupes de travail chargés d’aborder diverses questions, notamment celle des Houthis, la question du Sud et la nouvelle forme que devrait prendre l’État. Ils n’ont pu se mettre d’accord sur aucune question majeure.
Au cours de cette conférence, qui a duré onze mois en 2013-2014, les Houthis ont renforcé leur mainmise sur leur région d’origine et se sont étendus à d’autres zones voisines. Ils ont également initié une alliance avec Saleh, qui était pourtant auparavant leur ennemi numéro un. Or, tant les Houthis que Saleh s’opposaient au fédéralisme, qui était l’une des principales propositions du régime transitoire, ainsi qu’à l’existence même de ce régime. Ayant un ennemi commun, ils se sont unis et ont déposé le gouvernement début 2015. Ils ont alors formé une alliance, dans laquelle les tensions se sont peu à peu accentuées, jusqu’à ce que les Houthis en viennent à assassiner Saleh en décembre 2017.
La guerre à grande échelle a réellement débuté en 2015. Cette guerre est avant tout un conflit interne au Yémen entre toute une série de factions différentes, impliquant différents groupes sociaux et aspects régionaux. L’aspect international du conflit est un facteur supplémentaire et aggravant. L’intervention directe de l’Arabie saoudite et de la coalition de dix États qu’elle dirigeait (dont deux seulement avaient réellement du poids : les Saoudiens eux-mêmes et les Émirats arabes unis) n’a fait qu’augmenter les meurtres et aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique.
Voyez-vous des raisons d’être tout de même optimiste quant à la possibilité de résoudre le conflit et de ramener plus de paix et de stabilité dans le pays ?
Un accord entre les Houthis et leurs opposants est possible, à condition d’amender sérieusement la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations unies du 14 avril 2015, qui a été l’élément onusien déterminant pour l’action au Yémen. En réalité, cette résolution exige la reddition complète des Houthis.
En fin de compte, les Saoudiens ont perdu cette guerre au bout de sept ans. Cela leur a coûté cher en termes d’argent, mais aussi de réputation.
Entre 2015, date à laquelle cette résolution a été votée, et aujourd’hui, les Houthis ont gagné du terrain. Ils contrôlent désormais 70 % de la population du pays et disposent d’un gouvernement opérationnel dans la zone qu’ils contrôlent. Ce gouvernement a beau être horrible, extrêmement tyrannique, fondamentaliste, c’est tout de même un gouvernement opérationnel.
D’autre part, les personnes qui s’y opposent, et notamment le gouvernement reconnu au niveau international, sont de moins en moins influents. Ce gouvernement n’a pratiquement aucun ancrage dans le pays. Il ne représente qu’un petit groupe de personnes opposées aux Houthis.
Un accord entre les Houthis et les Saoudiens, que les Houthis considèrent comme leurs principaux interlocuteurs en matière de négociations, est possible car les Saoudiens ont fini par perdre cette guerre au bout de sept ans. Cela leur a coûté cher, tant en termes d’argent que de réputation, sans parler d’autres facteurs, comme l’assassinat de Jamal Khashoggi. Je pense que Mohammed ben Salmane est prêt à signer un accord.
La question est de savoir s’il est possible de conclure un accord avec les Houthis. Ils sont en quelque sorte coincés dans leur offensive actuelle, mais ils ont progressé lentement. Certaines de leurs factions veulent sans doute la poursuivre, mais d’autres seraient plutôt favorables à un accord. Un accord de ce type est toutefois possible.
Mais, même en cas d’accord, tous les autres problèmes subsisteront, du mouvement séparatiste dans le Sud aux divisions entre les séparatistes du Sud eux-mêmes et les différentes factions politiques du Nord. Ces conflits ne cesseront pas tant qu’il n’y aura pas une approche entièrement nouvelle de la politique au Yémen. Une approche partant de la base pour mettre sur pied une classe politique qui soit autre chose qu’une bande de voleurs égoïstes.
Les Houthis contrôlent désormais 70 % de la population du pays et ont mis en place un gouvernement opérationnel dans la zone qu’ils contrôlent. Ce n’est pas le cas de leurs opposants, soutenus par l’Arabie Saoudite.
N’oublions pas non plus que le Yémen se trouve dans la péninsule arabique et que l’influence des Saoudiens restera puissante. Les Émiratis ont également renforcé leur influence, qui n’est en aucun cas positive. L’Iran exerce aussi son influence sur les Houthis, bien qu’elle ne soit pas déterminante comme d’aucuns ont tendance à le prétendre. Même si les combats cessent officiellement, l’ingérence extérieure se maintiendra, sous une forme ou une autre.
En outre, l’économie du pays s’étant complètement effondrée, la reconstruction ne pourra pas se faire sans un soutien financier de grande ampleur. Je crains la perspective de politiques néolibérales, de sociétés de conseil occidentales utilisant les fonds saoudiens et émiratis pour promouvoir leurs propres intérêts et créer des programmes de développement qui transformeraient le Yémen en une imitation, une version de mauvaise qualité de ce que les Émirats font de pire. J’entends par là les Émirats pauvres, pas Dubaï ou Abou Dabi. C’est là une perspective qui est tout sauf réjouissante.
Le 1er avril dernier, le nouvel envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a annoncé un accord de trêve de deux mois. Comment cet accord a-t-il été conclu et quelles en sont les implications à long terme pour le Yémen ?
En soi, la trêve est un événement important dans la mesure où c’est la première fois qu’une tentative d’arrêter les combats au Yémen aboutit en six ans. Elle prévoit aussi certaines mesures importantes qui amélioreront les conditions de vie du peuple yéménite. Une des raisons probables de cette trêve est la reconnaissance tardive par les dirigeants de toutes les parties de l’impossibilité de sortir de l’impasse militaire de la région de Marib.
Marib revêt une importance particulière car c’est le dernier véritable bastion du gouvernement internationalement reconnu (GIR). Deux années d’offensives des Houthis n’ont pas réussi à déloger les forces du GIR malgré des pertes humaines extrêmement lourdes. Fin 2021, alors que les Houthis semblaient proches d’une victoire, la coalition a montré sa détermination à défendre Marib en faisant venir des renforts d’autres régions du Yémen.
Une deuxième raison est la frustration croissante des acteurs internationaux (les Saoudiens et les Émiratis en particulier) face à l’incapacité de leurs partenaires yéménites à fonctionner de manière unifiée et à chercher sérieusement une solution. L’appel lancé début mars par le Plan d’action humanitaire des Nations unies n’a pas eu l’effet escompté, puisqu’il n’a permis de recueillir que moins d’un tiers du montant recherché. Troisièmement, Grundberg s’est montré compétent et déterminé dans le rôle d’envoyé qui lui a été confié en août 2021, en lançant un processus de discussions avec les différentes parties. Espérons que ces discussions porteront leurs fruits prochainement.
Dans un autre registre, le Conseil de coopération du Golfe a organisé à Riyad ce qui a été présenté comme un dialogue intra-yéménite de dix jours. Comme on pouvait s’y attendre, les Houthis ont refusé de participer à une réunion convoquée dans la capitale de l’État responsable du lancement de la guerre aérienne au Yémen. C’est devenu une réunion des forces anti-Houthi, dont les différentes factions sont hostiles les unes envers les autres, quand elles ne s’opposent pas carrément militairement.
Si l’on s’attendait bien à des changements dans la direction du GIR, le résultat a été une surprise, peu en lien avec la réunion elle-même. Le 7 avril, Hadi a annoncé son propre retrait et celui de son viceprésident, qui sera remplacé par un conseil présidentiel de direction (CPD) composé de huit hommes (et d’aucune femme). Le texte qu’il a lu n’était pas sans rappeler la démission forcée du Premier ministre libanais Saad Hariri en 2017, également sous pression saoudienne.
Il faudra bien plus que des négociations pour parvenir à une paix durable et constituer un gouvernement soucieux de résoudre les problèmes de la population dans son ensemble.
Le CPD est chargé, entre autres, de négocier la paix avec les Houthis. Cet organe, imposé par les régimes saoudien et émirati sans que les Yéménites eux-mêmes aient pu donner leur avis à ce sujet, se compose d’individus dont l’inimitié est notoire. Il s’est maintenant réuni à Aden, mais il reste à voir s’il sera en mesure de fonctionner efficacement et de prendre ses responsabilités.
Grundberg procède à de larges consultations des parties yéménites concernées. L’envoyé des Nations unies tentera probablement d’élargir la participation aux pourparlers afin d’améliorer l’équilibre entre femmes et hommes et d’y inclure des personnalités influentes de la société civile. C’est essentiel si l’on veut parvenir à une paix véritablement durable, en répondant aux besoins des Yéménites en matière de droits, d’opportunités et de niveaux de vie acceptables. Ce nouveau CPD simplifiera-t-il ou compliquera-t-il la tâche à Grundberg ? La question reste ouverte.
Un accord pour mettre fin aux combats semble maintenant plus plausible, car la plupart des dirigeants reconnaissent qu’il est peu probable que l’on sorte de l’impasse actuelle. Toutefois, il faudra bien plus que des négociations entre les factions actuelles pour aboutir à une paix durable et à un gouvernement soucieux de se pencher sur les problèmes de la population dans son ensemble. Or, ces problèmes sont colossaux, avec plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté et sept années de destruction des infrastructures du Yémen, tant matérielles que sociales.