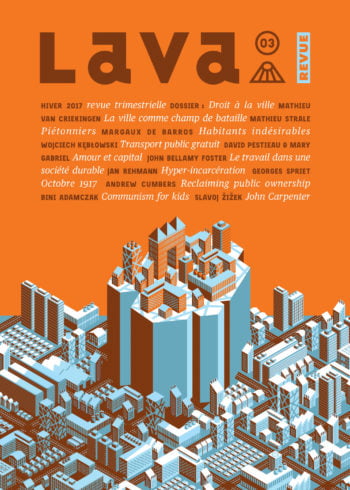Les questions urbaines, souvent présentées comme des problèmes « techniques », sont plus que jamais traversées par de profonds antagonismes. Elles sont matière à conflits sociaux bien davantage qu’à « consensus »

Au tournant des années 1960 et 1970, dans ce qui était alors le bloc de l’Ouest, la « question urbaine » était parvenue à se hisser parmi les sujets politiques primordiaux. Les réflexions d’Henri Lefebvre sur le droit à la ville, de Manuel Castells sur les luttes urbaines ou de David Harvey sur les liens entre ville et justice sociale, combinées à celles de toute une génération de militants engagés dans une myriade de luttes concrètes, n’étaient pas pour rien dans cette situation. Elles avaient notamment permis de diffuser l’idée que l’espace (urbain) n’est pas donné comme un fait de la nature, mais activement produit.
Autrement dit, le cadre de la vie quotidienne des citadins, ses formes matérielles (bâtiments, équipements, espaces publics…), comme ses paysages symboliques (les images, les réputations ou les stigmates associés aux lieux), est toujours le résultat d’une production sociale. Pour Lefebvre, Castells, Harvey et beaucoup de militants, poser la question urbaine était ainsi la voie à suivre pour dévoiler au grand jour l’emprise d’impératifs spécifiquement capitalistes (fabriquer et vendre avec profit toutes sortes de marchandises, spéculer sur des bâtiments ou des terrains pour capter des plus-values immobilières ou foncières, inscrire la domination sociale dans le paysage des villes tout en se prémunissant des révoltes…) sur la production de l’espace de vie des citadins. C’était également la voie à suivre pour trouver des pistes pour contester cette emprise et chercher des alternatives.
Il était alors clair que produire l’espace urbain n’est pas réductible à une somme d’actes techniques et technocratiques — de « gouvernance urbaine », comme on dit aujourd’hui —, mais qu’il s’agit, d’abord, d’une matière profondément politique. La production de l’espace repose constamment sur toute une série de choix posés en fonction d’intérêts économiques, d’ambitions politiques, de cadres idéologiques ou encore de logiques institutionnelles. Par (sans) qui l’espace urbain est-il produit ? Pour (contre) qui ? Au profit (détriment) de quels intérêts ? En phase (décalage) avec quelles aspirations ? Au nom de quel modèle de développement ? Qui décide (ou pas) ?
Les réponses à toutes ces questions ne découlent jamais d’un « bon sens » universel ou d’un « intérêt général » défini une fois pour toutes. Au contraire, elles sont ordinairement affaire de concurrence, de rivalités et d’antagonismes, entre des fonctions, des activités, des groupes d’intérêts, des classes ou fractions de classes… Produire la ville est une activité sociale éminemment conflictuelle et les transformations qui en découlent dans le cadre de vie sont d’ordinaire bien plus violentes (socialement, économiquement ou symboliquement) qu’elles n’en ont l’air de prime abord. En ce sens, la ville est aussi un champ de bataille1.
Dans un schéma où « développement urbain » rime avec spéculation forcenée, l’accumulation va structurellement de pair avec la dépossession
Pourtant, la substance profondément politique des questions de production de l’espace urbain est aujourd’hui rarement reconnue, et encore plus rarement discutée publiquement. Elle n’émerge du flot des actualités que par la médiatisation de grands projets urbains qui font particulièrement polémique et suscitent beaucoup d’oppositions — sacrifier un parc public pour faire place à un nouveau centre commercial à Istanbul, défigurer d’anciens quartiers ouvriers pour y aménager des nouvelles zones haut de gamme to live, work and play à Hambourg ou Marseille, détruire des quartiers d’habitat populaire pour permettre l’organisation des Jeux olympiques à Rio de Janeiro, par exemple.
D’ordinaire, par contre, ces questions baignent dans un climat dépolitisé, comme engluées dans un marais post-politique. Toute l’attention semble consacrée à construire le « dialogue » entre les « parties prenantes du territoire », à pérenniser des « partenariats » entre les « forces vives » (publiques et privées) de la ville et à entretenir la « participation citoyenne » en matière d’aménagement urbain. Les appels à construire des « visions partagées » du développement territorial succèdent aux invitations à « coproduire la ville » ou à « faire ville ensemble », comme si toutes les inégalités de classe, de « race » ou de genre pouvaient s’effacer par la seule force de l’appel au consensus. Qui plus est, l’heure est aussi à « l’urbanisme de projet », censé plus efficace, imaginatif, ouvert et souple que « l’urbanisme de plan ».
Cette façon de faire mène inlassablement à compartimenter les discussions, toujours focalisées sur un projet, et puis un autre, et puis un autre… C’est alors la réflexion sur le système urbain dans son ensemble qui se perd, sur tout ce qu’un projet ici implique pour là-bas, et vice versa. N’y a-t-il pas, par exemple, quelques liens à identifier entre la reconversion d’un ancien bâtiment industriel en musée d’art contemporain dans un quartier en plein « renouveau », la croissance du nombre de logements proposés sur airbnb aux alentours et le nombre de mal-logés dans l’ensemble de la ville ?
En somme, l’air du temps veut que les questions urbaines, pareillement à d’autres questions à dimension collective (la question environnementale, par exemple2), soient traitées sur le mode de la recherche du consensus entre « partenaires » reconnus, au moyen de mécanismes de gouvernance ad hoc et de dispositifs de participation citoyenne — du moins tant que ceux-ci ne remettent rien de sérieux en cause dans l’ordre urbain existant. Que « le clivage gauche/droite [soit] de moins en moins prédictif du contenu des politiques urbaines »3 n’est qu’un des symptômes apparents de cette dépolitisation. Quant à penser les questions urbaines en termes de lutte des classes, la chose paraît désormais incongrue, inaudible.
Les paradoxes de la dépolitisation
Cette dépolitisation des questions urbaines contemporaines est, à vrai dire, très paradoxale. En effet, les acteurs dominants du capitalisme contemporain ont fortement « besoin de ville » pour soutenir et perpétuer leurs logiques d’accumulation. En d’autres mots, produire des espaces urbains à leur image et à leur avantage leur est plus que jamais nécessaire.
D’aucuns, dans les années 1990 ou au début des années 2000, avaient cru pouvoir anticiper un déclin inexorable des villes, concentrations spatiales devenues superflues ou même contre-productives à l’ère de l’internet et des technologies numériques. Les contraintes de distance s’effaçant du fait des avancées technologiques et de la libéralisation des échanges commerciaux et des marchés de capitaux. Le monde était en train de devenir « plat », vaste level playing field effaçant les divisions culturelles, politiques, historiques… En conséquence, s’il ne voulait pas être déserté par les entreprises et les capitaux, chaque territoire (ville, région, pays…) devait sans tarder se préoccuper de sa compétitivité.
C’est pourtant l’inverse d’une dispersion spatiale qui s’est produit. Les leviers de commande du capitalisme mondialisé (sièges des multinationales et des grands médias, banques, gestionnaires de fonds financiers, cabinets de consultance, agences de publicité, etc.) n’ont sans doute jamais été autant concentrés en aussi peu de lieux : des villes devenues métropoles (ou « villes globales »), et dans certaines d’entre elles, encore davantage que dans d’autres.
Dans le même temps, de très nombreuses autres villes ou régions ont été marginalisées, reléguées dans un statut de périphérie dominée (comme Valenciennes, Charleroi, Sheffield, Aberdeen, Leipzig ou encore Detroit et Cleveland, par exemple). Souvent, il s’agit de villes moyennes frappées par les fermetures d’industries, les politiques d’austérité adoptées à la suite du krach financier de 2008, et qui peinent à retenir leurs jeunes. Au contraire d’un « aplatissement » des hiérarchies territoriales, celles-ci se sont renforcées et leurs pôles opposés — la métropole globalisée et la ville en décroissance (ou shrinking city )4 — se sont éloignés.
En outre, le caractère très financiarisé du capitalisme contemporain est particulièrement lourd de conséquences pour les villes et leurs habitants. Une nuée « d’investisseurs » — des propriétaires lucratifs de capitaux en recherche de nouveaux profits de rente, plus exactement — scrutent à présent les espaces urbains en quête de sites « sous-valorisés » selon des critères de marché, mais « pleins de potentiels », dont la transformation augure de juteuses plus-values foncières et immobilières. À leurs yeux, les environnements urbanisés ne constituent pas seulement des lieux où l’accumulation du capital se produit (dans des bureaux, des usines, des ateliers…), mais aussi, voire avant tout, des ressources, foncières et immobilières en particulier, pour l’accumulation.
Les paysages urbains donnent de plus en plus à voir à l’œuvre la violence économique, écologique et symbolique des riches.
Les quartiers centraux d’habitat populaire, souvent d’anciens faubourgs créés pour les besoins du capitalisme industriel et façonnés par une longue histoire d’accueil des populations immigrées, sont particulièrement dans le viseur de ces stratégies de spéculation. Des plaidoyers s’élèvent à présent de toutes parts pour « redynamiser » ces quartiers « oubliés », « optimiser » leurs territoires et y faire revenir de la « mixité ». Pour quantité de promoteurs, d’entrepreneurs, d’organisateurs d’événements, mais aussi pour beaucoup d’aménageurs et même certaines organisations citoyennes, l’heure serait venue pour ces quartiers de remiser leurs habits populaires et d’enfiler de nouveaux costumes, plus « métropolitains ».
Pour quantité d’habitants ou d’usagers ordinaires de ces territoires, par contre, ces convoitises se paient par des évictions, des relégations en périphérie, des blocages résidentiels, la fermeture de lieux d’approvisionnement ou de socialisation familiers, voire même par des répressions policières. Dans un tel schéma où « développement urbain » rime avec spéculation forcenée, l’accumulation va structurellement de pair avec la dépossession5.
En somme, les paysages urbains donnent de plus en plus à voir à l’œuvre la violence économique, écologique et symbolique des riches. Pourtant, les bestsellers des rayons « études urbaines » des libraires ont pour titre The triumph of the city, Cities are good for you, Happy city, Pour des villes à échelle humaine ou Éco-urbanisme. Défis planétaires, solutions urbaines6.
Pour ajouter encore au paradoxe, toute une série d’institutions prescriptrices de politiques urbaines (la Commission européenne, l’OCDE ou des firmes de consultance comme Mc Kinsey, notamment) martèlent que l’urbanisation du monde est la solution pour relancer l’économie, pérenniser les profits, protéger la nature et assurer la cohésion sociale. À une condition, néanmoins : que le gouvernement des villes fasse place à la gouvernance urbaine et à sa litanie de projets et de partenariats pour que, ainsi, chaque ville puisse devenir « créative », « innovante », « verte », « intelligente » (ou smart) et encore « résiliente ». Le paradoxe de la dépolitisation des problèmes urbains contemporains est là, dans ce fossé entre les fantasmes martelés par ces discours normatifs et les réalités vécues par la grande majorité des citadins.
D’où vient cette dépolitisation ?
Ouvrons d’abord un journal ou un poste de radio. Quand il est question de problèmes urbains — ce qui est en général plutôt rare —, le traitement journalistique proposé est superficiel et souffre de l’utilisation d’un langage particulièrement dégradé. On se trouve en effet habituellement plongé dans un bain de métaphores de la nature, comme s’il était devenu impossible de parler de la ville sans évoquer son « cœur » (c.-à-d. le centre-ville, généralement), ses « artères » (c.-à-d. des boulevards, des tunnels…), ses « poumons verts » (c.-à-d. des parcs, des bois, des jardins…) ou même son « âme » (c.-à-d. à peu près n’importe quoi). Dans la même veine, les opérations de rénovation de quartiers populaires anciennement industriels sont d’ordinaire présentées comme s’il s’agissait d’interventions médicales sur un corps souffrant : « panser les plaies » de la ville, « effacer ses cicatrices » ou même « soigner des cancers urbains ».
Ces formules toutes faites sont moins inoffensives qu’elles n’en ont l’air. À force de répétition, elles impriment dans les esprits l’idée qu’une ville fonctionnerait à la manière d’un organisme vivant, soumis aux lois de la nature et à des rythmes cycliques. La « vie » de la ville ne serait qu’une suite d’épisodes de « déchéance » et de « renaissance », de « dégénérescence » et de « régénération », sans autres causes que des forces naturalisées de développement ou de déclin, et sans autres mécanismes que le passage d’une phase à l’autre du cycle de vie du « corps urbain ». Les villes bougent, changent, mutent, grandissent ou trébuchent… ainsi va la vie… Voir l’œuvre de forces de la nature là où des décisions, des intérêts, des idéologies, des stratégies d’investissement ou de désinvestissement ou encore des logiques institutionnelles opèrent est la plus sûre manière de dénier toute dimension politique à la question traitée.
Penchons-nous à présent sur les documents produits par les agences ou administrations en charge des politiques d’aménagement urbain (brochures, sites web, présentations lors de séances d’information publique, etc.). Le langage, ici, est structuré par une série de mots-clefs qui reviennent sans cesse, d’un document à l’autre comme d’une ville à l’autre : équilibre et cohérence du territoire, qualité ou excellence urbaine, attractivité et rayonnement de la ville…
Le verbiage managérial semble y avoir définitivement pris le dessus : défi, innovation, modernité, connexion, cohésion, dialogue… Au lecteur de s’accommoder de cette « novlangue technométropolitaine »7— aussi pauvre que stéréotypée — ou de passer son chemin. Tout ce discours semble n’avoir pour but que de susciter d’emblée le consensus, plutôt que d’informer un public adulte sur les tenants et aboutissants des options privilégiées en matière de production des espaces urbains.
Les projets y succèdent aux projets, en matière de transport, puis de logement, puis d’environnement…, sans jamais souligner la moindre contradiction possible entre eux. Pourtant, est-il simplement concevable de prétendre réduire l’empreinte écologique de la ville tout en soutenant des politiques d’attractivité qui cherchent à capter toujours davantage de flux de personnes et de marchandises ? Une ville « attractive à l’international » pour les touristes voyageant en avion peut-elle en même temps se prétendre « durable » ? De même, peut-on à la fois vouloir « ramener de la mixité sociale » dans des quartiers populaires et en même temps y assurer le droit au logement des mal-logés déjà là ? N’y a-t-il pas aussi quelque chose de profondément contradictoire à vouloir à la fois susciter des « effets d’entraînements » (ou des « effets de levier ») auprès de « partenaires privés » dans des quartiers rénovés par des programmes publics et, en même temps, y « lutter contre la spéculation » ? Accoler deux objectifs n’a jamais fait disparaître magiquement les contradictions entre eux. Effacer ces contradictions de la discussion, ou faire comme si elles n’existaient pas est par contre un autre puissant levier de dépolitisation.
Les opérations de rénovation de quartiers populaires anciennement industriels sont présentées comme s’il s’agissait d’interventions médicales sur un corps souffrant
Dans les discours politiques, journalistiques, comme dans ceux de maints professionnels de la ville (urbanistes, architectes, consultants…), la dépolitisation des questions urbaines est encore renforcée par une forme de langage utilisée à tort et à travers : la ville. La ville se développe, la ville change, la ville s’engage… comme s’il s’agissait d’un tout homogène fondé sur une seule et même communauté d’intérêts, de besoins et d’aspirations. Les nouvelles technologies comme les piétonniers ou les grands événements sportifs seraient bons pour la ville. Il n’y aurait que d’éternels grincheux pour penser que certains y gagneraient beaucoup plus que d’autres, voire que d’autres pourraient y perdre beaucoup.
La ville, en ce sens, est une « métaphore perverse »8 qui finit par rendre invisibles les lignes de fractures, les divergences de vues et les rapports de forces entre les multiples groupes et catégories de citadins. Cette propriété dépolitisante est d’autant plus pernicieuse que, comme aujourd’hui, les inégalités de classe se creusent, dans les villes particulièrement.
Le verbiage managérial semble avoir définitivement pris le dessus dans les documents produits par les agences en charge des politiques d’aménagement urbain
Enfin, ce climat de dépolitisation doit encore beaucoup à l’incursion de catégories morales dans les discussions sur les problèmes de la ville. La nécessaire critique des modèles urbains aujourd’hui en vue, la « ville créative », la « ville intelligente » et la « ville durable » en particulier, a en effet tôt fait de se cogner à un écran moralisateur. Qui osera se dire contre la « ville durable » passera pour un conservateur insensible à la crise écologique, voire un ami des embouteillages. Qui critiquera la « ville créative » sera promptement assimilé à un ennemi des arts et de la culture, opposé à « tout ce qui bouge et va de l’avant ». Qui s’opposera à la smart city sera dépeint comme un réfractaire au progrès technologique, incapable de « vivre avec son temps ».
Toujours suspectée d’une faute morale, la critique peine à imposer les questions qui permettent de révéler la substance politique des problèmes urbains : produire la ville pour (contre) qui, au nom de quoi et qui décide (ou pas) ? Ces questions, pourtant, ont plus que jamais lieu d’être. Il est en effet symptomatique de constater à quel point ces figures dominantes de la modernité urbaine contemporaine ont en commun d’éviter toute référence à un contenu de classe. Leur imagerie est systématiquement lisse, rassurante et bien rangée, comme sortie tout droit du catalogue d’un marchand suédois de meubles à monter soi-même.
Ces modèles normatifs projettent l’image fantasmée de villes entièrement « moyennisées », c’est-à-dire exclusivement composées de « classes moyennes », à l’exception de quelques « très démunis » dont il est simplement impossible de nier l’existence. Il ne devrait plus être question d’inégalités, mais seulement de différences entre des styles de vie — jeunes cadres dynamiques ou artistes, cyclistes ou joggeurs, amateurs d’art moderne ou de musique du monde, etc.
Les classes populaires, par contre, semblent avoir disparu des radars et, avec elles, c’est la perception des dimensions spatiales des rapports de domination sociale qui s’efface9. Les inégalités entre les parties de la ville sont vues comme des « fractures » territoriales que des programmes ad hoc de « désenclavement » permettront de résorber, plutôt que comme des matérialisations d’une des divisions sociales de l’espace qui réservent les « beaux quartiers » aux groupes dominants et confinent les classes populaires (et une part croissante des classes intermédiaires, en proie à la précarisation) aux parties les moins prisées du territoire. En somme, la ville post-industrielle serait — et devrait être — une ville post-classe, et donc, naturellement, une ville post-politique10.
L’exemple de la gentrification
Dans L’illusion du consensus, Chantal Mouffe pose le « constat de notre incapacité à penser politiquement les problèmes auxquels nos sociétés font face. … [Les] questions politiques ne sont pas de simples problèmes techniques susceptibles d’être résolus par des experts. En vérité, les questions politiques impliquent toujours des décisions qui exigent que l’on fasse un choix entre plusieurs options en conflit »11. Comme j’en ai défendu l’idée au début de ce texte, les questions urbaines sont à ranger parmi ces questions politiques qui peinent aujourd’hui à être pensées comme telles, au même titre, par exemple, que la question écologique.
Chantal Mouffe ajoute encore que « cette incapacité à penser politiquement est très largement due à l’hégémonie incontestée du libéralisme12. » À nouveau, un lien peut être tracé vers les questions urbaines. Au cours des trois dernières décennies, en effet, la production des espaces urbains a été profondément teintée de (néo)libéralisme, même si toute autre influence ou tradition politique n’a pas été pour autant complètement effacée13. Les stratégies de gentrification figurent en bonne place parmi les traits saillants de cette « ville néolibérale ».
À la différence d’emblèmes comme la durabilité, la créativité ou l’intelligence urbaine, la notion de gentrification n’est pas d’emblée propice à l’installation d’un large consensus dans les débats. Elle risque, au contraire, de crisper plus d’un interlocuteur. L’idée même d’en parler est parfois balayée d’un simple revers de main — « je me suis toujours opposé à ce que l’on qualifie de « gentrification » l’installation dans Bruxelles de ménages à revenus élevés. Il faut de tout dans une ville, cela me semble évident15.
De quoi parle-t-on ? Le plus souvent, la notion de gentrification sert à désigner l’appropriation de quartiers populaires par des groupes socialement mieux lotis que leurs habitants ou usagers ordinaires16. Plus ou moins rapidement, ces quartiers deviennent des parties de la ville prisées par des publics bien dotés en capitaux économiques ou culturels, les magazines lifestyle commencent à les trouver « branchés », les guides touristiques découvrent leurs cafés et restaurants « sympas » et des blogueurs se mettent à y faire le classement des meilleures adresses pour bruncher le dimanche. Pour les habitants et les usagers ordinaires des lieux, par contre, cette transformation à la fois matérielle, fonctionnelle et symbolique de l’espace implique toute une série de préjudices : déménagements contraints par des hausses de loyers ou des ventes d’immeuble, blocages résidentiels, fermetures de commerces ou de lieux de socialisation familiers, exclusions symboliques, etc.
Plutôt que de se féliciter de la « revitalisation » de quartiers « qui avaient bien besoin d’un nouvel élan », de leur « renaissance » ou encore de la « résurrection », la notion de gentrification pointe explicitement l’envers du décor : dans les espaces en voie de gentrification, nombreux sont ceux qui font les frais du réinvestissement. Pour cette raison, la gentrification nourrit aussi des vocabulaires de lutte, alors qu’on n’a jamais vu de tags « stop à la résurrection ».
La gentrification est, depuis son origine, un concept critique, bâti sur une lecture en termes de classe de la production de l’espace urbain. On le doit à une sociologue marxiste, Ruth Glass, qui travaillait sur les transformations de quartiers centraux de Londres au début des années 1960, dans le borough d’Islington en particulier. Constatant les effets inégalitaires du réinvestissement de ces quartiers à l’époque encore largement ouvriers, Ruth Glass voulut forger une notion qui, dans son étymologie, pointerait explicitement le contenu de classe du changement à l’œuvre. Elle opta pour la racine « gentry », terme qui désigne une fraction des classes dominantes britanniques et qui, de plus, est souvent employé dans un sens ironique et péjoratif pour désigner des gens aisés, parce que « bien nés ».
Telle qu’initialement posée, donc, la notion de gentrification ne se veut pas propice à une expertise neutre de « mutations » ou de « métamorphoses » urbaines plus ou moins naturalisées. Il s’agit, bien plus profondément, de donner à voir l’une des façons par lesquelles la domination sociale se matérialise et se perpétue au travers de reconfigurations de l’espace urbain — et tous les dégâts que cela engendre. En somme, la gentrification permet aujourd’hui de désigner ce qui se passe dans des quartiers touchés par des processus de réinvestissement en capitaux et en symboles qui impliquent un double mouvement d’appropriation (pour les uns) et de dépossession (pour d’autres)17.
Pourtant, la notion de gentrification — dont l’usage a aujourd’hui largement débordé du champ académique — n’est elle-même pas épargnée par le climat post-politique entourant les questions urbaines contemporaines. C’en est déjà à un point tel que plus d’un expert plaide à présent pour considérer la gentrification comme une « dynamique positive », à encourager et encadrer plutôt qu’à décourager et (surtout pas) à combattre18. En ce sens, le cas de la gentrification est symptomatique de la dépolitisation ordinaire des questions urbaines contemporaines. Il donne aussi à voir ce qui l’en coûte pour la réflexion et l’action.
Pour plus d’un commentateur, la gentrification de quartiers centraux d’habitat populaire dotés de caractéristiques « intéressantes » au plan architectural ou paysager serait simplement un phénomène « naturel », le cours « normal » et même inévitable des « villes qui gagnent » au 21e siècle. Certains quartiers anciens se rénovent, de nouveaux habitants y arrivent et de plus pauvres s’en vont : la gentrification ne serait rien d’autre qu’un indice de (bonne) santé urbaine, un marqueur du « succès » de la ville. Inversement, l’absence de gentrification serait une marque d’échec ou de déclin19.
Beaucoup, aussi, abordent la question sous un angle moral, partant d’une antinomie totalement inepte, pourtant largement répandue : la gentrification ou le ghetto. Par exemple, à Bruxelles, on peut entendre que « le grand débat… est inévitablement la question de “l’envahissement” des quartiers populaires. […] Il faut décomposer ce discours, sortir de la simplification qui dit que ceux qui sont “pour” un développement des quartiers sont automatiquement “pour” l’embourgeoisement, que ce sont des “gentrificateurs” et que les pauvres quartiers populaires doivent rester de pauvres quartiers populaires. » Ce discours est encore assez fort à Bruxelles, mais un tel manque d’ouverture paralyse toute initiative20.
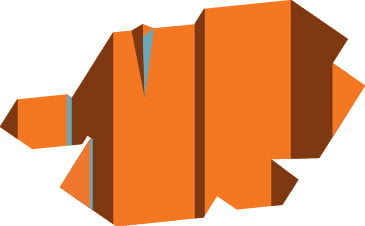 À défaut de « s’ouvrir » à la gentrification, il n’y aurait simplement aucun avenir souhaitable pour les quartiers populaires. Si ce n’est pas la gentrification, ce sera l’appauvrissement, le déclin commercial, la dégradation physique et environnementale… S’appuyer sur un tel faux choix aux lourds accents moralisateurs congèle d’emblée toute réflexion digne de ce nom : « vous n’êtes pas pour l’abandon et la mort des quartiers, tout de même ? ». S’opposer aux logiques de gentrification reviendrait à vouloir faire obstacle à l’aménagement d’une ville rénovée, consciente des enjeux écologiques du présent et autant soucieuse de ses performances économiques que de sa cohésion sociale. Déguisée en « revitalisation urbaine » — ou sous un autre avatar puisé dans la novlangue chère aux nouveaux managers urbains —, la gentrification se confondrait en somme avec l’intérêt général.
À défaut de « s’ouvrir » à la gentrification, il n’y aurait simplement aucun avenir souhaitable pour les quartiers populaires. Si ce n’est pas la gentrification, ce sera l’appauvrissement, le déclin commercial, la dégradation physique et environnementale… S’appuyer sur un tel faux choix aux lourds accents moralisateurs congèle d’emblée toute réflexion digne de ce nom : « vous n’êtes pas pour l’abandon et la mort des quartiers, tout de même ? ». S’opposer aux logiques de gentrification reviendrait à vouloir faire obstacle à l’aménagement d’une ville rénovée, consciente des enjeux écologiques du présent et autant soucieuse de ses performances économiques que de sa cohésion sociale. Déguisée en « revitalisation urbaine » — ou sous un autre avatar puisé dans la novlangue chère aux nouveaux managers urbains —, la gentrification se confondrait en somme avec l’intérêt général.
Un chercheur allemand a appris à ses dépens qu’utiliser la notion gentrification pouvait être retenu comme indice de sympathies « terroristes »
On voit ici clairement que la dépolitisation des questions urbaines empêche la possibilité de réfléchir à ce que peut être le contraire progressiste des formes dominantes de la production de l’espace urbain, c’est-à-dire, la possibilité de remettre en cause la version urbaine du there’s no alternative chère aux partisans du capitalisme néolibéral. Le contraire de la gentrification, ce n’est pas l’appauvrissement, la ghettoïsation ou la déglingue. Le contraire de la gentrification, c’est un projet d’amélioration et de renforcement de tout ce qui fait ressource pour les classes dominées dans les quartiers populaires (et au-delà), un droit à la ville populaire, en somme.
Footnotes
- Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, La violence des riches (chapitre 6 : « La ville comme champ de bataille »), La Découverte / Zones, 2013.
- Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille. Essai d’écologie politique, La Découverte (Zones), 2014.
- Gilles Pinson, La gauche, la droite, les villes, Métropolitiques, 19 mars 2014
- La collection d’articles réunis dans le dossier « Shrinking Cities » de la revue en ligne Métropolitiques, 2017
- David Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, 2003; Andy Merrifield, The New Urban Question, Pluto Press, 2014.
- Edward Glaeser, Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, Penguin Press, 2011 ; Leo Hollis, Cities Are Good for You: The Genius of the Metropolis, Bloomsbury Press, 2013 ; Charles Montgomery, Happy City : Transforming Our Lives Through Urban Design, Farrar, Straus and Giroux, 2013 ; Jan Gehl, Pour des villes à échelle humaine, Ecosociété, Montréal, 2013 ; Jean Haëntjens et Stéphanie Lemoine, Éco-urbanisme. Défis planétaires, solutions urbaines, Ecosociété, Montréal, 2015.
- Jean-Pierre Garnier, Petit lexique techno-métropolitain, Article 11, 18 janvier 2011
- Peter Marcuse, « The city’ as perverse metaphor », City, 2005, 9, 2, pp. 247–254.
- Anne Clerval et Jean-Pierre Garnier (dir.), « Où est passé le peuple ? », Espaces et sociétés, no 156-157, 2014.
- Mark Davidson, Elvin Wyly, « Class-ifying London », City, 2012, 16, 4, pp. 395–421; Erik Swyngedouw, « The Post-Political City », In BAVO (Eds.) Urban Politics Now. Re- imagening Democracy in the Neoliberal City, NAI Publishers, 2007, pp. 58–76.
- Chantal Mouffe, L’illusion du consensus, Albin Michel, 2016, p. 19.
- Chantal Mouffe, op. cit., p. 20.
- Jason Hackworth, The Neoliberal City: Governance, Ideology, and Development in American Urbanism, Cornell University Press, 2006; David Harvey, Le capitalisme contre le droit à la ville : Néolibéralisme, urbanisation, résistances, Amsterdam, Paris, 2011 ; Max Rousseau, Redéveloppement urbain et (in)justice sociale : les stratégies néolibérales de “montée en gamme” dans les villes en déclin, Justice spatiale | Spatial justice, 6, 2014; Gilles Pinson, Christelle Morel Journel (éds.), Debating the neoliberal city, Routledge, 2017.
- Interview de Charles Picqué, alors Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, L’Écho, 21 mai 2010.[/note]». Cas extrême, un chercheur allemand a même appris à ses dépens qu’utiliser la notion pouvait être retenu comme indice de sympathies supposées avec un groupe qualifié de « terroriste ». À la clef, dans son cas : trois semaines de détention préventive en régime d’isolement14Martin Kreickenbaum, Un sociologue de Berlin incarcéré durant trois semaines. La science suspectée de terrorisme, WSWS.org, 6 septembre 2007.
- Mais on peut parler aussi de gentrification de villages, de stations balnéaires, de médinas…
- Cette définition est proche de celle proposée par Loretta Lees, Tom Slater, Elvin Wyly, Gentrification, Routledge, 2008 ou de celle proposée par Anne Clerval, Claire Colomb et Mathieu Van Criekingen, « La gentrification des métropoles européennes » in Denise Pumain et Marie-Flore Mattei (dir.), Données urbaines, 6, Paris, Economica, 2011, p. 151-165.
- Anne Clerval et Mathieu Van Criekingen, “Gentrification ou ghetto”, décryptage d’une impasse intellectuelle, Métropolitiques, 20 octobre 2014
- Par exemple Philip Ball, « Gentrification is a natural evolution », The Guardian, 19 novembre 2014. La réponse de Tom Slater est salutaire — « There is Nothing Natural about Gentrification », New Left Project, 24 novembre 2014.
- Point de vue de Wim Embrechts, animateur de « Platform Kanal », exprimé dans le rapport « Élaboration d’un plan directeur pour la zone du canal. Présentation des caractéristiques de la zone et synthèse des enjeux », Architecture Workroom Brussels, 2011, p. 176.