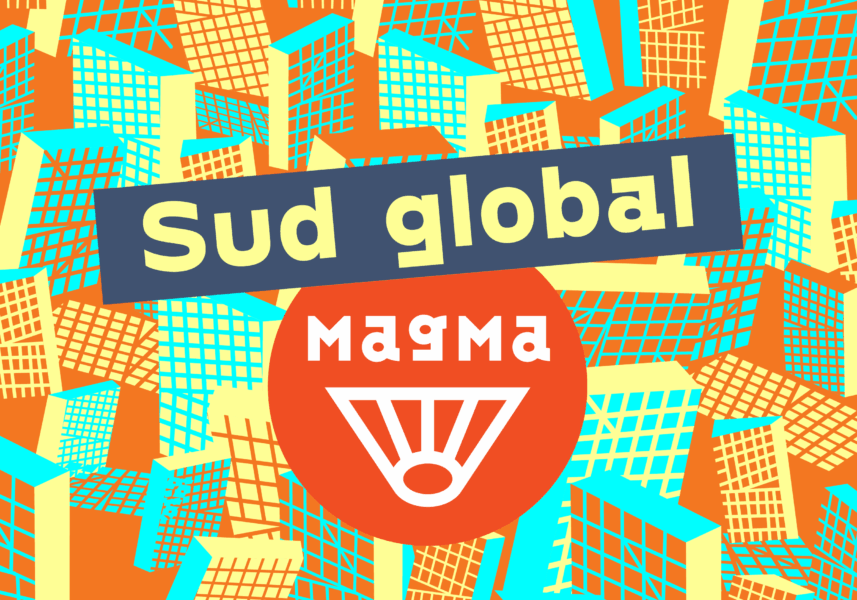Alors que le monde entre dans une nouvelle ère, l’avancée de l’Europe dépend de l’établissement de partenariats plus solides avec le Sud global et de l’adoption du socialisme. Dans cet entretien, Brett Christophers évoque l’état du capitalisme occidental, le déclin du néolibéralisme et l’essor de la Chine en tant que grande puissance mondiale.

Vous évoquez la montée d’une forme de « capitalisme de rente » au cours des dernières décennies. Qu’entendez-vous par là ?
J’utilise l’expression « capitalisme de rente » pour décrire un capitalisme particulièrement façonné et dominé par les rentes et les rentiers. Les revenus y prennent principalement la forme de rentes et les intérêts rentiers y sont devenus particulièrement puissants.
Par « rentes », j’entends un type de revenu qui ne provient pas de la production de quelque chose, mais de la possession ou du contrôle d’un actif économique rare. Si vous possédez une partie d’un réseau d’énergie régional dont d’autres personnes ont besoin, par exemple, vous pouvez faire payer l’accès à ce réseau. Il s’agit d’une rente, un revenu généré par la simple possession de l’infrastructure.
Il en va de même pour les plateformes numériques. Si vous contrôlez une plateforme numérique comme Airbnb à laquelle d’autres personnes ont besoin d’accéder pour participer à certains échanges économiques, vous tirez un revenu de chaque transaction qui y est effectuée. Un rentier est simplement un acteur économique dont les revenus proviennent principalement, ou entièrement, de l’extraction de rentes.
Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur le Royaume-Uni pour étudier ce phénomène ?
Selon moi, le Royaume-Uni est un exemple typique de cette transformation. Depuis les années 1980, l’économie britannique a évolué vers ce que l’on pourrait qualifier de système capitaliste de rente par excellence. Au cours des trois ou quatre dernières décennies, les acteurs rentiers et les rentes comme sources de revenus y sont devenus de plus en plus dominants.
Mon analyse se concentre sur le Royaume-Uni, mais bon nombre des dynamiques que je décris, comme le pouvoir croissant des intérêts rentiers et le rôle grandissant de la rente, sont également visibles, à des degrés divers, dans d’autres pays.
Quels sont les principaux effets du rentiérisme ?
Son premier effet, et le plus fondamental, est la stagnation. Le rentiérisme étant basé sur le contrôle monopolistique d’actifs, il tend à créer une économie stagnante. Cela est tout à fait évident au Royaume-Uni, où la productivité et l’innovation ont fortement chuté et où la croissance économique générale a considérablement ralenti au cours des dernières décennies.

C’est exactement ce à quoi on peut s’attendre dans une économie saturée de pouvoir monopolistique. Si vous possédez un monopole, vous n’avez pas intérêt à innover ou à prendre des risques, mais plutôt à protéger cet actif, à le conserver et à utiliser différents moyens, notamment juridiques, pour prolonger la période pendant laquelle il peut générer une rente. L’accent n’est plus mis sur le développement de nouveaux produits et services, mais simplement sur l’extraction d’une rente de produits et services existants. Il en résulte une économie stagnante et peu productive.
Lorsque vous construisez un système politique et économique qui privilégie les intérêts rentiers, vous découragez activement la véritable innovation.
Lorsque vous construisez un système politique et économique qui privilégie les intérêts rentiers, qui protège ceux qui contrôlent les actifs existants et leur permet d’en tirer des revenus de manière fiable, vous découragez activement la véritable innovation.
Vous affirmez également que le capitalisme de rente alimente les inégalités, en particulier en matière de richesse. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
En effet, je pense qu’il est impossible de comprendre l’augmentation des inégalités, en particulier la montée en flèche des inégalités de richesse au Royaume-Uni au cours des deux ou trois dernières décennies, sans se pencher sur l’essor du capitalisme de rente.
Je me réfère souvent à la formule bien connue de Thomas Piketty dans Le capital au XXIe siècle : r > g, où r est le taux de rendement du capital et g le taux de croissance économique. L’argument de Piketty est que lorsque r dépasse g, lorsque les rendements de la richesse croissent plus rapidement que l’économie elle-même, les inégalités se creusent inévitablement. Essentiellement, c’est cela, une économie de rente : une économie dans laquelle le taux de rendement des actifs est supérieur à la croissance générale.
C’est exactement ce que nous avons constaté au Royaume-Uni : une croissance faible (g) associée à un rendement élevé du capital (r). Dans ces conditions, l’inégalité croissante en matière de richesse n’est pas seulement probable, elle est intégrée au système.
Un économiste du Financial Times a parfaitement résumé la situation : « La Grande-Bretagne est aujourd’hui une société pauvre avec quelques personnes très riches. » C’est tout à fait exact. Les revenus moyens y sont aujourd’hui inférieurs d’environ 20 % à ceux de la plupart des économies comparables du nord-ouest de l’Europe, ce qui n’était pas le cas en 2000, il n’y a pas si longtemps. La Grande-Bretagne est en réalité devenue une société à faibles revenus avec une élite extraordinairement riche, à l’instar des États-Unis.
D’une certaine manière, c’est ce que mon livre tente de comprendre : comment en sommes-nous arrivés là, et pourquoi cette structure rentière produit-elle inévitablement de tels résultats.
Le Royaume-Uni sous Thatcher a été l’un des berceaux du néolibéralisme. Comment les politiques néolibérales ont-elles favorisé ces évolutions ?
Le développement du capitalisme de rente est le résultat de choix politiques délibérés. L’État a activement poussé le capitalisme dans cette direction. Je soulignerais trois façons principales dont l’État a contribué à la rentiérisation du capitalisme, en particulier au Royaume-Uni, bien que des dynamiques similaires existent ailleurs.

Pour comprendre ce changement, il faut remonter aux années 1970 et 1980. La domination du capitalisme de rente a quelque peu reculé au milieu du 20e siècle, mais il est revenu en force à partir de la fin des années 1970. Les raisons de ce phénomène sont nombreuses, mais trois changements politiques ont été particulièrement décisifs.
Premièrement, la privatisation. Les intérêts rentiers dépendent d’actifs privés de grande valeur pour générer des revenus. Plus il y a d’actifs privés, plus la rente extraite peut être élevée. Le Royaume-Uni est sans doute le berceau de la privatisation à grande échelle. Pratiquement tous les grands actifs publics susceptibles d’être privatisés l’ont été : le marché foncier et du logement, les infrastructures électriques, le gaz, les transports, les télécommunications, l’eau et les eaux usées, et des entreprises nationales telles que British Rail, British Telecom, British Airways et BP. Aujourd’hui, à quelques exceptions près, comme le métro de Londres et Scottish Water, la quasi-totalité des infrastructures essentielles du Royaume-Uni appartiennent au secteur privé.
Ces actifs privatisés génèrent désormais des rentes de monopole, car dans la quasi-totalité des cas, ce sont des monopoles qui les contrôlent. Si vous contrôlez le réseau électrique ou un réseau national de télécommunications, vous n’avez pas de véritable concurrence, ce qui signifie des revenus rentiers stables et garantis. L’ensemble des actifs générateurs de rente détenus par le secteur privé est beaucoup plus important qu’il y a quarante ans.
Le développement du capitalisme de rente est le résultat de choix politiques délibérés. L’État a activement poussé le capitalisme dans cette direction.
Deuxièmement, les droits de propriété. Un actif privatisé n’est pas très utile à un rentier si les droits qui y sont attachés ne sont pas suffisamment forts pour garantir l’extraction de revenus. Imaginez que vous soyez propriétaire d’un appartement, mais que vous ne soyez pas en mesure d’exiger le paiement d’un loyer : ce bien n’aurait aucune valeur. Cependant, si la loi favorise fortement le propriétaire, le bien devient une source de rente lucrative. Au Royaume-Uni, cette logique s’étend bien au-delà du marché du logement. Elle concerne les licences pétrolières et gazières de la mer du Nord, les infrastructures et la propriété intellectuelle, comme les brevets, les marques déposées et les droits d’auteur. Dans tous ces domaines, les droits de propriété privée sont extrêmement forts et favorisent largement les propriétaires par rapport aux utilisateurs.
Troisièmement, la fiscalité. Au cours des trente à quarante dernières années, le régime fiscal britannique a été remarquablement favorable aux rentiers, en particulier en ce qui concerne les revenus du capital et des actifs. Par rapport aux revenus du travail, les revenus du capital ont été traités beaucoup plus généreusement, avec de faibles taux d’imposition sur les plus-values et d’autres avantages, en particulier dans le domaine immobilier et foncier. Pendant des années, les propriétaires louant leur bien ont bénéficié d’un traitement fiscal plus favorable que les propriétaires occupants. Ces avantages fiscaux ont rendu plus facile et plus rentable l’extraction de rente à partir d’actifs de toutes sortes.
Des économistes comme Thomas Piketty ont montré comment cela alimente les inégalités de richesse, et je suis d’accord. Cependant, mon propos est plus large : ces politiques ne se contentent pas de récompenser les comportements rentiers ; elles créent des rentiers en encourageant davantage de personnes et d’entreprises à s’engager dans cette voie.
Et cela ne s’arrête pas là. L’État fournit également des subventions, des garanties et des mécanismes de soutien qui réduisent les risques pour les investisseurs privés, avec par exemple des rendements garantis pour les projets d’énergie renouvelable.
Privatisation, droits de propriété forts, fiscalité favorable… Le tableau est clair : l’État a activement soutenu et renforcé les intérêts rentiers. Le résultat est l’économie britannique dominée par la rente que nous connaissons aujourd’hui.
Nombreux sont ceux qui croient encore que le néolibéralisme est synonyme de « gouvernement limité ». Pourtant, vous affirmez le contraire : le gouvernement reste très impliqué. Qu’entendez-vous par là ?

Cette croyance est en réalité un mythe ancré dans les débuts de la littérature néolibérale. Le néolibéralisme n’a jamais eu pour but de retirer complètement l’État de l’économie. Il voulait en réduire certains segments, notamment l’État-providence et les services publics qui soutiennent les travailleurs et les personnes vulnérables. Les gouvernements ont réduit l’aide sociale, externalisé des services et réduit certaines formes de dépenses.
Mais l’État ne s’est pas retiré de l’économie. Il est resté un acteur puissant et interventionniste, façonnant les marchés, établissant le cadre juridique et soutenant activement les intérêts rentiers par la privatisation, la dérégulation et une fiscalité avantageuse. Dans la plupart des pays dits néolibéraux, l’État reste important et fort, mais ses priorités sont très différentes.
Vous avez également écrit sur l’essor de ce que vous appelez une « société de gestionnaires d’actifs ». Que voulez-vous dire par là ?
Les gestionnaires d’actifs sont des capitalistes rentiers par excellence : ils préfèrent investir dans des actifs qui génèrent des revenus réguliers et fiables.
Expliqué simplement, les gestionnaires d’actifs sont des institutions financières qui investissent l’argent des autres plutôt que le leur. Deux évolutions majeures depuis les années 1970 et 1980 expliquent leur essor.
Premièrement, il existe tout simplement beaucoup plus de capital excédentaire dans le monde aujourd’hui. D’énormes réserves d’argent privé et public sont disponibles pour des investissements. Les fonds de pension en sont l’exemple le plus évident. Il y a cinquante ans, les actifs des fonds de pension mondiaux s’élevaient à environ un billion de dollars ; aujourd’hui, ils s’approchent de 60 billions de dollars. À cela s’ajoutent les fonds souverains, les réserves d’assurance et d’autres investisseurs institutionnels. L’ampleur est sans précédent.
Deuxièmement, les propriétaires de ce capital, administrateurs de caisses de retraite, assureurs, fonds souverains, ont de plus en plus confié les décisions d’investissement à des sociétés spécialisées, les gestionnaires d’actifs. Ces derniers perçoivent des honoraires pour gérer et faire fructifier ce capital.
Si l’on combine ces deux tendances, plus de capital à investir et plus d’externalisation, le résultat est stupéfiant. Les gestionnaires d’actifs supervisent aujourd’hui plus de 100 billions de dollars dans le monde, par rapport à un demi billion il y a cinquante ans.
Les gestionnaires d’actifs sont ceux qui contrôlent les excédents de capitaux au niveau mondial : BlackRock, Blackstone, Vanguard, State Street, KKR et d’autres. Ils décident collectivement de la destination des capitaux et donc du financement des activités économiques – marché foncier et du logement, énergie, télécommunications, infrastructures.
Leur pouvoir économique est énorme et se traduit par deux autres dimensions d’influence.
Tout d’abord, le pouvoir financier se traduit par un pouvoir politique. De nombreux gouvernements, en particulier dans les pays occidentaux, affirment qu’ils ne disposent pas des fonds, ou de la marge de manœuvre budgétaire, pour investir dans les infrastructures. Ils se tournent donc vers les gestionnaires d’actifs. Une fois que l’État dépend d’elles pour son financement, ces entreprises bénéficient d’un effet de levier : elles peuvent définir les termes, et donc la politique elle-même.
La Chine n’est pas près de disparaître et l’Inde est en plein essor. L’objectif devrait être d’établir des relations qui permettent à l’Europe de bénéficier de ces avancées.
Deuxièmement, les gestionnaires d’actifs sont passés d’actifs financiers à des actifs réels, tangibles, l’infrastructure de la vie quotidienne. Aujourd’hui, ils ne possèdent plus seulement des actions de Microsoft ou d’Amazon, mais aussi des lignes de tram, des parkings, des logements, des réseaux de télécommunications, des terres agricoles et même des systèmes d’approvisionnement en eau et en énergie. Lorsque les gens ordinaires se déplacent, paient leur loyer, consomment de l’électricité ou se connectent à Internet, ils utilisent souvent des infrastructures appartenant à des gestionnaires d’actifs, généralement sans en avoir la moindre idée.
C’est ce que j’entends par société de gestionnaires d’actifs : un monde où l’infrastructure de base du quotidien est de plus en plus détenue et contrôlée par des acteurs financiers privés largement invisibles.
Au cours des dernières décennies, la Chine a fait preuve d’un dynamisme économique et d’une innovation remarquables. Comment l’expliquer ?
Le premier facteur est l’échelle. Depuis des décennies, la Chine poursuit son développement économique et industriel avec une immense concentration, surtout dans le domaine des technologies vertes. La combinaison d’un vaste marché intérieur et d’un soutien important de l’État fait qu’il est presque impossible de rivaliser avec elle à armes égales.
Cependant, l’élément essentiel est que le modèle chinois est fondamentalement différent de celui de l’Occident. L’État chinois est beaucoup plus interventionniste, dans la technologie, les industries vertes, les télécommunications, etc. De nombreux secteurs qui stimulent la croissance et l’innovation en Chine sont détenus ou dirigés par l’État, contrairement aux États-Unis ou à l’Europe, qui sont dominés par la propriété privée.
Prenons l’exemple des énergies renouvelables : ce n’est pas une coïncidence si les investissements verts les plus importants sont réalisés en Chine, la seule grande économie où les investissements ne sont pas principalement motivés par le profit. Lorsque le profit n’est pas l’objectif premier, les investissements transformateurs deviennent possibles.
Les États-Unis ont adopté une nouvelle position de guerre froide à l’égard de la Chine. Comment l’Europe doit-elle se positionner ?
La Chine ne peut plus être traitée comme un acteur marginal dans un monde dirigé par les États-Unis. Elle est désormais une grande puissance mondiale, dominante dans de nombreux secteurs. Cela change tout.
Dans le même temps, l’Occident, tant l’Europe que les États-Unis, fait preuve d’une certaine arrogance. Nous avons fonctionné sur la base d’une croyance dépassée en la supériorité technologique de l’Occident, mais cette époque est révolue. Northvolt, la supposée réponse suédoise à la domination de la Chine dans le domaine des batteries lithium-ion, qui a fait faillite, en est un exemple parfait.
En réalité, des approches telles que les guerres commerciales de Trump ne feront que creuser le retard des États-Unis. Pour l’Europe, la solution n’est pas de concurrencer frontalement la Chine. Ce n’est pas la bonne attitude. L’Europe doit définir sa place dans un monde multipolaire. La Chine n’est pas près de disparaître et l’Inde est en plein essor. L’objectif devrait être d’établir des relations qui permettent à l’Europe de bénéficier de ces avancées, de travailler avec ces puissances, et non contre elles.
En réaction à la montée en puissance de la Chine, la politique économique de l’Occident est de plus en plus influencée par la géopolitique. Assiste-t-on à la fin de l’ère néolibérale ?
Je pense qu’il est juste de dire que nous avons assisté à des changements significatifs au cours des quatre ou cinq dernières années, en particulier aux États-Unis. L’État joue désormais un rôle plus actif dans l’orientation de l’économie. L’Inflation Reduction Act en est un bon exemple : il témoigne d’un État plus interventionniste qui oriente les investissements vers des objectifs spécifiques, que ce soit dans le secteur militaire ou, sous la présidence de Joe Biden, dans les technologies vertes.
Nous constatons une moindre dépendance à l’égard des marchés et une plus grande implication directe de l’État. C’est pourquoi de nombreux observateurs se demandent si cette période marque un tournant par rapport au néolibéralisme. La confiance aveugle dans les marchés décline et l’activisme de l’État refait surface.
En Chine, de nombreux secteurs porteurs de croissance et d’innovation sont détenus ou dirigés par l’État, et les investissements ne sont pas essentiellement motivés par le profit.
Je suis d’accord, dans une certaine mesure. Mais une chose essentielle n’a pas changé : malgré le rôle plus actif de l’État, la plupart des investissements dépendent encore entièrement du secteur privé. Et, surtout, la propriété des actifs créés par ces politiques reste très majoritairement privée.
Donc, oui, certains éléments sont moins néolibéraux, mais d’autres pas. Ce système est toujours profondément privatisé. La question clé n’est pas seulement de savoir comment les investissements sont orientés, mais qui finit par posséder quoi. Dans la plupart des cas, ce sont encore des acteurs privés, en particulier les grands gestionnaires d’actifs, qui en profitent en fin de compte.
Prenons l’exemple des énergies renouvelables : tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, il existe une forte dynamique politique en faveur des investissements verts. Pourtant, la grande majorité du financement et de la propriété reste entre les mains du secteur privé.
En bref, il n’y a pas eu de transformation majeure concernant ceux qui en profitent. C’est toujours la même classe capitaliste, les mêmes élites économiques, qui tirent parti de ces développements.
En Occident, les travailleurs sont de plus en plus mécontents de leurs conditions de vie, mais la droite s’empare d’une grande partie de ce mécontentement. Comment expliquez-vous cela ?
Il est en effet ironique qu’une grande partie de la frustration et de la colère politiques que nous observons en Grande-Bretagne ne soit pas dirigée contre ceux qui bénéficient réellement de ce déséquilibre, à savoir les personnes et les institutions qui extraient des rentes et bénéficient des plus hauts rendements, mais s’oriente à tort dans une autre direction.
La droite populiste a été très efficace dans la canalisation des frustrations réelles des gens. La vie est devenue plus difficile pour de nombreuses personnes. Pourtant, au lieu de pointer du doigt les véritables bénéficiaires, c’est-à-dire les élites fortunées, les sociétés de capital-investissement et les gestionnaires d’actifs, elle redirige leur colère. Elle crée un « bouc émissaire immigré » et affirme que l’immigration est responsable des difficultés économiques. En réalité, les groupes et institutions qui en profitent sont en grande partie les mêmes depuis les deux dernières décennies.
Parallèlement, nous constatons que la lutte des classes se développe et que certains partis de gauche grandissent également. Quelle alternative envisagez-vous pour la gauche ? Est-il temps de remettre le socialisme à l’ordre du jour ?
Les capitalistes ne sont jamais rassasiés, la volonté d’accumulation n’a pas de limite interne. Comme M. Piketty et d’autres l’ont déjà affirmé, au cours de l’histoire, seuls des événements catastrophiques tels que des guerres, des crises ou des effondrements sociaux, ont véritablement inversé la spirale des inégalités. Si on la laisse faire, la classe capitaliste ne s’arrêtera pas. Si elle possède 99 % du gâteau, elle en voudra 99,5 %.
Il est donc peu probable qu’un changement significatif vienne de l’élite dirigeante. Cela dit, certains gouvernements reconnaissent que les inégalités non maîtrisées menacent la cohésion sociale. Cette prise de conscience se traduit, même si ce n’est que par souci d’auto-préservation, par un engagement limité en faveur de l’aide sociale et de la stabilité.
Dans le cadre du socialisme, en revanche, les conditions de départ seraient totalement différentes : le marché du logement et les investissements ne seraient pas régis par la recherche de profit. Pour moi, le marché du logement, la politique climatique et les inégalités sont différents aspects du même problème. Tant que nous nous contenterons de bricoler aux limites d’un système fondé sur le profit privé, rien de tout cela ne changera fondamentalement.