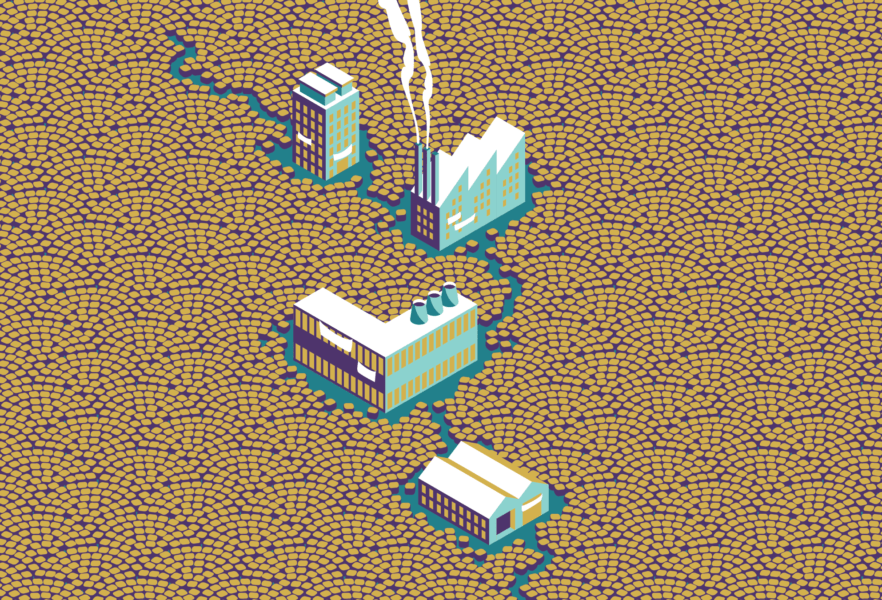La domination masculine n’est pas qu’affaire de préjugés sexistes et de discrimination. Elle trouve ses origines dans une très longue histoire économique et politique.

De tous les thèmes qu’aborda il y a cent trente ans Friedrich Engels dans L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, celui de l’oppression des femmes est sans aucun doute l’un de ceux qui continuent de nos jours à être le plus chargé d’enjeux. Les féministes conséquents ont en effet toujours considéré qu’ils devaient s’appuyer sur une claire compréhension des causes et des mécanismes de ce qu’ils combattaient. Or, depuis la rédaction de l’ouvrage d’Engels, les connaissances alors balbutiantes sur les sociétés primitives et la préhistoire ont avancé à pas de géant, en rendant caducs bien des développements. On se propose donc d’indiquer autour de quels axes il convient d’actualiser les raisonnements marxistes sur ce sujet à la lumière des découvertes qui se sont accumulées depuis lors1.
- 1 Les positions marxistes traditionnelles
- 2 Les observations
- 3 Sociétés « néolithiques »
- 4 Chasseurs-cueilleurs nomades
- 5 Un premier bilan
- 6 La division sexuelle du travail
- 7 Pourquoi contrôler les femmes ?
- 8 Contre-pouvoirs féminins et pseudo-matriarcats
- 9 Archéologie de la division sexuelle du travail
- 10 Les évolutions ultérieures
- 11 Le rôle historique du capitalisme
Les positions marxistes traditionnelles
Dans la seconde moitié du 19e siècle, alors que l’archéologie et, plus encore, l’anthropologie sociale se constituaient à peine en tant que sciences, un faisceau d’indices concordants semblait militer en faveur de l’idée que la domination masculine n’avait pas existé de tout temps. Johann Jakob Bachofen2, mobilisant à la fois l’analyse des mythes des anciens Grecs et certains éléments archéologiques, concluait qu’avant les époques historiques, connues pour le règne sans partage du sexe masculin, les sociétés grecques — et, au-delà, toutes les sociétés humaines — avaient traversé une longue période de « droit maternel ». Avant d’être renversé par les hommes, ce matriarcat primitif était même censé avoir culminé en une forme suprême et militarisée, l’amazonat.
Ces thèses eurent un retentissement considérable ; elles rencontrèrent un écho particulier chez Lewis Morgan, un spécialiste des Iroquois. L’organisation sociale de ces Indiens du nord-est des États-Unis était notamment marquée par l’existence de clans matrilinéaires et par la place élevée qu’y tenaient les femmes. Outre une grande autonomie en matière conjugale (elles pouvaient se séparer de leur mari comme bon leur semblait, simplement en mettant ses affaires sur le pas de la porte), les Iroquoises détenaient un fort pouvoir économique, possédant les maisons et gérant les réserves de grains de la tribu, et leurs représentantes pouvaient destituer des chefs masculins. Fait rarissime, la compensation à verser en cas de meurtre était supérieure lorsque la victime était une femme. Bref, les Iroquois constituaient une réfutation vivante de l’idée selon laquelle, dans les sociétés primitives, les femmes étaient traitées en quasi-esclaves et semblaient illustrer à merveille le matriarcat théorisé par Bachofen.
Le « matriarcat » au sens strict, c’est-à-dire une situation dans laquelle ce seraient les femmes qui dirigeraient, n’a jamais été observé nulle part.
Dans son schéma général de l’évolution sociale, Morgan3, voyait dans la matrilinéarité une caractéristique universelle des sociétés des débuts de la « Barbarie » (nous dirions aujourd’hui le néolithique). Conjuguée à une structure économique présumée égalitaire, elle était censée avoir garanti aux femmes une position favorable, jusqu’à ce qu’à l’Âge des métaux ne se développent tout à la fois la propriété privée, les inégalités matérielles et la domination masculine.
Ces travaux, dont la perspective évolutionniste procédait d’une connaissance encyclopédique des matériaux alors disponibles suscitèrent l’enthousiasme de Marx et Engels. À leurs yeux, ils représentaient l’œuvre scientifique la plus aboutie de leur temps. Marx étant décédé, c’est Engels qui en popularisa les principales thèses en 1884 dans l’ouvrage qui allait devenir la référence de générations de marxistes sur le sujet : L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État.
Engels prolongeait les conclusions de Morgan sur l’apparition tardive — avec les classes sociales, ou très peu de temps avant elles — de la domination masculine. Pour lui, « L’assujettissement d’un sexe par l’autre, [ …] [ le] conflit des deux sexes [ est] inconnu [ …] dans toute la Préhistoire»4. Cette harmonie initiale entre les sexes avait pris fin à l’aube des sociétés de classes, parmi ces peuples métallurgistes qui avaient généré tout à la fois les inégalités matérielles et la propriété privée, scellant ainsi le sort des femmes : « Le renversement du droit maternel fut la grande défaite historique du sexe féminin. Même à la maison, ce fut l’homme qui prit en main le gouvernail ; la femme fut dégradée, asservie, elle devint esclave du plaisir de l’homme et simple instrument de reproduction.»5 En quelques pages lumineuses, Engels mettait en regard la situation des femmes dans les sociétés structurées par l’économie « communiste domestique » avec leur position dans la société capitaliste — mais aussi, avec les perspectives que celle-ci, pour peu qu’on la renverse, ouvrait à leur émancipation.
Une masse considérable de nouvelles preuves matérielles a entre-temps été accumulée. Les sociétés primitives avaient été étudiées par centaines et des courants de pensée, loin d’être tous inspirés par des motivations progressistes, avaient depuis très longtemps concentré leur feu sur les principaux raisonnements de Morgan (en visant explicitement, par ricochet, le marxisme). Du côté du marxisme, un certain nombre de chercheurs se battirent bec et ongles pour tenter de prouver que cet afflux de données ne remettait pas en cause les schémas hérités d’Engels6. Nous ne pensons pas qu’une telle position puisse être valablement défendue. L’arbre des artefacts ne saurait cacher la forêt des observations qui résistent à l’examen ; sous peine de faire preuve d’aveuglement, les raisonnements marxistes doivent donc « [ tenir] compte, comme il se doit, de l’état actuel de la science »7 et intégrer ces éléments plutôt que les ignorer.
Les observations
Pour commencer, les rapports entre les genres ne se laissent pas ramener à une loi générale simple. Pour chacun des principaux niveaux techniques et des grands types d’organisation sociale, depuis les chasseurs-cueilleurs nomades égalitaires jusqu’aux premières sociétés étatiques, les sociétés se répartissent tout au long d’un continuum entre les deux points extrêmes que sont une domination masculine exacerbée d’un côté et un équilibre relatif entre les sexes de l’autre.
On constate ainsi que le « matriarcat » au sens strict, c’est-à-dire une situation dans laquelle ce seraient les femmes qui dirigeraient, n’a jamais été observé nulle part — aucun indice archéologique sérieux ne plaide davantage en faveur de son existence passée. Même chez les Iroquois, souvent cités en exemple, en face des pouvoirs bien réels des femmes, les hommes détenaient eux aussi des pouvoirs tout aussi réels. Pour en juger, il suffit de dire que les femmes, par exemple, n’étaient pas éligibles aux plus hautes fonctions politiques, c’est-à-dire au Conseil de la Ligue. Depuis les Iroquois, on a identifié d’autres peuples chez qui les femmes jouissaient de prérogatives qui leur conféraient un poids social comparable à celle des hommes : ainsi, entre autres, les Khasi de l’Inde, les Minangkabau de Sumatra, les Ngada de l’île de Florès ou les Na de Chine. Cependant, nulle part, pas même chez les Na — sans doute le seul peuple au monde à ignorer tant le mariage que la paternité —, les femmes ne dirigent la société. Ce qui est vrai de peuples ayant maîtrisé l’agriculture ou l’élevage l’est aussi de chasseurs-cueilleurs nomades : les !Kung du Kalahari, les Mbuti d’Afrique centrale ou les indigènes des îles Andaman sont autant d’exemples où la domination masculine, si elle n’est sans doute pas totalement absente, est en tout cas relativement ténue.
Mais à l’autre extrémité du spectre, on trouve d’innombrables témoignages d’une domination masculine incontestable, parfois extrême, et qui ne peut être attribuée ni aux biais de l’observation ni aux effets du contact avec des sociétés modernes.
Sociétés « néolithiques »
Ainsi en va-t-il dans l’aire néo-guinéenne, où quelques tribus de chasseurs-cueilleurs avoisinent de nombreux petits cultivateurs et éleveurs de porcs.
Une femme vraiment rebelle est ramenée sous contrôle par des rapports sexuels disciplinaires, le mari et tous les hommes de sa lignée copulant avec elle.
Dans les sociétés de cultivateurs où existaient certaines inégalités de richesse, la condition des femmes était souvent inférieure à celle des hommes. Entre autres chez les Bena Bena, où « les hommes considèrent les femmes, et les femmes tendent à se considérer elles-mêmes, comme (relativement) faibles, plus sexuées, moins intelligentes, plus sales et inférieures sur presque tous les plans »8. Le droit consacrait cette inégalité : « Si une femme attaque ou blesse son mari, son lignage doit payer une compensation. L’inverse n’est pas vrai.»9 Autant dire que les maris avaient toute latitude de frapper et blesser librement leurs femmes. Chez les Fore : « La mauvaise femme [ …] est celle qui défie l’autorité masculine, qui est indisciplinée et forte tête [ …] Une femme vraiment rebelle est ramenée sous contrôle par des rapports sexuels disciplinaires, le mari et tous les hommes de sa lignée copulant avec elle tour à tour.»10 Chez les Mae Enga : « Les hommes ont remporté la bataille et ont relégué les femmes dans une position inférieure. En termes juridiques, par exemple, une femme reste tout au long de sa vie une mineure (la pupille de son père, de son frère, de son mari ou de son fils), et on lui refuse tout droit à une propriété.» 11Dans la même région, les sociétés qui restaient marquées par un égalitarisme économique parfois très strict exhibaient généralement une domination masculine tout aussi exacerbée, sinon davantage encore.
Tel est le cas des emblématiques Baruya, petits cultivateurs et éleveurs étudiés par Maurice Godelier, et chez qui la supériorité des mâles s’affirmait de toute part. Un jeune garçon était automatiquement considéré comme l’aîné de toutes ses sœurs, même de celles nées avant lui. Les femmes n’avaient — entre autres — pas le droit d’hériter la terre, de porter les armes, de fabriquer les barres de sel. Les outils servant à défricher la forêt leur étaient interdits, de même que la fabrication de leurs propres bâtons à fouir. Quant aux objets sacrés, flûtes et rhombes, censés incarner les mystères les plus intimes de la religion baruya, toute femme qui était amenée à les voir, même par inadvertance, était immédiatement mise à mort. Et si les hommes pouvaient à tout moment répudier leur épouse ou la donner à qui bon leur semblait, celle-ci ne pouvait quitter son mari sans s’exposer aux châtiments les plus sévères.12
À quelques nuances près, l’Amazonie présente un visage voisin. La légitimité de violence contre les femmes, en particulier, y est largement attestée. Ainsi, chez les Kulina, chasseurs, cueilleurs et petits cultivateurs économiquement égalitaires : « La violence physique peut être utilisée, quoique de manière non régulière. Les hommes peuvent battre leurs filles ou leurs sœurs non mariées parce qu’ils désapprouvent le choix de leurs amants, ou parce que leurs amants sont trop nombreux. Les hommes peuvent frapper ou violer collectivement les femmes qui refusent d’avoir des rapports sexuels avec eux, et ils peuvent également frapper leurs femmes lorsqu’elles refusent d’avoir des enfants.»
« Oui, Señor, nous autres Ona, avons beaucoup de chefs. Les hommes sont tous capitaines, et toutes les femmes sont des matelots.»
Chez leurs voisins, les Amahuaca : « [ …] Une fois marié, un homme peut frapper [ sa femme] sur les épaules, les bras, les jambes, les fesses ou le dos avec un gourdin spécial en bois dur, qui possède une lame aplatie aux bords effilés. Une bastonnade avec un tel gourdin peut être si sévère que la femme sera ensuite à peine capable de marcher durant plusieurs jours. Une femme peut être battue pour avoir irrité son mari de maintes manières, par exemple en ne préparant pas de la nourriture lorsqu’il le désirait ou en versant trop de sel (une denrée récemment acquise par le commerce) dans son plat.»13 Des viols collectifs en cas de refus de rapports sexuels, un « gourdin spécial en bois dur » pour battre les épouses : voilà qui en dit long sur les relations qu’un tel peuple conçoit entre les sexes. Sans l’ombre d’un doute, la violence masculine n’est pas ici occasionnelle et individuelle : elle est institutionnalisée, reconnue par la société comme nécessaire et légitime.
Chasseurs-cueilleurs nomades
Chez nombre de chasseurs-cueilleurs nomades, par ailleurs strictement égalitaires sur le plan matériel, la situation des femmes apparaît tout aussi peu enviable.
En Australie, cet immense continent exclusivement peuplé, lors du contact avec les Occidentaux, de chasseurs-cueilleurs nomades, les premiers observateurs furent unanimes à noter l’extrême inégalité qui présidait aux relations de genre. « Esclaves », « servantes », « bêtes de somme », tel est le vocabulaire qui revient invariablement sous leur plume à propos des femmes aborigènes14.
Même si l’ethnologie du 20e siècle apporta de sérieuses nuances à ces appréciations, elle confirma que dans l’ensemble du continent régnait une domination masculine plus ou moins prononcée, et qui pénétrait tant les domaines domestiques que politiques ou religieux. Des ethnologues aussi peu suspects d’antipathie à l’égard des Aborigènes que Catherine et Ronald Berndt écrivaient ainsi : « Dans l’ensemble, un homme possède davantage de droits sur sa femme qu’elle n’en a sur lui. Il peut la répudier ou la quitter à son gré sans donner d’autres raisons que son bon plaisir. Elle [ …] ne peut le quitter, en fin de compte, qu’en s’échappant, autrement dit, en prenant un autre conjoint ; mais dans ce cas, le mari est parfaitement en droit de s’en prendre à elle et à son amant. La nouvelle union n’est pas considérée comme un mariage valide tant que le premier mari n’a pas renoncé à ses droits sur elle ou accepté une compensation [ …].»15
Chez des chasseurs-cueilleurs nomades de la Terre de Feu, les Ona (ou Selk’Nam), les hommes organisaient des cérémonies religieuses explicitement destinées à contrôler et terroriser les femmes16. À un marin anglais qui demandait s’ils possédaient des chefs, un Indien répliqua : « Oui, Señor, nous autres Ona, avons beaucoup de chefs. Les hommes sont tous capitaines, et toutes les femmes sont des matelots.»17
Un premier bilan
De ce rapide tour d’horizon, deux points essentiels se dégagent. Pour commencer, ces éléments montrent que la domination masculine n’est pas restreinte à un stade technico-économique déterminé. Si cela ne prouve pas ipso factoqu’elle ait existé — y compris dans ses formes exacerbées — dès les sociétés techniquement équivalentes de la préhistoire, cela indique à tout le moins qu’elle a pu y être possible.
Ensuite, si du point de vue des rapports entre les sexes les sociétés présentent une grande diversité, sur tous les continents et à tous les degrés du développement social règne une division sexuelle du travail et des rôles sociaux dont certains traits s’avèrent remarquablement constants.
Ceci suggère que si le scénario et les raisonnements traditionnels du marxisme sur cette question ne peuvent désormais plus être considérés comme valides, la clé de l’énigme se trouve bel et bien dans la direction où la cherchait le matérialisme historique : du côté des structures économiques — en l’occurrence, les modalités de la division sexuelle du travail ; là réside l’élément fondamental qui permet de rendre compte des rapports entre les sexes à la fois dans ce qu’ils possèdent de contingent et de général.
La division sexuelle du travail
La division sexuelle du travail est un trait universel et majeur des sociétés humaines. Elle représente la plus ancienne forme de division sociale du travail, présente dès les sociétés de chasse-cueillette. La manière dont elle répartit les tâches masculines et féminines varie beaucoup d’un peuple à l’autre ; toutefois, elle est partout marquée par le monopole masculin de ce qu’on peut appeler avec un soupçon d’anachronisme le complexe militaro-industriel, à savoir l’ensemble formé par la chasse au gros gibier, le maniement des armes les plus létales et les fonctions politico-militaires. Il existe certes de très rares occurrences où ce monopole est entamé — on pense par exemple aux Agta des Philippines, des chasseurs-cueilleurs où les femmes peuvent elles aussi manier l’arc — mais ces exceptions relatives s’expliquent par les circonstances très particulières dans lesquelles vivent ces peuple18.
L’origine de la division sexuelle du travail est sans doute une des questions les plus difficiles qui soient. On est aujourd’hui incapable de dire avec certitude à quelle époque remonte ce trait, même si certains indices plaident pour la situer au début du paléolithique supérieur19. Pour un certain nombre de raisons, il est permis de douter qu’elle ait été instituée dans le but conscient de placer les femmes en sujétion ; plus vraisemblablement correspond-elle à la première forme de division du travail social, où les handicaps relatifs et temporaires liés à la maternité ont pris la forme d’interdits rigides et permanents, dictés par quelque impératif surnaturel. Son succès tient vraisemblablement au fait qu’elle assurait une productivité plus élevée et une exploitation plus diversifiée des ressources.
La sécurisation des rapports entre les hommes était une préoccupation permanente, et la circulation des femmes en constituait un moyen privilégié.
On a parfois tenté d’expliquer la domination masculine par des motivations psychologiques : c’est parce que les hommes auraient voulu s’approprier le pouvoir reproductif des femmes qu’ils les auraient dévalorisées et, par là même, dominées20. Le problème de cette thèse, en plus d’être fort peu vérifiable, est de rester muette sur les raisons pour lesquelles les femmes se sont laissé faire, permettant aux intentions supposées des hommes de devenir réalité. Contre l’idée que la dévalorisation des activités féminines serait un présupposé à l’oppression des femmes, on peut invoquer le cas des Achuar, des chasseurs-cultivateurs d’Amazonie qui se rattachent à l’ensemble Jivaro, chez qui les mécanismes de la domination masculine se présentent sous une forme pour ainsi dire chimiquement pure. Les Achuar n’établissent aucun jugement de valeur entre la chasse masculine et la culture féminine des jardins. Contrairement à un schéma courant, les cultivatrices ne sont pas considérées comme plus redevables aux hommes que l’inverse. Cet égalitarisme entre les sexes s’arrête toutefois aux relations de travail. Socialement, les hommes dominent les femmes, et même sous une forme extrêmement brutale, puisque le droit des maris va jusqu’à leur permettre de disposer de la vie de leur épouse.
Puisqu’elle ne tire pas sa source du prestige lié à leurs travaux respectifs, cette autorité possède une autre origine : « Le lieu stratégique du pouvoir masculin est [ …] extérieur au procès de production. Les hommes achuar possèdent le monopole absolu de la conduite des “ relations extérieures ”, c’est-à-dire de cette sphère des rapports supra-familiaux qui commande la reproduction sociale. Corrélativement, ils exercent un droit de tutelle sur leurs épouses, leurs sœurs et leurs filles, et ils sont donc les seuls décideurs dans le procès général de la circulation des femmes, soit sous la forme pacifique de l’échange avec les alliés, soit sous la forme belliqueuse du rapt chez les ennemis.»21
L’échange pacifique avec les alliés, le rapt chez les ennemis : tout est dit. Chez les Achuar, comme dans toutes les sociétés primitives économiquement égalitaires, du fait qu’elles ne disposent pas des armes, les femmes tendent à devenir, en l’absence d’éléments pesant en sens contraire, à la fois les enjeux et les instruments des rapports entre les hommes. Peut-être jugera-t-on que cette analyse fait la part trop belle aux problématiques liées à la violence. Parce que le mythe du « bon sauvage » a la peau dure, on est souvent enclin à imaginer que l’égalité socio-économique va de pair avec le pacifisme et que les conflits armés ne sont apparus qu’avec les inégalités de richesse, voire avec l’État. C’est là une idée qui a été amplement démentie par l’ethnologie et l’archéologie22 : pour la plupart de ces peuples, la sécurisation des rapports entre les hommes était une préoccupation permanente, et la circulation des femmes en constituait un moyen privilégié.
Pourquoi contrôler les femmes ?
En ce qui concerne l’enjeu de la domination masculine dans ces sociétés, deux thèses sont parfois évoquées. La première porte sur la dimension économique : les hommes auraient dominé les femmes pour s’approprier leur travail ou, tout au moins, pour s’assurer sur elles certains avantages matériels. Sans écarter totalement cette possibilité, l’examen des données disponibles ne la valide pas nettement. Même si, selon certains témoignages, il arrivait effectivement que les hommes convertissent leur domination en privilèges économiques, l’impression générale (certes fondée sur des éléments parcellaires et fragiles) est plutôt celle d’un contraste entre le caractère limité de ces privilèges et les formes parfois exacerbées de domination masculine23.
L’art figuratif représente des personnages sexués en activité, permettant ainsi de vérifier à la fois la division sexuelle du travail et le monopole masculin sur les armes.
On a également voulu voir une dimension déterminante de la domination masculine dans le contrôle de la reproduction du groupe. Cette idée a d’ailleurs produit deux thèses symétriques : celle de Paola Tabet24, qui identifie des mécanismes de « reproduction forcée », et celle de J. Estevez et A. Vila25, qui met l’accent sur le contrôle des naissances. Là encore, tout au moins en ce qui concerne les chasseurs-cueilleurs nomades, ces deux raisonnements ne paraissent pas clairement étayés par les faits ethnographiques ; on trouve fréquemment des coutumes pesant à la fois dans un sens et dans l’autre au sein d’une même société. Ainsi l’Australie aborigène, où les jeunes filles étaient systématiquement contraintes dès la puberté aux rapports sexuels avec leur époux mais où, dans le même temps, les mères avaient toute liberté pour pratiquer l’infanticide à la naissance.
Davantage donc que celui de leur travail ou de leurs capacités reproductives, l’enjeu le plus clair, et le plus largement partagé, du contrôle des femmes dans ces sociétés sans richesse semble être celui de leur sexualité. On ne peut qu’être frappé, chez tous ces peuples, tant de la vigilance farouche avec laquelle les maris veillent sur l’empiètement de leurs droits conjugaux que de leur propension à concéder ces mêmes droits de leur plein gré à d’autres hommes, que ce soit dans un cadre cérémoniel ou, tout simplement, pour sceller une alliance ou vider une querelle. A. P. Elkin26 fournit une description saisissante de ces pratiques pour l’Australie ; on lit de même, chez les Inuits : « Quand un mari punit sa femme pour infidélité, c’est parce qu’elle a outrepassé ses droits ; le soir suivant, il la prêtera très probablement de lui-même.»27 Au demeurant, ces faits contredisent frontalement le raisonnement sociobiologique selon lequel la jalousie sexuelle des mâles serait au fondement des institutions humaines. Dans toutes ces sociétés, ce que les hommes défendent au besoin les armes à la main n’est jamais leur accès sexuel exclusif à leur épouse, mais leur droit exclusif d’en disposer à leur guise.
Contre-pouvoirs féminins et pseudo-matriarcats
Ainsi, partout, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs comme dans les stades techniques plus avancés, ce sont les hommes qui détiennent les armes les plus efficientes et qui sont formés et organisés pour les utiliser. Partout, ce sont eux qui exercent l’essentiel ou la totalité des fonctions politiques, n’en concédant le plus souvent aux femmes que la portion congrue. Telle est la raison pour laquelle nulle part on n’a vu les femmes diriger la société dans un « matriarcat » qui aurait été le miroir inversé du patriarcat.
Voilà aussi pourquoi, dans de nombreuses sociétés, les hommes ont concentré entre leurs mains tous les pouvoirs et tous les prestiges. Maîtres des armes, de la guerre et de la politique, ils y sont également maîtres du gibier, des champs, du bétail, du commerce, de la magie et des rites ; de toute part, ils exercent des droits non réciproques sur les femmes.
Pourtant, les hommes ne sont pas parvenus à cette situation d’hégémonie toujours et en tous lieux. Leurs pouvoirs ont pu être contrebalancés par ceux des femmes au point que les deux sexes ont parfois exercé une influence équivalente sur le destin de la société. C’est en particulier le cas dans ces fameux — et mal nommés — « matriarcats » qu’étaient les Iroquois, les Minangkabau, les Ngada ou les Na. Au-delà de leurs différences, ces quatre exemples, ainsi que tous ceux qu’on pourrait citer dans la même veine, présentent des similarités trop nombreuses pour être dues au hasard.
Chez tous ces peuples, en effet, la situation relativement favorable des femmes va de pair avec leur position économique élevée, qui est à la base de leur influence. Celle-ci suppose une participation notable au travail productif, mais cette participation, à elle seule, ne suffit pas (car partout les femmes travaillent, et travaillent dur) : il faut de plus que les femmes exercent un plein droit sur leurs propres produits, autrement dit que ce soient elles qui en contrôlent la distribution. Chez les Iroquois, ce sont les « matrones », à la tête des maisons-longues et des entrepôts de grains qu’elles contenaient, qui pouvaient refuser de délivrer aux hommes les ressources nécessaires à une expédition guerrière et exercer ainsi sur eux une pression redoutable. Chez les Minangkabau, en l’absence prolongée des hommes partis exercer leurs talents en dehors des villages, ce sont les femmes qui possédaient et géraient maisons, champs et bétail.
Archéologie de la division sexuelle du travail
Étudiant des éléments matériels, l’archéologie ne saurait rendre compte de manière directe des rapports entre les sexes. Ceux-ci ne peuvent être reconstitués qu’au travers des raisonnements appelant une certaine prudence. C’est ainsi que les nombreuses statuettes féminines du paléolithique et du néolithique européens, parfois présentées comme le signe infaillible d’un culte de la Grande Déesse, culte caractérisant lui-même des sociétés nécessairement « matristiques »28 a fait long feu : une telle lecture se heurte à de nombreuses et convaincantes critiques29. Alors que pénétrer le sens des représentations symboliques de cultures disparues tient de la gageure, la division sexuelle du travail représente un point d’entrée plus solide vers les rapports entre les sexes dans la préhistoire.
Le monopole masculin sur les armes apparaissant comme un élément décisif de la domination masculine dans les sociétés étudiées par l’ethnologie, il est permis de penser que dans le passé, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Pour être précis : ce monopole ne prouve pas ipso facto l’existence d’une domination masculine, puisqu’il était effectif y compris dans les pseudo-matriarcats Iroquois, Minangkabau ou Na. Il indique néanmoins sa probabilité. Or, sur ce point, les données issues des cinq continents, au-delà des inévitables difficultés d’interprétation, sont remarquablement convergentes. Qu’il s’agisse des représentations artistiques, des biens funéraires ou des traces d’activités sur les corps, les indices, lorsqu’ils existent, plaident très majoritairement dans le même sens.
En plusieurs endroits du monde, l’art figuratif représente des personnages sexués en activité, permettant ainsi de vérifier à la fois la division sexuelle du travail et le monopole masculin sur les armes. C’est le cas dans les nombreuses et éloquentes scènes du Levant espagnol, malheureusement difficiles à dater, entre Mésolithique et Néolithique. C’est également vrai de l’Australie aborigène30 ou encore de l’iconographie du Sud-ouest américain, qu’il s’agisse de chasseurs-cueilleurs ou de cultivateurs31. En ce qui concerne les biens funéraires du Néolithique et des époques postérieures, les tombes féminines sont très généralement celles où sont déposées meules et alênes, et les tombes masculines celles des haches, des épées et des pointes de flèche.
La domination masculine plonge donc ses racines très loin dans le passé, bien avant l’apparition des classes sociales et de l’État.
Enfin, les marqueurs d’activité sur les squelettes, lorsqu’ils sont exploitables, révèlent eux aussi une différence significative entre hommes et femmes au début du Néolithique et dans la période précédente, comme au Proche-Orient32 ou en Italie33. Signalons également, pour un Paléolithique généralement avare d’indices, une récente étude34 sur des restes datés de 30 000 ans. Les squelettes masculins, et eux seuls présentent au coude, et plus souvent sur le membre droit que gauche, une lésion typique des joueurs de base-ball. Celle-ci s’interprète comme le stigmate d’un lancer puissant et répété — sans doute celui de la sagaie à l’aide d’un propulseur. À ce jour, ce résultat constitue sans doute d’une des plus anciennes indications de la division sexuelle du travail.
Les évolutions ultérieures
La domination masculine plonge donc ses racines très loin dans le passé, bien avant l’apparition des classes sociales et de l’État, avant même celle de la richesse et des inégalités : elle est le produit de la plus élémentaire des divisions du travail, celle qui répartit les tâches selon le sexe. Plus exactement, elle est le produit de la manière dont la division sexuelle du travail s’est effectuée et dont elle s’est traduite dans l’idéologie, établissant une incompatibilité plus ou moins totale entre les rôles sociaux dévolus aux femmes et l’ensemble formé par la chasse, les armes et la guerre.
C’est l’attribution initiale de ces tâches qui a donné aux hommes une position stratégique, celle de la direction politique de la société. Et c’est ainsi que les femmes, sauf si elles disposaient par ailleurs de positions économiques leur permettant de contrebalancer avec plus ou moins d’efficacité ce pouvoir masculin, sont devenues à un degré ou à un autre, et malgré leur résistance, les objets des stratégies masculines.
La position de faiblesse des femmes, déjà effective dans nombre de sociétés économiquement égalitaires, les mettait de surcroît en situation de subir défavorablement les évolutions ultérieures. Lorsqu’avec l’apparition du stockage, les richesses ont commencé à être accumulées et le travail humain systématiquement exploité, les premières victimes ont logiquement émané des catégories les plus vulnérables. Ce furent essentiellement les prisonniers de guerre, privés du soutien de leur parenté et dont la vie, virtuellement prise au combat par leur vainqueur, se retrouvait tout entière entre les mains de celui-ci. Ce furent aussi les femmes, pour peu qu’aucun point d’appui ne leur permette de s’opposer à l’extension du champ de la domination masculine. Plus tard, l’apparition de certaines formes d’agriculture intensive ont sans doute elles aussi joué dans le même sens, en faisant de l’homme le conducteur de l’attelage et le travailleur agricole par excellence, excluant les femmes de cette sphère d’activité et sapant ainsi les lignes de défense qu’elles avaient pu conserver dans certaines sociétés.
Le rôle historique du capitalisme
Si la domination masculine trouve son origine ultime dans le monopole masculin des armes et des activités qui lui étaient liées, on est en droit de se demander pour quelles raisons cette domination a perduré sous une forme ou sous une autre jusqu’à nos jours.
Un élément central de la réponse est que jusqu’à l’époque contemporaine, aucune des organisations économiques qui se sont succédé n’a remis en cause la division sexuelle du travail. Or, le fait que chaque sexe se voie assigner un rôle propre dans la production a été le substrat sur lequel s’est maintenue l’idée ancestrale selon laquelle, plus généralement, chaque sexe devait être assigné à un rôle social différent et, potentiellement au moins, inégalement valorisé. Même si les monopoles masculins sur la chasse et sur les armes ne jouent bien évidemment plus depuis longtemps le rôle-clé qui fut jadis le leur, la division sexuelle du travail est restée depuis des millénaires le socle de l’inégalité des sexes.
Cependant, sur la base de cette permanence, des évolutions se sont produites. Aussi longtemps que la division du travail restait élémentaire, attribuer certaines tâches aux hommes et d’autres aux femmes apparaissait sans doute comme la manière la plus évidente et la plus adéquate d’effectuer la répartition. Mais au cours du temps, la complexification de la division sociale du travail qui a accompagné les progrès de la productivité et de la technique a peu à peu pénétré les sphères dévolues à chaque sexe. Là où, auparavant, tous les individus effectuaient les mêmes travaux élémentaires et spécifiques à leur sexe, ils exerçaient désormais des activités de plus en plus spécialisées et différentes les unes des autres. Ainsi, à mesure qu’elle s’approfondissait, la division du travail contribuait à rendre objectivement le critère du sexe de plus en plus dépassé et superflu, sans toutefois le dissoudre. Il y avait de plus en plus de métiers d’hommes et de plus en plus de métiers de femmes ; mais les métiers restaient des métiers d’hommes et des métiers de femmes.
Un pas décisif a été franchi avec le mode de production capitaliste qui, dans ce domaine comme dans bien d’autres, a joué un rôle révolutionnaire inouï. Le capitalisme est en effet le premier système économique à avoir jeté les bases d’une authentique (et mal nommée) égalité des sexes.
En généralisant la forme marchandise, il est le premier mode de production où sont comparés objectivement, quotidiennement et sur une large échelle, le travail féminin et le travail masculin, et où ils sont fondus sur le marché en une substance indifférenciée incarnée par la monnaie. C’est dans les profondeurs de sa machinerie économique que le capitalisme a mis en œuvre les mécanismes qui sapent les bases de la division sexuelle du travail et qui préparent les conditions objectives de sa disparition future.
En généralisant la forme marchandise, le capitalisme est le premier système économique à avoir jeté les bases d’une authentique (et mal nommée) égalité des sexes.
Marx remarquait déjà que si le génie d’Aristote avait échoué à découvrir la théorie de la valeur-travail, c’est parce que seule la société capitaliste avait fait émerger le concept de « travail » dans son sens le plus général, celui de l’activité économique humaine, abstraite de toutes ses formes particulières35. Pour toutes les sociétés précapitalistes, il existait des types de travaux de nature différente — en particulier, libre et servile — qui ne pouvaient être ramenés, ni dans les faits ni dans les esprits, à aucun dénominateur commun. Cette remarque s’applique tout aussi bien à la séparation entre travail masculin et travail féminin, perçus dans toutes les sociétés primitives, en l’absence du marché et en présence d’une forte division sexuelle du travail, comme de qualités différentes et donc incommensurables.
Or, dans une économie capitaliste achevée, les produits sont confrontés en permanence les uns aux autres par l’intermédiaire de la monnaie. Leur valeur, qui s’exprime dans le prix, est indifférente à la détermination concrète du travail et des travailleurs, entre autres à leur sexe. Dans la mesure où ils produisent des marchandises, les différents travaux concrets se dissolvent dans le travail abstrait, le « travail humain indistinct », une substance homogène par sa qualité et dont seule la quantité, le « temps de travail socialement nécessaire », intervient dans la création de valeur.
Et si la force de travail féminine est fréquemment moins payée que son homologue masculine, l’existence du marché crée en elle-même un point d’appui pour corriger ce qui apparaît comme une anormalité. « À travail égal, salaire égal ! » tel fut le cri de ralliement des femmes prolétaires qui, même si le chemin est encore long, ont peu à peu remporté des succès significatifs dans ce sens.
En posant les fondements d’une révolution dans les rapports sociaux objectifs, la société bourgeoise a créé les conditions d’une révolution des consciences. Le drapeau historique de la bourgeoisie dans son combat contre les classes dirigeantes du passé était celui de l’égalité juridique, qui incluait l’égalité des marchandises dans la concurrence et celle des différentes composantes de la force de travail. Bien entendu, en même temps qu’elle brandissait ce drapeau, la bourgeoisie était toute prête à le piétiner ; et lors de la grande Révolution française, les femmes furent parmi les premières à constater avec amertume que la simple égalité politique n’était pas censée les concerner. Mais même si la société bourgeoise naissante n’était pas prête à reconnaître les droits juridiques et politiques de la moitié féminine de la population, l’émergence de cette revendication — et son aboutissement, pays après pays — étaient en quelque sorte inscrite dans les gènes d’une organisation sociale qui se pense et qui s’annonce sous la bannière de l’égalité.
Que la possibilité qu’une authentique égalité des sexes se réalise un jour dans le cadre du système capitaliste est à douter.
Selon la célèbre formule de Marx, l’humanité ne se pose que des problèmes qu’elle peut résoudre ; nul hasard donc si c’est dans la société bourgeoise que pour la première fois dans l’aventure humaine sont apparus des courants, à commencer par le mouvement ouvrier révolutionnaire, qui se sont donné comme but l’égalité des sexes — il serait d’ailleurs plus juste de parler de disparition, ou d’identité, des genres.
Dans les sociétés primitives, la division sexuelle du travail était une chose si omniprésente, elle touchait si intimement aux faits essentiels de la vie matérielle et idéologique qu’elle imprégnait toute la vie sociale : ce n’était pas seulement au travail mais virtuellement dans tous les domaines de l’existence qu’hommes et femmes apparaissaient comme des entités différentes. On ne saurait mieux toucher du doigt à quel point la division sexuelle du travail imprimait sa marque sur les sociétés primitives qu’en rappelant qu’en Australie aborigène, hommes et femmes étaient désignés métaphoriquement par leur principal outil de travail : « des lances et des bâtons à fouir »36 (de la même manière, l’Amazonie opposait « l’arc et le panier »37).
Plus généralement, si l’on dispose de maints témoignages d’actes de résistance de la part de femmes des sociétés primitives contre les exactions commises par les hommes, l’idée que femmes et hommes pourraient de manière indifférenciée jouer les mêmes rôles sociaux, partager les mêmes droits et les mêmes devoirs n’a jamais émergé nulle part avant la période moderne. Dans toutes les sociétés du passé, lacérées par la division sexuelle du travail, elle demeurait, au sens propre du terme, impensable.
La question de la possibilité qu’une authentique égalité des sexes (c’est-à-dire, une dissolution des genres) se réalise un jour dans le cadre du système capitaliste est trop difficile pour être abordée ici. Pour un certain nombre de raisons, il est au moins permis d’en douter. Dans une célèbre formule, Marx affirmait que seule l’instauration d’une société socialiste permettrait à l’humanité de sortir véritablement de la préhistoire ; du point de vue des rapports entre les sexes, un siècle et demi après qu’elle a été écrite, cette phrase résonne avec une étrange profondeur.
Cet article a paru en version plus longue en anglais dans Albert García-Piquer et Assumpció Vila-Mitjà (dir.), Beyond War : Archaeological Approaches to Violence, Cambridge Scholars Publishing, 2016.
Footnotes
- Cet article résume les thèses développées dans mon livre, Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était, 2e ed., Smolny, 2012.
- Johann J. Bachofen, Das Muterrecht, Stuttgart, Verlag von Kreis & Hoffman, 1861.
- Lewis Morgan, Ancient Society, University of Arizona Press, 1st THUS edition, 1985 [ 1877].
- Friedrich Engels, L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Moscou, Éditions du progrès, 1980 [ 1884], p. 78.
- Ibid., p. 68-69.
- Voir par exemple Eleanor B. Leacock, Foreword to F. Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, London, Lawrence & Wishhart, 1972 ; « Women’s Status in Egalitarian Society : Implications for social evolution [ and comments and reply] », Current Anthropology, vol. 19-2, p. 247-275, 1978.
- F. Engels, Ibid., p. 12.
- Lewis L. Langness, « Ritual, Power, and Male Dominance », Ethos, vol. 2-3, p. 189-212, 1974, p. 191.
- Ibid.
- Shirley Lindenbaum, « A Wife is in the Hand of Man », dans Man and woman in the New Guinea Highlands, P. Brown & G. Buchbinder (dir.), American Anthropological Association, Washington, no 8, 1978, p. 55-56.11 Mervyn Meggitt, « Male-Female Relationships in the Highlands of Australian New Guinea », American Anthropologist, New Series, vol. 66-4, p. 204-224, 1964, p. 220-221.
- Mervyn Meggitt, « Male-Female Relationships in the Highlands of Australian New Guinea », American Anthropologist, New Series, vol. 66-4, p. 204-224, 1964, p. 220-221.
- Debra L. Martin, David W. Frayer (dir.), Troubled Times : Violence and Warfare in the Past, Routledge, New York, 1997 ; Mark W. Allen, Terry L. Jones (dir.), Violence and Warfare among Hunter-Gatherers, Left Coast Press, Walnut Creek, 2014 ; Azar Gat, War in Human Civilization, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Gertude E. Dole, « The marriages of Pacho : a woman’s life among the Amahuaca » in Many sisters, C. Matthiason (dir.), Free Press, Londres, p. 3-35, 1974, p. 12-13.
- Pour une synthèse, voir Bronislaw Malinowski, The Family Among the Australian Aborigines, London, University of London Press, 1913.
- Catherine et Ronald Berndt, The world of the first Australians, Canberra, Aboriginal Studies Press, 1992 [ 1964], p. 208.
- Anne Chapman, Drama and Power in a Hunting Society : the Selk’Nam of Tierra del Fuego, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
- Debra L. Martin, David W. Frayer (dir.), Troubled Times : Violence and Warfare in the Past, Routledge, New York, 1997 ; Mark W. Allen, Terry L. Jones (dir.), Violence and Warfare among Hunter-Gatherers, Left Coast Press, Walnut Creek, 2014 ; Azar Gat, War in Human Civilization, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Christophe Darmangeat, « Certains étaient-ils plus égaux que d’autres ? Formes d’exploitation sous le communisme primitif », Actuel Marx 58, p. 144-158, 2015.
- Steven L. Kuhn, Mary C. Stiner, « What’s a Mother to Do ? The Division of Labor among Neandertals and Modern Humans in Eurasia », Current Anthropology, vol. 47-6, 2006.
- Françoise Héritier, Masculin / Féminin ; la pensée de la différence, Odile Jacob, Paris, 1996.
- Philippe Descola, « Le jardin de Colibri : Procès de travail et catégorisations sexuelles chez les Achuar de l’Équateur », L’Homme, vol. 23-1, p. 61-89, 1983, p. 87.
- Debra L. Martin, David W. Frayer (dir.), Troubled Times : Violence and Warfare in the Past, Routledge, New York, 1997 ; Mark W. Allen, Terry L. Jones (dir.), Violence and Warfare among Hunter-Gatherers, Left Coast Press, Walnut Creek, 2014 ; Azar Gat, War in Human Civilization, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Christophe Darmangeat, « Certains étaient-ils plus égaux que d’autres ? Formes d’exploitation sous le communisme primitif », Actuel Marx 58, p. 144-158, 2015.
- Paola Tabet, « Fertilité naturelle, reproduction forcée » in N.-C. Mathieu (dir.), L’arraisonnement des femmes : Essais en anthropologie des sexes, Éditions de l’EHESS, Paris, 1985.
- Jordi Estévez et al., « Cazar o no cazar, ¿Es ésta la cuestión ? », Boletín de Antropología Americana, vol. 33, p. 5-24, 1998 ; Assumpció Vila, Jordi Estévez, « Naturaleza y Arqueología : La reproducción en sociedades cazadoras-recolectoras o la primera revolución reproductiva », Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueologia Social, vol. 12, p. 11-25, 2010.
- Adolphus Peter Elkin, The Australian Aborigines, Angus and Robertson, Londres, 1956 [ 1938], p. 128.
- Kaj Birket-Smith, Mœurs et coutumes des Eskimos, Payot, Paris, 1937, p. 173.
- Marija Gimbutas, The Civilization of the Goddess, Harper, San Francisco, 1991.
- Peter Ucko, « The Interpretation of Prehistoric Anthropomorphic Figurines », The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 92-1, p. 38-54, 1962 ; Margaret W. Conkey, Ruth E. Tringham, « Archaeology and the Goddess : Exploring the Contours of Feminist Archaeology », dans Stanton D.C., Stewart A.J. (dir.), Feminisms in the Academy, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1995 ; Alain Testart, La déesse et le grain : Trois essais sur les religions néolithiques, Errance, Paris, 2010.
- Jane Balme, Sandra Bowdler, « Spear and digging stick : The origin of gender and its implications for the colonization of new continents », Journal of Social Archaeology, vol. 6, p. 379-401, 2006.
- Patricia L. Crown, « Gendered Tasks, Power, and Prestige in the Prehispanic American Southwest », dans Women and Men in the Prehispanic Southwest, Crown P. L. (dir.), School of American Research Advance Seminar Series, Santa Fe, p. 3-42, 2000 ; Marit K. Munson, « Sex, Gender and Status : Human Images from the Classic Mimbres », American Antiquity, vol. 65-1, p. 127-143, 2000.
- Vered Eshed, Avi Gopher, Ehud Galili, Israel Hershkovitz, « Musculoskeletal stress markers in Natufian hunter-gatherers and Neolithic farmers in the Levant : The upper limb », American Journal of Physical Anthropology, vol. 123-4, p. 303-315, 2004.
- Damiano Marchi, Vitale S. Sparacello, Brigitte M. Holt, Vincenzo Formicola, « Biomechanical Approach to the Reconstruction of Activity Patterns in Neolithic Western Liguria, Italy », American Journal of Physical Anthropology, vol. 131, p. 447-455, 2006.
- Sébastien Villotte, Christopher Knüsel, « “ I sing of arms and of a man… ” : Medial epicondylosis and the sexual division of labour in prehistoric Europe », Journal of Archaeological Science, vol. 43, p. 168-174, 2014.
- Karl Marx, Le Capital, Livre I, Gallimard, Paris, 2008 [ 1867], p. 590-591.
- Catherine Berndt, « Digging sticks and spears, or the two-sex model » dans F. Gale (dir.), Woman’s Role in Aboriginal Society, Australian Institute of Aboriginal Studies, Canberra, p. 64-84, 1974.
- Pierre Clastres, La Société contre l’État, Éditions de Minuit, Paris, 1974, p. 92.