Depuis des décennies, les politiques de la ville se soumettent aux intérêts des investisseurs privés au détriment des habitants et de leurs besoins. Mais des solutions existent pour une ville démocratique et accessible à tous.

S’opposer à la gentrification , ce n’est pas plaider pour laisser les quartiers populaires à l’abandon , c’est construire une politique urbaine qui répond aux besoins des habitants. Qui produit la ville et pour quel public ? Comment comprendre et lutter contre des politiques déconnectées des besoins de la population? Quelles alternatives proposer? C’est à ces questions que veulent répondre les défenseurs du «droit à la ville». Pour comprendre l’utilité pratique de ce concept né il y a un peu plus de cinquante ans, nous avons organisé une discussion entre Ben Van Duppen, échevin PTB à Borgerhout, un district de la Ville d’Anvers, et Mathieu Van Criekingen, géographe à l’Université Libre de Bruxelles et spécialiste des questions urbaines.
Ben, c’est en discutant avec toi qu’est venue l’idée de mener cet entretien croisé. Peux-tu nous expliquer pourquoi c’est important ?
Van Duppen. J’assiste à de nombreuses transformations dans mon district de Borgerhout. Par exemple, le prix des logements augmente bien plus vite que les revenus des habitants. Des services publics essentiels disparaissent comme les crèches, les guichets publics, les banques, les maisons de repos. Si l’on élargit à l’ensemble d’Anvers, on voit que les autorités communales détruisent des logements sociaux tout en laissant quelques milliardaires s’emparer de quartiers entiers ou construire des tours hors normes.
Qu’est-ce que ça veut dire de gagner du pouvoir d’achat à l’usine si le loyer a augmenté de 50% pendant ce temps-là ?
À notre niveau, on essaie de lutter contre ces mesures. Borgerhout, c’est un district de la ville d’Anvers. Cela veut dire que dans la majorité PTB-Groen-Vooruit dont je fais partie, on a des compétences limitées: petite enfance et bien-être des personnes âgées, gestion de l’espace public, une partie des travaux publics et la culture. Par contre, les politiques sociales, d’urbanisme, de logement, sont décidées au niveau de la Ville d’Anvers, qui est dirigée par Bart De Wever, au sein d’une majorité N-VA-Vooruit.
Mais ce que je vois à Anvers existe dans d’autres villes, par exemple à Charleroi ou Bruxelles. Donc, je suis content de discuter avec Mathieu Van Criekingen du cadre politique et idéologique qui guide ces mesures et de réfléchir à la manière de lutter contre elles. Comment faire une politique de la ville qui réponde aux besoins des gens ?
Mathieu, cette idée de partir des besoins des habitants de la ville et de mener une politique qui y répond, c’est ce que défendent celles et ceux qui mobilisent le «droit à la ville». Pourrais-tu nous rappeler d’où vient ce concept?
Van Criekingen. Le «droit à la ville », c’est une expression qu’on entend aujourd’hui dans différents milieux, pour dire des choses assez différentes et pas toujours progressistes. Donc, je pense que c’est important de revenir au sens d’origine. Au départ, c’est un concept créé par Henri Lefebvre, un sociologue et philosophe français, en 1968 à Paris, dans un contexte de politisation, notamment sur les questions urbaines. En parallèle aux luttes sociales de Mai 68, une série de collectifs et d’organisations se mobilisent contre des politiques de «modernisation» des villes qui impliquent de détruire des quartiers entiers, avec beaucoup d’expropriations et d’évictions d’habitants, comme dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles par exemple.
L’idée de Lefebvre, c’est de montrer que ces transformations servent des intérêts et s’appuient sur des idéologies. Ce ne sont pas des phénomènes naturels ou simplement liés à l’évolution des techniques ou à la «modernité ». Les intérêts que servent ces politiques sont à la fois des intérêts capitalistes privés et des intérêts étatiques. Les deux vont souvent main dans la main.
Et donc, par le droit à la ville, il veut poser la question de comment renverser ce mode de production des espaces urbains: quel contre-pouvoir construire, pour quelle alternative? Il défend l’idée de réfléchir à une production de la ville au départ des besoins et des aspirations de tous ceux et celles qui habitent la ville. Il appelle cela les valeurs d’usage de la ville: se loger, élever ses enfants, se divertir et pour les sociabilités, l’éducation, le travail.

Parler du droit à la ville au sens de Lefebvre, c’est donc parler d’un conflit autour de la production de la ville: à quelle fin est-elle aménagée ou rénovée, pour ou contre qui, avec ou sans qui? Lefebvre essaie aussi de s’adresser aux partis de gauche et aux syndicats. Il les appelle à élargir leurs combats au-delà de la question du travail. Il dit qu’il ne faut pas négliger les questions de ce qu’il se passe après la journée de travail, quand l’ouvrier rentre chez lui. Qu’est-ce que ça veut dire de gagner du pouvoir d’achat à l’usine dans une lutte contre son patron si pendant ce temps-là le loyer payé à son propriétaire a augmenté de 50% ?
Aujourd’hui, ces idées sont toujours mobilisées dans les luttes urbaines, mais la formule «droit à la ville» a aussi été reprise par des institutions qui, elles, l’entendent plutôt comme « droit à consommer la ville ». Par exemple, dans le plan qui guide le développement stratégique de la Région bruxelloise, on trouve des phrases qui lient droit à la ville et attractivité urbaine. Donc, lorsqu’on entend parler de droit à la ville, il faut toujours s’interroger sur qui mobilise le concept et pourquoi.
Ben, pourrais-tu nous expliquer plus en détail les transformations que tu observes dans les politiques urbaines à Anvers ainsi que leurs origines?
Van Duppen. À Anvers, on retrouve cette volonté d’attractivité dont parle Mathieu. On a assisté à un virage vers cette politique au début des années 2000, sous la direction de Patrick Janssens, l’ancien bourgmestre SP.A (futur Vooruit), qui venait du monde de la publicité. Son projet était de «mettre Anvers sur la carte internationale ». Rivaliser avec d’autres villes pour attirer les entreprises, les cerveaux, les visiteurs (les trois «B» en flamand: Bedrijven, Brains, Bezoekers). Ainsi qu’un quatrième «B », Bewoners, c’est-à-dire les habitants.
Mais la question est de savoir quels habitants il souhaitait attirer. Ça, on peut le comprendre en regardant sa politique de développement urbain. Elle s’est matérialisée d’abord dans le quartier «Het Eilandje ». Il s’agissait d’un quartier de dockers à la limite entre le port et la ville. Qui est aujourd’hui complètement transformé, avec des appartements de luxe et des commerces à la mode. Ces transformations ont été encouragées par la politique de la ville d’Anvers. Le point de départ a été l’ouverture du MAS (Museum Aan de Stroom), le nouveau musée public de la ville. En soi, un musée, c’est plutôt positif, mais ici, ça semble surtout avoir servi d’outil pour changer l’image du quartier et renforcer l’attractivité pour les investisseurs. Même chose au sud de la ville, où la construction d’un nouveau palais de justice a été le point de départ pour la création du Nieuw Zuid. Un quartier présenté comme vert et basé sur l’économie circulaire. Là aussi un point plutôt positif a priori, mais dans les faits, ce quartier est composé essentiellement de logements privés à prix élevé.
Sous la direction de De Wever, les règles urbanistiques ont été modifiées pour faciliter la délivrance des permis pour des projets immobiliers privés.
À chaque fois, on retrouve une coordination étroite entre les promoteurs immobiliers privés et les autorités publiques. Avec pour objectif de produire des logements privés, vendus ou loués au prix du marché. Alors que la demande de logements abordables ou sociaux est forte, les «bewoners» que Janssens voulait attirer sont clairement des populations plus riches que les habitants d’alors.
En devenant Bourgmestre en 2012, Bart De Wever (N-VA) a poursuivi cette politique. Je dirais même qu’il a été au bout de la démarche lancée par son prédécesseur. Sous la direction de De Wever, les règles urbanistiques ont été modifiées pour accélérer et faciliter la délivrance des permis pour des projets immobiliers privés. Il expliquait que cela allait permettre de construire plus rapidement et donc de répondre à la crise du logement, un discours qu’on entend souvent aujourd’hui.
Dans les faits, ça a rendu la ville encore plus attractive pour les capitaux. Ainsi, deux milliardaires anversois, Fernand Huts, le patron de Katoen Natie, et Paul Gheyssens, patron de Gelhamco, ont tous les deux pour projet d’avoir leur grande tour dans le centre d’Anvers. On vit une sorte de moment Trumpien. Et le même Fernand Huts est occupé à racheter tout un quartier dans le nord de la ville.
La proximité entre autorités publiques, grandes fortunes et entreprises privées est de plus en plus visible. Un échevin du développement urbain a par exemple annoncé deux semaines avant les élections qu’il abandonnait la politique pour travailler dans la promotion immobilière. De grands promoteurs immobiliers sont allés dîner avec le conseil de la ville d’Anvers pour faciliter la vente de terrains publics. Sur certains terrains ou bâtiments achetés par des promoteurs, on change subitement les règles d’urbanisme pour permettre de construire des bâtiments plus hauts et de faire plus de profits. Aujourd’hui, de nombreux projets de construction sont rejetés par la population, et pourtant, ils continuent.
Mathieu, ces politiques d’attractivité pour les investisseurs, on les retrouve dans d’autres villes belges sur lesquelles tu as travaillé, notamment à Bruxelles et Charleroi.
Van Criekingen. Effectivement, même si je crois qu’il faut faire une différence avec Bruxelles et Charleroi, malgré tout.
Si je commence par Bruxelles, je vois de nombreux parallèles avec ce que Ben explique pour Anvers. Ce qui me marque sur les quinze dernières années, c’est une pression croissante d’une série d’acteurs capitalistes de l’immobilier, qui misent sur l’image de Bruxelles comme capitale européenne pour en tirer profit sur le marché résidentiel ou hôtelier.
Or, une grande partie du centre-ville de la ville est composée de quartiers populaires, avec des prix des terrains ou des bâtiments relativement bas par rapport aux autres villes européennes ou par rapport aux quartiers plus chics de Bruxelles. Ce différentiel, ces prix abordables des anciens terrains industriels ou portuaires ou des quartiers populaires, c’est une opportunité d’investissement intéressante pour un promoteur si vous arrivez à y développer des logements haut de gamme. Moyennant évidemment, un changement complet de la population, des usages et de l’image actuels de ces quartiers. Ces transformations sont en cours, particulièrement le long du canal qui traverse Bruxelles.
Le raisonnement des promoteurs, c’est de tirer profit de ce que le géographe britannique Neil Smith a appelé le rent gap ou différentiel de rente foncière. C’est l’écart entre la rentabilité actuelle du sol, héritée de la phase industrielle, et sa rentabilité potentielle s’ils arrivent à construire dessus des logements de luxe, un hôtel ou un centre commercial. Plus cet écart est grand, plus le profit du promoteur le sera aussi. C’est ce même mécanisme que l’on retrouve dans les quartiers anversois dont parle Ben.

Ça, c’est la logique des promoteurs privés. Mais les pouvoirs publics aussi jouent un rôle crucial. À Bruxelles, les autorités régionales lancent toute une série de signaux qui encouragent à venir profiter de ce rent gap. Par exemple, en changeant les règles d’affectation des sols pour permettre de construire des logements ou des commerces dans les zones d’industries, ou en implantant des équipements publics qui changent l’image des quartiers et attirent de nouveaux publics. Un exemple actuel, c’est la construction du Musée Kanal-Pompidou, le long du canal. Un projet 100% public: la Région bruxelloise a racheté un grand garage à Citroën pour le transformer en musée d’art contemporain d’envergure internationale. Ce type de projet a toutes les caractéristiques d’un «projet-vitrine»: un nouvel équipement qui «met en vitrine» une partie de la ville, où déjà une série de promoteurs privés s’activent, en prenant avantage de la proximité du futur musée pour augmenter les prix. Le parallèle avec Anvers et le MAS est clair.
À Charleroi, par contre, la pression des acteurs immobiliers est nettement moins forte. Elle est limitée à quelques portions du centre-ville, notamment autour du centre commercial Rive Gauche, qui a ouvert en 2017 et qui est le fruit d’une opération de spéculation immobilière privée suivie par un plan d’expropriation et la destruction de plusieurs îlots. Aujourd’hui, il y a d’autres projets immobiliers dans la même zone, le long de la Sambre et tout près de la gare. Mais si on regarde plus globalement, Charleroi est moins dans le viseur des investisseurs immobiliers, surtout des grands.
Par contre, ce qu’on voit à Charleroi, c’est un volontarisme politique fort en matière de renouvellement urbain, surtout depuis l’arrivée de Paul Magnette (PS) en 2012 comme bourgmestre. Ce volontarisme se traduit notamment dans des projets de rénovation d’espaces publics et d’équipements: un centre d’entreprises hi-tech et de start-ups dans l’ancien tri postal, des équipements culturels rénovés, une nouvelle tour de police dessinée par un architecte reconnu internationalement, etc. La Ville s’est dotée aussi d’un nouveau logo en 2015, comme l’avait fait Anvers du temps de Patrick Janssens. Comme la Ville de Charleroi a une situation financière difficile, ces projets sont essentiellement financés par des fonds publics régionaux, fédéraux ou européens.
Pour le moment, on ne peut pas dire que ça ait abouti à une vague de gentrification dans le centre de Charleroi. La sociologie y reste populaire. Par contre, on observe des inégalités fortes entre les espaces qui sont complètement rénovés, où tout est neuf, et vingt mètres plus loin des rues où les bâtiments sont dégradés, où les commerces sont vides. On a vraiment un grand décalage entre les populations et les activités qui parviennent à s’insérer dans ce «nouveau Charleroi» et les autres, pour qui les développements ne correspondent pas à leurs besoins, en termes de logements notamment.
Même si les stades de mise en œuvre et les niveaux d’investissement du capital privé sont différents dans ces trois villes, le cadre idéologique de ces politiques est similaire. Il est orienté sur l’attractivité pour des capitaux privés.
Van Criekingen. Oui, tout à fait. Et on retrouve ce même cadre idéologique dans beaucoup d’autres villes encore. «L’attractivité territoriale» est devenue un mantra des politiques urbaines depuis au moins trois décennies, une option qui n’est même plus discutée et qui, de fait, dessert des intérêts de classe.
Alors se pose la question du devenir des habitants qui n’entrent pas dans ce cadre. Qui n’ont pas les revenus pour se payer ces nouveaux logements, ces services de luxe.
Van Duppen. Borgerhout, historiquement, c’est un quartier ouvrier, populaire et c’est toujours le cas. Mais en même temps, on voit de nouveaux habitants, jeunes, plus diplômés, s’installer dans le district. Notamment parce que les prix des logements sont plus bas qu’ailleurs à Anvers. Ils sont aussi attirés par les politiques qu’on mène dans le district: améliorer la qualité de vie, verdir les espaces publics, mener des activités culturelles ou sociales pour animer la vie urbaine, etc. Le quartier devient plus mixte. Il me semble qu’il n’y a pas de mal en soi a priori, mais pour l’instant la concrétisation de cette mixité se fait au détriment des plus petits budgets, des classes populaires, car l’attrait nouveau pour le quartier fait monter les prix de l’immobilier. C’est la gentrification.
« L’attractivité territoriale» est devenue un mantra des politiques urbaines qui dessert les intérêts de classe.
Si on développait le logement social, on pourrait sans doute résoudre cette contradiction, en permettant à plus de familles de se loger à un prix abordable et protégé des logiques de marché. Mais c’est l’inverse qui se produit. À Anvers, le nombre de logements sociaux est en baisse, alors que des milliers de familles sont en attente. La Ville n’en construit pas de nouveaux et lorsqu’on rénove d’anciens logements sociaux, on en profite par exemple pour n’en reconstruire qu’un sur deux, ou pour les transformer en logements «moyens» avec des loyers plus élevés qui ne s’adaptent plus aux revenus des locataires. La Ville cherche à attirer d’autres publics à revenus et diplômes un peu plus élevés: les cerveaux, les start-ups, les jeunes entrepreneurs, etc.
Van Criekingen. À Bruxelles comme à Charleroi, l’usage de cette idée de mixité est problématique. Elle permet de justifier de ne pas construire de logements sociaux là où la demande est la plus forte, comme au centre-ville de Charleroi par exemple, pour ne pas «créer des ghettos », ou de reconstruire moins de logements sociaux après rénovation sous prétexte d’une meilleure «mixité ». On voit aussi cela ailleurs, comme dans certaines communes autour de Paris, dominées historiquement par le Parti communiste. Certains maires reprennent aujourd’hui ce refrain de la «mixité sociale », tandis que d’autres, qui voudraient construire des logements sociaux pour répondre à la demande, doivent lutter contre l’État français qui leur interdit de construire du logement social sous prétexte qu’ils en auraient déjà trop. Si le maire veut en construire plus, alors il doit les financer lui-même. Donc, le principe de mixité sociale s’oppose ici de manière frontale au droit au logement. En même temps, les communes voisines dominées par la droite ne construisent pas non plus de logements sociaux, car elles n’en veulent pas. Certains maires préfèrent même payer des amendes que de construire des logements sociaux. Donc, en fait, la production est bloquée partout, au moment-même où les prix sur le marché privé augmentent fortement. C’est le droit au logement qui recule, au nom d’un principe qui apparaît progressiste sur le papier, mais qui a comme conséquence concrète de réduire la production de logements sociaux.
Pourtant, cette idée de mixité est valorisée. On y associe l’image de quartiers agréables et rénovés. Si tu t’opposes à ces politiques, on va vite essayer de te disqualifier en te disant: «En fait, vous êtes pour le statu quo ». Rénover ça fait monter les prix, c’est vrai, mais vous trouvez que c’est mieux de ne rien faire, de laisser les quartiers se dégrader et les logements en mauvais état?». Que peut-on répondre à ça ?
Van Criekingen Je réponds que mettre l’alternative entre gentrification d’un côté et déglingue et misère de l’autre, c’est une arnaque intellectuelle. Le contraire de la gentrification, ce n’est pas la déglingue. Cela n’a rien à voir. Au contraire, gentrification et déclin, appauvrissement, ce sont deux éléments d’un même système, qu’on va appeler l’urbanisation capitaliste. Il n’y a pas à choisir entre les deux, de toute façon, dans la ville actuelle, on a les deux: en même temps des quartiers populaires qui se dégradent et qui sont désinvestis par les autorités, et des quartiers populaires «à la mode» où se concentrent les investissements publics et privés et où les prix du logement augmentent au point de chasser les habitants.
La question est donc de savoir selon quelle logique et selon quels objectifs on mène la rénovation ou le réinvestissement public dans les quartiers populaires. Soit on est sur des objectifs d’attractivité, comme l’explique Ben avec les «brains, bedrijven, bezoekers en bewoners». Alors la réflexion est comment mettre en avant les potentiels, qu’est-ce qu’on va pouvoir changer dans le quartier pour capter l’attention ou les capitaux des gens ou des fonctions qu’on souhaite attirer.
Une autre approche, c’est de se demander quels sont les besoins actuels qui ne sont pas satisfaits pour les habitants. Par exemple, il n’y a pas assez de crèches. Et donc, faire du réinvestissement public pour répondre à cette demande. Il ne s’agit pas de choisir entre rénover ou pas mais bien, par exemple entre investir dans un musée d’art contemporain ou des crèches. Là, il y a un choix politique.
S’opposer à la gentrification, ce n’est pas plaider pour laisser les quartiers populaires à l’abandon. Au contraire, c’est construire une politique urbaine qui répond aux besoins des habitants, des travailleurs et de leur famille, contrairement aux mesures actuelles.
Je pense que derrière ce débat, il y a une question de représentation de ce qu’est un bon quartier. Pour beaucoup de politiques, c’est d’abord un quartier attractif, qui attire des touristes, où les gens viennent faire du shopping ou investir. Mais on peut dire que le bon quartier, c’est d’abord celui qui répond aux besoins des habitants. Oui, bien sûr, il peut être attractif. Les gens peuvent venir, ce n’est pas le problème, mais pas au point de devenir inaccessibles aux habitants actuels.
Mais alors, il y a une question plus subtile: on rend un quartier plus agréable pour ses habitants, avec des services qui répondent à leurs besoins, comme des crèches, une école, un parc avec des jeux. Mais dans les logiques de marché, il y a quand même des chances que ce quartier voie le prix des logements augmenter, même si ce n’est pas l’objectif politique. Alors, comment lutter contre ces mécaniques qui chassent les habitants en question ?
Van Criekingen. J’ai déjà entendu des responsables politiques bruxellois dire: «Dès qu’on plante un arbre, ça fait augmenter les loyers ». Donc, on doit réfléchir à chaque fois qu’on plante un arbre dans la ville. Mais justement, la question, ce n’est pas «est-ce qu’on doit planter un arbre ou pas?», c’est «qu’est-ce qu’on fait pour empêcher que, dès qu’on plante un arbre, le loyer augmente?». En d’autres mots, la question cruciale est de savoir comment empêcher ces mécanismes de transfert d’une richesse publique, par exemple planter un arbre, refaire une place ou installer une école et des crèches, vers une richesse privée. Ou le transfert de valeurs d’usage en valeurs d’échange, pour reprendre les catégories d’Henri Lefebvre.
Dans certaines villes allemandes, il y a des dispositifs pour bloquer cela. Quand ils lancent un plan de rénovation dans un quartier, ils font d’abord un relevé de tous les loyers. Et après les travaux, il y a interdiction d’augmenter les loyers dans le périmètre. La régulation des loyers, c’est le levier à mobiliser pour lutter contre ces hausses de prix.
Poser l’alternative entre gentrification d’un côté et déglingue et misère de l’autre, c’est une arnaque intellectuelle.
En Belgique, les salaires sont régulés par des conventions collectives, c’est-à-dire soumis à une forme de démocratie sociale entre patrons et travailleurs via les syndicats. Un patron ne peut pas fixer librement les salaires de ses travailleurs, il doit respecter la convention collective de son secteur. Par contre, un propriétaire-bailleur, lui, peut fixer tout seul le montant du loyer de l’appartement qu’il loue. Il n’y a pas, pour les loyers, ce niveau de régulation collective des prix. C’est le reflet d’un système où le droit de propriété lucrative des logements est quasi illimité, du moins sur les prix. Et cette absence de régulation collective, cette absence de démocratie sociale sur la question des loyers, se paie par des situations de mal-logement de plus en plus massives, avec toutes les conséquences que cela a derrière pour les personnes mal-logées (santé, fins de mois difficiles…).
Ben, en plus de la question du logement qui est fondamentale, il y a d’autres domaines au niveau desquels ces deux visions de villes s’opposent. Dans ta pratique ou celle de tes camarades à Borgerhout ou à la ville d’Anvers, quelles autres luttes vois-tu se dérouler ?
Van Duppen. La lutte concerne aussi les services publics. La politique de la Ville est de plus en plus basée sur l’idée qu’il faut maximiser la valeur marchande, au détriment de la valeur d’usage pour les gens. Par exemple, on ferme les crèches publiques pour les remplacer progressivement par des crèches privées, plus chères pour les parents. C’est un choix encouragé par une étude du géant privé de la consultance KPMG. La conclusion de cette étude était que les crèches publiques étaient un problème, car «elles offraient un service de tellement bonne qualité qu’il n’y avait pas de place pour une concurrence privée, ce n’était pas possible de rivaliser !» Alors, la ville fait le choix de désinvestir le secteur public pour laisser la place au privé. Je connais des parents qui ne vont plus au travail parce que c’est moins cher de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants. À Borgerhout, notre échevine de la petite enfance lutte pour garder les services publics de crèche ouverts.
On voit la même chose de l’autre côté de la pyramide des âges. Nous menons une bataille acharnée contre la privatisation du service public de soin pour les personnes âgées. Petit à petit, les autorités d’Anvers suppriment certaines allocations, transforment l’organisation du service public pour le faire ressembler à une entreprise. Un exemple: le service public gérait une série de logements avec services de soin près de la Grand-Place. Les résidents payaient 300-320 euros par mois. Ces logements ont été démolis et remplacés par une résidence service privée, à 1800€ par mois.
Un autre élément dont on n’a pas encore parlé, c’est l’insécurité, et évidemment le trafic de drogue. Cette problématique justifie des politiques de plus en plus répressives. Mais en réalité, ces moyens sont utilisés contre la population. Un exemple: les quais de l’Escaut rénovés dans le centre-ville attirent les amateurs de skateboard. Cela dérange les propriétaires des bâtiments en face. Ils craignent que cela fasse baisser la valeur de leurs biens. Alors les autorités interdisent le skateboard. C’est frustrant pour les jeunes, ils ne faisaient rien de mal. Par contre, on a l’impression que rien n’est fait pour lutter contre ceux qui tirent profit du trafic de drogue qui empoisonne la vie de nombreux quartiers. Toujours au nom de la lutte contre la criminalité, la sécurité électronique explose. Il y a de plus en plus de caméras pour suivre le trafic routier et mettre des amendes de stationnement ou pour contrôler les espaces publics avec des caméras «intelligentes» qui reconnaissent les comportements dangereux. Les autorités sont fières et disent qu’en moins de dix minutes après le constat d’une infraction par caméra, elles sont sur le terrain. Mais en même temps, on ferme les commissariats de quartier. Du coup, la distance entre la police et la population est plus grande. Je ne crois pas que c’est comme cela qu’on va résoudre les problèmes. Le contrôle électronique à distance ne remplace pas l’expertise des policiers de proximité, ni le travail social des travailleurs de terrain. Par contre, cela crée un danger pour la démocratie: qui contrôle les images et les données, pour en faire quoi ?
Toujours au sujet de l’électronique, Anvers est fière d’être une smart city, donc de proposer de nombreux services administratifs numériques. Cela pourrait être une bonne chose pour faciliter les procédures et ne pas avoir besoin d’aller à la Maison communale. Mais, dans les faits, cela sert surtout à fermer des guichets. Donc les gens qui ne trouvent pas l’information en ligne ou qui ont une demande spécifique ne trouvent plus d’aide. Et lorsque la ville a subi une cyberattaque en 2023, plus rien ne fonctionnait. Cette attaque risque de coûter des dizaines de millions et ça a mis fin aux rêves de Bart De Wever de vendre son concept de smart city ailleurs… À Borgerhout, pour lutter contre cet éloignement des services publics, nous avons ouvert une heure de consultation par semaine avec le collège de district: les gens peuvent s’y rendre pour toute question administrative.
Ce qui est nécessaire, c’est de pouvoir écouter les gens et leur permettre de prendre part aux décisions publiques et démocratiques.
En fait, finalement, je pense que ce qui est nécessaire, c’est de pouvoir écouter les gens et leur permettre de prendre part aux décisions publiques et démocratiques. Un exemple, ici à Borgerhout: un commissariat de police est en train d’être vidé pour être déplacé ailleurs. Alors, il y a débat: faut-il le remplacer par un parc ou par une bibliothèque? Pour l’instant, cela crée de la contradiction entre les habitants, car les gens ont besoin des deux. Et en même temps, le projet de la ville, c’est de vendre le commissariat et les terrains qui l’entourent aux promoteurs privés. Mais si on reprenait l’église vide du coin entre les mains du public et qu’on gardait la main sur l’ancien commissariat, on pourrait faire les deux! Un parc à la place du commissariat et une bibliothèque dans l’église. C’est ce genre de lutte qu’on veut mener: rassembler les gens autour d’un autre projet de ville qui réponde à nos besoins et pas à ceux des promoteurs privés. Nous avons récemment pris l’initiative de rassembler les organisations de la société civile, le monde associatif du district et d’organiser des réunions régulières, pour connaitre leurs besoins et pour que tout le monde se connaisse mieux. Suite à cette initiative, ces associations sont revenues me voir avec un plan en dix points sur les priorités pour le district.
C’est comme cela qu’on veut mener une autre politique de la ville. En partant de l’écoute des besoins des habitants et de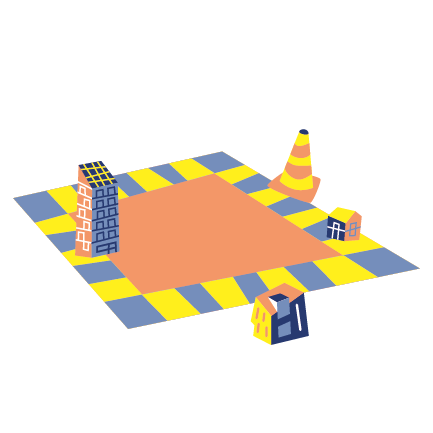 leurs représentants pour établir nos priorités en matière de logement, de services publics, de politique sociale ou de sécurité.
leurs représentants pour établir nos priorités en matière de logement, de services publics, de politique sociale ou de sécurité.




