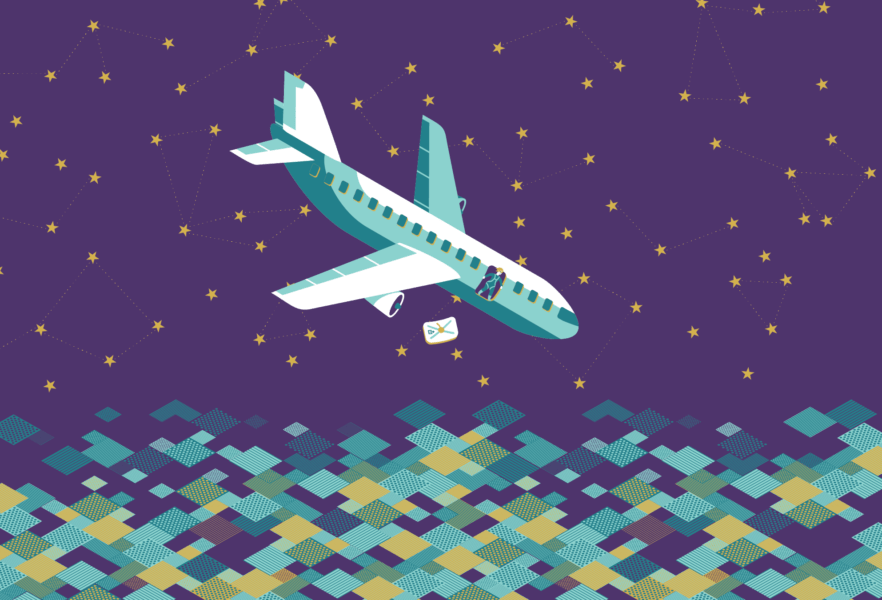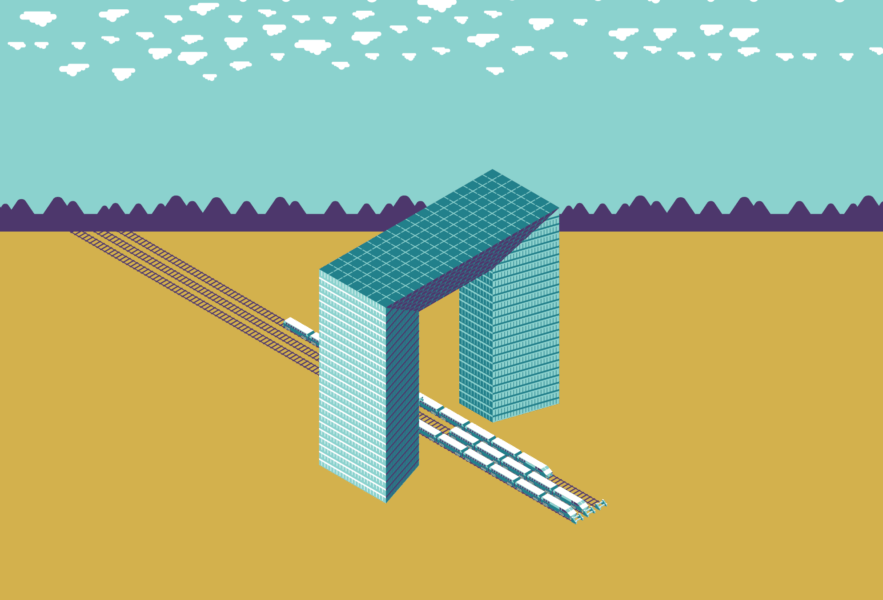Dans une ère de globalisation ce monde est de plus en plus concentré sur la limitation de la circulation du peuple. Le renforcement des frontières joue un rôle fondamental dans la « course vers le bas ».
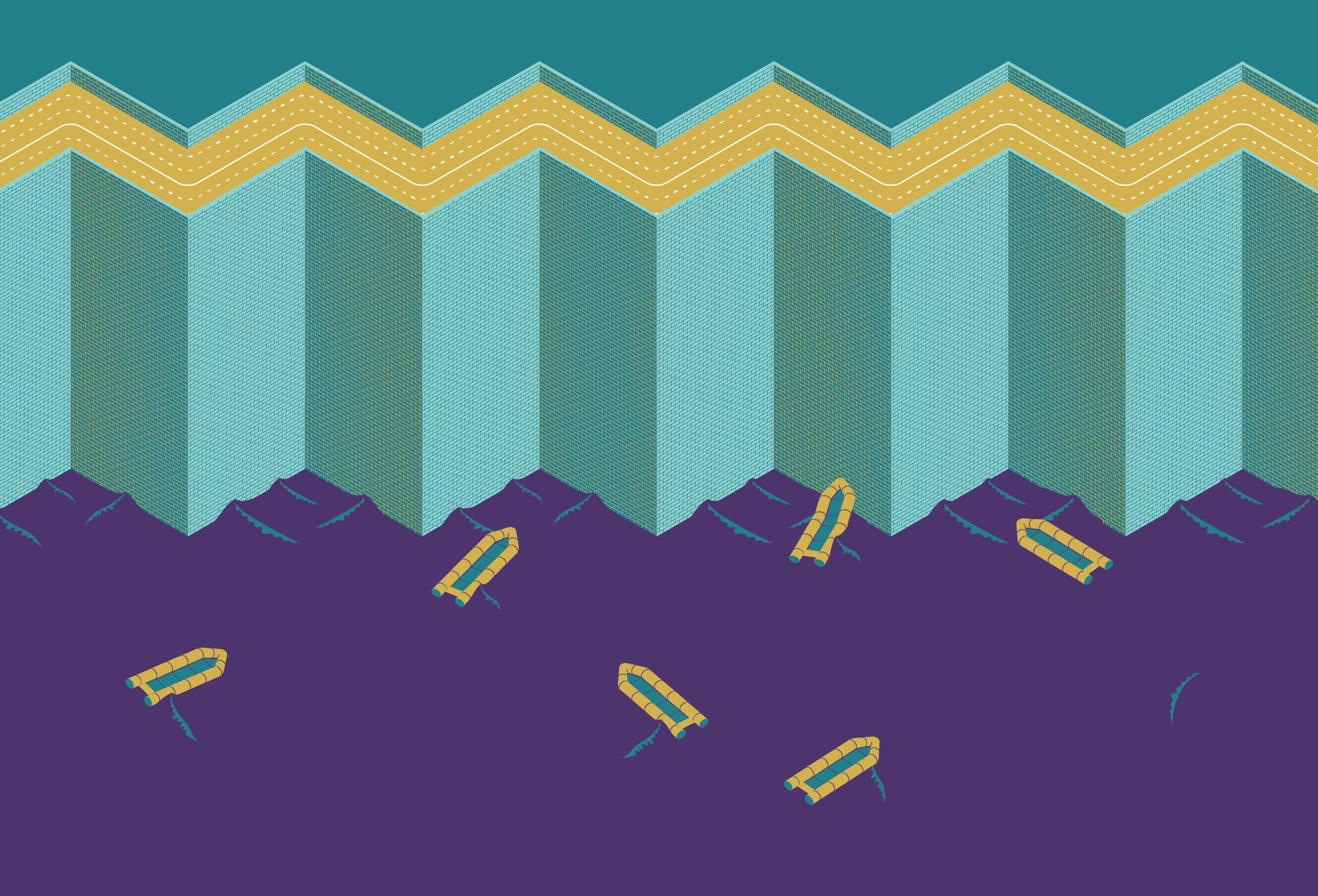
En 2016, face à la crise des réfugiés qui secoue l’Europe et les réactions xénophobes qu’elle suscite parmi de nombreuses couches de la population européenne, le philosophe slovène Slavoj Žižek écrivait qu’il est du devoir de la gauche occidentale de « construire des ponts entre « notre » classe ouvrière et « la leur » [à savoir la classe ouvrière non occidentale], afin qu’elles s’unissent dans une lutte commune et solidaire… Il nous faut mettre en avant un projet positif et universel soutenu par tous les participants et lutter pour sa concrétisation. Nous devons, non seulement respecter les autres, mais aussi leur proposer un combat commun, puisque nous rencontrons tous les mêmes problèmes aujourd’hui »1. Et c’est précisément ce que Reece Jones suggère de faire dans son livre Violent Borders, en formulant des propositions concrètes, concises et clairement motivées.

Dès la première page, Jones indique clairement que la question qui anime son ouvrage est de comprendre pourquoi, partout dans le monde, limiter la circulation des pauvres est une chose qui préoccupe les États au plus haut point. Pour trouver la réponse à cette question, il se base sur une description lucide des pires conséquences découlant des différentes formes de violence exercées aux frontières nationales et autour de celles-ci, au travers d’une analyse critique du tracé historique des frontières et des usages qui en sont faits de nos jours. Il conclut en proposant l’application de quelques principes universels qu’il juge essentiels pour éradiquer la violence aux frontières et arriver à une politique migratoire internationale plus équitable.
Violence aux frontières
« Les frontières sont violentes par nature et engendrent des violences systématiques envers les individus et l’environnement », écrit Jones. Non seulement en raison des violences que les agents de patrouilles frontalières ou les maffias impliquées dans le trafic d’êtres humains infligent directement aux migrants qui tentent de traverser les frontières, mais aussi en raison du rôle central joué par les frontières dans ce que Johan Galtung appelle la « violence structurelle », à savoir une forme de violence infligée aux pauvres en les privant d’accès aux richesses et aux ressources. Partant de cette distinction entre violence directe et violence structurelle, Jones recense cinq différentes manières dont les frontières portent préjudice aux couches les plus vulnérables de la population mondiale, à savoir : les violences ouvertement perpétrées par les gardes-frontières et l’infrastructure frontalière ; le risque élevé pour les migrants démunis d’être blessés ou tués lorsqu’ils sont dirigés vers des postes frontières dangereux ; la menace de violence constante envers ceux qui ne possèdent pas les documents requis ; la violence structurelle liée à l’annexion des ressources et la délimitation des États ; et enfin l’inefficacité des normes environnementales internationales, pourtant absolument indispensables à la protection de toute forme de vie sur notre planète.
Rien qu’au sein de l’Union européenne, 23.700 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser une frontière entre 2004 et 2015.
Le nombre de migrants et de réfugiés morts au cours de ces dernières années en tentant de traverser les frontières illustre éloquemment la première et la seconde formes de violence décrites par Jones. En une dizaine d’années à peine, la violence aux frontières a causé des dizaines de milliers de morts, avec un nombre de victimes estimé à 40.000 entre 2004 et 2015. D’après les calculs de Jones, rien qu’au sein de l’Union européenne, 23.700 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser une frontière au cours de cette même période. Quant à l’année 2016, elle apparaît comme la plus meurtrière avec 5.000 morts2.
Aux États-Unis, les corps sans vie de 6.029 migrants ont été découverts du côté américain de la frontière avec le Mexique entre octobre 1997 et septembre 2014, sachant que « depuis 2000, les dépouilles d’au moins 300 migrants sont récupérées chaque année le long de la frontière »3. Toutefois, ce chiffre n’inclut pas les milliers de personnes qui trouvent la mort sur la route le long de ce qu’on appelle aujourd’hui la « frontière verticale », à savoir la route traversant le Mexique, suivie par les migrants d’Amérique centrale pour rejoindre la frontière nord des États-Unis depuis la frontière sud guatémaltèque. Entre 2007 et 2013, selon Jones, « on estime à 47.000 le nombre de migrants décédés au Mexique ».
En Union européenne comme aux États-Unis, certaines de ces morts sont directement imputables aux gardes-frontières — entre 2010 et 2015, par exemple, les agents de la patrouille frontalière américaine ont abattu et tué trente-trois personnes — certes, parmi les décès recensés, la grande majorité n’est pas directement perpétrée par les agents de sécurité. Quoi qu’il en soit, la forte augmentation du nombre d’agents affectés à la sécurité des frontières au cours de ces dernières années a rendu le passage vers ces pays beaucoup plus périlleux. La fermeture progressive des points de passage les plus aisés, aujourd’hui transformés en zones hautement surveillées suite à l’installation d’une importante infrastructure de sécurité et de surveillance (murs, clôtures, caméras, drones, détecteurs de mouvements, etc.), a poussé les migrants à suivre des itinéraires beaucoup plus périlleux, comme les eaux de la mer Méditerranée, les déserts de l’Arizona ou encore ceux de l’ouest du Texas, où la plupart des migrants vers les États-Unis ont trouvé la mort au cours de ces dernières années.
Préserver la domination du capital transnational implique également d’empêcher les travailleurs de trouver ailleurs de meilleures opportunités.
Les cas de décès de migrants ne se cantonnent pas aux frontières entre les pays riches d’Occident et leurs voisins plus pauvres, ce phénomène s’observe également ailleurs dans le monde. En Israël, par exemple, la répression à l’égard de ceux qui s’insurgent contre la construction de murs et clôtures entre les territoires palestiniens et les colonies et terres israéliennes a déjà coûté la vie à de nombreux protestataires. En Inde, entre 2000 et 2015, les forces de sécurité aux frontières ont abattu plus d’un millier de migrants bangladais qui tentaient de pénétrer sur le territoire indien. À son tour, le Bangladesh a récemment limité l’accès aux réfugiés Rohingyas fuyant le Myanmar voisin. Dans cet État où la population est à 90 % bouddhiste, la minorité musulmane des Rohingyas, non seulement se voit refuser la citoyenneté dans son propre pays, mais est également la cible d’attaques répétées et de déplacements forcés. Au début de l’année 2015, la fermeture de la frontière bangladaise a contraint 25.000 Rohingyas à s’embarquer pour un périple en mer à la recherche d’un endroit plus sûr où vivre. La plupart ont été refoulés aux côtes malaisiennes, indonésiennes et thaïlandaises toutes proches, sans compter les centaines de migrants morts durant la traversée. L’Australie s’est, elle aussi, révélée un lieu mortel où, « selon les chiffres de la base de données sur les décès aux frontières, le nombre de migrants morts en tentant de rejoindre l’île Christmas en Australie depuis le Timor s’élève à 1974 entre janvier 2000 et novembre 2015 ».
Tous ces chiffres donnent une idée de la dimension planétaire que revêt le problème de violence aux frontières, un phénomène qui ne se limite donc pas à quelques riches États du Nord. Derrière ces chiffres abstraits et ces données statistiques se cachent de véritables drames vécus par des personnes fuyant la guerre, la persécution, ou la pauvreté dans leur pays d’origine. Dans le cadre des recherches effectuées pour son livre, Jones a visité certains des postes frontières les plus sensibles. Il a ainsi personnellement fait l’expérience des conditions dans lesquelles vivent les migrants en transit et ceux qui campent aux abords d’une frontière dans l’espoir de pouvoir la traverser un jour. Ainsi, loin d’être une simple compilation de chiffres et de données anonymes, le livre de Jones propose un riche recueil de récits véridiques — généralement racontés par les protagonistes eux-mêmes ou des témoins oculaires — et dresse un compte-rendu précieux des risques auxquels les migrants sont confrontés et des conditions de vie pénibles existant le long des murs et des clôtures.
Dans la ville marocaine de Tanger, l’auteur a été témoin de la tentative de sept jeunes Marocains de rejoindre l’Europe en s’agrippant à un bus et en se cachant dans le compartiment moteur. À Nador, Jones s’est entretenu avec un migrant ghanéen, contraint de demander la charité pour survivre, en attendant de pouvoir embarquer avec sa famille à bord d’un bateau et rejoindre l’Espagne par le détroit de Gibraltar, après trois tentatives infructueuses. Quelques mois plus tôt, cet homme et sa famille avaient échappé aux raids lancés par les autorités marocaines sur les camps de migrants du mont Gourougou en Afrique subsaharienne, raids au cours desquels des centaines de migrants ont été arrêtés en vue d’être déportés.
À El Paso, au Texas, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Jones a rencontré un témoin du meurtre de Sergio Hernández Guereca tué en 2010 à l’âge de 15 ans par un agent de la patrouille frontalière. Le jeune garçon s’était mis à lancer des pierres aux agents après que ceux-ci aient arrêté son ami qui avait traversé le fleuve Rio Grande pour entrer aux États-Unis. Jones a également interviewé un agent de relations publiques de la patrouille frontalière qui lui a expliqué, comme pour s’excuser, que « les rochers sont une arme mortelle ».
En Palestine, Jones s’est entretenu avec la famille d’Abu Rahma à Bil’in, un village situé à quelques centaines de mètres de la barrière israélienne. Deux de ses enfants ont été tués près de la barrière frontalière et deux autres ont été arrêtés par les Forces de défense israéliennes. Ce qui est reproché à la famille c’est sa participation aux protestations organisées contre la construction de la barrière frontalière qui sépare le village des champs qui étaient leur gagne-pain. Quelques mois après sa visite à Bil’in, Jones a appris l’arrestation d’un autre fils d’Abu Rahma et le décès d’une de ses filles, tuée par une bonbonne de gaz lacrymogène pendant les manifestations.
Inutile de dire que ces formes de violence se sont poursuivies après la publication du livre de Jones en 2016. Pire encore, la situation s’est aggravée avec le Brexit, l’élection présidentielle de Trump aux États-Unis et l’influence croissante du discours xénophobe dans les politiques européennes. Au moment où j’écris ces lignes, fin février 2017, le quotidien barcelonais La Vanguardia titre en première page : « Les États-Unis prévoient d’embaucher 15.000 agents supplémentaires pour procéder à des expulsions de masse.»4 Le système punitif que Trump souhaite renforcer est pour ainsi dire déjà pratiquement mis en place : « avant 1986, il y avait au maximum 20.000 expulsions par an ; au milieu des années 2000, ce chiffre est passé à 400.000 par an ». Cette tendance s’est accélérée sous Obama : « [sa] présidence a connu un nombre d’expulsions supérieur par rapport à toutes les administrations précédentes ». L’expulsion n’est qu’un exemple de forme de violence — même s’il s’agit du pire — que Jones classe en troisième catégorie, à savoir la menace constante qui pèse sur tous ceux qui ne sont pas en possession de papiers d’identité adéquats.
Violence par frontières
Au-delà de ces violences directes et indirectes, ce qui est particulièrement frappant c’est que les frontières nationales créent des discontinuités économiques et juridictionnelles extrêmes entre les pays et stimulent la circulation transfrontalière des marchandises, des drogues, des armes, des emplois, des fonds et des personnes. Dans cette optique, les frontières — et le système mondial d’États-nations qu’elles contribuent à déterminer — s’avèrent cruciales pour les différentes formes d’impérialisme modernes.
À une époque où l’on estime de manière générale que les États-nations sont en train de perdre du terrain sur le plan géopolitique au profit des institutions supranationales — comme l’Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — Jones estime, lui, que les actuelles politiques frontalières révèlent au contraire un renforcement de l’autorité des États. Voyons ensemble ce qu’il en est.
Si d’une part il est vrai que l’OMC et les accords de libre-échange multilatéraux qui se sont multipliés au cours des dernières décennies ont favorisé la dérégulation des flux transnationaux de capitaux et de marchandises, imposant à de nombreux pays un régime mondialisé de libre concurrence relative entre les sociétés multinationales géantes ; d’un autre côté, ces mêmes institutions supranationales ont généralement maintenu, voire renforcé, les réglementations nationales en matière de taxes, salaires, normes industrielles et autres qui, en fin de compte, sont responsables des discontinuités juridiques entre pays, des discontinuités dont profitent les grandes entreprises pour maximiser leurs profits.
Ces sociétés profitent notamment des divergences au niveau des réglementations en matière de travail et de protection de l’environnement qui, associées à la suppression des tarifs douaniers et autres restrictions au commerce international et investissements, leur permettent de fabriquer des biens ou de fournir des services dans des États où les salaires sont inférieurs et où les réglementations sont moins nombreuses que dans les pays consommateurs où leurs produits et services sont finalement vendus. Ce mécanisme mondial, qui permet aux sociétés d’accroître leurs profits en réduisant les coûts salariaux et les coûts liés à la réglementation, est l’outil le plus utilisé pour contrôler les flux transfrontaliers de capitaux, marchandises et services.
Maintenir ce mécanisme en place implique de faire en sorte que la main-d’œuvre bon marché reste là où elle est, et c’est précisément ce que font les frontières. Ainsi, les accords commerciaux, en ne touchant pas aux normes de travail, offrent à chaque État la liberté d’édicter et de faire respecter (ou non) ses propres réglementations. Si ce n’était pas le cas, l’Association des Fabricants et Exportateurs de Textile du Bangladesh, par exemple, ne pourrait pas présenter sur son site web « les nombreux travailleurs à bas salaire » du pays comme un des principaux attraits pour les sociétés étrangères. En décembre 2013, après l’effondrement de l’usine textile Rana Plaza, le salaire minimum au Bangladesh est passé de 39 $ par mois (un des plus bas du monde) à 68 $. Or, les salaires extrêmement faibles ne sont pas le pire problème auquel les travailleurs sont confrontés. Comme l’a déclaré Human Rights Watch en 2015, « ce que veulent les propriétaires d’usine, c’est maximiser leurs profits ; pour cela, ils économisent sur la sécurité, l’hygiène et les systèmes de ventilation. Ils refusent de payer les heures supplémentaires ou d’apporter une aide en cas d’accident. Ils ne font pas construire d’issues de secours ou ne prévoient pas d’extincteurs. La plupart d’entre eux traitent leurs employés comme des esclaves ».
Préserver la domination du capital transnational implique également d’empêcher les travailleurs de trouver ailleurs de meilleures opportunités, autrement dit, de ne pas leur permettre de migrer vers d’autres pays pour y trouver de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. C’est donc ici qu’entrent en jeu les politiques en matière de migration et de contrôle des frontières. Même si la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés garantit certaines protections fondamentales aux personnes qui fuient leur pays d’origine parce qu’elles « craignent avec raison d’être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques », cette convention ne dit rien sur les personnes qui fuient les violences structurelles liées au fait « de vivre dans un bidonville sale, bondé, ravagé par la maladie et dangereux, où la seule option est de travailler de longues heures dans un atelier clandestin pour un salaire de misère ». Les déplacements de ces « migrants économiques » sont considérés comme « volontaires » et sont, en tant que tels, soumis à des exigences légales strictes qui, souvent, forcent ces migrants à faire un choix entre rentrer chez eux ou vivre en « illégaux » exposés à un risque d’expulsion constant, voire pire.
Jones nous aide à comprendre le rôle des États-nations modernes en tant qu’extension du cloisonnage capitaliste des terres communes dès le dix-septième siècle.
La multiplicité de lois environnementales dans les différents pays constitue également une discontinuité importante. Les États où les restrictions en matière de pollution, consommation d’énergie, émissions carbones, etc. sont les moins nombreuses et les plus laxistes offrent naturellement des sites de production meilleur marché que ceux où les normes en matière de respect de l’environnement sont plus strictes. Quoi qu’il en soit, l’impact des contrôles nationaux va bien au-delà des variations des coûts de production liées aux externalités environnementales négatives. Comme le souligne pertinemment Jones : aaaa
« Tout comme les frontières sont utilisées pour limiter la circulation des personnes défavorisées en créant des réserves de main-d’œuvre exploitable, elles sont aussi utilisées pour contrôler l’environnement en créant des réserves de ressources exploitables, avec des normes en matière d’extraction et d’accès différentes en fonction des territoires. Ces clôtures vont permettre à certains d’utiliser les ressources de la terre tout en limitant leur accès et utilisation au plus grand nombre. La division de la terre en juridictions politiques distinctes implique que la portée du processus décisionnel (l’État) ne correspond pas à l’échelle du système (le monde), ce qui peut entraîner une surexploitation et rendre plus complexe la résolution des problèmes qui dépassent les frontières ».
Jones nous aide donc de manière très originale à mieux comprendre les tensions existant entre la mondialisation économique et le système d’État-nation : le rôle des États-nations modernes en tant qu’extension du cloisonnage capitaliste des terres communes.
Haies et cartes
Selon Jones, le cloisonnage des terres communes mis en place en Angleterre et ailleurs dès le dix-septième siècle, n’est qu’une première étape vers un nouveau système d’exploitation des ressources basé sur une limitation de l’accès aux terres et autres ressources naturelles. La mise en place de ces clôtures, qui empêchent les paysans d’accéder aux terres communes et qui jettent les bases du régime capitaliste moderne, est pratiquement immédiatement suivie du traçage des frontières nationales et de leur mise en œuvre sur le plan juridique5.
Les traités comme ceux de Westphalie (1648) innovent en instaurant un système « d’États souverains modernes qui revendiquent une autorité absolue sur toutes les terres, les ressources et les personnes se trouvant à l’intérieur d’un territoire délimité par des frontières tracées sur une carte. Tout comme les nouvelles techniques vont permettre de cartographier les domaines des seigneurs et de les repenser en tant qu’espaces délimités, la cartographie va transformer la manière dont les États vont concevoir leurs terres et contrôler leurs royaumes ». Le colonialisme européen a étendu ce système d’États souverains au reste du monde et mis en place des frontières nationales qui sont pratiquement restées intactes durant l’ère postcoloniale.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), rédigée en 1982 et appliquée pour la première fois en 1994, après avoir été ratifiée par soixante États membres des Nations Unies, marque la dernière étape de ce long processus de cloisonnage des ressources. La CNUDM va, non seulement entraîner l’extension « des eaux territoriales » le long des côtes nationales qui passent de trois à douze miles nautiques, mais elle va également conduire à la création de ce qu’on appelle les zones économiques exclusives, qui s’étendent sur douze à deux cents miles nautiques au large des côtes, et où les États côtiers disposent d’un contrôle absolu sur toutes les ressources marines, en ce compris pêche, minéraux et combustibles fossiles. Tout cela va permettre l’expansion d’un système politique et économique mondial qui « cherche à préserver les privilèges et les opportunités de quelques-uns en limitant l’accès aux ressources et la circulation des autres ».
Migration, travail et environnement
On pourrait résumer la description que donne Jones de ce système mondial de contrôle territorial en ces termes : le récent renforcement des frontières a joué un rôle fondamental dans la « course vers le bas » mondiale, avec des multinationales qui produisent dans les endroits les moins chers possible en profitant des divergences au niveau des réglementations nationales en matière de travail et de protection de l’environnement. Plutôt que de fonctionner comme des institutions de gouvernance mondiale, les organisations internationales existantes protègent au contraire les États et leurs pouvoirs en accordant à chacun « le droit souverain d’exploiter ses propres ressources conformément aux politiques mises en place en matière d’environnement et de développement »6. À une époque où la nécessité d’un système mondial de contrôle territorial et des ressources se fait plus que jamais sentir, la structure de la politique globale rend pratiquement impossible de surmonter les barrières nationales à la gouvernance mondiale.
La plupart des gens préfèrent rester à un endroit où ils se sentent à l’aise culturellement.
Pendant ce temps, sur le plan idéologique, on assiste à une recrudescence du racisme, du nationalisme et du nativisme dans de nombreux États occidentaux prospères, entravant les efforts déployés pour s’attaquer aux causes profondes de la migration et des déplacements et favorisant les politiques protectionnistes destinées à maintenir ou à renforcer les disparités existantes entre États. Ou pour reprendre les termes de Jones : « la distinction entre extérieur et intérieur, entre natif et étranger est omniprésente dans le discours politique de nombreux pays dans le monde puisque cela fait partie intégrante de la fondation d’un État en tant qu’institution. La conception territoriale de l’humanité joue un rôle prépondérant dans le discours public contemporain de nombreux pays, où les migrants sont présentés comme constituant une menace pour le système économique, culturel et politique du pays ».
Que faire ? Jones propose les trois principes de base suivants : libre circulation des personnes entre États, normes internationales en matière de conditions de travail et réglementations internationales en matière de protection de l’environnement et restriction à la propriété privée. Une réduction des obstacles à la libre circulation aura pour effet immédiat de diminuer considérablement le nombre de morts aux frontières. Cela permettra en outre de réduire les énormes inégalités salariales entre pays/régions riches et pays/régions pauvres. À ceux qui craignent que ces changements ne génèrent un flux de migrants envahissant un petit nombre de pays riches, Jones fait remarquer que l’adhésion des pays d’Europe de l’Est à l’Union européenne a, à l’époque, soulevé des préoccupations similaires. Au fait, dit-il, rien de tout cela ne s’est réellement produit : après tout, « la plupart des gens préfèrent rester à un endroit où ils se sentent à l’aise culturellement », pour autant qu’ils puissent s’en sortir et gagner leur vie.
Face à ces disparités profondes entre États, traverser les frontières devient une manière de repolitiser la notion même d’États, de frontières et de nations.
Dans sa proposition de normes internationales en matière de travail, Jones souligne que « la plupart des acquis obtenus par les travailleurs aux États-Unis et en Europe au milieu du vingtième siècle sont aujourd’hui menacés en raison de l’absence de protection des travailleurs dans les autres régions du monde ». Plutôt que de renforcer les différences entre États en favorisant un système mondial d’États isolés, comme sont en train de le faire certaines organisations nationalistes xénophobes en Europe, les travailleurs du monde entier devraient plutôt s’unir dans une lutte commune pour « l’instauration d’un salaire minimum mondial, des normes internationales en matière de conditions de travail [et] des réseaux internationaux de sécurité sociale pour les plus démunis ». C’est aussi la « lutte commune » que propose Žižek, le « projet universel positif soutenu par tous les participants » qu’il faut mettre en avant.
La troisième proposition de Jones concernant des réglementations internationales contre la dégradation de l’environnement et le réchauffement climatique nous rappelle fort opportunément que le futur de l’humanité est compromis. Laisser les mesures de protection de l’environnement aux mains d’États territoriaux — qui se servent de ces réglementations comme instruments pour attirer les investissements étrangers — est tout bonnement irresponsable. À ce stade également, il est urgent et il importe de faire correspondre la portée de la prise de décision à l’ampleur du problème : « Il serait peut-être intéressant de créer une nouvelle infrastructure institutionnelle qui s’occuperait exclusivement des besoins environnementaux et qui serait habilitée à outrepasser la souveraineté des États pour les matières qui touchent à l’environnement mondial ». Il faut contrer, non seulement les effets nocifs du système étatique mondial sur l’environnement, mais aussi les conséquences néfastes du droit que possèdent les propriétaires fonciers privés d’exploiter leurs biens sans limites. Une mise à jour du concept de propriété est également nécessaire, une mise à jour qui donnerait la priorité aux biens collectifs et non aux intérêts privés.
Face à ces disparités profondes entre États, traverser les frontières devient une manière de repolitiser la notion même d’États, de frontières et de nations — des concepts qui, durant des siècles, ont été tenus pour acquis et exclus du débat. La décision prise par les migrants de traverser les frontières défie donc « les programmes nationaux d’exclusion, de contrôle et de violence », écrit Jones : « Ils le font simplement en circulant ».
L’article a été publié précédemment dans Monthly Review, Vol. 69, Issue 07, December 2017 avec comme titre Movement as a political Act.
Footnotes
- Slavoj Žižek, Against the Double Blackmail (London : Allen Lane, 2016). Les extraits sont des traductions de la version espagnole, La Nueva Lucha de Clases, Barcelone, Editorial Anagrama, 2016, 74, 115.
- Operational Data Portal : Mediterranean Situation, Haut-Commissariat des Nations-unies pour les réfugiés, visité le 31 octobre 2017.
- Tara Brian and Frank Laczko (eds.), Fatal Journeys : Tracking Lives Lost during Migration (Genève : Organisation internationale pour les migrations, 2014), 54.
- La Vanguardia, 22 février 2017.
- Ellen Meiksins Wood, « The Agrarian Origins of Capitalism », Monthly Review 50, n° 3, 1998, 13–31.
- Rapport de la Conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le développement, Annexe I : Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 1992.