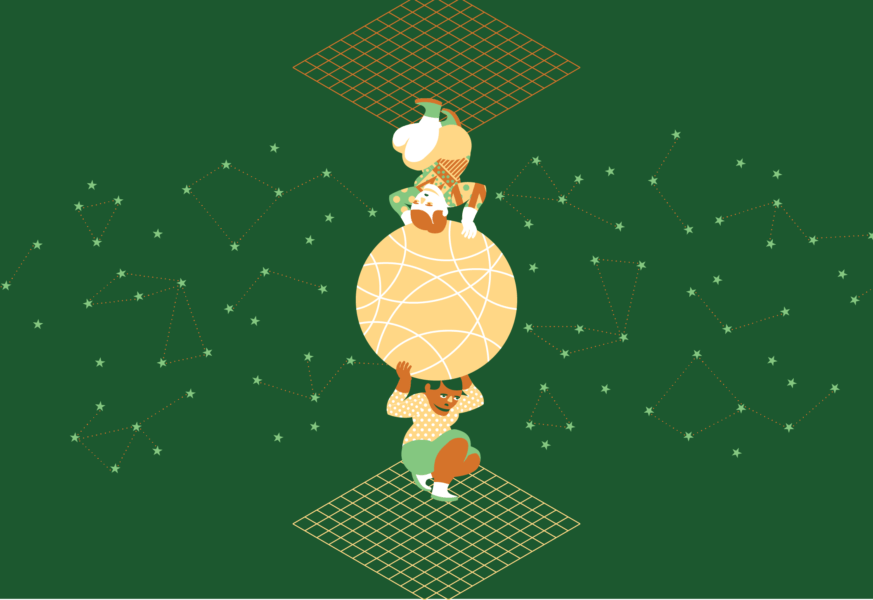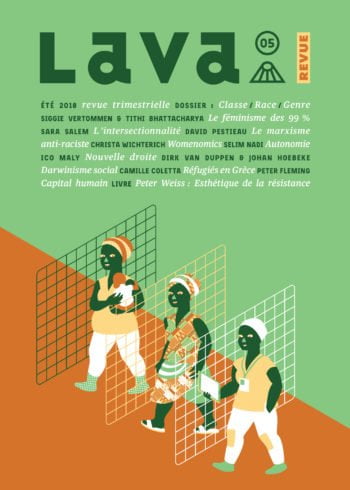C’est une fresque monumentale que Peter Weiss (1916-82) a réalisée avec son Esthétique de la Résistance, aujourd’hui rééditée par Klincksieck. La lutte antifasciste, ici, là, alors et maintenant.
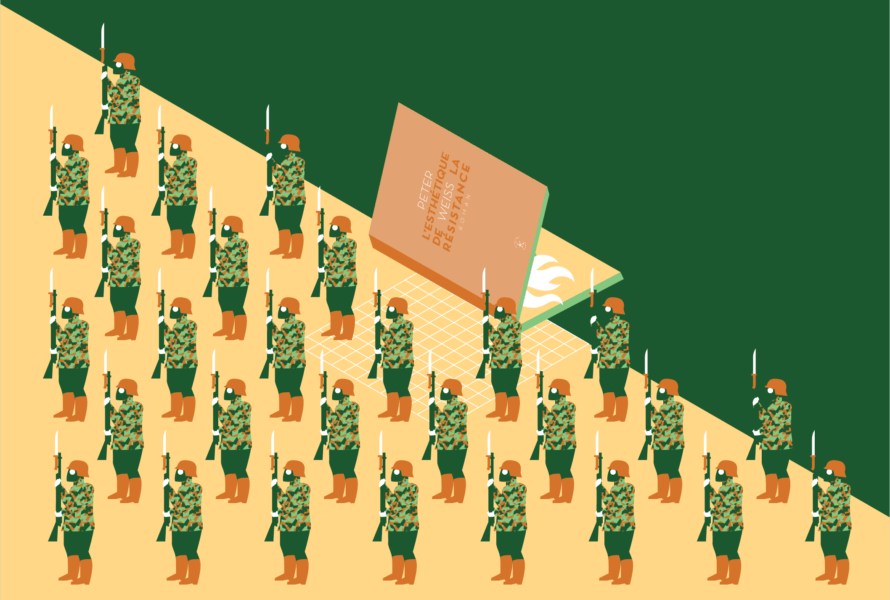
Peter Weiss, personnalité allemande ou suédoise1 ? Un peu des deux. Cinéaste, peintre, dramaturge, essayiste ou écrivain ? Il s’est essayé à tout mais c’est en qualité d’homme de plume, arrivé à la cinquantaine, qu’une reconnaissance internationale tardive le rendra célèbre : Prix du mouvement ouvrier suédois en 1965, prix Heinrich Mann (Allemagne de l’Est) l’année suivante. Né en 1916 pas loin de Berlin, d’un père tchèque, juif, industriel, et d’une mère suisse, actrice célébrée, dont les deux fils, d’un premier mariage, devenus nazis fervents, lui reprocheront de ne pas être de « race pure ». Ce sont des choses qui marquent. Son œuvre maîtresse, saluée comme un des grands romans du XXe siècle, l’Esthétique de la résistance, rédigé entre 1970 et 1980 au soir de sa vie (il meurt en 1982), est un monument dressé à celles et ceux qui ont combattu l’infâme, en Espagne d’abord, à l’intérieur du Troisième Reich ensuite et, enfin, en Suède dont la « neutralité » fut pour le moins ambiguë. C’est de ce livre inclassable, hommage d’un écrivain engagé réputé pour le combat antifasciste et anti-impérialiste ainsi qu’à ses frères et sœurs tombés dans l’oubli de la guerre froide, dont il est question.
Par quel bout le prendre, ce labyrinthe littéraire de 889 pages ? On a l’embarras du choix. On peut choisir Brecht, par exemple. Brecht en avril 1940, dans la maison qu’il occupait dans la banlieue cossue de Stockholm. Peter y a dépeint, à la manière d’un catalogue, les livres dont Brecht ne voulait pas se séparer. Ce sont les métamorphoses d’Ovide dans une édition de 1791. Les deux bouquins usés d’Homère édités chez Cotta. Le Tristam Shandy de Sterne et l’Ulysse de Joyce. l’Histoire de la Commune de Lissagaray. Le Contrat social de Rousseau et des éditions bon marché de Descartes, Kant et Taine. Ajouter Kafka, Baudelaire. Kraus. Darwin. Freud. Hegel. Et une caisse de livres sur César et son époque. De même que l’encyclopédie Britannica (2 caisses). Puis Grimmelshausen, Cervantès, Croce, Machiavel, Marlowe, Shakespeare, Goethe et Schiller. Sa collection de la revue Die Neue Zeit de 1883 à 1913. Et sans oublier les romans policiers, Doyle, Chandler, Carr, Sayers, Wallace, Christie… Ce n’est là qu’un échantillon. Chez Peter Weiss, l’énumération scrupuleuse, commentée, rendue palpable par la présence de policiers suédois qui surveillent le déménagement du sulfureux personnage, occupe près de sept pages.
Brecht en tant que tel, ce n’est pas loin de 200 pages. Il est resté un an en Suède, venant du Danemark, allant vers les États-Unis, fuyard comme tant d’autres depuis qu’Hitler a transformé l’Allemagne en un grand camp de concentration, irrespirable et meurtrier, dans l’indifférence tacite, complice des pays voisins. Des fuyards, tragiquement malchanceux parfois, comme Walter Benjamin, il y en avait beaucoup, mais aussi des résistants antinazis agissant dans la clandestinité, au sort tragique pour la plupart, eux aussi. En effet, dès les premiers mois du règne hitlérien, en 1933, les arrestations frapperont quelque 20.000 personnes, elles atteindront autour d’un million durant les six années suivantes. En 1936, une opération coup de poing de la Gestapo conduira à l’arrestation de quelque 12.000 résistants communistes. Environ 30.000 fuiront en France et y seront massivement internés dès la déclaration de guerre en 1939. Les tribunaux d’exception allemands – dont aucun des magistrats ne sera inquiété après la guerre – auront prononcé dans l’entre-temps quelque 50.000 condamnations à mort2. C’est à eux que Peter Weiss élève une stèle qui prend la forme d’une épopée. C’est si loin, tout cela.
Hier maintenant
Brecht aussi paraît loin, de même que la Suède : que vient-elle faire dans un roman sur la machine à broyer nazie ? d’autant que la très longue section que Peter Weiss consacre à l’escale suédoise de Brecht (avril 1939 à avril 1940) a principalement trait à une grande figure de la résistance locale, Engelbrekt Engelbrektsson, qui mena en Suède, au XVe siècle, une guerre des gueux de libération nationale contre le 1 % parasitaire de l’époque, châtelains, clergé et leurs mercenaires en armes, pour finir traitreusement assassiné le 4 mai 1436. De ce symbole de la lutte antifasciste, Brecht pensait faire une pièce et il y a beaucoup travaillé durant son séjour, aidé par toute une équipe d’exilés communistes allemands, dont le narrateur du livre. Si Brecht n’en fera finalement rien, Weiss, par contre, conte les moments saillants de la trajectoire d’Engelbrekt avec les leçons politiques qu’on peut en tirer dans la lutte antinazie. Chez Weiss, c’est une constante, le passé vit dans le présent. Engelbrekt est contemporain de Jean Moulin, pour prendre une figure connue de la résistance française. Tellement contemporain que le récit de Weiss, bien souvent, glisse sans transition d’un moment historique à l’autre et, par exemple, des effets du pacte germano-soviétique sur le moral des combattants communistes clandestins au … 13 janvier 1435 lorsque les notables suédois s’assemblent à Arboga à huis clos, faisant alliance pour déterminer la marche à suivre.
Ce va-et-vient débute dès les premières pages du livre qui s’ouvre sur la frise du grand autel de Pergame, chef-d’œuvre de sculpture grecque antique qui fut élevée à l’époque hellénistique puis, au XIXe siècle, transporté et reconstitué dans un musée à Berlin. Weiss place alors le lecteur dans le musée en 1937 mais, en même temps, au XXe siècle avant notre ère, dans les splendeurs de la sculpture. On y accompagne alors trois jeunes gens, Hans Coppi, Horst Heilmann et le narrateur, le témoin sans nom – alter ego collectif de Peter Weiss – qui ira bientôt rejoindre les brigades internationales en Espagne. Mais là, sur près de huit pages, c’est la frise qui est le « personnage » central. Ce n’est plus Engelbrekt, c’est Héraclès qui fait figure de prototype révolutionnaire. Le rôle de l’art dans la prise de conscience politique, son retournement, son expropriation, pour libérer la culture de l’emprise asphyxiante de la bourgeoisie, sont dès lors des thèmes récurrents dans la vie et l’œuvre de Peter Weiss.
Posthume a posteriori
Revenons cependant sur l’objet du livre. À défaut de résumé, quelques fusées éclairantes. l’action ? Elle se déroule principalement à Berlin, dans la République espagnole agonisante, à Paris et à Stockholm. l’unité de temps ? Marquée par le triomphe de la droite pure et dure, Franco et Hitler, 1933-1945 – telle que vécue et héroïquement combattue par l’armée de l’ombre, celle que les nazis baptiseront d’Orchestre rouge : pour leur donner un visage, Weiss suit pas à pas certains d’entre eux, dont les onze combattants clandestins qui, arrêtés grâce notamment au décryptage d’un message radio soviétique en novembre 1942, seront peu après soit guillotinés (les trois femmes du groupe), soit pendus (les huit hommes) à la prison de Plötzensee à Berlin.
Ce sont presque tous des personnages historiques : leurs photos et biographies sont sur Wikipédia. Passer par ce détour-là en vaut la peine. On s’apercevra alors que la plupart se verront attribuer des plaques commémoratives, voire des rues à leur nom mais ce ne sera, au bas mot, que quelque vingt ans après la victoire des Alliés. Le centre à la mémoire de la résistance allemande à Berlin (Gedänkstätte Deutcher Wiederstand, dont le site fourmille de courtes biographies) n’a été institué par le Sénat allemand qu’en 1967. La « dénazification », on ne s’y est guère précipité, comme on le sait3 Parmi les réfugiés allemands dans l’entourage du narrateur en Suède, il y a Rosalinde, fille du pacifiste Carl von Ossietsky que le Prix Nobel de la Paix en 1936 ne sauvera pas d’une condamnation pour trahison et d’un internement dans un camp, où il mourra en 1938, peut-être assassiné sur ordre de Goering, faute de soins adéquats. En 1991 et 1992, en dépit d’une campagne internationale pour sa réhabilitation promue par sa fille, cette demande sera rejetée par deux fois, d’abord par le tribunal de Berlin, ensuite par la cour suprême du pays. Commentaire désabusé de l’avocat de Rosalinde : « Pour les juges de la Cour, le Troisième Reich, la Seconde Guerre mondiale et ses 50 millions de morts n’ont jamais eu lieu. » On est porté à le croire : un des juges de la Cour avait, quelques années auparavant, acquitté un magistrat pour sa participation aux tribunaux nazis. Rosalinde, c’est un peu comme Charlotte Bischoff. La première, née en 1919, vivra jusqu’à l’an 2000. La seconde, née en 1901, décédée en 1994, mérite le terme de miraculée. Du groupe autour de Hans Coppi et Horst Heilmann, – qu’elle rejoindra en 1941 clandestinement par mer, déguisée en mousse – elle sera à Berlin la seule rescapée, poursuivant jusqu’au bout son périlleux travail d’agent de liaison avec l’Union soviétique tout en accumulant les notes sur ses camarades tombés, afin que nul n’oublie. Pourtant, comme note Weiss dans ses dernières pages, alors que Berlin se voit réduite en cendres autour d’elle, elle est saisie d’un doute : le nombre des partisans « avait fondu de plus en plus, de ces milliers, de ces centaines, de ces quelques dizaines finalement, seuls quelques-uns restaient encore. Qu’adviendrait-il du pays qu’on avait privé de presque tous ceux qui auraient pu lui donner un visage nouveau ? »
Réfugiés welcome
Charlotte, en même temps, jette une lumière assez crue sur la question, à nouveau actuelle, de l’accueil des réfugiés. Lorsqu’on fait sa connaissance dans le roman, elle est en Suède, en état d’arrestation. On est en 1939 et elle est sous le coup d’un ordre d’expulsion, direction l’Allemagne. Pour en atténuer la froide rigueur administrative, on ose à peine dire l’humaniser, on lui autorise une journée d’excursion à Stockholm sous bonne escorte, accompagnée de sa gardienne de prison. C’est une page d’anthologie. La gardienne, cette brave dame qui ne ferait pas de mal à une mouche en temps ordinaire, accomplit son devoir de tortionnaire déléguée avec la bonne conscience des citoyens respectueux des lois, quelles qu’elles soient. Ces braves gens-là, qu’on croise tous les jours, aimables voisins de palier et sympathiques petits commerçants, sourire aux lèvres, avec toujours un bon mot sur la pluie et le beau temps, ce sont ceux-là mêmes qui, un ordre nouveau s’installant, veilleront à la bonne marche des « trains spéciaux ».
Pas en Suède, aurait-on pu croire. Pays neutre, gouverné par une coalition associant les sociaux-démocrates. Eh bien, si. Des Juifs seront refoulés en nombre (s’ils ne sont pas riches). Le ministre social-démocrate Rickard Sandler ira jusqu’à dire qu’admettre les réfugiés d’origine juive « pourrait avoir une influence négative sur l’opinion publique du pays ». Des communistes aussi, bien sûr. En 1939, une révision de la loi sur les étrangers laissera toute latitude aux services de police, qui collaboraient souvent étroitement avec leurs collègues allemands. À la même époque, le ministre des Affaires sociales Gustav Möller, social-démocrate comme son secrétaire d’État Tage Erlander (plus tard Premier ministre d’une extraordinaire longévité, 1946-1969), seront à la base d’une liste noire de 80.000 personnes qui devaient être « observées, prises en chasse et arrêtées ». Certes, rappelle Weiss, la Suède ne faisait pas cavalier seul : à la Conférence d’Évian, en juin 1938, le « Comité des puissances occidentales, convoqué pour régler le problème de l’émigration, se souciait surtout de limiter le plus possible ou d’empêcher l’immigration dans les territoires nationaux respectifs. » Une procédure de Dublin avant la lettre … Charlotte Bischoff aura plus de chances que d’autres, elle sera libérée sous condition peu avant la date d’expulsion. Elle pourra remplir son devoir de mémoire et, par la même occasion, celui de Peter Weiss, auquel elle apportera une aide épistolaire précieuse lorsqu’il entamera, en 1971, sa grande œuvre.
Enigma
D’aucuns ont jugé qu’il n’a fait que remuer de vieilles histoires qui n’intéressent plus grand monde. Il est vrai qu’il y a mis le temps. En 1971, il a 55 ans et, déjà derrière lui, un riche tableau de chasse, comme dramaturge (Marat-Sade, 1964), cinéaste expérimental, peintre, romancier (Point de fuite, 1962), essayiste et polémiste engagé (Tribunal Russell sur les crimes des États-Unis au Vietnam, 1967). Son itinéraire terrestre épouse en partie celui du narrateur anonyme de l’Esthétique. Fuite de l’Allemagne en 1935 avec ses parents, qu’il rejoindra en 1939 en Suède, ayant fait le mauvais choix de s’établir à Prague où la Wehrmacht entreprend d’élargir l’espace vital hitlérien : le périple de sa traversée de l’Allemagne sera raconté par le truchement de sa mère qui ne s’en relèvera pas. Trop d’horreurs vues. En Suède, au contraire du narrateur, ce seront les premiers pas de l’artiste, puis de l’homme de plume. Le camp d’Auschwitz, il n’ira le voir qu’en 1964. Est-ce l’éveil du Vietnam qui l’y a poussé ? On ne peut que constater, encore une fois, que l’histoire nazie de l’Europe est restée assez longtemps relativement occultée.
La publication de l’ordre du jour d’Eric Vuillard, prix Goncourt et une des meilleures ventes de la rentrée 2017, est une sorte de signe. Quoi ? Plus de 70 ans après les « faits » ! On ne peut évidemment que se réjouir de savoir un large public informé par Vuillard, dans le détail, comme si on y était, de la réunion au cours de laquelle, le 20 février 1933, Goering et Hitler ont demandé et obtenu, de la crème industrielle allemande, l’appui financier leur permettant de gagner les élections et, ce, avec l’assurance que, grâce à l’ordre nouveau, demain, il n’y aura plus d’élections, plus de syndicats, plus rien n’entravant le « climat d’entreprise ». Peter Weiss en donne une bonne représentation. Krupp, Thyssen, Wolff, IG Farben fondent sur l’Espagne dès la victoire de Franco (houillères, mines de plomb et d’argent, usines d’armement). Idem ensuite en Autriche, la Dresdner Bank et la Deutsche Bank se partageant fabrique de munitions et association des banques viennoises. Idem encore en Tchécoslovaquie : usines chimiques et métallurgiques d’Aussig, charbon de Brüx, usine d’aviation de Prague, les usines Skoda de Pilsen, etc. Cadeaux ! Retours d’ascenseurs ! Dans le texte, Vuillard lâche : la dynastie Krupp fournira « l’un des hommes les plus puissants du Marché commun, le roi du charbon et de l’acier, le pilier de la paix européenne ». La dénazification, ce n’est pas qu’en Allemagne que cela s’est grippé.
Mais, pour y revenir, 1971 pour l’un, 2017 pour l’autre, l’énigme du surgissement hitlérien, adhésion populaire incluse, paraît singulièrement affligé d’un méchant décalage horaire. Parce que, malgré les années, malgré le recul, l’énigme resterait entière ? Dans un texte de présentation de son livre La zone d’intérêt paru dans le Financial Times, le romancier britannique Martin Amis invoque Primo Levi pour éluder l’analyse de l’inexplicable. Comprendre équivaudrait à justifier, dit-il. C’est une pirouette. On touche le problème d’un peu plus près dans la monumentale biographie d’Albert Speer (bras droit d’Hitler) de Gitta Sereny. Obsédée par le désir de lui faire avouer qu’il aurait su, qu’il aurait été au courant de la politique génocidaire nazie, elle glisse sur tout le reste : guerre d’agression, asphyxie et crétinisation d’un peuple entier, élimination physique de toute opposition – tout en signalant, comme pour s’en excuser, au détour d’une phrase que, « à tort ou à raison, c’est le génocide des Juifs qui a dominé, non seulement la vision mondiale du nazisme après la chute du Troisième Reich, mais également dans la conscience des Allemands. » C’est resté vrai jusqu’à nos manuels scolaires aujourd’hui. Tout ramener au génocide des seuls Juifs est évidemment une simplification commode, surtout après la création de l’État d’Israël en 1948. Donc, on oublie. On oublie que, aux élections de 1933 qui vont porter Hitler au pouvoir, les communistes du KPD recueillaient encore près de cinq millions de voix et les sociaux-démocrates plus de dix-sept millions. On oublie aussi allègrement qu’une grande partie des Allemands deviendront des nazis fervents.
Voix d’outre-tombe
Le philosophe marxiste Ernst Bloch a, lui, esquissé des pistes. Il a relevé ainsi que les nazis ont kidnappé les symboles de la gauche, en commençant « par voler la couleur rouge », en lui volant ensuite « la rue, la pression qu’elle exerce », les défilés, les chants, les forêts de drapeaux, ce sera « une escroquerie montée grâce à des mots d’ordre révolutionnaires pervertis ». Tout leur sera volé à l’exception « du mot prolétaire », note Bloch en 1933 dans Héritage de ce temps. Peter Weiss en esquisse aussi. Il parle de « l’incapacité de l’homme à imaginer sa propre extinction qui avait servi de présupposé au fascisme », de ce processus où « goutte à goutte, sans discontinuer, le poison de la dépravation et de l’esprit de lucre s’infiltrait dans chaque groupe, dans chaque communauté d’intérêts et chaque organisation », un travail de sape qui « minait l’intégrité des personnes » et « fonctionnait si bien parce que le terrain avait été préparé depuis des décennies. »
Pour comprendre 1933, il faut remonter loin en arrière et, c’est pourquoi sans doute, Weiss s’attarde sur La Méduse de Géricault (1818), sur La Liberté guidant le peuple de Delacroix (1830), sur les Désastres de la guerre de Goya (1810-20), sur le Guernica de Picasso (1937), mais aussi sur Dante, Karin Boye, le temple d’Angkor Vat et Héraklès… Mais le mystère reste entier. Le philosophe Jean-Luc Nancy, revenant sur les condamnations à répétition de Heidegger4 et, plus particulièrement sur la « possibilité théorique et historique d’un pareil fourvoiement » (celui de Heidegger vis-à-vis du nazisme mais aussi de tant d’autres), il caractérise bien la réception de cette question : elle est « délaissée, sinon écartée ». Ceci rejoint en quelque sorte l’appel pressant venant de divers lieux de la gauche éclairée (Losurdo, le regretté Jean Salem, Samir Amin, par exemple) posant l’exigence et la nécessité de reprendre à zéro le bilan historique du siècle court. Mais là, on s’éloigne de Peter Weiss.
Pas tout à fait, en réalité. Lui aussi, avec d’autres mots, dans un autre contexte, parle de la nécessité de forger de « nouveaux concepts politiques utilisables ». Les « Justes » qui peuplent son roman l’ont payé au prix fort, presque tous décimés, jetés dans la fosse commune d’un oubli dont on ne peut ignorer aujourd’hui à quel point il a été voulu et programmé. Des gêneurs, les partisans allemands. À la fin de la guerre, en 1944 et 1945, personne ne voulait entendre parler d’eux. Déjà, l’ennemi n’était plus à Berlin, mais à Moscou. Déjà, les États-Unis se préparaient à établir « leur empire sur le monde ». La guerre allait se poursuivre par d’autres moyens. C’est sur cet adieu que Peter Weiss termine. Afin que nul n’oublie. Afin que chacune et chacun refasse le bilan de son héritage.
Peter Weiss, l’esthétique de la résistance, 1974-81, réédition Klincksieck, 2017, 888 pages (trad. de l’Allemand, Éliane Kaufolz-Messmer), 29 euros.
Footnotes
- S’il naît en Allemagne, Peter Weiss obtiendra la nationalité suédoise en 1946 après s’y être réfugié avant la guerre
- Là-dessus, lire la monographie de T. Derbent, La résistance communiste en Allemagne, 1933-1945, Aden, Bruxelles, 2008
- Qui veut approfondir cette question lira par exemple le journal 1945-1949 de Victor Klemperer, cet érudit juif qui va s’efforcer, à la Libération, de rebâtir sa vie dans les débris de Dresde en zone occupée soviétique — sous cette protection-là, grâce à dieu, dit-il, vu le climat antisémite persistant — et qui, en 1957, se dit, dans cette Allemagne de l’Est dont il est partisan, «détester la nazisme de Bonn encore plus que notre dictature stupide et dépourvue d’imagination ».
- Jean-Luc Nancy, Chroniques philosophiques de Nancy, éditions Galilée, 2004.