Au sein des mondes de l’art, cela fait quelques temps que les corps racisés fournissent un terreau fertile à la récupération idéologique et marchande – élisant quelques happy few aux premières loges du beau spectacle de la diversité culturelle, servant contre leur gré de faire-valoir au pouvoir en place1.

Il y a de quoi être circonspect face aux injonctions morales appelant à décoloniser2, posées comme autant de mots d’ordre aux contenus interchangeables, lorsqu’elles émanent de la bouche des directeurs de fondation ou de centres d’art blancs-hétéros-bourgeois, quand ces slogans ne sont pas directement portés par les hipsters de l’industrie de la mode, voire par Coca-Cola auto-érigé en prêtre du progressisme3. La réalité, sous son aspect le plus cru, est qu’à l’heure du capitalisme cognitif, ces discours ne sont plus simplement des arguments de vente, ce sont devenus des produits à part entière.
C’est à l’urgence d’élaborer des stratégies évitant ce genre de récupération que répond le livre d’Olivier Marboeuf. On pourrait, dans l’esprit de Gilles Deleuze et Félix Guattari, résumer l’ambition de ce livre par cette question : comment se faire un corps irrécupérable ?

Paru aux nécessaires éditions du commun, Suites décoloniales est une lecture dont on ne sort pas indemne. Un livre foisonnant et cacophonique, n’ayant pas peur de mélanger les genres, de produire de l’impureté et du trouble.
Quelque part entre fable, récit spéculatif et roman d’apprentissage, traçant la trajectoire d’un jeune « Africain par détour »4 allant de la banlieue parisienne aux centres d’art contemporain, ce livre est construit à partir de corps palpables mis en situation et d’expériences de vie. L’auteur y retrace et cartographie l’histoire des théories décoloniales depuis les guerres d’indépendance, et en extrait la trame nécessaire à la construction de nouveaux récits. Qui veilleront autant que possible à éviter de se faire capturer par Empire5. Et qui veilleront à ne pas alimenter la petite machine du mérite social.
La fable d’Océan-devenu-Conteur
Nous savons que chaque régime politique impose son lot de récits – récit des Évangiles et de la bonne parole à prêcher, récit « scientifique » défendant l’inégalité des races, récit national autour de héros républicains, récit du blanc-sauveur-qui-a-construit- des-ponts-et-des-hôpitaux, récit de la méritocratie « aveugle aux couleurs », récit de la mise en scène de corps invisibilisés, récupérés à bon compte par les pôles de pouvoir et destinés à entretenir sa mauvaise conscience.
À différentes échelles, à différentes intensités, ces récits se sont sédimentés dans nos imaginaires occidentaux de manière inconsciente. Et ils ont la peau dure. Retournez écouter « Le temps des colonies » de Michel Sardou. À l’entendre, on penserait que le mot « colo » renvoie à « colonie de vacances ».
Contre cette nostalgie blanche de la vie d’aventurier-colon et ses narrations dominantes, Marboeuf rappelle qu’il est primordial pour les communautés non-blanches d’archiver et de nourrir leurs propres récits. La manière de se raconter, soi et son histoire, intime et historique, infléchit la manière de se penser, de se considérer comme être humain. D’où l’importance, pour les générations racisées, de ne plus se réfléchir à travers le prisme des discours blancs-occidentaux mais de se construire à partir d’un autre miroir. Car « la scène primitive de notre crime est celle de l’imagination »6.
En effet, la colonisation ne s’est pas limitée à exploiter des corps et des ressources. Elle a également colonisé des imaginaires et les stigmates qui en subsistent sont profonds. L’attribution des rôles sociaux et des identités s’enracinent dans cet imaginaire colonial fonctionnant de manière polarisée : d’un côté, les « bons noirs »7 assimilés, qui travaillent dans l’ombre, qui se déplacent sans bruit, corps épuisés, réduits au semblant de place qu’Empire daigne leur accorder ; de l’autre, les « mauvais nègres » trop fiers pour se soumettre, parlant trop fort pour passer inaperçus, choisissant la voix du rap ou du crime en guise de réponse aux politiques d’identification, réactivant par-là le fantasme occidental du nègre dangereux, violeur de femmes blanches, et qui se verront finalement digérés par Empire, en finissant soit en prison, soit en icône multimillionnaire justifiant la loi de la jungle.
La colonisation ne s’est pas limitée à exploiter des corps et des ressources. Elle a également colonisé des imaginaires et les stigmates qui en subsistent sont profonds.
Pour rompre le mauvais sort, pour briser le miroir de la blanchité et les deux destins qu’elle institue (noir « blanchi » ou mauvais nègre), l’auteur propose une fable8. Une fable qui n’a rien d’imaginaire. Et elle commence sur cette scène, indigne : la calle d’un bateau.
Plantationocène contre capitolocène
Selon l’auteur, ce n’est ni dans l’apparition des banques de commerce italiennes, ni dans la crise des enclosures en Angleterre, qu’il faut aller chercher les racines du capitalisme moderne. Mais bien dans la déportation de corps noirs de l’Afrique vers l’Amérique. Dans l’organisation de la traite négrière. On ne peut trouver d’exemple plus éloquent quant au mode de fonctionnement du capitalisme : sans distinction, il transforme n’importe quel matériau en matière. Formellement, rien n’interdit qu’il fasse usage du genre humain comme d’une ressource en soi9. Qu’il fasse de chaque corps une monnaie d’échange, quitte à le déchoir de tout droit naturel. Posant ceci, on comprend l’inanité qu’il y a à vouloir hiérarchiser les luttes entre lutte des classes et lutte des races. L’oppression subie par ces corps noirs soumis à l’esclavage scelle définitivement la catégorie de classe et de race : noir parce qu’esclave et esclave parce noir. Dans le cas de la plantation, racisme, colonialisme, impérialisme et capitalisme sont inextricables et s’impliquent mutuellement.
C’est au nom de la mémoire des peuples esclavagisés que la plantation devient un lieu d’énonciation à part entière. Lieu traumatique duquel il faut partir au deux sens du terme : prendre comme point de départ ; mais surtout, quitter.
C’est à cet endroit que Marboeuf propose une nouvelle manière de comprendre le capitalisme écocide ne se limitant pas à une compréhension strictement économique, mais intégrant la dimension fondamentalement raciste de ce dernier.
Refusant l’appellation « anthropocène » (faisant de l’humanité le principal agent de la destruction des conditions de vie sur terre) ainsi que celle de « capitolocène » (faisant de l’économie capitaliste le principal agent de cette destruction), l’auteur propose le néologisme de « plantationocène » qu’il définit comme « le lieu paroxystique de l’accumulation primitive, scène de crime liminale et radicale où la production de richesses pour un ailleurs provient d’un ensemble de destructions dans le ici de la colonie» 10. Et c’est ce lieu de la plantation qui a donné naissance au Système-Corps Blanc, compris comme corps narcissique « qui souhaite que tout se rapporte à lui, qui veut tout voir et tout savoir, que rien ne lui soit caché et que rien n’interrompe ni ne reporte sa voracité sans fin (…), corps qui veut continuer à décider de qui peut vivre, de qui peut jouir, où et comment »11.
C’est de ce Système-Corps Blanc, de son regard et de son économie extractive, dont il faut se départir. La question presse : comment ?
Vers un matérialisme décolonial
Comment poser un geste décolonial au sein des mondes de l’art ? La colonisation étant dans son essence une vaste opération d’appropriation, de nombreuses voix issues des luttes antiracistes ont revendiqué une réappropriation active de leur parole et de leur corps, réclamant plus de reconnaissance et de représentation dans la sphère publique. Or, Marboeuf soutient que faire de la visibilisation une fin en soi aboutit à des effets politiques pervers. Cette visibilisation « libéralise » les luttes antiracistes, détricote le pouvoir du collectif au profit d’une logique individuelle de starification et de fame.
Partant du principe qu’une image est désormais une ressource exploitable, l’auteur démontre que cette mise en lumière des minorités fonctionne dans bien des cas comme un vaste mouvement de spectacularisation où les corps racisés sont amenés à convertir leur représentation en capital. Cette mise en lumière reposant sur une asymétrie entre corps racisés mis-en-scène (passif) et metteurs-en-scène blancs (actif), elle reproduit une logique d’exploitation, passée du corps à l’image. Ce capital est capté par des institutions culturelles gavées de bonnes intentions, avides de capitaliser sur cette diversité culturelle acquise à moindre frais, dépossédant au passage les communautés minoritaires des fruits de cette capitalisation.
La mise en lumière des minorités fonctionne dans bien des cas comme un vaste mouvement de spectacularisation où les corps racisés sont amenés à convertir leur représentation en capital.
Il n’y avait qu’à voir les performances proposées par Anne Imhof lors de sa dernière exposition au Palais de Tokyo (Natures Mortes, 2021) pour saisir l’ampleur de ce constat12 et pour éprouver la pertinence de la punchline de Marboeuf :
À l’autre bout de la chaîne, nulle fondation du grand capital ne saurait se passer aujourd’hui de son petit spectacle de voguing, de son moment d’écologie indigène, et de sa table ronde de pensée radicale, noire ou queer13.
Contre la logique du mot d’ordre, de la recette éthique, du contenu interchangeable et de la communication claire et distincte, Marboeuf propose de multiplier les foyers d’énonciation, de brouiller les pistes et d’avancer à tâtons, à l’ombre des projecteurs. De ne pas restreindre les pratiques minoritaires à réclamer de la « visibilisation » – car c’est encore là jouer le jeu du Regard Blanc14. C’est consentir au logiciel d’Empire, reposant sur l’individualité, la réussite personnelle et la propriété, que de chercher à se faire une place au soleil.
Selon Marboeuf, un geste décolonial est avant tout un geste appelant à dé-parler, à dé-faire, à dis-paraître, à se dés-identifier. Ces gestes de recul, de désapprentissage, de refus de l’assignation sont cruciaux pour réussir à mettre en branle ce qui nous fonde : une couleur, un genre, une position sociale. Car si le geste décolonial est avant toute chose un geste de négation, c’est justement pour éviter de se faire piéger par la logique identitaire. L’ordre donné par la police est toujours : « décline ton identité ».
Plutôt que d’y répondre, Marboeuf propose de faire grève. De laisser place à des existences moindres, de créer de nouvelles manières de parler et d’écouter, de nouvelles pédagogies expérimentant le commun, de préparer des noces imprévisibles auxquelles « aucun œil ne pourra imposer sa propre puissance »15.
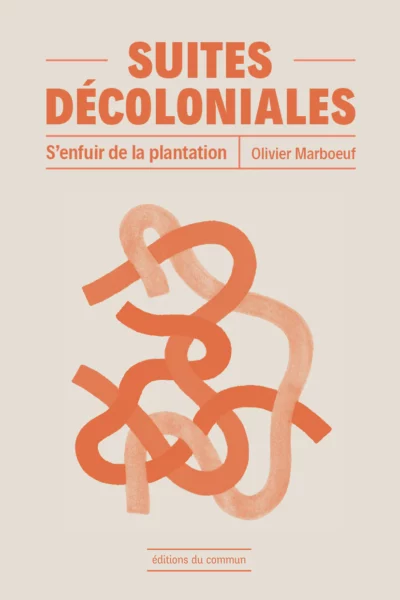 Olivier Marboeuf, Suites décoloniales. S’enfuir de la plantation, éditions du commun, Paris, octobre 2022.
Olivier Marboeuf, Suites décoloniales. S’enfuir de la plantation, éditions du commun, Paris, octobre 2022.
Footnotes
- Le terme de « token » a été forgé pour désigner cette instrumentalisation des corps racisés, discriminés positivement, exhibés au nom de politiques de représentation ou de quotas et amenant souvent à reproduire des logiques de domination à un niveau logique supérieur.
- La remarque vaut également pour tous les trendy topics – à savoir l’écologie, la pensée queer, etc.
- Sur la moralisation du capitalisme, lue comme capitalisation de la morale, je renvoie à Charles Bosvieux- Onyekwelu et Valérie Boussard, « Moraliser le capitalisme ou capitaliser sur la morale ? », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 241, no. 1, 2022, pp. 4-15.
- Olivier Marboeuf, Suites décoloniales. S’enfuir de la plantation, éditions du commun, Paris, 2022, p. 39.
- Marboeuf fait du complexe impérialiste-capitaliste-patriarcal-raciste un personnage qu’il nomme Empire
- Marboeuf, p. 42.
- Je reprends ici la terminologie polémique de l’auteur.
- Pour l’auteur, ces miroirs ou récits issus de la blanchité agissent comme le voile de l’idéologie chez les penseurs marxistes. C’est-à-dire comme une illusion que la critique est censée dissoudre. Le problème avec cette épistémologie est qu’elle reconduit une partition inégalitaire entre, d’un côté, le critique « sachant » et de l’autre, le noir prétendument « docile », ignorant sa condition réelle. On retrouve dans l’ensemble de l’ouvrage l’influence de Guy Debord et de sa métaphysique du spectacle, qui ne laisse que peu de place à une compréhension locale de l’image.
- Il n’est pas innocent que, depuis les années 80, le langage néolibéral ait remis au goût du jour cette expression, sémantiquement macabre, de « matériau humain ».
- Marboeuf, p. 34.
- Marboeuf, p. 37.
- Il ne faut jamais perdre de vue ce que cache l’esthétisation – par une belle image (ou une « laide » image comme chez Imhof), il y a toujours un monde, une manière de faire monde, une manière de lier les gens entre eux, d’établir des positions. Et des angles morts. L’esthétisation oblitère les rapports de force et une pratique comme celle d’Imhof tend clairement à les sublimer. Ce n’est pas tant un propos politique qu’Imhof entend esthétiser dans ses performances que des positions sociales qu’elle exhibe en « manières d’être » ou « styles de vie ». Et cette transformation s’effectue par la valorisation de l’aspect schlag-précaire-underground, notamment par l’entremise des industries du luxe (Balenciaga en tête). Sur le problème Imhof, nous renvoyons à cet article de Samuel Belfond, « Anne Imhof, faire partie du problème » publié par les Jeunes Critiques d’Art : https://yaci-international.com/fr/anne-imhof-faire-partie-du-probleme/.
- Marboeuf, p. 59.
- Puisque « the Master’s tools will never dismantle the Master’s house », comme le faisait observer Audrey Lorde.
- Marboeuf, p. 68.



