La controverse est vive entre les partisans de la décroissance et ceux du socialisme ces dernières années. Les contradictions portent sur la vision de société, la manière de surmonter le capitalisme et ce par quoi le remplacer, tour d’horizon des divergences fondamentales mais aussi des convergences entre décroissance et socialisme.

Le capitalisme peut être considéré comme une production généralisée de marchandises dans laquelle les unités de production individuelles (entreprises) prennent des décisions indépendantes concernant le contenu et la quantité à produire, la combinaison d’intrants et de technologies à utiliser, la manière d’organiser le processus de production, etc. Étant donné que les unités de production individuelles n’ont d’autre choix que de se relier au reste du monde par le biais de leurs produits, la valeur sert de base commune pour placer les marchandises sur un même pied d’égalité en termes de quantité de travail abstrait qu’elles contiennent et où les différentiels de profits émergents donnent des indications sur le taux et l’orientation des nouveaux investissements. La recherche du profit constitue le principe régulateur, et la production au niveau global est régulée car chaque expansion ou contraction excessive met en branle des forces qui contrecarrent la déviation.
L’exploitation, la réification des relations sociales1, le fétichisme de la marchandise2, ainsi qu’une perturbation croissante de la relation métabolique avec la nature font partie intégrante du processus de (re)production décrit ci-dessus en quelques mots. Ainsi, une alternative systémique au capitalisme doit se fonder sur des relations sociales différentes et offrir un ensemble de mécanismes et de processus pour réguler et coordonner l’ensemble complexe et interdépendant d’activités.

la réorganisation de la production sociale, notamment sur les exemples de réseaux informatiques du projet Cybersyn, au Chili et en URSS de Glushkov.
La planification est l’une de ces alternatives, avec une longue histoire de discussions théoriques et d’applications pratiques à différentes échelles. Cependant, jusqu’à récemment, la littérature sur la décroissance se tenait clairement à l’écart de l’idée de planification. Au lieu de cela, la transformation à venir se dessinait en termes de ce que l’une des sources d’inspiration de la décroissance, André Gorz, appelait les « réformes non réformistes », qui se manifestent aujourd’hui par des propositions telles que l’octroi d’un revenu de base universel, la réduction du temps de travail, des financements publics, la réappropriation et l’expansion du domaine des biens communs et du partage, la relocalisation de la production3, etc. Ces réformes n’offrent pas, même de loin, une alternative au rôle de coordination des marchés dans la production.
La planification en tant que mode radicalement différent d’organisation et de coordination de la production et de la reproduction sociale a rarement été abordée dans la littérature sur la décroissance. Cette situation évolue depuis que des penseurs plus radicaux de la décroissance abordent de plus en plus explicitement la question de la planification.
- 1 Production planifiée et niveaux de vie
- 2 Contrôle planifié de l’utilisation de la matière et de l’énergie
- 3 Au-delà des dichotomies : planification et autonomisation
- 4 (Re)localisation : éviter l’unilatéralité
- 5 L’autonomie : où est le capitalisme ?
- 6 Délibération : le travailleur collectif se réapproprie l’intellect général
Production planifiée et niveaux de vie
La plupart des penseurs de la décroissance s’accordent à dire que la croissance est engendrée par le capitalisme. Il est même admis que la croissance n’est pas le moteur, mais un résultat, « l’apparence de surface ou le « fétiche » d’un processus sous-jacent : l’accumulation du capital. » On pourrait donc s’attendre à ce que la remise en cause de ce processus et l’imaginaire d’une société alternative se fondent sur la négation du capitalisme en tant que mode de production. Pourtant, c’est la croissance qui reste au centre de la discussion.
L’accent mis sur la croissance n’est pas anodin. Telle que nous la connaissons, c’est une croissance capitaliste, ou en fait une accumulation de capital, constituée par des processus d’exploitation et d’expropriation propres au capitalisme, mesurée par des indicateurs conçus par et pour les sociétés capitalistes. Pourquoi devrions-nous alors nous préoccuper de la croissance en tant que telle du point de vue d’une société socialiste ( ou postcapitaliste ) ? La décroissance fascine et captive les imaginaires individuels et sociaux, les mouvements politiques, les partis et les projets, y compris ceux du socialisme : « La croissance est l’enfant du capitalisme, mais l’enfant a dépassé le parent, la pour- suite de la croissance survivant à l’abolition des relations capitalistes dans les pays socialistes. »4
La transplantation de la croissance hors de son contexte historique capitaliste vers un avenir socialiste, et donc la problématisation de la croissance en tant que telle, ne peut être justifiée qu’à une seule condition : si toutes les croissances, quelles que soient les relations sous-jacentes des humains avec les humains et la nature, peuvent être considérées comme homogènes, ou du moins semblables . C’est précisément ce que propose par exemple Giorgos Kallis : « la croissance socialiste ne peut être durable, car aucune croissance économique ne peut être écologiquement durable. La croissance du niveau de vie matériel nécessite une croissance de l’extraction des matériaux. Cela porte inévitablement atteinte à l’environnement et, en fin de compte, aux conditions de production et de reproduction. »
La conclusion logique de cet argument est que toute activité humaine impliquant l’extraction, la transformation et l’utilisation de matériaux, est en conflit direct avec l’environnement, car la première nuit inévitablement au second. Il s’agit d’un retour à l’opposition binaire entre nature et société. Selon Kallis, ce conflit devient insoutenable si le niveau de vie matériel continue d’augmenter.
Les partisans de la décroissance réduisent la discussion à la dimension quantitative.
La différence qualitative entre le socialisme et le capitalisme en tant que modes de production distincts est très pertinente ici. La fonction première de la production sous le socialisme est de fournir à tous les citoyens des besoins de base ( essentiels ). Cela comprend non seulement le logement, les produits alimentaires de base, l’approvisionnement en eau potable, les soins de santé, l’éducation et les transports publics accessibles, mais aussi les soins aux enfants et aux personnes âgées, les parcs et les loisirs, les services culturels et d’information de base, ( éventuellement ) les activités de restauration écologique, etc. Une fois que cet ensemble de besoins essentiels est déterminé socialement et arbitré politiquement, le nombre total d’heures de travail ( directes et indirectes ) socialement nécessaires pour produire ces biens essentiels peut être calculé. Ce montant total pourrait ensuite être réparti sur l’ensemble de la population en âge de travailler, en tenant compte des préférences sociales et politiques, des handicaps et du principe de rotation du travail. Il s’agit du travail de base de chaque citoyen afin de reproduire un niveau de vie décent universellement accordé à tous. Elle est en même temps la base de la convivialité d’une société égalitaire sans lutte pour les biens de première nécessité.
Les travailleurs peuvent utiliser les revenus de temps de travail restants pour acquérir d’autres produits que ceux de première nécessité, ce qui implique de travailler un nombre d’heures supplémentaire, déterminé à son tour par le temps de travail socialement nécessaire pour produire leur demande additionnelle.
Contrôle planifié de l’utilisation de la matière et de l’énergie
L’enjeu de la planification n’est pas le travail abstrait et aliéné mesuré par les catégories monétaires propres au capitalisme, mais le travail produisant des valeurs d’usage dans le cadre d’une rotation consciente, volontaire et planifiée. C’est l’un des traits distinctifs du socialisme par rapport aux divers imaginaires sociaux qui ne visent pas clairement à abolir la production capitaliste de marchandises. C’est très différent d’exiger des réductions d’impôts ( ou des augmentations d’impôts pour les riches ), un revenu de base universel ou des contraintes à la marchandisation.
Le processus de planification pourrait être piloté par une structure de conseils, où les travailleurs façonnent et valident activement les divers aspects du plan global. L’utilisation globale d’énergie et de matière à un moment donné peut être gérée par des contraintes déterminées de manière récurrente. Ces contraintes résulteraient de processus politiques de délibération à la lumière des connaissances scientifiques sur l’éventail le plus complet possible des conséquences de nos décisions, de la poursuite du principe de précaution, de la complexité des écosystèmes et de la multiplicité des critères d’évaluation utilisés.

Dans la planification socialiste, le fait que le travail social ne sera plus gaspillé dans des secteurs tels que le marketing et la publicité, le conseil et les services financiers, que les stratégies d’accumulation telles que l’obsolescence programmée et le gaspillage alimentaire cesseront d’exister, que les industries écologiquement destructrices ( production de combustibles fossiles, d’armes, de jets privés, de véhicules utilitaires de sport, etc. ) seront massivement réduites ou entièrement limitées, combiné à l’abolition complète du chômage et à la participation de tous les citoyens actifs à la production et à la fourniture des biens essentiels mentionnés ci-dessus, implique que le temps de travail associé au domaine de la nécessité sera nettement inférieur à huit heures par jour.
Selon la définition plus ou moins étroite de la catégorie des « produits essentiels », sa part dans la sphère de la production se situe approximative- ment entre 45 et 70 %, avec des variations significatives d’un pays à l’autre5. Ainsi, une implication directe du pilotage conscient de la production est une réduction significative du débit de matière et d’énergie associée à la cessation ou à l’élimination progressive des activités susmentionnées. Il s’agit d’un résultat souhaité et attendu, commun aux imaginaires de la décroissance et du socialisme. Une ligne de démarcation persiste cependant lorsqu’il s’agit de la question de l’institutionnalisation de la décroissance : « La croissance du niveau de vie matériel signifie, en fait, une croissance de l’utilisation des matériaux ( et de l’énergie ). Que l’économie qui produit cette croissance soit capitaliste, précapitaliste ou socialiste ne fait aucune différence. »6.
Nous pensons qu’une augmentation substantielle du temps libre et l’organisation sociale et communautaire du travail reproductif, combinées à l’accès universel aux produits essentiels au sens large ( services de haute qualité dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports publics, de la culture et de l’information, des parcs et installations de loisirs, en plus d’autres aspects matériels de la vie ), constituent une croissance du niveau de vie matériel pour la grande majorité de la population mondiale. C’est ici que les partisans de la décroissance, en adoptant une notion de croissance indifférente à la forme sociale de l’organisation, brouillent la relation entre quantité et qualité, ou peut-être suppriment la question de la qualité et réduisent la discussion à la dimension quantitative.
L’autonomie par rapport à l’État et au capital ( en tant que relation sociale ) suppose la persistance de ces derniers.
La littérature sur la décroissance elle-même soutient clairement que la question n’est pas « plus ou moins ? », mais plutôt « plus de quoi et moins de quoi ? ». En outre, il ne fait aucun doute que dans certaines parties du monde, la plupart des activités de production doivent être massivement développées pour assurer un niveau de vie décent, tandis que dans d’autres endroits, il s’agit de modifier l’échelle, la direction et la composition de la production. En tout état de cause, cela implique l’abolition du mode de production capitaliste au profit d’une formation sociale où la (re)production sociale est planifiée et dirigée consciemment par les travailleurs et les citoyens eux-mêmes. De l’aveu même de ses défenseurs, la décroissance est un projet taillé sur mesure pour le Nord global, où prévaut un mode de vie impérialiste. Ce n’est pas une voie souhaitable et viable pour le Sud global7.
Au-delà des dichotomies : planification et autonomisation
La réalité de la planification — ses principaux acteurs, qu’elle soit centralisée ou décentralisée, participative ou imposée — est rarement abordée par les penseurs de la décroissance. Cet évitement presque délibéré de la question de la planification peut être partiellement attribué à la réticence généralisée à affronter directement le capitalisme en tant que mode de production. Cette réticence est attribuée à trois facteurs : premièrement, l’insistance de penseurs influents de la décroissance à ne pas prendre le capitalisme comme objet principal de la critique ; deuxièmement, l’importance accordée par la décroissance à l’association volontaire, à l’auto-organisation décentralisée et horizontale ; et troisièmement, l’évitement tactique du bagage historique qui accompagne l’anticapitalisme et le socialisme explicites.
La même réticence est remarquable lorsqu’il s’agit des questions d’organisation, d’usage de la force et de révolution. Il s’agit là d’une lacune importante dans l’argumentation en faveur de la décroissance, qui ne peut être négligée. Qu’il s’agisse de l’infrastructure et de l’utilisation de l’énergie, du flux de production ou de la prise de décisions autonomes sur l’ampleur et la composition du produit social, toutes les transitions présupposent un changement des relations de pouvoir qui impliquent ( mais ne se limitent pas à ) la propriété des moyens de production. La littérature sur la décroissance préconise une variété de stratégies telles que les réformes non réformistes, les nowtopias, les actions contre-hégémoniques ( blocages, espaces interstitiels, etc. ). La question de l’organisation et du monopole de l’État sur l’usage de la force est cependant négligée et la question de la révolution est confortablement contournée.
Il existe donc une tension entre l’intérêt croissant pour la planification et le socialisme de la part des penseurs de la décroissance d’une part, et la réticence à envisager une rupture claire avec le capitalisme et à discuter de la planification comme pilier central d’une alternative au mécanisme de marché d’autre part. Nous développons trois domaines qui se rapportent à cette tension et qui ressortent comme des thèmes récurrents dans la littérature sur la décroissance : la localisation, l’autonomie et la délibération. Nous soutenons que les penseurs de la décroissance attirent l’attention sur des questions cruciales, mais leurs analyses restent généralement unilatérales et ne parviennent pas à s’attaquer à la totalité du capitalisme en tant que mode de production et, par conséquent, à proposer une alternative systémique.
(Re)localisation : éviter l’unilatéralité
La (re)localisation de la production est l’un des principes fondamentaux de la décroissance, définie comme une « trajectoire où le flux de production ( c’est-à-dire les flux d’énergie, de matières et de déchets ) d’une économie diminue tandis que le bien-être s’améliore. » Cela implique de répondre aux besoins locaux par une production locale, ou par des circuits plus courts de production, d’échange et de consommation. Ce qui est en jeu ici est sans doute plus que la simple réduction de l’énergie et des déchets associée au commerce résultant de la spécialisation et de la division du travail. Elle est liée à l’importance tout aussi grande que la décroissance accorde aux structures décentralisées et à l’organisation horizontale, qui sont supposées être plus compatibles avec la production locale et à petite échelle.
Il convient de rappeler l’appel à la prudence lancé par Murray Bookchin lorsqu’il s’agit de supposer une relation directe entre l’échelle et la hiérarchie :
« La décentralisation, les petites communautés, l’autonomie locale, voire l’entraide et le communautarisme ne sont pas intrinsèquement écologiques ou émancipateurs. Peu de sociétés ont été aussi décentralisées que le féodalisme européen, qui était en fait structuré autour de petites communautés, de l’entraide et de l’utilisation commune des terres. L’autonomie locale était très prisée et l’autarcie constituait la clé économique des communautés féodales. Pourtant, peu de sociétés étaient plus hiérarchisées. »8. Tout ensemble donné de technologies simples ou complexes, d’organisations à petite ou grande échelle, ou de structures locales, régionales, nationales et même mondiales, dont le contexte social et le contenu ne sont pas spécifiés, est nécessairement soit oppressif et exploiteur d’une part, soit émancipateur d’autre part.
La décroissance ne précise pas comment ( ou si ) les relations de pouvoir basées sur les classes seront transformées ou abolies.
La deuxième question qui se pose en cas de localisation potentiellement étendue de la production est celle de la perte de productivité associée à la diminution de l’échelle. Bien que cela puisse être accueilli favorablement par les penseurs de la décroissance en général, puisque la productivité et la production à grande échelle sont considérées comme intrinsèquement liées à l’esprit de l’accumulation du capital, nous insistons pour distinguer la productivité du travail des diverses notions d’efficacité définies par des critères propres à l’accumulation de capital. Le socialisme vise l’augmentation de la productivité du travail et le développement des forces productives en général. Une réduction de la productivité du travail entre en conflit avec un autre objectif central de l’imaginaire de la décroissance et du socialisme, à savoir le raccourcissement de la journée de travail nécessaire à la reproduction de la vie.
Une fois la question appréhendée en termes de cette double conception du travail et de la relation intrinsèque entre nécessité et liberté, il devient clair que ce qui importe, ce sont les relations sociales de production qui conditionnent le caractère, la qualité et l’importance relative des deux sphères. Le problème principal de l’accent mis sur la localisation n’est pas l’échelle économique, géographique ou administrative. Il s’agit plutôt de l’unilatéralité de l’argument.
La proximité ne peut devenir une vertu émancipatrice que si elle est incluse dans une structure plus large et imbriquée, régulée et coordonnée par des organes collectifs de travailleurs. L’interdépendance des localités sous le socialisme n’impliquerait pas une asymétrie de pouvoir ou une hiérarchie entre elles, caractéristique du capitalisme, mais représenterait plutôt la source de leur pouvoir collectif. Par exemple, les perturbations anticipées de la production alimentaire et les changements prévus dans les pratiques agricoles en raison de la crise planétaire ne seraient pas résolus par l’autosuffisance locale dans le cadre du socialisme, mais plutôt par une concentration de la coordination à des niveaux de planification plus élevés, où une vision plus globale est disponible. Il en va de même pour l’expansion et l’élargissement des systèmes alimentaires agroécologiques, de la restauration écologique et du travail de protection de la terre.
Les mises en garde formulées ci-dessus ne signifient nullement que la localisation ou le caractère local n’a pas sa place dans le socialisme. Nous pensons que le socialisme ne se caractérise pas par le simple remplacement de la propriété privée des moyens de production par la propriété sociale et l’abolition de la loi de la valeur au profit d’une production planifiée. Il implique également l’autonomisation des travailleurs et des citoyens, dont le travail est constitutif de la production, de la reproduction sociale et de la création de l’environnement. Cette autonomisation renforce l’autonomie des producteurs directs dans toute la mesure du possible, sans pour autant négliger la nécessité d’intégrer les localités autonomes dans un plan plus large, harmonieux et cohérent à différentes échelles.
L’autonomie : où est le capitalisme ?
L’accent mis sur la localisation dans la pensée de la décroissance est lié à la centralité du concept d’autonomie. Le lien entre les deux sphères est enraciné dans l’engagement en faveur de l’idée qu’à mesure que l’échelle de l’activité économique augmente, la capacité à s’autogouverner diminue. la littérature sur la décroissance associe l’autonomie à la prise de conscience par les gens qui font eux-mêmes leurs propres lois et leur propre histoire, sans recourir à certaines autorités extérieures ( comme Dieu, l’Église et les marchés ). Ainsi, ce n’est qu’en s’émancipant de l’imaginaire addictif de la croissance et du productivisme et en pratiquant une autolimitation consciente que les gens peuvent fixer des normes, des règles et des valeurs, et ainsi établir l’autonomie et la démocratie.
Les expériences locales d’auto-organisation et d’auto-gouvernance sont précieuses et instructives. Cependant, la poursuite de l’autonomie en tant que pratique révolutionnaire dans un contexte capitaliste a ses limites. Une véritable autonomie, en soi, n’est pas possible car la sphère de l’autonomie est liée et donc conditionnée par les forces mêmes dont elle prétend être autonome9.
L’autonomie par rapport à l’État et au capital ( en tant que relation sociale ) suppose la persistance de ces derniers. En tant que tel, le projet d’autonomie affirme l’hégémonie du capital par sa négation limitée et partielle, et devient ainsi partie intégrante de cette hégémonie. Il ne s’agit pas de rejeter ou de sous-estimer les expériences inestimables de La Vía Campesina, de l’EZLN ou de l’administration autonome kurde au Rojava, etc. Toutes ces expériences contiennent des leçons cruciales qui valent la peine d’être apprises. Toutes ont cependant en commun d’être entourées, voire assiégées, par les forces sociales, économiques et militaires dont elles veulent s’affranchir. Ainsi, la question de la totalité du capitalisme en tant que mode de production, y compris sa forme étatique historiquement spécifique, peut peut-être être supprimée localement, mais pas évitée pour de bon.
La planification centrale n’excluait pas les initiatives, les négociations et les délibérations locales.
Un degré maximal d’autogestion et d’autonomie ( à différentes échelles ) est une caractéristique souhaitée et nécessaire d’une société socialiste. Ce dont le « moi » est autonome est cependant très différent. Il ne s’agit pas du mastodonte de l’accumulation du capital, ni de la relation sociale du capital qui s’infiltre dans toutes les dimensions de l’être et de la vie, mais plutôt de niveaux plus élevés et plus centraux de coordination, de planification et de gestion. L’intégration d’unités locales et inférieures dans une structure imbriquée de conseils et d’instances de planification ne nie ni ne supprime l’autonomie locale.
Le local et le central se présupposent l’un l’autre pour fonctionner efficacement et harmonieusement : d’une part, en l’absence de structures qui supervisent le système global en utilisant toutes les informations disponibles, les unités locales peuvent entrer en dissonance, et les perturbations qui en résultent peuvent menacer l’ensemble du système. D’autre part, sacrifier l’autogestion des travailleurs en commençant par le lieu de travail et imposer un processus décisionnel purement centralisé ne met pas seulement le système en danger en réduisant sa flexibilité et sa capacité d’adaptation, mais abandonne également le contenu politique même du socialisme. Le processus politique d’autoconstitution et d’autogestion, également appelé « délibération » dans la littérature sur la décroissance, nécessite donc simultanément des instances autonomes et intégrées, locales et centrales.
Délibération : le travailleur collectif se réapproprie l’intellect général
La délibération est la notion selon laquelle les décisions, y compris dans le contexte environnemental, sont prises par le biais d’institutions et de processus sociaux qui impliquent la participation de toutes les parties potentiellement concernées. Avant tout, ce processus délibératif implique que les besoins, les désirs et les évaluations ne sont pas considérés comme acquis, mais qu’ils sont le fruit d’un processus social de négociation qui est constitutif de la subjectivité. En d’autres termes, la délibération et l’autogestion ne sont pas de simples moyens, mais également des fins en soi. Un autre avantage d’un tel processus est de révéler des évaluations divergentes ou conflictuelles concernant différentes dimensions du produit environnemental social. C’est essentiel selon les penseurs de la décroissance, car il n’existe pas d’échelle unique permettant de mesurer, d’exprimer ou d’étalonner les différentes valeurs et qualités.
L’une des lacunes des discussions sur la délibération dans la littérature sur la décroissance est qu’elles ne précisent pas comment ( ou si ) les relations de pouvoir basées sur les classes seront transformées ou abolies. Ce point est crucial car les questions de délibération et de planification dépendent essentiellement de l’existence ou non d’une rupture avec les relations de pouvoir et de propriété existantes ( ou envisagées ), et des moyens de cette rupture.
L’une de ces expériences d’auto-organisation a été celle des soviets et des conseils ouvriers qui se sont formés dans le cadre de la lutte des classes pour prendre en charge la production sociale dans la période qui a précédé la révolution d’Octobre ( en Russie ). Les travailleurs collectifs, qui produisaient différentes parties de la production sociale totale, unis dans les conseils et les soviets, formaient des institutions de coordination supérieures et déléguaient le contrôle de la production aux conseils centraux et à la planification. La planification centrale n’excluait pas les initiatives, les négociations et les délibérations locales. En outre, elle n’était pas perçue comme une question purement technique sur les chiffres, ni désignée comme le domaine d’expertise des érudits. Avec tous ses défauts, mais aussi ses forces et ses réussites ( ces dernières sont généralement négligées, voire rejetées, par la plupart des penseurs de la décroissance ), cette histoire est riche d’enseignements pour ceux qui envisagent la planification comme une alternative systémique à la production capitaliste de marchandises.
Un siècle plus tard, la portée du travailleur collectif s’est considérable- ment élargie. Il en va de même pour les connaissances relatives à l’ensemble de la ( re ) production sociale. Les données sont extraites non seulement pendant le processus de production, mais aussi dans la consommation et dans la vie quotidienne, sous la forme de l’extractivisme des données et du profilage des consommateurs. Ceci, une fois dissocié de sa forme capitaliste, renforce notre capacité à envisager une société alternative. Cela implique la réappropriation de l’intellect général produit par le travailleur collectif.
En ce qui concerne le problème crucial des frontières écologiques et les questions d’échelle et de limites biophysiques, les connaissances scientifiques constituent un pilier central. Il est vrai que dans nos sociétés capitalistes, la science peut tantôt être glorifiée comme juge ultime et employée pour guider les hommes, tantôt être totalement ignorée au gré de l’accumulation du capital. Cependant, des courants émergents tels que la communication scientifique, la compréhension de la science par le public, la science ouverte, la science citoyenne et les mouvements en faveur des logiciels libres représentent une alternative sous une forme embryonnaire. Les décisions environnementales, et par voie de conséquence, les décisions de production, doivent être éclairées par la science, mais restent avant tout des processus sociaux et politiques. Le processus de délibération doit impliquer des assemblées de travail collectif, des conseils unis représentant la (re)production de la vie, y compris les travail- leurs scientifiques ainsi que d’autres personnes qui possèdent maintenant des connaissances sur la production socialisée.
Le local et le central se présupposent l’un l’autre pour fonctionner efficacement et harmonieusement.
Ce que l’on appelle la délibération dans la littérature sur la décroissance est, de toute évidence, un principe central de l’autonomisation des travail- leurs. La coexistence et les conflits d’intérêts partiels, les processus politiques par lesquels ces intérêts et ces évaluations ( du produit social, des impacts environnementaux, etc. ) sont arbitrés doivent être discutés et explorés dans la pratique par des mouvements réels. Il est tout aussi important de mettre en place des structures et des processus qui garantiront la viabilité et faciliteront l’adaptation du système global en cas de conflits aigus et d’obstruction éventuelle. Les questions correctement identifiées comme cruciales ( autonomie et délibération ) par la décroissance n’étaient pas absentes des expériences pratiques de la planification socialiste du vingtième siècle.
Une société alternative égalitaire ne peut être le fruit de l’intellect. Elle doit se fonder sur des mouvements et des conflits existants et réels. La décroissance identifie et se nourrit de divers mouvements et pratiques, d’espaces autonomes et de laboratoires qui renforcent le pouvoir des gens et la contre-hégémonie, autant d’éléments très précieux. Cependant, ce qui lui manque, c’est une vision et un engagement clairement révolutionnaires pour s’attaquer au mode de production capitaliste dans sa totalité. Bien que ce ne soit pas le sujet de cet essai, la décroissance reste 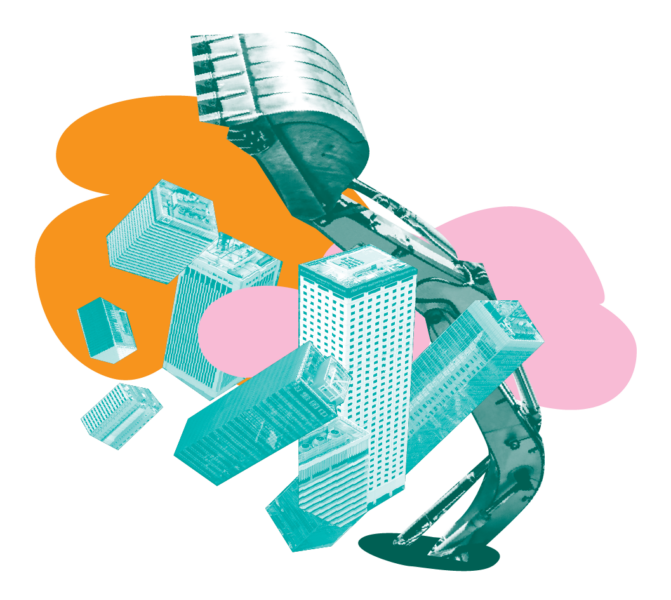 ambiguë quant aux questions de l’organisation, de l’usage de la force et du moment révolutionnaire de la rupture. En ce qui concerne les mécanismes et les processus de planification visant à remplacer la production capitaliste de marchandises, elle évite de se confronter à la nécessité d’ancrer les instances locales et auto- nomes et de les compléter par des instances centrales à plus grande échelle. Elle fétichise la croissance, la transpose de son contexte capitaliste et, par conséquent, ne parvient pas à saisir les différences qualitatives entre le capitalisme et le socialisme en tant que modes de production distincts.
ambiguë quant aux questions de l’organisation, de l’usage de la force et du moment révolutionnaire de la rupture. En ce qui concerne les mécanismes et les processus de planification visant à remplacer la production capitaliste de marchandises, elle évite de se confronter à la nécessité d’ancrer les instances locales et auto- nomes et de les compléter par des instances centrales à plus grande échelle. Elle fétichise la croissance, la transpose de son contexte capitaliste et, par conséquent, ne parvient pas à saisir les différences qualitatives entre le capitalisme et le socialisme en tant que modes de production distincts.
Tout cela ne signifie pas que le socialisme et la décroissance sont absolu- ment incompatibles. Il existe toutefois des divergences importantes entre les moyens et les objectifs, qui méritent d’être débattues.
Cet article est originellement paru dans la revue Monthly Review de juillet-août 2023 sous le nom Degrowth and Socialism: Notes on Some Critical Junctures. Il a été traduit et édité par la rédaction de Lava.
Footnotes
- « le fait qu’un rapport, une relation entre personnes, prend le caractère dune chose». Voir Vincent Chanson, Alexis Cukier, Frédéric Montferrand, La Réification ( La Dispute, 2014 )
- Le fétichisme désigne l’illusion selon laquelle l’être humain attribue aux choses des propriétés humaines, des caractéristiques qui ont en réalité leur source dans les rapports sociaux entre les humains. En particulier, le caractère « échangeable» des marchandise est vu comme étant une propriété des marchandises elles-mêmes, et non comme une conséquence du fait qu’elles sont des produits du travail humain.
- Hickel, Less Is More; Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth ( Cambridge : Cambridge University Press, 2017 ).
- Kallis, Degrowth, 73.
- Ces chiffres incluent la production des moyens de production nécessaires à la production des biens essentiels. On trouvera des détails dans Güney Işıkara, « The Weight of Essentials in Economic Activity », Review of Radical Political Economics 53, n° 1 ( 2021 ) : 95–115.
- Giorgos Kallis, « Capitalism, Socialism, Degrowth : A Rejoinder », Capitalism Nature Socialism 30, n° 2 ( 2019 ), 267.
- Matthias Schmelzer, Andrea Vetter et Aaron Vansintjan, The Future Is Degrowth ( New York : Verso, 2022 ), 25.
- Murray Bookchin, « Social Ecology versus Deep Ecology », Green Perspectives, n° 4-5 ( été 1987 ).
- Steffen Böhm, Ana C. Dinerstein et André Spicer, « ( Im) possibilities of Autonomy », Social Movement Studies 9, n° 1 ( 2010 ) : 17-32.




