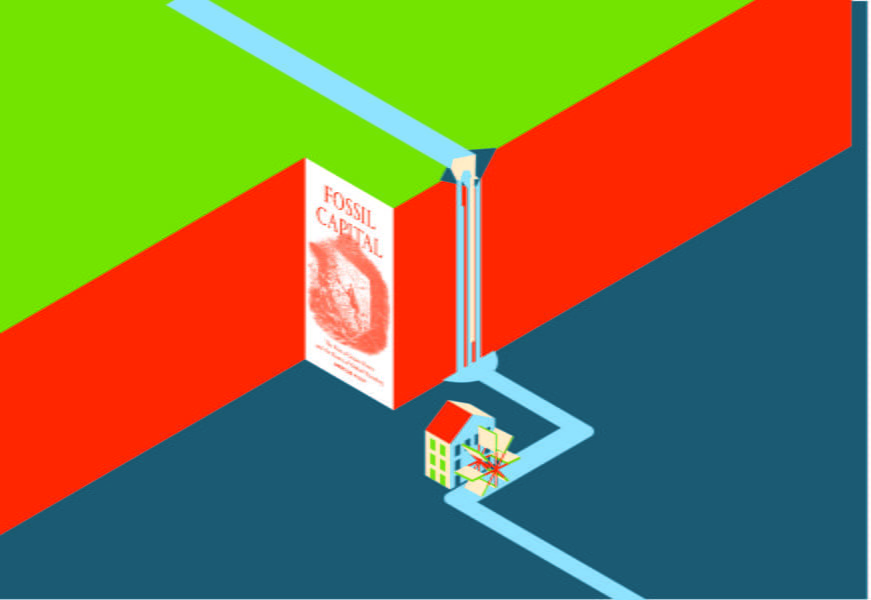L’idée selon laquelle le libéralisme économique serait de gauche est à la mode. Sauf à mettre n’importe quoi sous l’étiquette de « gauche », cette idée est un contresens qu’il est urgent de déconstruire.
Avant d’élaborer une stratégie du « ni de droite ni de gauche », Emmanuel Macron pouvait affirmer que « le libéralisme est une valeur de gauche1 ». Observant « la consternation » et « l’étonnement » qu’ont suscités ces propos en France, Kevin Brookes et Jérôme Perrier commentent dans un article publié dans Libération le 1er octobre 2015 : « on est […] en droit de s’étonner d’un tel étonnement. Un simple détour par le passé suffit en effet à montrer que les propos du ministre de l’économie n’ont vraiment rien d’iconoclastes (sic)2. » En réalité, ce n’est pas tant le passé que le présent qui délivre la déclaration de l’actuel président français de son vernis iconoclaste : l’idée est à la mode et transcende les frontières. En 2007, les économistes italiens Alberto Alesina et Francesco Giavazzi intitulent un ouvrage commun Il liberalismo è di sinistra (« Le libéralisme est de gauche »). La même année, dans un entretien accordé à La Libre, le politicien belge (libéral) Richard Miller déclare : « Le libéralisme est par nature, authentiquement social3 ». En 2013, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rainer Hank déplore la rupture entre les « moralistes de gauche » (linke Moralisten) et les « idéalistes du libre marché » (liberale Marktidealisten) qui, selon lui, gagneraient à être réunis4. Toutes ces déclarations se réfèrent avant tout au libéralisme économique (libre-échange), qu’elles amalgament quelquefois avec la revendication de libertés politiques, culturelles ou idéologiques, comme si celle-ci ne pouvait se passer de celui-là. Il faut avoir passé les dernières décennies dans un goulag ou souffrir d’une indécrottable mauvaise foi, voire d’un penchant inné pour la manipulation, pour pouvoir soutenir aujourd’hui, sans le moindre scrupule, que la vraie gauche, c’est le libéralisme économique. Tout incongrue qu’elle paraît, cette idée mérite pourtant d’être réfutée en bonne et due forme car à travers elle, c’est tout un système économico-politique qui se perpétue en érigeant la confusion, quand ce n’est pas de la simple bêtise, en fer de lance du commentaire journalistique. Il est temps, et plus que temps, de rompre avec le mythe d’un libéralisme de gauche, qui détourne bon nombre de consciences progressistes vers la reconduction du même.
L’enterrement de la gauche
Les « libéraux de gauche » sont semblables à la grenouille de la fable : se voulant plus de gauche que la gauche, ils s’étendent, et s’enflent, et se travaillent. « Je suis de gauche, ne vous déplaise », écrit le Belge Marcel Sel dans un article de son blog, dans lequel il s’emploie à réfuter l’idée selon laquelle Jean-Luc Mélenchon serait de gauche : « c’est parce que je suis de gauche que Mélenchon me dégoûte5 ». Le blogueur serait donc plus à gauche que Mélenchon ? Serait-il communiste ? anarchiste ? anarcho-syndicaliste ? nihiliste ? Rien de tout cela. Marcel Sel est, en réalité, un libéral de gauche, la quintessence même de la gauche !

La réticence de certains libéraux à se revendiquer de la droite s’explique aisément par des raisons psychologiques autant que stratégiques. L’étiquette de droite est lourde à porter : elle véhicule des idées de pouvoir, de domination, de conservatisme, d’immobilisme, quand la gauche évoque le progrès, l’égalité, les luttes sociales, l’intérêt pour le peuple. Imagine-t-on aujourd’hui un politicien être élu sur la base d’un programme prônant ouvertement la dégradation des conditions de vie des travailleurs ? En politique, il y a des choses qui ne se disent pas.
Deux stratégies s’offrent à la droite pour viser malgré tout au succès. La première consiste à renverser l’opposition du positif et du négatif. La droite devient la force motrice de la société, elle se range du côté de la « modernité », elle fait preuve de « courage » en mettant en œuvre des « réformes » conçues pour vaincre les « archaïsmes » du système économique actuel. La gauche, quant à elle, demeure attachée à un monde révolu, son passéisme explique les blocages actuels, elle favorise l’inactivité, la paresse, l’assistanat. La seconde stratégie est celle du refoulement. En dépit du bon sens, la droite en vient à se dire « de gauche ». C’est à fort juste titre que Frédéric Lordon qualifie le Parti socialiste français – et tous ses équivalents « sociaux-démocrates » européens, tels que la SPD en Allemagne, le PASOK en Grèce ou encore le PSOE en Espagne – de « droite complexée6 ». En tant qu’ils adoptent la plupart du temps la grille d’analyse des politiciens de droite et de leurs affidés sans la questionner, les médias dominants achèvent de légitimer l’idée d’un conflit terrible opposant la droite à la droite complexée.
C’est à fort juste titre que Frédéric Lordon qualifie le Parti socialiste français de « droite complexée »
On pourrait rire du phénomène s’il n’avait des conséquences graves sur l’imaginaire politique et les choix électoraux, et donc sur les conditions de vie des citoyens. Par-delà les spécificités locales, l’offre politique se décline désormais dans la plupart des pays dits « occidentaux » sous une même forme, consacrant la domination sur le monde économique d’un certain courant de pensée : à droite le capitalisme libéral, à gauche le capitalisme libéral. Comme il faut bien, cependant, marquer une différence, celle-ci portera sur la nature précise des réformes à mener pour faire prospérer – ou pour redresser – l’économie du pays (l’idéologie étant par là réduite à des débats techniques) et sur l’affirmation de « valeurs », auxquelles les politiciens s’avisent parfois de tourner le dos une fois arrivés au pouvoir. Ainsi posée, l’offre politique est somme toute assez maigre. Il existe certes d’autres courants ; mais ceux-ci sont d’emblée discrédités en étant associés aux « extrêmes » (comprenons : à ces partis qui nous ramènent aux « heures les plus sombres de notre histoire »).
En France, le coup de force du Front national a été de mettre le doigt sur cette « non-alternative » que représenterait « l’UMPS » pour s’afficher comme le parti du renouveau. En mêlant subtilement critiques de gauche et solutions (essentiellement) de droite, en suggérant que le contrôle des frontières est une panacée, en enterrant ainsi le clivage travailleurs vs détenteurs de capitaux au profit d’un clivage Français vs étrangers ou patriotes vs mondialistes, Marine Le Pen a achevé de brouiller la carte politique et a su séduire nombre d’électeurs qui, sans bien saisir les conséquences probables de leur vote, ont néanmoins d’excellentes raisons d’aspirer à une remise en cause du libre-échange.
Loin de constituer un « rempart contre le Front National », Emmanuel Macron n’a fait que conforter cette analyse en proclamant la nécessité de dépasser le clivage gauche vs droite
Loin de constituer un « rempart contre le Front National », Emmanuel Macron n’a fait que conforter cette analyse en proclamant la nécessité de dépasser le clivage gauche vs droite. Selon lui, la gauche et la droite ne sont pas ennemies par définition et peuvent donc être réconciliées. À première vue, la formule est séduisante : elle propose une vision apaisée de la politique, orientée désormais vers le bien de tous les citoyens. Mais en régime capitaliste, une telle politique peut-elle être autre chose qu’un leurre ?
La glorification du libéralisme
Le schéma mental des libéraux de gauche est à peu près toujours le même. Ayant prêté allégeance au capital, de qui ils attendent le salut, ils célèbrent sans nuances les bienfaits du libre-échange et fustigent la (vraie) gauche au nom d’arguments fallacieux. Le libéralisme devient l’incarnation la plus parfaite de l’idée de démocratie et de liberté, quand le socialisme, le communisme, l’anarchisme, sont associés au totalitarisme, au goulag et aux massacres de masse.
On passera sur les délires de Marcel Sel, qui prend le keynésianisme protectionniste de Mélenchon pour du communisme, et le communisme pour du stalinisme : « Jean-Luc Mélenchon n’est que le énième avatar de cette chanson sempiternelle qui finit toujours de la même façon. (…) Ça a le goût du communisme, le programme du communisme, mais ce n’est pas du communisme, c’est du mélenchonisme. Je perçois mal la différence. » Sans doute la percevrait-il rapidement s’il lisait le Manifeste du parti communiste, un bon livre d’histoire et le programme de la France insoumise – inutile d’en dire plus.
On prendra plus au sérieux la mise en équivalence du libéralisme et de l’idée de liberté, un poncif des manuels d’histoire et du commentaire politique de droite. Contrairement à une idée reçue, le fait qu’historiquement, le libéralisme politique ait été théorisé à peu près en même temps que le libéralisme économique ne fait en aucun cas de ceux-ci les deux aspects indissociables d’une même idéologie. Qu’il suffise de rappeler ici la citation fameuse de l’économiste libéral Friedrich von Hayek, appuyant le régime militaire d’Augusto Pinochet au Chili comme une nécessité provisoire : « personnellement je préfère un dictateur libéral plutôt qu’un gouvernement démocratique manquant de libéralisme » (El Mercurio, 12 avril 1981). Plus récemment, la répression militaire en moins, on se souviendra des protestations enragées formulées par nombre d’europhiles contre le référendum convoqué en 2015 par Alexis Tsipras en plein cœur de la crise grecque7, et du bon mot de Jean-Claude Juncker : « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Pour les tenants de la doctrine libérale en économie, démocratie et liberté politique pèsent souvent fort peu en regard des préceptes du libre-échange8.
La seule question qui vaille est donc la suivante : l’économie libérale est-elle, comme son nom semble l’indiquer, garante de la liberté économique de chacun ? D’une certaine façon, on peut dire que oui. En théorie, dans un marché libre, chacun est libre de tenter l’aventure de l’entreprenariat et, si d’aventure le succès est au rendez-vous, de s’émanciper ainsi de sa condition sociale. Seulement voilà : si tout le monde décidait un jour de devenir entrepreneur, le système s’effondrerait dans la minute 9. En tant qu’il est une configuration du capitalisme, le libéralisme présuppose qu’une majorité de la population doit se mettre au service d’une minorité pour s’assurer un salaire – quel que soit le travail qu’elle accomplit par ailleurs en dehors de l’emploi. Un travailleur qui passe, disons, 35 à 50 heures par semaine – pour ne parler que des pays dits « occidentaux » – à exécuter des tâches qu’il n’a pas choisies d’exécuter dans le seul but de pouvoir vivre plus ou moins dignement selon les cas, ce travailleur est-il, en termes économiques, vraiment « libre » ? Peut-il, avec la même liberté qu’un autre, optimiser son capital en l’investissant efficacement et en contournant les impôts ? Peut-il décider des produits dans lesquels il convient d’investir ? Le chômeur réprimandé pour n’avoir soumis que quinze candidatures sur le mois est-il libre ? Est-il libre de n’accepter un travail que si celui-ci lui paraît épanouissant et bon pour la société ? Est-il libre de négocier son salaire ? ses horaires ? ses conditions de travail ? Un État dont la politique économique est dictée, en tout ou en partie, par ses créanciers est-il libre ? S’il y a bien une liberté que le libéralisme garantit, c’est celle du capital. Pour celle du travail, on repassera.
L’autre incontournable du bien nommé libéralisme de gauche consiste à diaboliser la vraie gauche en dépit du bon sens historique le plus élémentaire. On connaît l’argument, désormais classique : l’opposition au capitalisme, « on a vu ce que ça donne ». Si la liberté est du côté du libéralisme, c’est que de l’autre côté, il y a la soumission, la peur, le contrôle de la pensée, la répression, le goulag, Staline, Pol Pot.
Qu’il suffise de rappeler ici la citation fameuse de l’économiste libéral Friedrich von Hayek, appuyant le régime militaire d’Augusto Pinochet au Chili comme une nécessité provisoire : « personnellement je préfère un dictateur libéral plutôt qu’un gouvernement démocratique manquant de libéralisme »
Il est symptomatique que dans l’énumération, l’expérience chilienne est presque toujours passée sous silence. On pensera ce qu’on veut de l’efficacité économique du gouvernement de Salvador Allende (1970-1973), dont ce n’est pas le lieu de discuter ; mais une chose est claire : élu démocratiquement pour appliquer une politique d’inspiration marxiste, soutenu par une part importante de sa population, toujours soucieux de respecter le fonctionnement des institutions, Allende se heurte à une opposition d’une violence terrible, qui culmine dans le coup d’État du général Pinochet en 197310. Car oui, l’opposition au capitalisme, « on a vu ce que ça donne » : la contre-opposition féroce des hérauts de la liberté et de la démocratie dès lors que la démocratie va dans un sens qui ne leur plaît guère.

L’anti-capitalisme n’est donc pas « totalitaire » par essence, si l’on entend derrière « régime totalitaire » le recours à la propagande d’État, au contrôle des consciences et à la répression systématique des dissidents11. Certes, à ce jour, le bilan des gouvernements de gauche aurait pu être plus idyllique. Mais il faut rappeler, d’abord, qu’ils ont dû faire face à chaque fois à la violence du capital national (appuyé à l’international par des alliés de taille), qui n’entendait guère renoncer à sa position dominante. Ceux qui veulent croire que l’on peut mettre en œuvre une politique favorable à la majorité des citoyens dans la joie et la bonne humeur n’ont pas eu à affronter la violence du perdant, prêt à accomplir le pire pour maintenir sa suprématie. Il faut rappeler, par ailleurs, que le nombre des expériences de gauche a été trop limité jusqu’à présent pour pouvoir conclure d’une contingence à une nécessité. L’une des grandes difficultés que rencontre la gauche, c’est que les solutions qu’elle doit adopter ne sont pas données d’avance, et que le chemin est semé d’embûches. Assurément, l’histoire inventera de nouvelles voies qui n’ont pas encore été explorées. Du reste, si le capitalisme avait dû être jugé sur ses premières performances, il n’aurait pas fait long feu.
On peut se demander, d’ailleurs, si le capitalisme libéral est vraiment la garantie d’une société où il fait bon vivre. En leur empruntant leur mauvaise foi, il serait aisé de prendre les libéraux de gauche à leur propre jeu : « le libéralisme, on a vu ce que ça a donné ». Ce fut d’abord, jusque tard dans le XXe siècle pour les pays dits développés, des conditions de travail épouvantables et des morts à foison, le tout s’accompagnant d’une répression souvent sanglante à l’égard du mouvement ouvrier. Si, aujourd’hui, les conditions de travail en Occident se sont globalement améliorées, d’autres pays sont moins heureux – pensons par exemple à l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. On prendra encore un malin plaisir à rappeler que les atrocités commises sous la dictature du général Pinochet ou lors de la guerre du Vietnam, pour ne prendre que ces deux exemples, furent le fait de régimes libéraux. Ajoutons à cela un bilan colonial désastreux et les millions de morts causées à travers le monde par la mise en œuvre dans les colonies des recettes économiques préconisées par Adam Smith, Jeremy Bentham et John Stuart Mill 12.
On voit en outre combien plusieurs décennies de recettes libérales attisent de plus en plus de contestations dans de nombreux pays et favorisent la montée d’une droite autoritaire, nationaliste et xénophobe
Aussi l’affirmation de Richard Miller selon laquelle « à la fin du XXe siècle, les grandes démocraties libérales ont été les seules capables de rendre les gens libres dans des sociétés prospères et sûres13 » doit-elle être fortement nuancée, sinon complètement rejetée. On relèvera d’ailleurs l’éternel sophisme visant à faire accroire que le libéralisme s’est toujours montré soucieux d’émanciper les citoyens, quand bien même ceux-ci ont dû se battre, parfois au prix de leur vie, pour acquérir une forme (toute relative) de liberté politique et des droits (limités) en matière économique, au sein même de régimes dits « libéraux ». On voit en outre combien plusieurs décennies de recettes libérales attisent de plus en plus de contestations dans de nombreux pays et favorisent la montée d’une droite autoritaire, nationaliste et xénophobe, quand ce n’est pas la « gauche libérale » elle-même qui se charge du sale boulot…

La vraie gauche
Nous ne sortirons de ce bourbier qu’en ayant les idées claires. Aux tenants d’un « capitalisme à visage humain », il va falloir expliquer que le capitalisme ne « s’améliore » pas, mais qu’il se combat ; ou plutôt, qu’il ne s’améliore qu’en étant combattu, et que c’est ce combat qui caractérise la (vraie) gauche.
Car en régime capitaliste, la politique du bien commun n’est qu’une dangereuse illusion : toute amélioration substantielle du bien-être des uns se fait forcément au détriment de celui des autres. Le capitalisme voit s’opposer deux logiques antagonistes : celle des « investisseurs » et « créanciers », désireux de faire « fructifier » leur capital, c’est-à-dire de capter une partie de la valeur produite par le travail d’autrui ; et celle des travailleurs, « exploités » en tant qu’ils sont dépossédés ainsi d’une partie des fruits de leur travail. Il existe, certes, des points de convergence : par exemple, il est dans l’intérêt du capital que les travailleurs disposent de suffisamment de liquidités pour pouvoir acheter les marchandises produites sous l’égide du même capital. Il n’en reste pas moins qu’à l’échelle d’une entreprise, c’est la logique du tir à la corde qui prévaut – avec un avantage certain en faveur du capital. Donnez au capital, et vous prendrez au travail ; donnez au travail, et vous prendrez au capital.
Sous prétexte que la situation a changé depuis le XIXe siècle, qu’il existe les impôts, la sécurité sociale, un code du travail, que le droit de grève semble acquis, que de nombreux travailleurs ne font pas fructifier de capital, c’est cette logique fondamentale qu’on a fini par ne plus voir. Le capitalisme s’est amélioré, nous dit-on. C’est faux. Ce qui a changé, c’est qu’il a été modéré par des conquêtes de gauche. Mais la logique du capital est toujours restée la même. Ces conquêtes, il s’emploie précisément à les remettre en cause. Au nom d’une modernisation, vous dira-t-il, pour ne pas avouer l’inavouable.
La politique, en régime capitaliste, voit s’affronter deux mouvements émancipateurs : la gauche, qui cherche à émanciper le travail (du joug du capital), et la droite, qui cherche à émanciper le capital (des conquêtes de gauche) et à étendre l’emprise de celui-ci
Cette contradiction fondatrice entre les intérêts des uns et les intérêts des autres est l’horizon indépassable de toute politique. Par conséquent, les étiquettes de gauche et de droite ne doivent servir qu’à traduire cette conflictualité inhérente au capitalisme. L’opposition peut se décliner en termes absolus et en termes relatifs. Dans l’absolu, la gauche ne peut viser qu’à un dépassement du capitalisme puisque le capitalisme consiste, par nature, dans l’exploitation du travail ; quant à la droite, elle s’ingénie à faire triompher le capitalisme, de manière plus ou moins subtile selon les cas. En termes relatifs, les ambitions de la gauche peuvent être plus modestes. Tandis que la droite tire la corde dans le sens du capital, la gauche la tire dans le sens du travail – sans pour autant prôner du jour au lendemain une sortie du capitalisme. Dans l’un et l’autre cas, les notions de centre, d’extrême-gauche et d’extrême-droite s’avèrent des contresens politiques, puisque toutes supposent qu’il peut exister un point de compromis dont la majorité se contenterait, situé quelque part « entre les extrêmes » – c’est-à-dire en plein dans le capitalisme.
La politique, en régime capitaliste, voit s’affronter deux mouvements émancipateurs : la gauche, qui cherche à émanciper le travail (du joug du capital), et la droite, qui cherche à émanciper le capital (des conquêtes de gauche) et à étendre l’emprise de celui-ci. En matière économique, le libéralisme, c’est l’une des composantes de la droite. L’idée d’un libéralisme de gauche est au mieux une grossière erreur, au pire un très laid mensonge. Au fond, le libéralisme de gauche, c’est un peu comme la charité de droite. Après avoir appelé à dépouiller les plus fragiles des derniers droits qu’il leur restait, l’homme charitable fait une démonstration de vertu en leur reversant une petite partie de ce qu’il leur a pris. Telle est la vocation du libéralisme de gauche : pouvoir défier la morale tout en passant pour un saint.
Footnotes
- http://www.lemonde.fr/festival/article/2015/09/27/emmanuel-macron-le-liberalisme-est-une-valeur-de-la-gauche_4774133_4415198.html.
- http://www.liberation.fr/debats/2015/10/01/quand-la-gauche-etait-liberale_1395163.
- http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-parti-socialiste-en-crise-d-identite-51b72eabe4b0de6db974c6b4.
- http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/liberalismus-deshalb-sind-liberale-nicht-mehr-links-12555018-p5.html.
- http://blog.marcelsel.com/2017/04/20/melenchon-linsoumise-trumperie.
- Voir par exemple http://blog.mondediplo.net/2013-04-12-Le-balai-comme-la-moindre-des-choses.
- http://blog.mondediplo.net/2015-06-29-L-euro-ou-la-haine-de-la-democratie.
- Pour d’autres exemples, voir Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme, trad. de l’italien par Bernard Chamayou, Paris, La Découverte, 2013.
- Cette configuration inédite accomplirait le miracle de montrer dans toute sa splendeur combien les grandes fortunes ne se construisent pas sur le mérite mais sur l’exploitation du travail d’autrui. Livré seul à lui-même, Bill Gates ne serait passé à la postérité, au mieux, que comme un inventeur quelconque.
- Signalons encore l’expérience révolutionnaire du Chiapas, qui a su donner à la démocratie une extension jamais vue dans les sociétés dites « libérales ».
- Sur la fortune du concept (fluctuant) de « totalitarisme », voir Le totalitarisme : le XXe siècle en débat, textes choisis et présentés par Enzo Traverso, Paris, Seuil (« Points essais », 442), 2001.
- Mike Davis, Late Victorian Holocausts : El Niño Famines and the Making of the Third World, London / New York, Verso, 2017.
- http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-parti-socialiste-en-crise-d-identite-51b72eabe4b0de6db974c6b4.