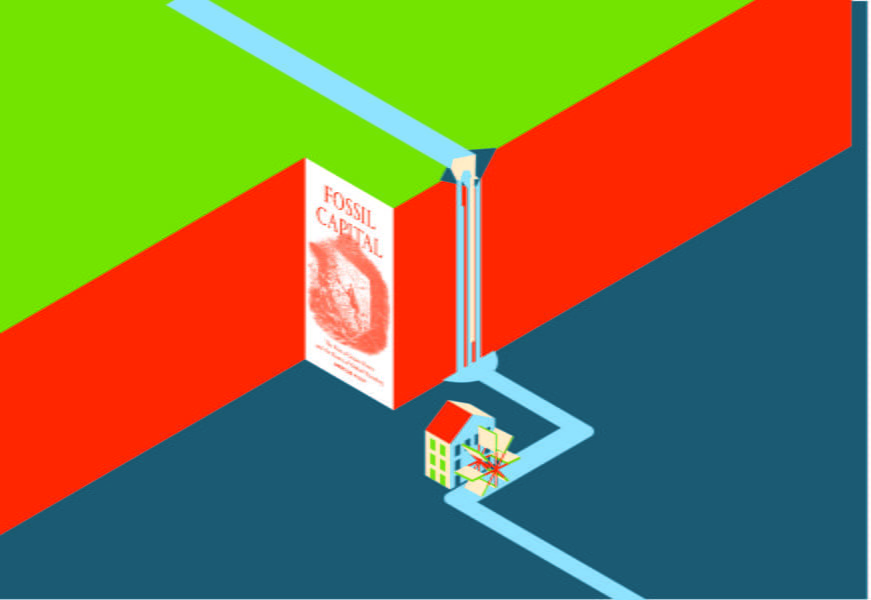Le danger « populiste » est sur toutes les lèvres. Pourtant, tant comme outil d’analyse que comme stratégie politique, il semble vouer la gauche à un cul-de-sac.
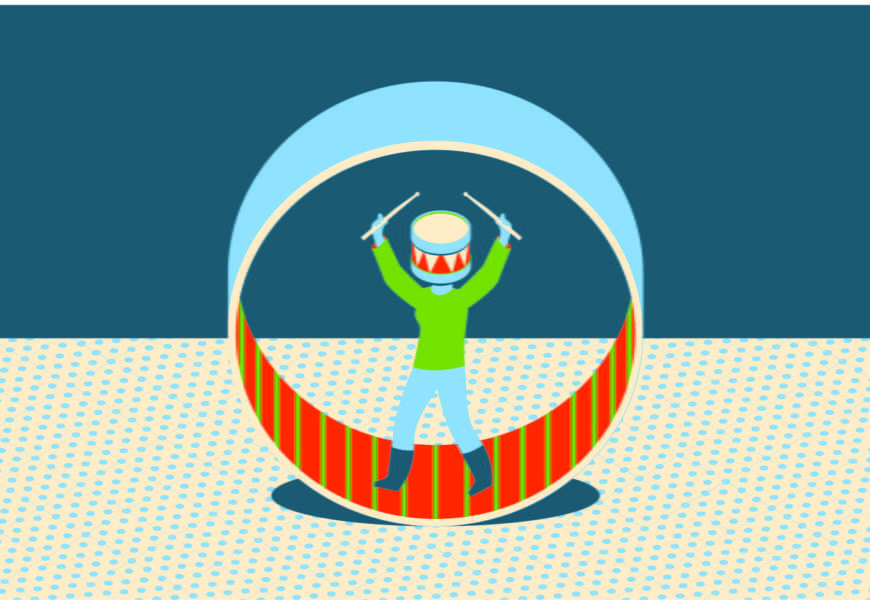
Populisme à la sauce élections présidentielles françaises, appliqué aussi bien au Front national, mouvement d’extrême droite de Le Pen, qu’à la France Insoumise de Mélenchon ; populisme à la sauce Amérique latine, sans distinguer Argentine, Brésil ou Vénézuela… populisme utilisé jusqu’à l’étude des mouvements sociaux au Japon…
Ce terme, qui revient allègrement dans la bouche des commentateurs politiques et figure en bonne place au hit-parade des recherches universitaires, se situe en réalité à un niveau de généralité et de confusion tel qu’il rend toute analyse politique impossible. On baigne dans une soupe abjecte, mobilisée par la classe dirigeante afin de disqualifier les mouvements de gauche tout en s’épargnant l’analyse véritable des moteurs de l’extrême droite. Il nous semblait donc nécessaire d’apporter quelques clarifications et d’ajouter un clou de plus au cercueil d’une mode au mieux chronophage, au pire néfaste : le vocable « populisme » ne recoupe aucune théorie politique largement reconnue, pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses aux problèmes stratégiques qui se posent à gauche et, surtout, brouille les cadres de pensée qui permettent d’avancer politiquement vers un changement de société.
Appeler un chat un chat
Il est particulièrement édifiant de voir le nombre d’articles ou de livres cherchant à valider le concept de « populisme », que ce soit pour décrire une idéologie ou une stratégie politique1. Mais, plus que le plaisir de la joute intellectuelle sur ce que pourrait apporter une nouvelle catégorie au paysage de la science politique, ce qui nous préoccupe ici, c’est la confusion provoquée par son emploi au quotidien, dans les médias et dans la vie politique, ainsi que ses conséquences pour la transformation de nos sociétés.
Ceux qui font usage du terme « populisme » l’appliquent généralement à un parti politique ou un mouvement qui utilise ou met en scène l’opposition entre « peuple » et « élite » et défend la souveraineté populaire. Ont ainsi été catégorisés « populistes » par les médias : le Front national ( extrême droite française), la France insoumise ( gauche, France), Podemos ( gauche, Espagne), le Mouvement cinq étoiles ( nationalistes, Italie), Hugo Chávez ( gauche révolutionnaire, Venezuela), Jeremy Corbyn du Labour ( parti travailliste, Royaume-Uni), l’UKIP ( parti nationaliste, Royaume-Uni), Trump ( capitaliste protectionniste, États-Unis),…
Premier constat rédhibitoire : on réunit sous l’appellation « populisme » des partis qui n’ont ni objectif ni vision en commun — si ce n’est qu’ils pourraient déstabiliser le capitalisme de manière révolutionnaire ou réactionnaire — et qui se développent dans des contextes sociaux, économiques et institutionnels totalement différents. Utiliser ce vocable comme s’il permettait de définir le programme et les caractéristiques d’un parti témoigne d’une légèreté intellectuelle dangereuse pour deux raisons : elle fait l’économie d’une analyse approfondie des causes de la montée de l’extrême droite et des solutions à y apporter ; et elle discrédite la gauche non sociale-démocrate en rapprochant extrême gauche et extrême droite, les faisant presque disparaître derrière cette étiquette commune.
Effet direct de l’emploi du mot « populisme » : les partis d’extrême droite comme le FN2 ou l’UKIP ( parti nationaliste raciste xénophobe ) ne sont plus clairement nommés, alors que le terme « extrême droite » pointe clairement l’ennemi de décennies de luttes sur les lieux de travail, combattu grâce à la solidarité entre travailleurs immigrés ou non, et a la capacité de provoquer une réaction épidermique dans de larges couches de la population.
Cet enjeu, Marine Le Pen l’a bien compris puisqu’elle menace d’attaquer ( avec des chances de succès assez faibles ) ceux qui oseraient encore qualifier le FN d’extrême droite3 et qu’elle a intégré le terme « populiste » voire « national-populiste4 » à la stratégie de dédiabolisation du FN : « Dès que vous remettez en cause l’ordre établi par les élites autoproclamées, vous êtes accusé de populisme. Et bien si c’est ça la définition, je l’assume, je l’endosse et même avec le sourire5. » Double aubaine donc pour l’extrême droite : plus elle se pose en contestataire du système et des médias — directement associés aux « élites autoproclamées » — qui crient au « populisme », plus elle apparaît comme antisystème et populaire. Un phénomène semblable a mené à l’élection de Trump aux États-Unis, contre Clinton portée aux nues par les médias. En outre, le vernis « populiste » déforme dangereusement la réalité en considérant les partis comme le FN comme des défenseurs du « peuple » contre les « élites ». Le FN souhaite, au contraire, remplacer l’élite existante par la sienne, par un capitalisme nationaliste ; il s’est opposé aux manifestations contre la loi Travail en 2016 et veut diminuer le rôle et l’expression des syndicats ; enfin, il ne sert pas un « peuple », mais cherche à le diviser sur des lignes ethniques et religieuses, dénonçant « assistés », « immigrants » et « délinquants » pour mieux régner6. La rhétorique populiste n’implique aucunement de renverser le pouvoir ou le système politique : elle ne vise qu’à en changer la composition, tout en servant de feuille de vigne à la démagogie et à la xénophobie, des classiques de l’extrême droite.
Une mauvaise grille d’analyse
Une raison avancée pour l’utilisation du mot « populisme » comme grille d’analyse serait la crise de représentation des démocraties actuelles, puisque ce terme met en avant la disjonction entre « peuple » et « élites » qui le gouvernent. Dans une vision libérale, nombreux sont ceux qui relient l’émergence d’un « populisme » au moment où « l’élite politique perd l’opinion publique, où les piliers “ constitutionnel ” et “ libéral ” de la démocratie écrasent les piliers “ démocratique ” et “ populaire ”7 », légitimant par là durablement la différence entre élite et opinion publique, et faisant preuve d’un mépris total envers un peuple moutonnier qui ne réagirait qu’à la flatterie de ses bas instincts.
Or, cette séparation est inhérente au système capitaliste actuel et au rôle que la représentation joue dans le maintien de l’organisation sociale. Le pilier « libéral », reposant sur son socle capitaliste, a poussé inéluctablement de larges couches de la population dans une situation de pauvreté insoutenable. Dans ce cadre, la « représentation » ( en très grande majorité assurée par des politiciens issus des mêmes milieux, écoles et universités, constamment soumis aux pressions du capitalisme financier ) n’existe que pour permettre à cette situation de perdurer. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le « recours au peuple » soit compris par les dirigeants comme une « anomalie mettant en péril l’ordre démocratique8 ».
Sans être irréductible, cette « crise » de la représentation ne pourra pas être résolue dans les limites du capitalisme ; c’est d’ailleurs clairement l’ensemble de la démocratie bourgeoise et de ses institutions ( gouvernements, médias, justice ) qui est dénoncé par les votes contestataires. La connotation péjorative du qualificatif « populiste » encourage la séparation entre des revendications portant à la fois sur la superstructure et l’infrastructure de notre société : pour être « raisonnable », il faudrait s’attaquer à des problèmes séparés, de préférence par une voie réformiste.
On a ainsi vu un chercheur de Cambridge9 proposer de considérer les mouvements antinucléaires au Japon et leur convergence avec le mouvement Occupy comme la rencontre de deux « populismes ». Les marqueurs de la confusion du peuple japonais seraient les mots d’ordre lancés entre 2011 et 2016 : « Faisons grève pour changer notre lieu de travail, pour faire tomber le gouvernement Abe, et pour sortir du nucléaire ». Ces revendications montrent, bien au contraire, que les travailleurs se sont emparés de la lutte antinucléaire, sortant du registre économiste pur ( préservation des emplois ) pour s’attaquer à l’ensemble de la société ( politique et forces productives). Devrait-on de même concevoir la Marche blanche de 1996 en Belgique comme un mouvement populiste parce que les ouvriers ont débrayé en solidarité avec les familles des victimes de Marc Dutroux contre une justice de classe indifférente à leur drame ? Parce que la contestation de la superstructure est venue précéder les revendications économiques ? La droite ne s’est pas privée de le faire, dénonçant un mouvement « émotionnel » ou même d’extrême droite ( avant de faire un pas en arrière face à l’ampleur des mobilisations), et l’on voit ici que certains universitaires lui préparent un terrain encore plus facile, donnant une base académique à un mépris de classe pur et simple10.
Il semble fondamental, à gauche, de rejeter clairement tout ce qui peut atténuer la portée de tels mouvements de convergence : ils témoignent du potentiel de radicalité des travailleurs et de leur exaspération face à un malaise social plus large, dont l’ampleur et la portée doivent être analysées sur des bases de classes. Enfin, il est également faux de penser que le mot « populisme » viendrait pallier une absence de concepts pour décrire la situation actuelle, et plus particulièrement les mouvements de droite. Avant d’utiliser un terme fourre-tout aux contours flous, qui ne donne aucune clef d’analyse des reconfigurations économiques, sociales, industrielles, ni de leur impact sur les groupes sociaux, leur expression politique, et l’évolution des rapports de force au sein de la société, il faudrait avoir épuisé les catégories pertinentes de bonapartisme, nationalisme, poujadisme, fascisme ( utilisé à bon escient)… Celles-ci fournissent un guide réellement utile pour comprendre les dynamiques de ces partis et pouvoir lutter contre eux11. En réalité, sous couvert d’une économie de mots, la locution « populisme » ôte toute signification de classe aux événements et prive la gauche d’outils puissants pour comprendre les mouvements et leurs chefs, reflétant les intérêts de groupes sociaux ou de certaines classes.
Populisme sur fond de perte de repères
L’usage du terme « populisme » reflète un changement de tactique plus ou moins volontaire à gauche depuis les années 80. Suite à leur tournant néolibéral, les partis socialistes, perdant leur électorat ouvrier, se sont tournés vers des thèmes progressistes ( genre, race, culture…), substituant ainsi à « la coalition historique de la gauche centrée sur la classe ouvrière » une nouvelle alliance « plus jeune, plus diverse, plus féminisée, plus diplômée, urbaine et moins catholique12 ». En France, ceci a provoqué, selon Gérard Mauger, l’abandon des « classes populaires travailleuses » au FN13 et à ses positions ouvertement racistes, notamment par le rejet du vocable « travailleur immigré » pour « Beur14 ».
Le vocable « populisme » ne recoupe aucune théorie politique largement reconnue
C’est en réaction aux effets catastrophiques de ce délaissement de plus de trente ans ( montée de l’extrême droite, recul de la conscience de classe… ) qu’une partie de la gauche européenne, en plein désarroi, semble s’intéresser à une « nouvelle » tactique : revendiquer elle aussi le terme « populiste », malgré toute la confusion et l’inefficacité de ce concept. L’idée est arrivée en Europe avec Podemos : considérer le populisme comme une stratégie positive, intéressante d’un point de vue électoral, et créer un « populisme de gauche » pour contrebalancer le poids du « populisme de droite ». Outre, et c’est déjà rédhibitoire, que ce terme facilite la montée de l’extrême droite dans les pays où elle est implantée et qu’il est utilisé avec un intérêt de classe très net, peut-il correspondre à une stratégie efficace ?
Tirant ses lointaines origines des États-Unis et de la Russie du 19e siècle, le « populisme » a été remis au goût du jour, dans des réalités sociales et économiques totalement différentes, par Enersto Laclau, philosophe argentin ayant surtout écrit durant la seconde partie du 20e siècle. Sa pensée a ensuite été approfondie et diffusée en Europe par Chantal Mouffe, actuelle « conseillère » de Podemos et de la France insoumise. Selon eux, pour exprimer « le rejet de la pause politique et démocratique » induite par la « globalisation néolibérale », il faut créer un « peuple » en reconnaissant le rôle des affects ( au rang desquels le « terroir », le nationalisme, le patriotisme ) et en leur donnant un contenu progressiste, pour aboutir à une frontière politique qui ne soit pas basée sur la distinction bourgeoisie/prolétariat15.
Pour comprendre pourquoi Laclau considère le peuple comme le seul sujet politique contemporain pertinent, il est important de souligner que sa pensée et celle de Mouffe s’inscrivent dans les théories postmodernistes pour lesquelles tout sujet social n’est plus un sujet de classe. L’existence de structures sociales « objectives » au sein desquelles évolue le sujet est niée par l’ensemble des postmodernismes16, qui rejettent donc également les classes comme catégorie centrale d’analyse et de lutte politique17.
La rhétorique populiste n’implique aucunement de renverser le pouvoir ou le système politique
On voit ici que, fondamentalement, il ne peut y avoir de conciliation entre le postmodernisme de Laclau, qui mènera à la stratégie « populiste », et une conception marxiste de la société : comme l’indique Fabien Escalona, le populisme pensé par Laclau part « d’une conception anti-essentialiste de la société et des individus […] Partisans d’une approche résolument constructiviste du lien politique entre subalternes, ils estiment par ailleurs que le conflit social ne s’éteindra jamais. Toute réconciliation finale, comme celle que promet la vulgate marxiste une fois le capitalisme dépassé, est pour eux fantasmatique18 ».
C’est sur ces prémisses « hors sol », puisqu’elles ne reflètent pas les logiques et mécanismes de domination primaires, que le populisme de gauche va chercher à établir une stratégie basée sur un sujet émancipateur à géométrie totalement variable ; cette stratégie recoupe les différentes tentatives théoriques et politiques effectuées depuis les années 70 pour agréger des demandes sociales hétérogènes ( genre, antiracisme, culture), sur fond de reconfiguration du monde ouvrier et de complexification des structures de classe.
Pour une gauche révolutionnaire
Podemos, en Espagne, a ainsi cherché à créer une identification entre tous les « gens » qui ne se sentaient ni représentés ni respectés par la « caste ». Selon Fabien Escalona, en Grèce, « Syriza a usé d’un langage unifiant tous les groupes se sentant lésés par les élites nationales et internationales, en mobilisant moins sur une identité commune que sur les différents “ manques ” que leur auraient fait subir ces élites, notamment via les mémorandums infligés à la population19 ». En France, Mélenchon a dénoncé les médiacrates et la caste, accompagné de Chantal Mouffe lors du rassemblement du 1er Mai où les drapeaux tricolores et la Marseillaise avaient remplacé le drapeau rouge et l’Internationale de 2012.
Quels ont été les résultats d’une telle stratégie ? Podemos s’est imposé comme une nouvelle force de gauche, ratant tout de même le sorpasso, le dépassement du parti socialiste espagnol ; malgré son élection, Syriza a perdu plusieurs centaines de milliers de membres après six mois de participation gouvernementale ; Mélenchon a obtenu 19,5 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle française de 2017, mais reste au coude à coude avec le candidat de la droite conservatrice mis en examen, François Fillon, et derrière le Front national. Si sa percée est exceptionnelle dans certaines franges de la population ( 30 % des 18-24 ans ont voté pour la France Insoumise, et plus de 40 % des votants de certains quartiers les plus défavorisés lui ont apporté leur voix), elle semble plus due à un fort ancrage programmatique à gauche qu’à la récupération des symboles français pour « faire peuple ». La lutte contre les inégalités ( citée par 51 % des électeurs ) et l’emploi ( 48 % ) sont ainsi les thèmes qui ont le plus compté pour les électeurs de Mélenchon en 201720.
L’existence de structures sociales « objectives » au sein desquelles évolue le sujet est niée par l’ensemble des postmodernismes
Il ne s’agit toutefois pas de nier l’importance d’une vague « souverainiste » sur laquelle surfent les partis de gauche cités ci-dessus ( ainsi que le FN), mais d’en relativiser les effets électoraux face à un discours de gauche cohérent. Tous deux se font écho d’une même réalité ( hausse de la pauvreté, précarisation des classes moyennes…) ; un « souverainisme » comme celui de Mélenchon met néanmoins l’accent sur le capitalisme financier, ou l’impossibilité d’appliquer une politique de gauche sous les traités européens, sans apporter de possibilité crédible de transformation. Le « peuple souverain » n’aura, pas plus qu’un « autre système monétaire » ou un « plan B », évité à Syriza de s’écraser contre le mur de la finance, des institutions capitalistes européennes, et surtout, des capitalistes grecs : à l’intérieur même des frontières, les banquiers et patrons s’opposent avec tous les leviers qu’ils ont entre les mains à l’idée d’une « souveraineté populaire », puisqu’ils tirent profit des échanges internationaux.
Passés les très relatifs premiers succès électoraux, il semblerait que la stratégie populiste achoppe à transformer le pouvoir, coincée le plus souvent dans une impasse réformiste, mais confrontée surtout à l’inefficacité de stratégies considérant le « peuple » comme sujet émancipateur pertinent, plutôt que les travailleurs, acteurs premiers de l’économie. Partout en Europe, ce n’est pas un « peuple » indéterminé qui fait trembler les gouvernements lors des mobilisations de masse, mais les grèves de dockers, d’éboueurs, de cheminots, de travailleurs d’usine et de centrales électriques, à la base des processus de production.
Progressivement, les partis de gauche arrivent dans ce cul-de-sac du « populisme ». Suite aux reculs électoraux des législatives de l’été 2016, Podemos s’est ainsi réorienté, après avoir pourtant longtemps affirmé la disparition du clivage gauche/droite. Entre Iñigo Errejón ( proche de Mouffe et Laclau), tenant du populisme « ni gauche ni droite », et Pablo Iglesias, qui a changé son fusil d’épaule en s’affirmant comme le défenseur d’une démarcation à gauche tournée vers les travailleurs, c’est Iglesias qui a été reconduit à la tête du parti à 56 % contre 34 %. Le clivage gauche/droite hérité du franquisme semble toujours structurer la conscience populaire.
Ce virage à gauche s’observe également dans plusieurs partis sociaux-démocrates européens : en Espagne, Pedro Sánchez ( ancien secrétaire général du PSOE ) a ainsi obtenu plus de 50 % des voix lors de nouvelles élections internes face à sa rivale de droite Susana Diaz. El Periodico, journal de gauche, note avec enthousiasme une « résurrection de la dialectique droite/gauche que l’on croyait dépassée21 ».
Au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn se trouve poussé par la branche conservatrice du parti travailliste ( Labour ) à aller, non pas vers un « peuple », mais vers les travailleurs et les pauvres. Dans le manifeste du Labour pour les élections anticipées de juin 2017, le slogan for the many not the few met en avant l’opposition pauvres/riches, soulignée dans l’ensemble des secteurs de la société. En plus de revendiquer la suppression des frais universitaires, le refinancement du secteur de la santé et la renationalisation du rail, Corbyn dénonce ainsi la justice de classe « devenue le privilège des riches », ou encore les clubs de première division qui ne payent pas leurs taxes, au détriment des « classes ouvrières qui construisent des clubs de foot22 ». Selon Bhaskar Sunkara du magazine Jacobin, « les protagonistes du Corbynisme […] discutent d’idées qui visent à étendre la démocratie et à remettre en question la propriété et le contrôle du capital, pas seulement la répartition de ses richesses. Quel autre parti de centre gauche a proposé un plan pour étendre le secteur coopératif, créer des entreprises appartenant aux communautés, restaurer le contrôle de l’État sur les secteurs clefs de l’économie ?23 »
Le résultat de cette clarification politique ne s’est pas fait attendre : le Labour a enregistré la plus impressionnante progression au cours d’une campagne électorale depuis la victoire de Blair en 1997 ( + 9,5 points, de 30,4 à 40,1 %)24 ainsi que l’adhésion d’au moins 100 000 membres supplémentaires depuis le début de l’année 2017. En cas de nouvelles élections, Jeremy Corbyn est maintenant donné largement gagnant devant Theresa May25. Ces développements montrent une chose très simple : la polarisation croissante à laquelle on assiste en Europe n’est pas soluble dans l’antagonisme « peuple »/« élite » qui ne fait que mener la gauche dans une impasse.
Donner corps à une radicalité ambiante
Dans une optique de lutte politique, la catégorie de « populisme » ne semble apporter ni aide à l’analyse idéologique des mouvements de droite ni stratégie valable pour la gauche, doublement perdante. D’un point de vue stratégique, la revendication de l’étiquette « populiste » par les partis d’extrême droite met surtout le doigt sur deux lacunes graves de la gauche actuelle : son positionnement centriste et réformiste et son absence du terrain, des territoires isolés où les structures de solidarité ont été les plus détruites par le néolibéralisme26.
 Prendre en compte ces préoccupations n’implique aucunement de sombrer dans l’illusion d’un peuple homogène à coups de drapeaux, d’hymnes ou de symboles, mais nécessite de désigner clairement l’ennemi actuel, le capitalisme, qui façonne ( et ce lien de subordination est essentiel ) la justice, le monde politique et les médias. D’expliquer en quoi la « crise de la représentation » est une crise systémique, qu’on ne pourra résoudre qu’en sortant du capitalisme. Politiquement, seul un virage à gauche avec une analyse profonde peut y répondre. Refuser d’utiliser le mot « populisme », ce n’est donc pas laisser des problématiques non économiques à la droite et l’extrême droite, mais au contraire, insister pour que la gauche aborde les questions du racisme, de l’immigration, de la corruption… par une analyse sérieuse, sur des bases de classe. Non que l’ensemble des problèmes sociaux y soient réductibles, mais ces bases conditionnent leur résolution et l’affrontement efficace des structures de la société.
Prendre en compte ces préoccupations n’implique aucunement de sombrer dans l’illusion d’un peuple homogène à coups de drapeaux, d’hymnes ou de symboles, mais nécessite de désigner clairement l’ennemi actuel, le capitalisme, qui façonne ( et ce lien de subordination est essentiel ) la justice, le monde politique et les médias. D’expliquer en quoi la « crise de la représentation » est une crise systémique, qu’on ne pourra résoudre qu’en sortant du capitalisme. Politiquement, seul un virage à gauche avec une analyse profonde peut y répondre. Refuser d’utiliser le mot « populisme », ce n’est donc pas laisser des problématiques non économiques à la droite et l’extrême droite, mais au contraire, insister pour que la gauche aborde les questions du racisme, de l’immigration, de la corruption… par une analyse sérieuse, sur des bases de classe. Non que l’ensemble des problèmes sociaux y soient réductibles, mais ces bases conditionnent leur résolution et l’affrontement efficace des structures de la société.
À l’image de la polarisation sociale, il semble donc urgent de revenir à une politique claire, sans ambiguïté, qui fasse appel à des concepts solides, éprouvés, affinés, pouvant prendre en compte les évolutions économiques et sociales, à un « ancrage dans une histoire politique où les forces de progrès […] étaient clairement à gauche27 ». Le « populisme » n’y contribue sur aucun tableau.
Footnotes
- Stijn van Kessel, Populist Parties in Europe : Agents of Discontent ?, Palgrave Macmillan, 2017.
- Au-delà de revirements sur la question européenne et un souverainisme encore plus affirmé, le FN n’a rien changé à son contenu raciste, xénophobe, violent, et anti travailleurs, comme le montrent les excellentes analyses de Médiapart explorant les liens forts de Marine Le Pen avec les anciens des jeunesses ultranationalistes et les cadres proches de son père. On peut consulter ce dossier en www.mediapart.fr/journal/france/dossier/front-national-notre-dossier et un contre-argumentaire en accès libre en www.mediapart.fr/journal/dossier/france/fn-2012-notre-contre-argumentaire.
- Gaspard Benilan, Marine Le Pen menace d’aller en justice : le juge dira si “ extrême droite ” est péjoratif , L’Obs, 3 octobre 2013 .
- La rédaction numérique de RTL, Marine Le Pen qualifie le FN de “ national-populiste ”, RTL, 16 octobre 2013.
- Vidéo YouTube, Marine Le Pen en Touraine : je suis populiste , 24 avril 2013.
- Rédaction de Médiapart, Le FN et l’immigration, Médiapart, 13 février 2012
- Paul Taggart, 2002, cité dans Stijn van Kessel, op. cit.
- Annie Collovald, « Populisme », Quaderni, vol. 63, no 1, 2007, p. 71-73.
- Makoto Takahashi, Maison française d’Oxford, 15 mai 2017.
- Comme l’indique Julian Mischi au sujet du populisme : « On a glissé de la mise en garde face à la manipulation du peuple au discrédit des aspirations politiques mêmes du peuple ». Cité dans : Julian Mischi : Il y a une dévalorisation générale des milieux populaires, Revue Ballast, 5 juin 2015.
- Un exemple en est donné sur le péronisme : Michel Delarche, Sur la notion de “ populisme ” et son application au péronisme, Médiapart, 27 juillet 2015.
- Terra Nova, Projet 2012. Contribution no 1, « Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 ? », cité dans Gérard Mauger, Pourquoi le populisme est-il si populaire ?, Lava, 3 mai 2017.
- Ibidem.
- Voir notamment : interview avec Gérard Noiriel, Pour une histoire populaire, Lava, 21 avril 2017.
- Sandrine Stevens, « Pour un populisme de gauche », Angles d’ATTAC, mai 2017.
- Voir l’excellent article de Filc et Ram, qui distinguent quatre grandes familles de postmodernisme et leurs interactions avec le marxisme : « Marxism after postmodernism : Rethinking the emancipatory political subject », Current Sociology, 3, 2014.
- Les postmodernistes remettent également en question la rationalité de l’histoire et l’existence de trajectoires de long terme.
- Fabien Escalona, Le populisme de gauche, au-delà des malentendus , Médiapart, 20 avril 2017.
- Ibidem.
- Etude Harris Interactive, « Le 1er tour de l’élection présidentielle 2017 », 23 avril 2017.
- Autre preuve de l’instrumentalisation du populisme par les gouvernements : El Pais, quotidien de droite, impute cette victoire à celle de « la démagogie de ceux d’en bas qui s’est imposée à la vérité […] dans un contexte politique de crise de la démocratie représentative ». Cité dans Le Courrier international, no 1386 du 24 au 31 mai 2017, p. 11.
- Vidéo YouTube, Jeremy Corbyn : This Election Is About You, 20 mai 2017
- Bhaskar Sunkara, Why Corbyn won, Jacobin, 6 août 2017.
- Fabien Escalona, Jeremy Corbyn enterre définitivement la Troisième Voie blairiste, Médiapart, 9 juin 2017.
- Rachael Revesz, Labour five points ahead and Jeremy Corbyn much more popular than Theresa May in new poll, The Independent, 25 juin 2017.
- Willy Pelletier, Vote FN, une bataille de proximité, Le Monde Diplomatique, juin 2017.
- Julian Mischi : « Il y a une dévalorisation générale des milieux populaires », op.cit.