La coalition «feu tricolore» allemande s’en tient fermement à la voie néolibérale. Ses changements de politique ne sont pas destinés à changer le statu quo, mais bien à le stabiliser.
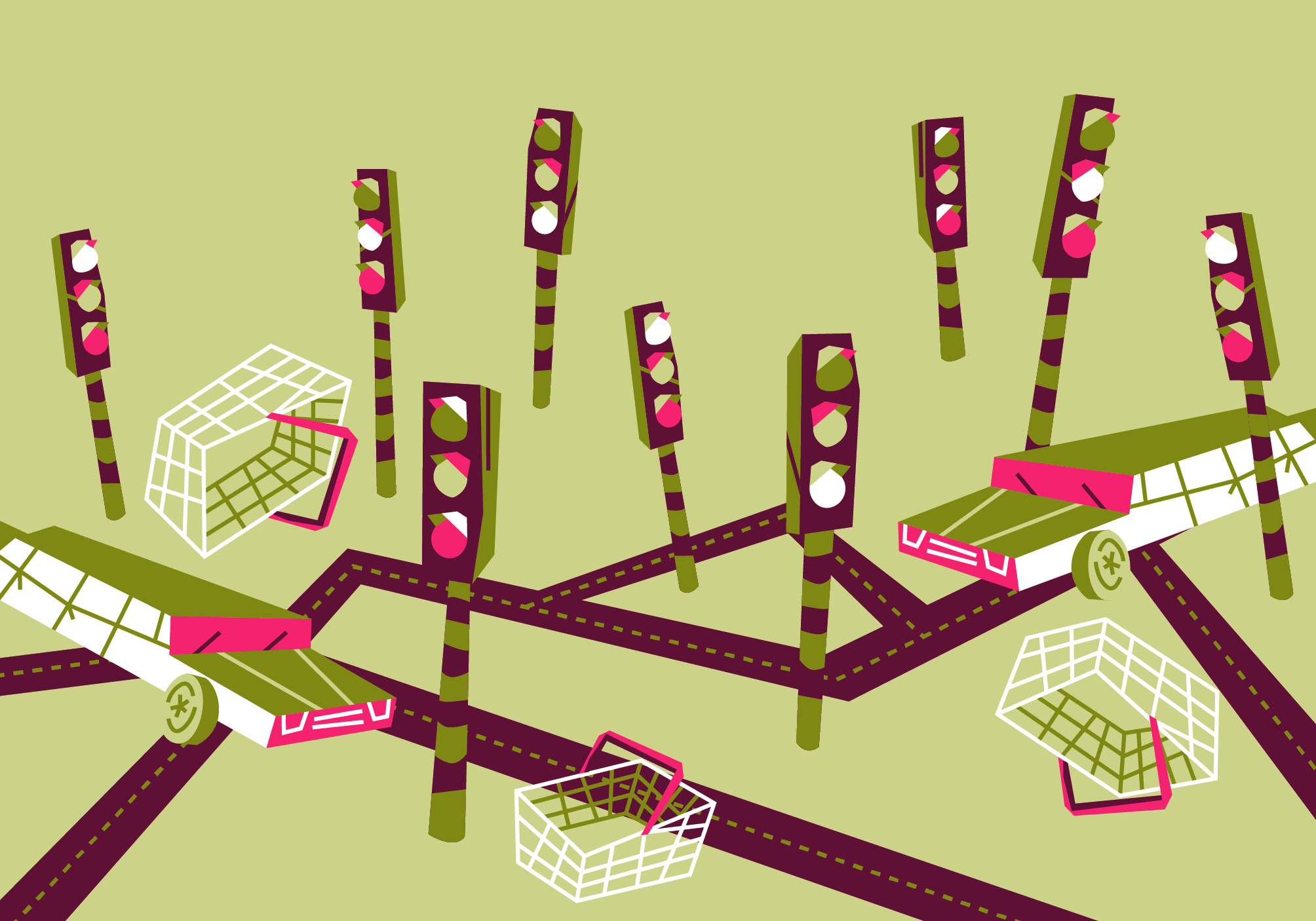
Toutes les choses, semble-t-il, doivent tôt ou tard avoir une fin. Après seize longues années, Angela Merkel a finalement quitté son poste de chancelière allemande en décembre 2021. Un record de longévité pour un dirigeant de ce pays, juste derrière son mentor politique, le démocrate-chrétien Helmut Kohl. Ce dernier avait présidé à la réunification de l’Allemagne en 1990 avant de rater sa réélection en 1998 et d’être destitué par Merkel elle-même un an plus tard.
Son mandat est marqué par une consolidation remarquable, bien que contradictoire, de la puissance politique et économique allemande. Le chômage est passé d’un niveau record de 12% lors de son arrivée au pouvoir en 2005 à 5%, l’un des plus bas d’Europe. Un afflux massif de réfugiés, venus de Syrie et d’ailleurs, et autorisé à contrecœur par Mme Merkel personnellement, a changé le visage de nombreuses villes allemandes et alimenté la montée alarmante d’une formation populiste de droite, l’Alternative für Deutschland (AfD), qui a fragmenté le paysage politique et rongé la base sociale de son propre parti. Mais surtout, l’Allemagne est devenue la puissance dominante de l’Union européenne, transformant celle-ci en ce que le sociologue Wolfgang Streeck a appelé un «empire allemand» dont l’union monétaire et les institutions technocratiques favorisent les intérêts du capital allemand au détriment des travailleurs du sud de l’Europe — mais aussi en Allemagne même, où les salaires stagnent depuis des décennies.
En ce sens, ce qui vient après Merkel ne concerne pas seulement les 83 millions de personnes qui vivent en Allemagne, mais l’ensemble des 450 millions de citoyens de l’UE pour lesquels la politique allemande a des conséquences très concrètes. Qu’ils soient conscients ou non de leur responsabilité continentale lorsque les électeurs allemands se rendaient aux urnes en septembre dernier, ils ont choisi — sans surprise peut-être — de remplacer un parti du centre par un autre. Les chrétiens-démocrates (CDU) de Mme Merkel ont été renvoyés dans l’opposition après avoir obtenu le pire résultat de leur histoire, tandis que ses partenaires de coalition junior de longue date, les sociaux-démocrates (SPD), ont réussi à se glisser à la première place avec 25,7% — un résultat toujours médiocre par rapport aux décennies précédentes, mais nettement meilleur que ces dernières années. Le résultat désastreux de Die Linke, 4,9%, a exclu toute possibilité de former un gouvernement de gauche, ce qui a permis au candidat du SPD, Olaf Scholz, d’entamer des négociations avec les Verts, avec lesquels son parti a gouverné de 1998 à 2005, et avec les Démocrates libres (FDP), qui ont gouverné avec Merkel pendant un mandat entre 2009 et 2013.
Le dernier gouvernement SPD, dirigé par Gerhard Schröder, a fondamentalement restructuré l’État-providence allemand dans l’intérêt des employeurs.
Ces trois partis gouvernent désormais au sein de la première «coalition à feux de signalisation» de l’histoire allemande — une nouvelle constellation qui s’engage à placer l’Allemagne sur une voie définie par «la liberté, la justice et la durabilité». Comme Mme Merkel avant lui, Olaf Scholz a jusqu’à présent été bien accueilli par la presse internationale. Des chroniqueurs, dans le New York Times, se demandent s’il a le potentiel d’inaugurer un renouveau social-démocrate en Europe. Le site Financial Times, qui se réfère vraisemblablement à la constellation de partis composant la coalition, a qualifié celle-ci d’ «expérience politique sans précédent».
Et en effet, certaines choses sont sans précédent: à l’instar de gestes symboliques pour la diversité consentis par l’administration de Joe Biden outre-Atlantique, le cabinet de M. Scholz compte un nombre égal de femmes et d’hommes et, autre première historique, un ministre d’origine turque. Mais, tout comme Biden, Scholz est, comme le New York Times l’a également reconnu, un «centriste post-idéologique» ayant peu à offrir en termes de vision ou d’idées ambitieuses. La coalition «feu tricolore» prévoit d’apporter plusieurs ajustements politiques notables, comme un retour sur les pires excès de la politique du marché du travail, l’accélération de la transition vers les énergies renouvelables, la légalisation de la marijuana et l’assouplissement des lois sur l’immigration et sur la naturalisation. Mais dans l’ensemble, un projet de continuité néolibérale subsiste — c’est du moins ce qu’il semblait, jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. Il est impossible de dire quelles seront les conséquences à long terme, mais il ne fait aucun doute que le gouvernement profitera pleinement de ce «changement de cap» historique, comme l’a dit M. Scholz, pour renforcer sa propre position géopolitique et étendre son influence en Europe.
Le centre d’auto-restriction
Au lendemain de l’élection, plusieurs commentateurs politiques ont craint que l’incapacité des camps traditionnels de centre-gauche et de centre-droit à consolider une majorité claire ne préfigure l’émergence des «relations néerlandaises» dans la politique allemande. Ayant en tête les neuf mois dont le premier ministre néerlandais Mark Rutte avait eu besoin pour former son dernier cabinet, ils craignaient que l’effondrement du système de partis traditionnels ne rende difficile la formation d’une coalition efficace et ne menace la stabilité qui caractérise la démocratie parlementaire allemande depuis sept décennies.
Il semblerait que les rapports concernant une telle défaillance aient été largement exagérés. Même s’il est vrai que le paysage des partis allemands s’est fragmenté au cours des deux dernières décennies, Die Linke et l’AfD siphonnant les voix des grands partis, les élections de 2021 ont démontré que cette dynamique s’est épuisée — du moins pour l’instant. La CDU a pris un grand coup électoral, mais pas au profit des deux partis protestataires, qui ont également vu leur soutien diminuer par rapport à 2017. En fait, les grands gagnants du déclin de la CDU ont été les autres partis du centre, centre pris au sens large, notamment les Verts et le SPD, qui ont tous deux enregistré des gains importants. En outre, les sondages sont restés remarquablement stables depuis l’entrée en fonction de la coalition, le mécontentement ne semblant profiter qu’à la CDU.
Le centre, donc, ne va nulle part. Et pourquoi le devrait-il? L’Allemagne reste, du moins par rapport à nombre de ses voisins européens, une société stable et prospère dans laquelle la majorité des citoyens se sent plus ou moins intégrée. Les inégalités ont indéniablement augmenté et la mobilité sociale s’est ralentie, mais il semblerait qu’aux yeux de nombreux électeurs, le pays ait relativement bien résisté aux crises récentes. Il semblerait que l’émergence d’un secteur à bas salaires — une couche semi-permanente de «travailleurs pauvres» qui représentent désormais 20% de la main-d’œuvre — ait contraint le reste de la population à la «discipline». Les sondages à long terme réalisés notamment par la ZDF, deuxième chaîne de télévision publique allemande, montrent systématiquement que les deux tiers de la population sont satisfaits de leur situation matérielle, ce qui représente une forte augmentation par rapport à il y a 20 ans, avant l’entrée en vigueur des réformes du marché du travail.
Dans ces conditions, personne ne sait comment le gouvernement pourra financer ses ambitieux programmes d’investissements climatiques.
Au cours de ses deux derniers mandats de chancelière, la stratégie de Mme Merkel a consisté à courtiser les Verts tout en adoptant juste ce qu’il fallait du programme du SPD pour le rendre politiquement non pertinent à long terme. Ce qui a longtemps semblé être un aboutissement probable a toutefois été remis en cause par le redressement inattendu du SPD et les performances maladroites du successeur qu’elle avait choisi, Armin Laschet. Par conséquent, le gouvernement qui a pris le relais à Berlin se trouvera limité par ses propres contradictions internes, la coalition «feu tricolore» cherchant à concilier les priorités parfois très divergentes des différents segments de la population. Les Verts ont bénéficié principalement des préoccupations croissantes concernant le changement climatique, et on attendra d’eux qu’ils respectent les objectifs d’émissions convenus à Paris en 2015. Le SPD, quant à lui, a bénéficié des préoccupations liées à l’accroissement des inégalités et devra augmenter les salaires et le niveau de vie des travailleurs et de la classe moyenne.
Les programmes de ces deux partis sont compatibles à presque tous les égards, et il semble naturel qu’ils gouvernent ensemble. La présence de Christian Lindner, du FDP, en tant que ministre des finances, complique toutefois le tableau. Le néolibéral mielleux qui, lors d’un récent voyage à Bruxelles, a rassuré les journalistes en leur affirmant qu’il était un «faucon amical, pas un faucon effrayant», est farouchement opposé aux types d’investissements publics proposés par ses deux partenaires de coalition pendant la campagne électorale, et il veillera à ce que rien de ce que fera le nouveau gouvernement n’aille trop à l’encontre des préférences du capital.
Dé-carboniser le Rhin
Une grande partie de l’attention accordée au nouveau gouvernement allemand s’est concentrée sur sa politique climatique, qui est désormais entre les mains du vice-chancelier vert Robert Habeck. Il dirige le nouveau ministère fédéral de l’Économie et de la Politique climatique. Ce «ministère de la Transformation», comme l’appellent certains experts bienveillants, est désormais chargé de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre tout en veillant à limiter au maximum les pertes d’emplois dans le secteur industriel. Désormais, promet la coalition, le climat fera partie intégrante de toutes les actions du gouvernement. Chaque nouvelle politique sera soumise à ce que la députée écologiste Katrin Göring-Eckhardt appelle un «contrôle climatique», ce qui signifie que chaque tonne de CO2 produite par une nouvelle mesure devra être compensée ailleurs.
Les mobilisations menées par les étudiants, comme les Vendredis pour le futur, et les catastrophes environnementales, comme les inondations en Rhénanie l’année dernière, ont propulsé le changement climatique au premier plan de la politique allemande et ont porté les Verts, dont les 16% aux dernières élections, bien que moins élevés que prévu, ont tout de même été le meilleur résultat national de leur histoire. Néanmoins, la transition vers une économie zéro émission nette est, pour le moins, délicate en Allemagne: en effet, l’économie du pays, orientée vers l’exportation, est fortement tributaire de la fabrication de biens à forte intensité énergétique, tels que les voitures, les machines et les produits chimiques, ce qui rend la transition vers des sources d’énergie entièrement renouvelables plus difficile que pour des économies largement basées sur les services, comme celle du Royaume-Uni.
C’est donc un signe de la force du FDP dans la coalition — bien qu’il y soit pourtant le partenaire le plus faible — que le nouveau gouvernement ait décidé de ne pas imposer de limitation de vitesse sur les autoroutes, une mesure pourtant simple de réduction des émissions ainsi que des accidents de voiture. Il en va de même pour la proposition d’interdiction des moteurs à combustion d’ici 2035, qui irait manifestement trop loin pour l’électorat aisé du FDP roulant en BMW. La coalition espère plutôt que 15 millions de véhicules électriques seront en circulation d’ici à 2030, véhicules pour lesquels des infrastructures de recharge seront considérablement développées.
Le ministre des Finances, Christian Lindner, a réussi à exclure toute hausse d’impôt sur la fortune.
Dans la plupart des autres domaines, les plans de la coalition représentent une concrétisation et une accélération des plans climatiques adoptés sous la présidence de Mme Merkel. Ces plans étaient déjà très ambitieux par rapport au retard accumulé par d’autres États riches comme les États-Unis. L’énergie charbonnière sera «idéalement» éliminée d’ici à 2030, soit huit ans plus tôt que prévu, l’objectif étant que 80% de la consommation énergétique de l’Allemagne proviennent de sources renouvelables. Si tout se déroule comme prévu, le nouveau gouvernement prévoit d’achever la transition vers une économie totalement neutre en carbone d’ici 2045, ce qui en ferait, selon les termes du député vert allemand Sven Giegold, «le premier grand pays industrialisé sur la voie d’un système d’énergie véritablement renouvelable».
Certains des investissements planifiés sont prévisibles: le gouvernement prévoit de développer considérablement les capacités des énergies éolienne et solaire, en réservant 2% des terres à l’énergie éolienne, en triplant les installations éoliennes en mer et en quadruplant la production d’énergie solaire grâce à l’installation obligatoire de panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments commerciaux.
Le gouvernement a également annoncé de gros investissements dans la modernisation du chauffage et de l’isolation dans tout le pays, à l’instar des programmes qui ont déjà été lancés au Danemark. Conformément aux traditions ordolibérales de l’Allemagne, la majeure partie de cette transition doit être mise en œuvre par une combinaison de subventions, de crédits et d’incitations financières visant à stimuler le secteur privé. Les entreprises du secteur de l’énergie verront leurs bénéfices garantis par le gouvernement.
Mais, en attendant, comment combler l’écart entre l’offre et la demande en matière de production d’énergie? Contrairement à la France voisine, l’énergie nucléaire ne fera pas partie du mélange. Les Verts allemands ont vu le jour lors des manifestations antinucléaires des années 1970 et nourrissent depuis lors une profonde aversion, sans doute plus émotionnelle que rationnelle, pour l’énergie nucléaire. Bien que l’opinion publique ait changé d’avis sur la question ces dernières années, les trois dernières centrales nucléaires du pays doivent déjà être mises hors service d’ici la fin de l’année — un autre héritage politique de l’ère Merkel.
À leur place, la coalition prévoit un rôle important pour l’énergie hydrogène prétendument «verte», dont la capacité doit être doublée d’ici 2030, ainsi que pour le gaz naturel. L’Allemagne consomme déjà un tiers de toutes les importations de gaz russe en Europe, et le gaz représente actuellement plus d’un quart de la combinaison énergétique totale de l’Allemagne. Cette tendance se poursuivrait dans un avenir prévisible, le gaz ne devant disparaître du bouquet énergétique qu’en 2040. À la suite de l’invasion russe, Robert Habeck a lancé l’idée d’importer du gaz naturel liquéfié des États-Unis et d’Australie. Certains commentateurs ont même émis l’hypothèse d’une remise en service de certaines centrales nucléaires dont déciderait le gouvernement.
La réponse à la question de savoir si ces mesures seront suffisantes pour que l’Allemagne atteigne les objectifs fixés par l’accord de Paris est sujette à débat. Des universitaires écosocialistes comme Markus Wissen ont fait valoir que les plans actuels ne laissent aucune place à des retards imprévus ou à d’autres obstacles inattendus. En outre, la nouvelle coalition n’a pas expliqué comment elle respecterait son engagement en matière de financement international en faveur du climat, ce qui laisse penser qu’en matière de lutte contre le changement climatique, le mot d’ordre reste «l’Allemagne d’abord».
Qui va payer les factures?
La nature conflictuelle de l’orientation du nouveau gouvernement est visible dans tous les domaines, mais elle n’est peut-être nulle part plus évidente que dans ceux de la politique fiscale et économique. En tant que chancelier social-démocrate, Scholz n’a pas la tâche facile. Le dernier gouvernement SPD sous Gerhard Schröder a promulgué une série de mesures, connues sous le nom d’Agenda 2010, qui ont fondamentalement restructuré l’État-providence allemand dans l’intérêt des employeurs. Les allocations de chômage ont été réduites de manière drastique et des incitations négatives ont été imposées aux chômeurs de longue durée, tandis que la protection contre le licenciement a été assouplie et que les cotisations d’assurance sociale ont été augmentées pour les employés.
Depuis lors, la série de grandes coalitions dirigées par Merkel (dont la dernière a vu Scholz occuper le poste de ministre des finances) entre la CDU et le SPD a adopté un certain nombre de réductions d’impôts pour les riches, tandis que les impôts sur les classes moyennes et inférieures sont restés les mêmes ou ont progressivement augmenté. Les trois partis «feu tricolore» ont décidé de remédier à cette situation et, depuis leur arrivée au pouvoir, ils se sont engagés à instaurer des allègements fiscaux pour les revenus faibles et moyens à hauteur de 11 milliards d’euros au cours des prochaines années — même si la manière exacte de le faire reste floue. Dans le même temps, le ministre des Finances, M. Lindner, a réussi à exclure toute hausse d’impôt pour les riches ou pour les entreprises, ce qui complique tout projet d’augmentation des dépenses au cours des quatre prochaines années.
L’augmentation du salaire minimum à 12,00€ reste en dessous des estimations propres au gouvernement allemand quant au minimum vital.
Bien que les sociaux-démocrates et les Verts aient fait campagne sur l’augmentation des dépenses publiques et la rupture avec l’orthodoxie du schwarze Null (déficit zéro) des gouvernements précédents, la présence du FDP garantit pratiquement que ces promesses ne seront pas tenues. La coalition s’est déjà engagée à ne pas augmenter les impôts et prévoit de rétablir, d’ici 2023, le frein à l’endettement qui avait été suspendu pour lutter contre le marasme économique induit par la pandémie. Dans ces conditions, personne ne sait comment le gouvernement pourra financer ses ambitieux programmes d’investissements climatiques. Selon toute vraisemblance, la coalition se trouvera soumise aux mêmes restrictions budgétaires que celles qui ont caractérisé l’ère Merkel. L’argent est là, mais le lobby des entreprises à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement ne veut pas le donner. Il est certain que, sans mesures de justice fiscale, les inégalités croissantes continueront à augmenter.
Quelques miettes supplémentaires
S’inspirant prétendument des écrits du philosophe américain Michael Sandel, la campagne électorale du SPD s’est fortement appuyée sur la notion de «respect» — pour les travailleurs à bas salaire, les mères célibataires et tous ceux qui se sont sentis marginalisés sous le gouvernement de Mme Merkel — et sur la nécessité de construire une société inclusive. Si l’on fait en sorte que les travailleurs se sentent respectés et reconnus, a soutenu M. Scholz, ceux-ci échapperont aux chants des sirènes des populistes, de gauche comme de droite. Étant donné que Scholz lui-même appartient à l’aile droite du SPD et qu’il n’a jamais été connu comme un ami particulièrement fidèle des syndicats, le pari semble étonnamment avoir été gagné: le SPD revient au pouvoir en promettant de s’attaquer aux inégalités sociales et de corriger les excès de ces dernières années.
Politiquement, cela signifie principalement une augmentation du salaire minimum de 9,60€ à 12,00€, tandis que sur le plan rhétorique, cela a consisté à vanter publiquement la vertu des travailleurs des services et des soins de santé pendant la pandémie, censés être les «vrais héros» qui ont permis à la société de fonctionner pendant les lockdowns. Le ministre fédéral SPD du Travail et des Affaires sociales, Hubertus Heil, a également exprimé son intention de soutenir les syndicats en promouvant les comités d’entreprise et en faisant pression sur les employeurs pour qu’ils signent des accords salariaux sectoriels — l’étalon-or du régime d’emploi allemand qui a été mis à mal par la flexibilisation et la libéralisation ces dernières années. Cela pourrait en fait avoir des répercussions sur l’équilibre des forces sur le marché du travail, comme la co-détermination (ce modèle unique de cogestion entre syndicats et entreprises en Allemagne) qui est en recul dans de nombreux secteurs depuis des années.
Prévue pour entrer en vigueur en octobre, l’augmentation du salaire minimum représente sans aucun doute une réelle amélioration par rapport au statu quo, tout comme l’intégration dans les structures de cogestion des branches où le travail flexible et à bas salaires est la norme. Cependant, le montant de 12€ reste en dessous des propres estimations du gouvernement allemand quant au minimum vital, et les mécanismes permettant à l’avenir de relier le salaire minimum à un indice du coût de la vie restent vagues. En outre, et depuis des décennies, les salaires allemands sont à la traîne de ceux des autres travailleurs européens. Et le salaire minimum actuel, introduit en 2015, est assez faible par rapport aux normes européennes.
La ministre écologiste des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s’est déclarée favorable au renforcement, voire même à l’élargissement de l’OTAN.
Ainsi, en augmentant le salaire minimum et en faisant du bruit sur l’élargissement des comités d’entreprise, le gouvernement semble relâcher une certaine pression au nom de la paix sociale et pour garder les syndicats de son côté. En contrepartie, les syndicats et les sociaux-démocrates ont accepté d’étudier la possibilité de «flexibiliser» les horaires de travail, ce qui revient à détricoter la journée de huit heures qui est la norme pour tous les salariés allemands depuis plus d’un siècle. Cet accord qui brise les tabous, bien qu’il n’en soit qu’à ses débuts, pourrait à l’avenir ouvrir la voie à d’autres attaques contre la journée de huit heures.
Un tour de passe-passe similaire peut être observé dans l’approche de la coalition à l’égard de Hartz IV, l’ensemble largement raillé de sanctions et d’incitations négatives imposées aux chômeurs de longue durée, introduit dans le cadre des réformes de l’Agenda 2010. Le programme lui-même va faire peau neuve car le Bürgergeld ou le «revenu citoyen», et certains de ses aspects les plus odieux doivent être adoucis ou complètement supprimés. Heil a même annoncé un supplément de 150 € par mois, en plus des 449 € habituels, pour les bénéficiaires qui choisissent de suivre une formation professionnelle supplémentaire ou un enseignement complémentaire.
Ces politiques constituent certainement un changement bienvenu par rapport au régime draconien auquel les citoyens les plus pauvres d’Allemagne ont été soumis au cours des deux dernières décennies, mais elles restent insuffisantes aux yeux de la plupart des syndicats et des associations de protection sociale. Un certain nombre de mesures — telles que la soustraction des allocations familiales des prestations sociales, un taux de base beaucoup trop bas pour les chômeurs avec enfants et, surtout, un certain nombre de sanctions punitives — resteront en place. Dans le pire des cas, ils pourraient alimenter la croissance du secteur à bas salaires en subventionnant la formation et les salaires, au lieu de conduire à son abolition.
La place au soleil de l’Allemagne
L’ancien vice-président des États-Unis, Hubert Humphrey, aurait dit un jour que «la politique étrangère est en fait une politique intérieure avec un casque». Cela s’applique à la politique européenne et étrangère de l’Allemagne en général. Les politiques de la nouvelle coalition à l’égard de ses voisins sont intimement liées aux intérêts des entreprises allemandes à l’intérieur du pays, comme elles l’étaient sous Merkel. Il n’est donc pas surprenant que la coalition «feu tricolore» la reprennait là où elle s’est arrêtée, en prolongeant et en approfondissant des tendances déjà amorcées au cours de la dernière décennie.
Sous le couvert de l’Union européenne, la nouvelle coalition adopte une rhétorique européiste que la chancelière précédente avait tendance à éviter (ne serait-ce que par crainte de s’aliéner ses partisans les plus patriotes). Le SPD, les Verts et le FDP, en revanche, représentent tous des segments de la population favorables à l’UE et sont largement d’accord sur la nécessité de «renforcer l’Europe». Tous trois avaient dans leur programme électoral des passages appelant à faire de l’UE une sorte d’État souverain à part entière. Bien qu’un tel projet ne soit probablement que des paroles en l’air, la ministre écologiste des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a fait de l’ «autonomie stratégique» européenne la ligne directrice de sa politique étrangère.
La vacuité du discours sur l’Europe en tant que «démocratie souveraine» est visible dans sa proposition d’utiliser la conférence en cours sur l’avenir de l’Europe comme une opportunité pour une convention constitutionnelle jetant les bases d’un «État européen fédéral». Pour ceux qui l’auraient manquée, la Conférence sur l’avenir de l’Europe, qui a débuté en 2019 et se termine plus tard cette année, est une «occasion unique et opportune pour les citoyens européens de débattre des défis et des priorités de l’Europe», parrainée par le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne. Pour l’essentiel, la Conférence propose que les citoyens de l’UE soumettent leurs propositions pour l’avenir de l’Union sur une plateforme numérique. Certaines sont ensuite sélectionnées pour être discutées dans des «panels de citoyens», qui envoient à leur tour leurs propositions favorites aux trois institutions susmentionnées pour «examen».
Tout renforcement de l’Europe se fera donc dans le dos des Européens, dans le cadre de négociations supplémentaires entre des technocrates non élus, et donc, en fin de compte, dans une large mesure, aux conditions allemandes. En effet, le plus grand obstacle à l’approfondissement de la démocratie européenne — le Traité de l’UE sur la «stabilité, coordination et gouvernance», qui prévoit un déficit annuel maximal de 3% du PIB et une dette maximale de 60% du PIB, ne sera pas modifié. Dans cette vision de l’Europe, les Européens devraient être libres d’élire qui ils veulent et d’écrire autant de courriels constructifs à la bureaucratie de Bruxelles qu’ils le souhaitent. Mais les résultats politiques doivent rester dans des couloirs étroitement définis, garantis non pas par un vote populaire, mais par une obligation contractuelle.
Sur la scène mondiale, la nouvelle coalition a promis d’inscrire davantage la politique étrangère allemande dans une «perspective européenne» et a annoncé une «offensive en matière de politique de désarmement». Cette offensive, à la définition nébuleuse, semblait toutefois se limiter entièrement au soutien des efforts internationaux en faveur du désarmement nucléaire, et ne parlait guère de la réduction des dépenses militaires ou des ventes d’armes de l’Allemagne. Après tout, l’Allemagne est le quatrième plus grand exportateur d’armes au monde, rapportant 9 milliards d’euros pour la seule année 2021. Ces bénéfices — et ces emplois — constituent une partie mineure, mais non négligeable, de la réussite économique de l’Allemagne.
Et depuis la dernière semaine de février, les cartes ont été rebattues. En effet, à la suite de l’invasion russe, l’Allemagne s’est rapidement engagée à envoyer des armes de défense à l’Ukraine, rompant ainsi la promesse formulée par la ministre écologiste des affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors de la conférence de Munich sur la sécurité. La ministre avait alors affirmé que l’Allemagne ne ferait rien de tel. Les quelques milliers de roquettes promises par l’Allemagne peuvent sembler dérisoires. Si on les considère comme une manifestation de solidarité avec l’Ukraine assiégée, c’est même un geste qui pourrait être compréhensible. Mais à peine un jour plus tard, Olaf Scholz a prononcé un discours saisissant devant le Parlement, annonçant que le gouvernement engagerait la somme exceptionnelle de 100 milliards d’euros pour moderniser l’armée allemande. Il a également décidé de porter les dépenses militaires à 2% du PIB, conformément aux directives de l’OTAN — ce qu’Angela Merkel n’aurait jamais pu faire.
La victoire retentissante de la «Deutsche Wohnen & Co. enteignen» démontre que la politique socialiste est capable de capter l’imagination de la majorité.
Difficile d’exagérer la tournure dramatique que prennent les événements pour la politique allemande. Dans les jours qui ont suivi l’intervention de M. Scholz, des analystes et des personnalités politiques ont appelé l’Allemagne à réorganiser son armée. Si l’armée allemande se consacrait essentiellement à des missions internationales de maintien de la paix, elle doit devenir une armée défensive musclée capable de faire face à la menace russe sur son propre territoire. Certaines figures politiques conservatrices, désireuses de damer le pion au nouveau chancelier dans son élan vers la guerre, sont allées jusqu’à envisager la participation de l’Allemagne à un arsenal nucléaire européen. D’autres ont avancé l’idée de rétablir le service militaire obligatoire, suspendu par Mme Merkel en 2011. Enfin, plus surprenant encore, des sondages indiquent que les mesures prises par Scholz sont très largement populaires, dans un pays qui, depuis 1945, s’est montré profondément opposé aux conflits militaires. Un changement radical, sans nul doute.
Les mesures prudentes prises par Mme Merkel et les gouvernements précédents en faveur du réarmement sont bien peu de chose par rapport à ce qui s’annonce. Le réarmement allemand est désormais une affaire bipartisane — les organisations de jeunesse des Verts et du SPD ont affiché une légère opposition symbolique mais, pour l’essentiel, l’ensemble de l’establishment politique marque son accord. Des projets tels qu’une armée européenne, qui semblaient autrefois presque impossibles en raison de l’opposition allemande, pourraient bientôt, à défaut de se concrétiser, devenir une possibilité très réelle.
Ciel bleu pour un capitalisme plus vert
Pour l’instant, il semble que la coalition «feu tricolore» soit bien en selle. Le malaise économique du début des années 2000 et la série de crises politiques et économiques qui ont suivi semblent avoir réduit les attentes des électeurs et consolidé un centre politique qui, bien qu’excluant une minorité importante de travailleurs, reste stable pour le moment. La plupart des Allemands semblent satisfaits et acceptent un capitalisme un peu plus vert avec quelques améliorations progressives du système social plutôt que de faire un saut dans le grand inconnu politique. De plus, la confrontation avec la Russie va probablement renforcer la popularité du gouvernement, au moins pour les prochains mois.
Mais comme le dit le vieil adage: «Il faut se méfier de l’eau qui dort.» L’apparente solidité du gouvernement ne doit pas être considérée comme une garantie que les quatre prochaines années se dérouleront sans aucune friction. Outre la défaite écrasante de Die Linke, l’autre grande nouvelle de la soirée électorale du 26 septembre pour la gauche a été la victoire retentissante de la «Deutsche Wohnen & Co. enteignen», un référendum organisé à Berlin pour savoir si le gouvernement de la ville devait ou non exproprier l’un des plus grands propriétaires du pays et rapatrier environ 200 000 appartements dans le domaine public. Le vote a représenté le point culminant d’une campagne de plusieurs années à laquelle ont participé des milliers de militants et qui a recueilli le soutien de centaines de milliers d’autres, démontrant que même dans une Allemagne apparemment pacifiée et prospère, les politiques socialistes sont capables de capter l’imagination de la majorité.
Le succès de la campagne ne doit pas être exagéré — le référendum n’était pas contraignant et son résultat sera probablement rejetté à plus tard et finalement ignoré par le gouvernement de centre-gauche de Berlin. Néanmoins, cette campagne rappelle que même un État-providence riche comme la République fédérale présente des contradictions et des tensions sociales qui peuvent être exploitées comme base de protestation sociale par les forces progressistes et socialistes. Qu’il s’agisse de la montée des tensions à la frontière russe, de la montée en flèche des prix de l’énergie ou de turbulences économiques imprévues — avec les deux partis de centre-gauche au gouvernement et la majorité de l’opposition reléguée à la CDU à droite et à l’AfD à l’extrême droite —, les forces de gauche bénéficient d’un cadre idéal pour transformer les échecs de la coalition en succès. Pour le bien de tous, espérons qu’elles s’y mettent.




