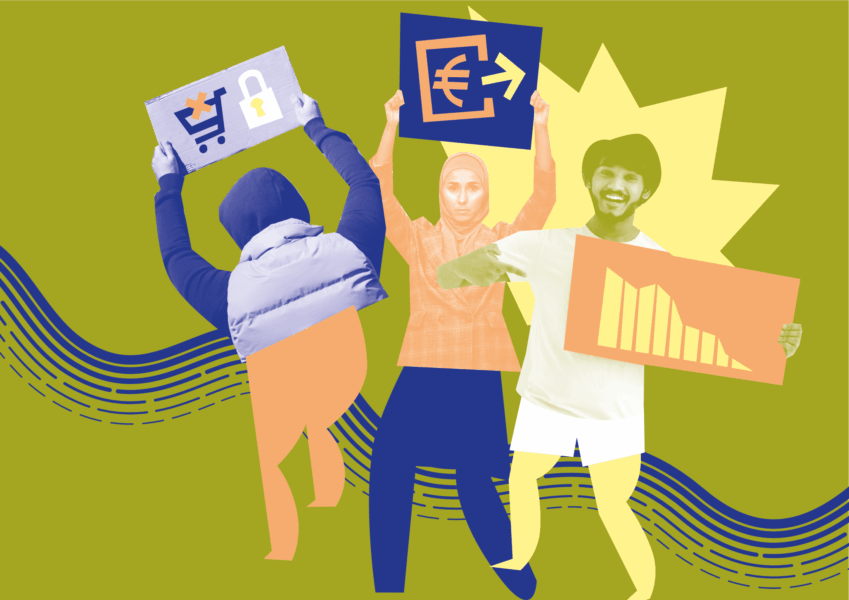Rendre l’impensable pensable, contre toute objection pratique. Dans un premier ouvrage passionnant, Grenskolonialisme (Colonialisme des frontières), Albina Fetahaj défend une idée audacieuse: un monde sans frontières. «Plus les capitaux ont circulé librement à travers le monde, moins les gens ont été libres.»

«Pas de frontières ouvertes. Pas de frontières du tout», déclare Albina Fetahaj dans un éclat de rire provocateur. La jeune Brugeoise, née en Belgique de parents réfugiés kosovars, met immédiatement la conversation sur les rails. Son livre est un exercice de réflexion philosophique visant à remettre en question les principes évidents du débat actuel sur les migrations. «On parle toujours de frontières ouvertes ou fermées, mais on ne s’interroge jamais sur ce qu’est réellement une frontière. Je veux montrer qu’une frontière est plus qu’une ligne liée à des États-nations sur une carte morte. La frontière est une structure de pouvoir qui perpétue l’inégalité, un mécanisme discriminatoire et hiérarchique. Mon plaidoyer va au-delà de la suppression des frontières, il remet en question l’ensemble de l’ordre politique et social mondial. Le sujet, ce n’est pas tant la politique frontalière, mais la frontière en tant que concept.»
Sylvie Walraevens : Vous reconnaissez qu’un monde sans frontières est une idée utopique: impossible pour certains, indésirable pour beaucoup. Pourquoi voulez-vous quand même en parler?
Albina Fetahaj : Parce que le débat est bloqué. Nous ne pensons qu’en termes de faisabilité. Nous n’arriverons à rien de cette manière. Au lieu de bricoler à la marge, nous avons besoin d’une imagination radicale. Pendant très longtemps, j’ai moi aussi cru à la ‘réforme’ des frontières. Aujourd’hui, je me rends compte que cela est tout simplement impossible. Nous sommes tellement enfermés dans un paradigme frontalier-colonial que nous avons du mal à en sortir. Nous avons d’innombrables conversations sur les migrations et les frontières, mais nous ne remettons jamais en question la frontière elle-même. C’est absurde! Nous grandissons dans une société qui impose ses structures violentes comme si elles étaient naturelles et immuables. Je veux me libérer de cette évidence. La frontière est intrinsèquement violente. Nous ne pouvons nous libérer de cette violence que lorsque la frontière disparaît.

Nous devons oser rêver d’un monde radicalement différent. Les idées utopiques sont nécessaires, car elles créent un contre-récit, un idéal pour lequel se battre. Sans garantie de succès, comment pouvons-nous encore rendre l’impensable, un monde sans frontières, concevable? L’abolition de l’esclavage et la décolonisation formelle ont longtemps semblé irréalisables pour la plupart des gens, même pour ceux qui souffraient de ces structures oppressives. Pourtant, ils ont continué à défier les limites du concevable. Être bloqué dans un certain mode de pensée est paralysant. Un monde sans frontières est également incompatible avec le récit et l’ordre social et politique actuels. Pourtant, comprendre la frontière comme une construction sociale provoque immédiatement un débat très différent. Il ne faut pas chercher dans mon livre une feuille de route pratique. C’est une invitation à réfléchir ensemble et à travailler avec ces idées. C’est une quête collective.
Pourquoi la langue est-elle si importante?
Outre les structures, nous devons également remettre en question les concepts qui nous sont transmis. Les mots ne sont pas neutres. Ils ont du pouvoir et déterminent non seulement la façon dont nous comprenons le monde, mais aussi la façon dont nous nous y rapportons et dont nous nous rapportons les uns aux autres. Ce n’est qu’en remettant en question certains termes que l’on se rend compte de leur violence. C’est pourquoi je parle systématiquement de «personnes faites migrantes», à l’instar du politologue Koen Bogaert et par analogie avec les «personnes faites esclaves». Cela souligne que «migrant» n’est pas une catégorie naturelle, mais une catégorie créée précédée d’un processus violent. Les médias font souvent la distinction entre les réfugiés et les migrants. Les réfugiés sont rapidement poussés dans un récit particulier. Ils doivent constamment justifier d’où ils viennent, pourquoi ils sont ici, ce qu’ils ont vécu. Comme s’ils devaient mériter d’être ici. C’est violent. Cela signifie qu’ils doivent constamment prouver leur humanité.

Cela crée également un «autre» binaire: des personnes qui ne méritent pas d’être ici parce qu’elles émigrent pour des raisons économiques. Nous ne considérons pas qu’il s’agit d’une raison suffisante. En soulignant constamment que les réfugiés méritent d’être ici parce qu’ils ont fui la violence, on dit en même temps que cela ne s’applique pas à ceux qui ne fuient pas la guerre. Mais pourquoi les raisons économiques ne sont pas de bonnes raisons pour fuir son pays? Pour quelqu’un qui possède un «bon» passeport, il suffit d’avoir le sens de l’aventure pour se déplacer. Pourquoi sommes-nous autorisés à aller partout alors que d’autres doivent prouver qu’ils ont été persécutés ou qu’ils ont subi des traumatismes, simplement pour être considérés comme des humains? Qui sommes-nous pour décider que d’autres ne devraient pas avoir ce droit? Ces catégories reproduisent donc certains rapports de force politiques et sociaux. Personne n’est migrant par nature, on est d’abord un être humain. Le migrant n’existe que par rapport à la frontière. Sans frontières, il n’y a pas de migration, seulement de la mobilité. En utilisant systématiquement le terme ‘migrants faits migrants’, j’oblige le lecteur à considérer le processus violent qui se cache derrière ces catégories soi-disant neutres.
Vous disséquez longuement le concept de «frontière», que vous considérez comme un concept existentiel et productif. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Les frontières sont existentielles parce qu’elles désignent le fondement de notre monde et la manière dont nous sommes en relation les uns avec les autres. Les frontières divisent les personnes entre les catégories de citoyens, de migrants, de réfugiés ou de touristes et les y maintiennent. En ce sens, elles sont également productives. Elles définissent l’équilibre des pouvoirs et notre place dans cette société. Ainsi, les frontières attribuent des valeurs différentes à différents corps et déterminent tout d’abord l’accès à la mobilité, mais aussi à l’éducation, aux soins ou à l’emploi. Elles déterminent quelles vies sont importantes et lesquelles ne le sont pas, lesquelles sont considérées comme jetables, exploitables et, en fin de compte, moins humaines.
Pour vous, les frontières sont aussi une tromperie, des revendications arbitraires. Pourtant, ne résultent-elles pas le plus souvent de conventions transparentes entre pays, après une paix ou un échange?
C’est vrai. Les frontières sont des accords. Autrement dit, elles ne reposent sur rien d’autre que sur l’acceptation collective de leur existence et de leur valeur. Nous acceptons ces accords interétatiques, mais cela ne les rend pas ‘réels’. La faune et le réchauffement climatique ne connaissent pas de frontières. Seuls les humains pensent avoir besoin de frontières, même si elles sont violentes. N’oublions pas que la plupart des frontières du continent africain, par exemple, ne sont pas le fruit d’un accord entre deux pays africains, mais ont été tracées par les puissances européennes à l’époque de la colonisation.
Une frontière n’est pas intrinsèquement violente et discriminatoire. Ne sont-ce pas les réalités politiques locales qui déterminent le fonctionnement d’une frontière?
La frontière entre la Belgique et la France n’est effectivement pas violente, mais on ne peut jamais limiter une frontière au local. Les frontières existent au sein d’un système mondial d’États-nations, ce qui perpétue les inégalités. Par exemple, il est impossible de séparer la frontière entre la Belgique et la France des frontières extérieures européennes. Avec la naissance de l’Union européenne et le développement d’un marché unifié est née l’illusion que nous allions nous retrouver dans un monde hypermondialisé et donc sans frontières. Mais que voit-on? Les frontières n’ont jamais disparu, elles ont simplement été déplacées. En Europe, les frontières intérieures ont disparu, mais cela n’a été possible qu’en renforçant les frontières extérieures. Dès que les contrôles de mobilité ont disparu au sein de l’espace Schengen, le budget consacré à la sécurité et à la militarisation des frontières extérieures de l’Europe a explosé. Les frontières intérieures ne sont donc plus violentes, mais les frontières extérieures bien.
Les frontières ne sont-elles pas inhérentes à la nature humaine? Les gens ont besoin de sécurité, de clarté et de reconnaissance. Les réfugiés ne tournent pas le dos à leur pays d’origine, seulement à la situation qui y règne. Même les personnes sans-abri délimitent leur espace avec leurs ressources limitées.
C’est vrai, mais il y a une différence entre une personne sans-abri qui délimite son espace et les pays riches et occidentaux qui font la même chose. Ces derniers ont surtout construit leur richesse et l’ont souvent volée. Les personnes qui viennent frapper aux portes de l’Europe sont souvent originaires de ces anciens pays colonisés. La sécurité est donc un faux prétexte. Dans mon livre, j’appelle cela une forme de ‘victimisation imaginaire’. Ceux qui n’ont jamais connu autre chose que le fait de dominer continuent à s’illusionner sur la nécessité d’opprimer pour contrer une sorte de colonisation à rebours. Ils construisent des frontières massives. Mais pour moi, ce n’est pas tant la barrière physique qui compte. Aujourd’hui, les frontières ont une portée beaucoup plus large que, par exemple, dans l’Empire romain. À l’époque, elles étaient destinées à arrêter l’ennemi, mais une fois que les gens étaient à l’intérieur, ils pouvaient être intégrés. Aujourd’hui, c’est différent, la frontière est élastique. Elle suit les individus, parfois au plus profond des États-nations. Si vous séjournez dans un pays sans avoir les bons papiers, la frontière vous suit toujours. Votre illégalité dépend de cette frontière. Ce n’est pas naturel.
Comment interpréter les rêves de liberté nationale des peuples? Ne s’agit-il pas également d’un désir de délimitation? L’universalisme séduit peu de monde.
Un monde sans frontières, ce n’est pas nécessairement la même chose qu’un unique grand pays. L’ordre mondial des États-nations tel que nous le connaissons aujourd’hui est relativement récent. Il est apparu après la Seconde Guerre mondiale et la soi-disant vague de décolonisation. En réalité, il n’y a jamais eu de véritable vague de décolonisation. Le modèle de l’État-nation est devenu universel. Si de nombreux penseurs décoloniaux de l’époque avaient eu leur mot à dire, le monde aurait pu être complètement différent. En effet, le rêve de liberté de nombre d’entre eux s’étendait au-delà de l’État-nation. En effet, ils ont œuvré à obtenir une indépendance formelle, mais leur lutte ne s’arrêtait pas là. Kwame Nkrumah, le premier Premier ministre ghanéen né en Afrique, a tenu un discours nationaliste et anticolonial. Dans le même temps, il voyait dans l’État-nation un instrument permettant de modifier l’ordre international inégal et racial et les relations de pouvoir. Le fait d’avoir son propre État-nation, avec des frontières d’État colonial et un siège aux Nations unies, crée surtout l’illusion de l’égalité. C’est pourquoi il a voulu utiliser l’État-nation dans la lutte internationale et a cherché à créer une fédération de pays africains. En effet, même quand les pays sont formellement décolonisés, cela ne signifie pas qu’ils deviennent économiquement indépendants. Il voulait unir les forces pour créer une contre-force. Cette conception de l’État-nation est très différente de celle qui prévaut aujourd’hui. Le projet décolonial envisagé par ces acteurs anticoloniaux avait donc une dimension à la fois nationale et internationale.
Une objection pratique à l’abolition des frontières est qu’elles constituent un moyen efficace d’assurer une répartition saine de la population mondiale. Ce n’est pas tant la mobilité des personnes qui pose problème, mais leur installation collective dans les meilleurs endroits. Une concentration de toute la population mondiale au même endroit, ce n’est pas souhaitable, qu’en pensez-vous ?
Je ne pense pas que tout le monde veut venir ici. Sans frontières, une mobilité plus dynamique verrait peut-être le jour. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays colonisés ont cherché à obtenir leur indépendance. Pour étouffer ce rêve nationaliste, les puissances européennes comme la Grande-Bretagne ont introduit la libre mobilité à l’intérieur de l’empire. Tout citoyen des colonies britanniques était libre d’aller et venir au sein de la mère patrie. Pourtant, dans la pratique, cela ne s’est produit que dans une mesure limitée. Cependant, les craintes d’un éventuel ‘repeuplement’ ont rapidement limité cette mobilité libre.
Un monde sans frontières, c’est une mobilité libre, mais aussi un nouvel ordre politique et social: un monde où ceux qui ne veulent pas émigrer ne sont pas contraints de le faire. La crise migratoire dont nous parlons aujourd’hui est essentiellement une crise de déplacement. Ouvrir les frontières ne signifie pas s’attaquer aux injustices.
Votre livre donne beaucoup d’informations sur le contexte historique. Quelles sont les époques qui ont façonné l’ordre mondial actuel?
Le droit international et le droit des migrations ont tout à voir avec l’expansion coloniale et la prétendue ‘découverte’ des Amériques en 1492. La traversée de Colomb et de ses successeurs est à l’origine de tout. La mobilité a joué un rôle important dans tout projet colonial. Pour s’installer ailleurs, pour occuper un pays, les Européens ont eu besoin de légitimité. La législation sur l’immigration élaborée à l’époque affirmait que la libre mobilité était essentiellement un droit des individus, chacun était libre d’émigrer. Cependant, dans la pratique, cela concernait principalement les échanges commerciaux. Si un peuple vous refusait le droit de circuler librement dans son pays, il s’agissait en fait d’un acte de guerre, qui légitimait une intervention et l’occupation du pays. Pendant trois siècles et demi, cette idée de libre mobilité a dominé. Il est à noter que le droit des migrations, en principe universel, ne s’applique en pratique qu’aux Européens blancs. Dès que ceux-ci se sont déplacés librement, les Africains ont été enlevés et transportés de l’autre côté de l’océan pour travailler dans les plantations d’outre-mer. En ce sens, je veux montrer que la mobilité de l’un et l’immobilité de l’autre vont de pair. C’est toujours le cas aujourd’hui.
Comment ça?
Les personnes venant de pays riches, surtout occidentaux, et les capitaux peuvent circuler librement et la prospérité qui en découle ne peut être assurée que par l’immobilité des autres. En créant des pays à bas salaires et en rendant les personnes présentes ici illégales, c’est-à-dire immobiles. Les sweatshops d’aujourd’hui sont les plantations d’autrefois. L’existence des pays à bas salaires n’est pas naturelle, ils sont créés artificiellement par les frontières.
Au 19e siècle, les papiers d’identité ont pris une nouvelle signification. Qu’en pensez-vous?
Après l’abolition de l’esclavage, les grandes puissances ont cherché un nouveau moyen de maintenir des plantations rentables puisqu’elles ne pouvaient plus utiliser la main-d’œuvre bon marché des esclaves. Le 1er août 1834, jour de l’entrée en vigueur de la loi britannique sur l’esclavage, la Grande-Bretagne a commencé à envoyer des travailleurs contractuels à l’île Maurice. Cette île est devenue le centre d’une expérience majeure. Le travail contractuel n’était plus considéré comme de l’esclavage, car les travailleurs partaient volontairement. Avant d’être autorisés à monter sur le bateau, ils devaient accepter ce contrat et donc donner leur accord. Il est intéressant de noter qu’au moment où la catégorie «esclave» a été abolie, la catégorie «migrant» est apparue. Les migrants ont dû prendre en charge le travail lourd des esclaves. En théorie ils étaient payés, mais en réalité ce n’était pas toujours le cas. Les contrats étaient donc un moyen de maintenir le système lucratif des plantations. Mais ce système de travail contractuel était également basé sur l’exploitation. Les mêmes papiers qui ont servi à faciliter la mobilité au 19e siècle servent à l’empêcher au 20e et en particulier au 21e siècles. Ils sont déployés en fonction des intérêts occidentaux.
Aujourd’hui, l’Occident domine, mais dans un passé lointain, des personnalités comme Alexandre le Grand ou Gengis Khan régnaient en maîtres. À l’avenir, l’Inde et la Chine éclipseront l’Occident en tant que superpuissances. Jugez-vous leur impérialisme et leur politique frontalière aussi sévèrement?
Le concept de ‘colonialisme’ n’est pas exclusivement européen. Par le biais du capitalisme, il est devenu un système mondial. Dans le futur, la Chine et l’Inde pourraient prendre ce pouvoir et nous devrons alors juger ces régimes avec le même regard critique. Il y a de fortes chances qu’un manque de vigilance vis-à-vis de la colonisation contemporaine amène au pouvoir de nouvelles forces qui reproduiront, à leur manière, les mêmes structures oppressives. Nous devons en être pleinement conscients. Pourtant, je refuse de penser que la pensée coloniale est inévitable.
Un monde fermé avec des frontières rigides semble en contradiction avec une autre réalité contemporaine: l’ordre néolibéral et la mondialisation. Que voulez-vous dire par un monde fermé?
En réalité, ce n’est pas aussi contradictoire que nous le pensons. Le débat sur les frontières est souvent hypermondialisé. On suggère que nous vivons dans un ‘monde aux frontières ouvertes’. Cependant, cela revient à regarder l’histoire et le présent avec des lunettes blanches et européennes. Le bouleversement néolibéral qui s’est opéré à partir des années 1970 a rendu le capital sans frontières. Cela devait conduire à la croissance économique et au développement. Mais plus les capitaux ont circulé librement dans le monde, moins les gens sont devenus libres, ou du moins les personnes racialisées du Sud. Des frontières de papier ont d’abord été introduites, mais lorsqu’il s’est avéré qu’elles n’arrêtaient pas les gens, on a construit des frontières physiques. Alors qu’il n’existait que 12 murs physiques au moment de la chute du mur de Berlin en 1989, on en trouve aujourd’hui plus de 70 dans le monde. Le monde non occidental a très peu ressenti l’hypermondialisation. Plus le capital est libre, moins les humains le sont. C’est une lame à double tranchant. Et ce n’est pas vraiment surprenant, puisque le capital libre a besoin d’un travail immobilisé. En réalité, la régulation du travail n’est pas le sujet principal.
La migration de la main-d’œuvre pourrait-elle faire partie de la solution aujourd’hui?
La migration de la main-d’œuvre est souvent très négative pour les pays d’origine. Ils perdent leurs meilleures forces après avoir investi dans leur formation. En outre, les travailleurs migrants continuent de vivre en fonction de notre économie. Ils doivent répondre à nos conditions, à l’idée que nous nous faisons d’un ‘bon migrant’. Et si la situation économique se dégrade? Est-ce qu’on les renvoie? En outre, les travailleurs migrants sont souvent employés dans le cadre de ‘contrats temporaires’. Par exemple, ils ne travaillent ici que pendant quelques années, puis ils doivent repartir. Ce qui est ironique, c’est que le système lui-même est permanent. Les gens font donc souvent profil bas, en tout cas s’ils veulent revenir la prochaine fois.
Que pensez-vous de la politique frontalière du président étasunien Donald Trump depuis l’entrée en vigueur de son second mandat?
Le discours de Trump se concentre sur l’expulsion des personnes vivant aux États-Unis sans papiers en règle. Leur présence est présentée comme le résultat d’un échec politique. En réalité, l’économie ne fait que profiter de ces personnes. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le discours sur l’expulsion favorise le capital. Dans la pratique, on constate que ces personnes ne sont pas expulsées en masse, mais qu’elles sont placées dans un état de ‘déportabilité’. Cela signifie qu’elles ont constamment peur d’être expulsées. Elles sont donc extrêmement vulnérables face à l’exploitation, ce qui profite aux grandes entreprises. L’entrepreneur Trump a également eu recours à cette main-d’œuvre bon marché et ‘illégale’ par le passé.
Le gouvernement Arizona promet lui aussi des politiques migratoires et frontalières plus strictes. Cela ne colle pas exactement avec votre discours.
Absolument. L’accord de l’Arizona prévoit les mesures les plus strictes jamais adoptées. Ce qui m’étonne particulièrement, c’est la façon dont des partis dits progressistes s’engagent dans cette voie. Les gens sont tellement déshumanisés que nous oublions presque à quel point les politiques actuelles sont déjà violentes. L’État belge et Fedasil ont été condamnés plus de 10 000 fois ces dernières années pour ne pas avoir respecté les lois nationales et internationales à l’égard des demandeurs de protection internationale. Des personnes meurent chaque jour à nos frontières extérieures. Ils sont battus ou laissés pour morts. Nous ne devrions jamais normaliser cela. Cela reste le cœur de mon argumentation.
Vous affirmez que nos frontières suivent les lignes raciales. Les blancs sont admis, les personnes racialisées ne le sont pas.
Dans mon livre, j’explique que les frontières sont des structures qui créent la race. La racialisation ne se préoccupe pas seulement de la couleur de la peau, mais aussi de la religion et de la culture. Les Européens sont également racialisés. Tout tourne autour de la ‘blancheur’. Cette ‘couleur’ est devenue la norme: elle attribue une valeur différente aux différents corps, qui s’organisent ensuite dans un ordre hiérarchique. Tout le monde doit se conformer à cette norme. Plus vous êtes ‘blanc’, plus votre vie a de la valeur. Regardez l’interdiction des musulmans par Trump I. Ou la guerre en Ukraine. Des réfugiés blancs ont été autorisés à franchir la frontière et ont reçu de l’aide, alors qu’un réfugié syrien avait été battu et renvoyé un an plus tôt à cette même frontière entre le Bélarus et la Pologne. Seuls ceux qui se rapprochaient de l’‘européanité’, et donc de la ‘blancheur’, ont pu et été autorisés à franchir la frontière. N’est-ce pas raciste? Les Européens au Maroc dont le permis de séjour a expiré ne doivent pas s’inquiéter; ils ne seront jamais confrontés aux mêmes politiques frontalières violentes que les personnes munies du ‘mauvais passeport’. Aux États-Unis, les Européens et les Canadiens constituent le groupe le plus important de personnes sans-papiers, mais ils finissent rarement dans des centres de déportation. Même s’ils restent là en permanence, ce n’est pas un problème. Toutes les personnes sans papiers valides ne seront pas expulsées, mais la menace crée une telle incertitude que les gens s’enfoncent encore plus dans l’illégalité. Et lorsqu’elles sont exploitées, elles ne peuvent en parler à personne.
La libre mobilité résout-elle donc la question des frontières? C’est dans notre tête.
En effet, les frontières sont essentiellement idéologiques. Elles servent une cause: notre croyance obstinée en la supériorité des blancs. Par conséquent, je souligne également la façon dont les frontières sont liées à la race, à la classe, à la sexualité et au genre. Les frontières déterminent qui peut circuler librement et qui ne le peut pas, souvent sur la base du passeport. Nous pensons que la vie de ceux qui ne jouissent pas de la même liberté de mouvement a moins de valeur. Il est important de toujours souligner la façon dont les frontières fonctionnent au sein d’un système colonial-capitaliste mondial construit sur des hiérarchies.
C’est pourquoi vous considérez la migration comme une forme de résistance?
Toutes les personnes qui émigrent ne le font pas consciemment comme un acte de résistance. Aujourd’hui, nous ne pourrions pas facilement considérer les ‘personnes faites migrantes’ comme des activistes. Les réfugiés tournent avant tout le dos à la mauvaise situation de leur pays. Bien sûr, personne ne migre pour critiquer la frontière et la violence frontalière-coloniale, mais cet acte devient un acte de résistance. En migrant, ils perturbent l’ordre mondial, de sorte que les superpuissances recourent de plus en plus à la violence et commencent à ériger des frontières. Leur mobilité est une forme de résistance quotidienne. Les migrants n’adhèrent pas au plan préétabli de ‘vous restez là et vous allez travailler pour nous dans des sweatshops’, précisément parce qu’ils sont bien conscients que le surdéveloppement d’une partie du monde est inextricablement lié au sous-développement d’une autre partie. Les gens suivent la richesse parce qu’ils ont aussi droit à leur part. Mais aujourd’hui, cela n’est possible presque uniquement en émigrant ici. Dans cette confrontation, leur mobilité devient un acte politique.
L’abolition des frontières est-elle pour vous l’objectif final, après avoir d’abord supprimé les injustices du système? Ou, à l’inverse, voulez-vous d’abord abolir les frontières au nom d’un monde plus juste?
Je considère l’ouverture des frontières comme une étape intermédiaire: plus humaine, mais toujours pas équitable. Le problème est que les frontières sont intrinsèquement violentes. Tant qu’il y aura des frontières, aussi humaines ou justes soient-elles, des personnes seront expulsées et des familles séparées. Nous pouvons toujours évoluer. La décolonisation consiste à démanteler les structures injustes actuelles et à réfléchir à la manière de faire les choses différemment. Il s’agit d’un projet créatif, créateur de monde. Il est important de comprendre que le monde actuel est un monde fabriqué. Son fonctionnement actuel n’est pas inéluctable. Nous pouvons aussi construire une nouvelle société. Je refuse d’accepter que l’ordre mondial actuel soit le meilleur que l’humanité puisse imaginer.
Enfin, vous ne demandez pas de faire preuve d’empathie ou de générosité à l’égard des réfugiés et des migrants. Pourquoi?
Leur mobilité est une forme de réparation décoloniale. Nous devons toujours replacer cela dans le contexte de l’ordre mondial et colonial qui est inégal. L’empathie entretient une sorte de relation de pouvoir. Il me semble absurde d’exiger de l’empathie de la part de structures injustes. Je crois davantage à la solidarité. La solidarité consiste à prendre conscience que cet ordre mondial et colonial a aussi un effet sur nous. Si les structures des personnes les plus opprimées, les personnes en exil, disparaissent, ces structures disparaîtront également pour nous. Leur combat est aussi le nôtre. En donnant la priorité à l’inclusion radicale, nous pouvons tous contribuer à l’écriture d’un nouveau récit décolonial, une nouvelle façon d’être ensemble qui ne repose pas sur les hiérarchies nationales existantes. La liberté, c’est justement le rejet de cela.»