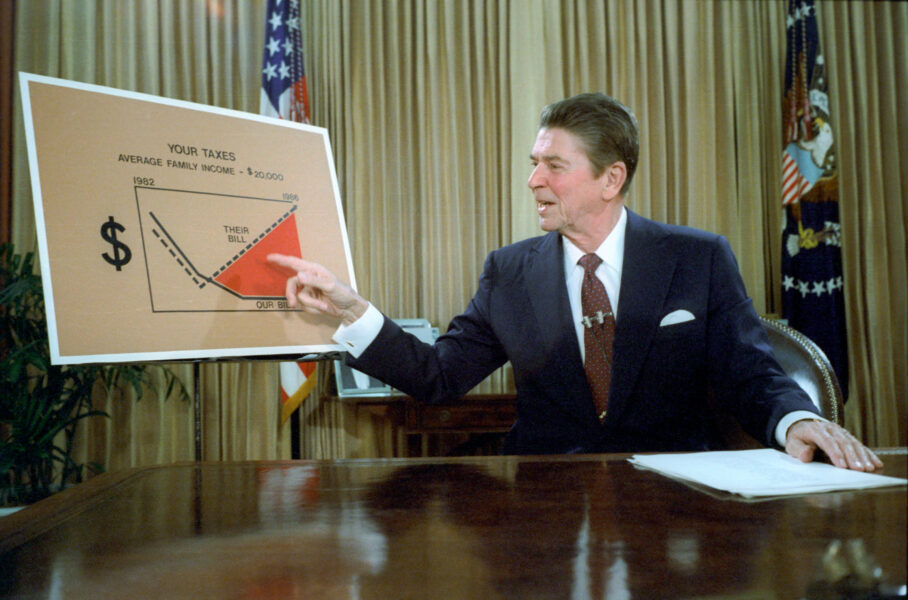Critique de Napoléon de Ridley Scott (2023). D’ordinaire symbole national glorieux entretenu par la classe dirigeante, Napoléon est dépeint comme un petit empereur bien maladroit et mièvre évoluant paradoxalement dans des scènes de combat grandioses.

Le Napoléon incarné par Joaquin Phoenix est délibérément décevant. Son bicorne emblématique, par exemple : d’abord, il le porte de travers, ensuite, il tombe, puis on le voit arboré par Joséphine (Vanessa Kirby) ; en Russie, l’empereur le déchire avec rage ; enfin, à Waterloo, il est transpercé d’une balle provenant d’un mousquet anglais. Une démystification aussi audacieuse de l’iconographie napoléonienne devrait être bienvenue. Après tout, Napoléon est aux Français ce que serait aux Anglais un mélange de Henri VIII et de Churchill : un symbole d’unité nationale, un alibi pour la légitimité de la classe dirigeante, l’occasion de maintes courbettes, de moulinets d’épées et de phrases creuses. Et bien que Napoléon ait relativement peu de monuments nationaux en son honneur et beaucoup moins d’avenues et de boulevards à son nom que de Gaulle, ou même que la plupart de ses propres généraux, il reste l’un des grands symboles nationaux, un statut que le président actuel, Emmanuel Macron, semble désireux d’entretenir. Tout en prenant soin de rappeler, à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021, les « fautes » de l’empereur (pouvoir arbitraire, rétablissement de l’esclavage, bilan humain des guerres napoléoniennes à travers l’Europe), le président français a célébré le « bâtisseur et le législateur » à l’origine des codes civil et pénal français et (sans employer ces termes) de l’appareil d’État centralisé1. Dans la foulée des turbulences provoquées par sa réforme des retraites, largement décriée, M. Macron a déclaré : « Nous avons devant nous cent jours d’apaisement, d’unité, d’ambitions et d’actions au service de la France », allusion à la dernière campagne de Napoléon, Les Cent-Jours, une référence peut-être inopportune compte tenu de la façon dont cette campagne s’est achevée2. De telles allusions fallacieuses au mythe napoléonien, destinées à s’assurer la docilité de l’opinion publique, n’ont rien d’exceptionnel en France depuis 200 ans. Curieusement, toutefois, la version de Ridley Scott, malgré son côté démystificateur, n’est ni aussi subversive ni aussi rafraîchissante qu’elle aurait pu l’être.

Beaucoup ont souligné l’inexactitude flagrante de ce dernier Napoléon, et pour cause. La falsification de faits historiques ne devrait guère surprendre dans le cadre d’une épopée historique. De nombreux biopics lui ont été consacrés, sans qu’aucun ne soit très fidèle aux faits. Le Napoléon d’Abel Gance (dans l’épopée muette de cinq heures, Napoléon, 1927) est un grand intellectuel : le film surestime probablement le génie et les desseins élevés du personnage. Le Napoléon de Marlon Brando (dans Désirée, 1954), quant à lui, est plus fringant que ne l’était vraisemblablement le général corse, et certainement plus grand. Ces falsifications ne sont pas fortuites : leur but premier est de rendre l’œuvre plus divertissante. Le propos est peut-être un peu facile, mais après tout, ces films sont censés divertir.
En revanche, Stendhal, dans La Chartreuse de Parme (1839), fait traverser à son héros Fabrice une bataille de Waterloo singulièrement peu dramatique. Il passe le plus clair de la journée à chercher le champ de bataille, allant jusqu’à interroger un compagnon hussard : « mais ceci est-il une véritable bataille ? ». Il ne comprend jamais vraiment ce qui se passe, et n’éprouve qu’horreur et embarras. Très vite, son cheval est réquisitionné et Fabrice se retrouve assis, les fesses dans la boue, à pleurer de frustration. Cette version démystifiée est convaincante par la représentation réaliste, si peu passionnante, qu’elle donne d’une bataille du 19e siècle. Stendhal savait de quoi il parlait (il a d’ailleurs écrit une biographie de Napoléon, publiée à titre posthume) 3, et a choisi consciemment de privilégier des détails précis mis en scène dans un registre comique plutôt que dramatique. Ces études de cas peuvent être considérées comme paradigmatiques : d’une part, des représentations fictives truffées de faits inventés à des fins de glorification et de divertissement ; de l’autre, des versions démystificatrices, avec le mérite du détail réaliste à défaut de celui de l’épopée grandiose.
Curieusement, l’histoire de Ridley Scott, malgré son côté démystificateur, n’est ni aussi subversive ni aussi rafraîchissante qu’elle aurait pu l’être.
Reste que le nouveau film de Ridley Scott confronte les spectateurs à un paradoxe peu familier : il est tout à la fois extrêmement peu crédible et résolument démystificateur, en même temps invraisemblable et délibérément peu convaincant. Les costumes sont exquis, les décors magnifiques, les charges de cavalerie tonitruantes. L’exécution de Marie-Antoinette (Catherine Walker) est spectaculaire : elle se déroule par ailleurs au mauvais endroit, au mauvais moment, et de surcroît en présence de Napoléon, ce qui est historiquement erroné. Néanmoins, la scène rend bien. Dans la bataille de Waterloo, on voit Napoléon en personne mener une charge de cavalerie, sabre au clair : le résultat est aussi impressionnant sur le plan visuel qu’il est absurde. Certes, Scott impressionne par son sens de la composition des plans pour le grand écran : à une autre époque, on l’aurait vu peintre à la cour, travaillant sur des toiles immenses. Dans le même temps, non seulement Napoléon n’arrête pas de perdre son chapeau, mais on le voit à bout de souffle pendant les scènes de combat, puis somnoler pendant les conseils de guerre, et jeter de la nourriture sur les enfants. En effet, même les scènes de bataille, qui sont sans doute le point fort du film, semblent avoir été tournées dans des sites qui ne ressemblent en rien aux champs de bataille réels, avec un nombre assez restreint de figurants. Nous sommes loin des dizaines de milliers de soldats qui ont livré bataille lors des guerres napoléoniennes, tout comme nous sommes loin des 15.000 figurants costumés du magistral Waterloo (1970) de Sergueï Bondartchouk : la plupart des sources estiment à environ 500 le nombre de figurants qui ont pris part à la production de Ridley Scott.
Quel est l’effet de cette étrange alchimie ? Non seulement l’invraisemblance de la performance de Joaquin Phoenix (aussi brillante soit-elle) est hypnotique, mais elle est si contagieuse qu’elle semble déteindre sur les personnages eux-mêmes. On a l’impression de voir des gens accoutrés de costumes d’époque pour satisfaire un penchant pervers, se livrer à des jeux de rôles obscurs et douteux. En d’autres termes, même les protagonistes semblent incapables d’échapper à l’incrédulité et à la maladresse que suscite le film. Dès leur premier échange, Joséphine demande à Napoléon : « Quel est ce costume que vous portez ? », ce faisant, elle exprime la question que le public voudrait poser à Joaquin Phoenix. Dans la scène au cours de laquelle Napoléon tombe résolument amoureux de Joséphine, qui arbore à ce moment-là une coiffure sexy qui évoque davantage Jean Seberg dans À Bout de Souffle (1960) que la plupart des portraits contemporains, commence par cette question : « Quand vous me regardez, voyez-vous une aristocrate ? ». Lorsque Phoenix-Napoléon répond « non », il pourrait parler en notre nom à tous. À mesure que la scène se poursuit et que Joséphine se hasarde à des allusions grivoises sur la vie sexuelle débridée de son ex-mari et la sienne, on croirait assister moins à un échange entre aristocrates français de la fin du 18e siècle, voguant au gré des changements de régime, qu’aux coquetteries d’un couple anglais ou étasunien du 21e siècle qui auraient décidé de s’appeler « mon général » et « madame » pour égayer leur vie de couple.

Cette première scène donne le ton de tout le reste. Dans un effort suprême, Phoenix-Bonaparte se met dans la peau de l’architecte de l’Europe et annonce à Joséphine : « Mon destin est plus puissant que ma volonté et mes affections doivent céder le pas aux intérêts de mon peuple ». Pour toute réponse, elle éclate de rire, et qui peut lui en vouloir ? On a vu Joséphine réprimander tendrement Napoléon en le traitant d' »homme dégoutant » et se plaindre, moins tendrement, de « passer des heures à nettoyer après [lui] ». On la voit lui cracher au visage : « Tu es gros » et Napoléon de rétorquer : « J’aime manger, j’avoue ! » Leurs échanges sont souvent prosaïques, même à l’écrit. Sur la carte postale que Napoléon envoie depuis sa campagne d’Égypte, on peut lire : « Les paysages sont extraordinaires et la chaleur étouffante », tandis que sur une autre carte envoyée d’Austerlitz, quelques années plus tard, Bonaparte commente : « Mon Dieu, qu’il fait froid ici ». Bientôt, tous les personnages tombent dans le bavardage : « Heureuse de vous rencontrer ! » s’exclame la mère de Napoléon (Sinéad Cusack) en voyant Joséphine pour la première fois ; ou dans cette autre scène où le tsar de Russie (Édouard Philipponnat) déclare, en s’adressant à l’empereur d’Autriche (Miles Jupp) peu avant la bataille d’Austerlitz, « Je suis là pour toi, François ». Celui-ci devra serrer les dents jusqu’à la fin de la bataille, quand Bonaparte, victorieux, lui lance à son tour : « François, quel plaisir de te rencontrer enfin ». Napoléon lui-même, après avoir avoué « Vous me manquez » à Joséphine, s’adresse dans les mêmes termes à ses hommes du cinquième régiment d’infanterie. Dans une scène moins tendre, il menace d’administrer une « fessée » au tsar Alexandre.
Tout en prenant soin de rappeler, à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021, les « fautes » de l’empereur, Macron a célébré le « bâtisseur et le législateur » à l’origine des codes civil et pénal français et de l’appareil d’État centralisé.
Dans de tels moments, Napoléon ressemble plus à un épisode des Sopranos (1999-2007) qu’à une épopée historique. Les parallèles entre Phoenix-Napoléon et Tony Soprano ne manquent pas : tous deux sont représentés comme issus d’un pays latin et d’un milieu modeste ; tous deux mangent trop ; tous deux semblent s’ennuyer dans un bureau (l’une des rares fois où nous le voyons derrière un bureau, Phoenix-Napoléon et son frère se livrent à un jeu consistant à jeter des noix dans une urne) ; tous deux semblent doués d’une certaine intelligence rusée, mais aucun n’est studieux ou cultivé ; tous deux ont du mal à maîtriser leurs accès d’humeur et ainsi de suite. On ne s’étonnera pas d’apprendre que Ridley Scott a déclaré voir Napoléon comme une sorte de gangster. 4
Il s’agit cependant d’un gangstérisme qui rappelle davantage The Sopranos que, par exemple, Le Parrain (1972), bien qu’il y ait des ressemblances ici aussi – il s’agit d’un gangstérisme de banlieue, domestique, peu glorieux. Inutile d’ajouter qu’il est difficile d’imaginer que cette banalité et cette maladresse délibérées soient fortuites. Ce qui rend surtout ce film mémorable – et qui fera que certains spectateurs, mais seulement certains, voudront aussi l’oublier — c’est la façon dont il allie le banal, le familier et la platitude à des scènes terriblement ambitieuses et à un budget dépassant largement les cent millions de dollars. C’est comme si M. Scott voulait avoir le beurre et l’argent du beurre, en représentant son protagoniste comme un mafioso sexuellement perturbé tout en exigeant du public qu’il se délecte de sa grandeur.
La gangstérisation de Napoléon, plutôt comique, n’est pas sans mérite, tout comme la suggestion par le film d’une continuité entre l’Ancien Régime et l’Empire, plutôt qu’entre la Révolution et l’Empire, quand Napoléon, guidé par Joséphine de Beauharnais, après tout une courtisane de l’Ancien Régime, danse maladroitement au milieu d’aristocrates somptueusement vêtus, sirotant du vin dans des salons faiblement éclairés et lourdement meublés, au son d’une musique baroque. Ces scènes sont innombrables : leur atmosphère suffit à montrer que ce Napoléon n’est pas le continuateur de l’œuvre de la révolution. Dans cette mesure, le Napoléon de Ridley Scott souscrit, bon gré mal gré, à une vision généralement de gauche des années 1790, qui souligne la rupture entre le projet révolutionnaire égalitaire et décentralisateur qui existait jusqu’en 1795 et, par la suite, la « république des propriétaires » centralisée 5 développée à travers le Directoire, le Consulat et l’Empire.
Une telle démystification ne construit toutefois pas une trame narrative convaincante, et le film ne parvient pas à produire un récit alternatif qui soit susceptible de retenir sinon la sympathie, du moins l’attention des spectateurs ou d’évoquer un contrepoint viable au Napoléon démystifié. Ce n’était pas le cas des précédentes épopées historiques de Ridley Scott, généralement construites autour d’un antagonisme – des Duellistes, le tout premier long métrage du réalisateur britannique, au Dernier duel : ces films opposent habituellement l’ascension sociale d’un méchant à la légitimité douteuse, de Gabriel Feraud (Harvey Keitel) à Jacques Legris (Adam Driver) au déclin d’un héros aux façons rustres mais au grand coeur. Fine lame, bon meneur d’hommes, il défend la justice auprès des laissés-pour-compte (gladiateurs, hors-la-loi), parfois au prix de sa vie. À l’exception du plus suave Armand d’Hubert (Keith Carradine) dans Les Duellistes, tous ses personnages – Maximus (Russel Crowe) dans Gladiator, Balian (Orlando Bloom) dans Kingdom of Heaven (2005), Robin des Bois (Russel Crowe, 2010) – entrent dans ce moule. Jean de Carrouges (Matt Damon) dans Le dernier duel (2021) pourrait être une autre incarnation du même type, mais poussé à ses limites et usé jusqu’à la corde : le héros bourru est devenu rustre au point d’être bestial ; mal aimé, il se bat seul pour une femme abusée dont il s’avère qu’il abuse lui aussi, tandis que l’audace politique, l’initiative et la sympathie ont basculé du côté de Marguerite.
Les esclaves des colonies françaises libérés par la Révolution (et ré-esclavagisés par Napoléon en 1802) ne font que des apparitions symboliques en tant que figurants d’arrière-plan ou rôles mineurs.
Napoléon fait une fois encore exploser la structure du duel – mais sans Marguerite de Carrouges : c’est Harvey Keitel sans Keith Carradine, Joaquin Phoenix sans Russel Crowe. Les contrepoints potentiels à la brutalité impériale de Napoléon sont neutralisés ou pas même envisagés : Robespierre (Sam Troughton), à la fois trop radical et pas assez soldat, est rapidement expédié comme un lâche grassouillet incapable de tirer un coup de feu (le film tire parti de son suicide raté). Par contraste avec la romantisation mielleuse des Français révolutionnaires dans Les Misérables (2012, pour la version cinématographique), le peuple est ici dépeint comme une foule assoiffée de sang et imprévisible – peut-être un symptôme de la méfiance des élites culturelles à l’égard du » populisme » dans le sillage du référendum sur le Brexit, des Gilets jaunes et de la « prise d’assaut » du Capitole.
Napoléon lui-même aurait, au besoin, pu être présenté comme un républicain, jouant Napoléon contre Napoléon : le jeune Corse révolutionnaire, à qui Beethoven a dédié une symphonie, qui a ensuite trahi ses propres principes en devenant empereur des Français. Après tout, Napoléon lui-même a voulu souligner son républicanisme dans son dernier exil, où exprimant son admiration pour la république des États-Unis d’Amérique, se décrivant comme « rien de plus qu’un George Washington couronné » et déclarant : « Je ne suis pas moins citoyen pour être devenu empereur » 6. Sans avoir à accepter ce récit révisionniste, le film aurait pu investir le conflit, incarné par une seule figure, entre le républicanisme et l’absolutisme. Ridley Scott n’a toutefois pas de temps à perdre avec Napoléon le législateur et le républicain : soit parce qu’il est réticent à présenter Napoléon sous un jour aussi positif, soit parce qu’il a perdu toute espèce de foi et d’intérêt dans le républicanisme lui-même. Exeunt la campagne italienne et la pierre de Rosette.
Les esclaves des colonies françaises libérés par la Révolution (et ré-esclavagisés par Napoléon en 1802) ne font que des apparitions symboliques en tant que figurants d’arrière-plan ou rôles mineurs, alors que la question coloniale est déplacée vers l’Égypte et le terrain culturel de l’art pillé. Son lien avec les planteurs d’Outre-mer par l’intermédiaire de Joséphine (née en Martinique) n’est jamais mis en avant, pour que celle-ci puisse rester une héroïne féministe d’appoint…
En l’absence d’énergie charismatique ou d’intérêt narratif, la volonté de démystification dans Napoléon ne suffit pas à générer un récit et se dissout dans des scènes satiriques vaguement reliées entre elles.
Néanmoins, bien que Joséphine soit dépeinte en victime d’un monde où sa survie dépend de son utérus et de mariages sexuellement peu satisfaisants, sa résistance se résume à l’initiative érotique et aux moues larmoyantes lorsque Napoléon se débarrasse d’elle à la demande de la redoutable Madame mère dans une dichotomie maman/putain qui ne préserve guère la perspective féminine comme contrepoint viable. A la place, les spectateurs doivent se contenter d’une combinaison hétéroclite d’opprimées – des reines (la courageuse Marie-Antoinette menée à la guillotine), des chevaux (spectaculairement mis en pièces par l’artillerie) et des soldats (le nombre de morts des guerres napoléoniennes est hypocritement annoncé à la onzième heure, une fois que Scott a embarqué le film et ses spectateurs dans son fantasme épique).
Naturellement, un sens de la conjoncture historique, la représentation de pressions sociales contradictoires ou une invitation à lire le film à contre-courant — c’est peut-être demander beaucoup à un film d’action hollywoodien. Mais tel n’est pas nécessairement le cas. Par exemple, dans Enemy of the State (1998), réalisé par Tony Scott (le frère de Ridley Scott), des agents de la NSA complotent l’assassinat d’un membre du Congrès et organisent ensuite une opération criminelle pour brouiller les pistes : le film dénonce la corruption de l’État profond aux États-Unis bien des années avant WikiLeaks. Parallèlement, le film Black Hawk Down (2001) de Ridley Scott offre, entre autres, un portrait dévastateur de l’excès de confiance de l’armée américaine et ses débâcles.
En l’absence d’une source alternative d’énergie charismatique ou d’intérêt narratif, la volonté démystificatrice de Napoléon ne suffit pas à générer un récit et se dissout dans des scènes satiriques vaguement reliées entre elles, rendant les deux premiers tiers du film plutôt ennuyeux. Dans Les duellistes, le seul autre film de Ridley Scott se déroulant à l’époque des guerres napoléoniennes, la période sert de toile de fond à un premier plan captivant : la rivalité meurtrière entre les deux protagonistes. Dans cette dernière épopée de Ridley Scott, les guerres napoléoniennes sont également réduites à un contexte – mais un contexte vide de toute substance. Dans le dernier tiers, cependant, une fois Napoléon promis à une défaite certaine face aux forces alliées de la contre-révolution, une fois qu’il cesse de représenter une quelconque menace, le film trouve son rythme et son point de mire, et nous offre l’épopée funeste de l’empereur-soldat à la redingote grise et au visage sombre, qui culmine dans une reconstitution assez poignante de la bataille de Waterloo, dans laquelle les spectateurs se rangent naturellement du côté de Napoléon plutôt que de celui d’un Wellington bedonnant et pompeux (interprété avec brio par Rupert Everett). Enfin, Scott semble réaliser le film qu’il voulait faire depuis le début.
Une hypothèse pour expliquer cette contradiction formelle serait que le film exprime des contradictions conceptuelles plus profondes, entre un sentiment vague, mais fort, de son réalisateur que Napoléon ne peut pas servir de héros contemporain, d’une part, et, d’autre part, son incapacité à se rallier à un contre-récit ou à une force alternative (qu’il s’agisse du peuple, de la République, de Robespierre, de la monarchie ou même de Wellington). En d’autres termes, le Napoléon de Scott ne croit plus en la possibilité d’une épopée bourgeoise (le film classique du Grand Homme, un genre dans lequel Hollwyood reste pourtant prolifique – il n’y a qu’à voir Oppenheimer et Maestro cette année), mais il se montre incapable d’avancer vers une vision jacobine du monde, ou même de revenir à une vision royaliste.
Dans le dernier tiers, une fois que Napoléon est confronté à une défaite certaine face aux forces alliées de la contre-révolution, le film trouve son rythme et son point de mire.
Pour reprendre la formule célèbre de Napoléon : « Quand je ne serai plus là, tout le monde dira : Ouf ! ». Pour certains de nos dirigeants actuels, cela reste vrai ; pour d’autres, notamment au sein de la droite française, on aurait plutôt l’impression qu’ils souhaitent son retour. Dans le cas de Ridley Scott, en revanche, le problème prend une tournure légèrement différente. Le personnage auquel on peut imaginer qu’il s’identifie n’est pas Napoléon lui-même, mais Jacques-Louis David (Sam Crane), le peintre du grandiose Sacre de Napoléon, que l’on aperçoit en train de dessiner des croquis dans la scène du couronnement telle que tournée par Ridley Scott. Nostalgique, non pas de l’Empire, mais de ses représentations épiques, Scott semble être en quête d’un style dans une conjoncture qui rend précisément un tel style impossible.
Footnotes
- “Macron et Napoléon : du bon usage de l’Histoire”, Le Monde, 6 mai 2021.
- ‘« Nous avons devant nous cent jours d’apaisement, d’unité, d’ambitions et d’actions au service de la France », promettait Emmanuel Macron lors de son allocution du 17 avril, qui a suivi la promulgation d’une réforme des retraites très contestée’, Le Monde, 14 juillet 2023.
- « Vie de Napoléon« (Paris : Payot, 1969)
- « Ridley Scott, entretien avec Léa Salamé », France Inter, le 14 novembre 2023.
- « Marc Belissa et Yannick Bosc, Le Consulat de Bonaparte : la fabrique de l’État et la société propriétaire 1799-1804″ (Paris : La fabrique, 2021)
- « Voir : “Quand le peuple français me confia ses destinées, je considérai les lois qu’il me donnait pour le régir ; si je les eusse crues insuffisantes, je n’aurais pas accepté. Qu’on ne pense pas que je suis un Louis XVI ! […] Pour être devenu empereur, je n’ai pas cessé d’être citoyen”; et “je ne pouvais être qu’un Washington couronné”, Emmanuel de las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, 10/18 (Paris : Union Générale des Éditions, 1962), p. 235 et p. 177. »