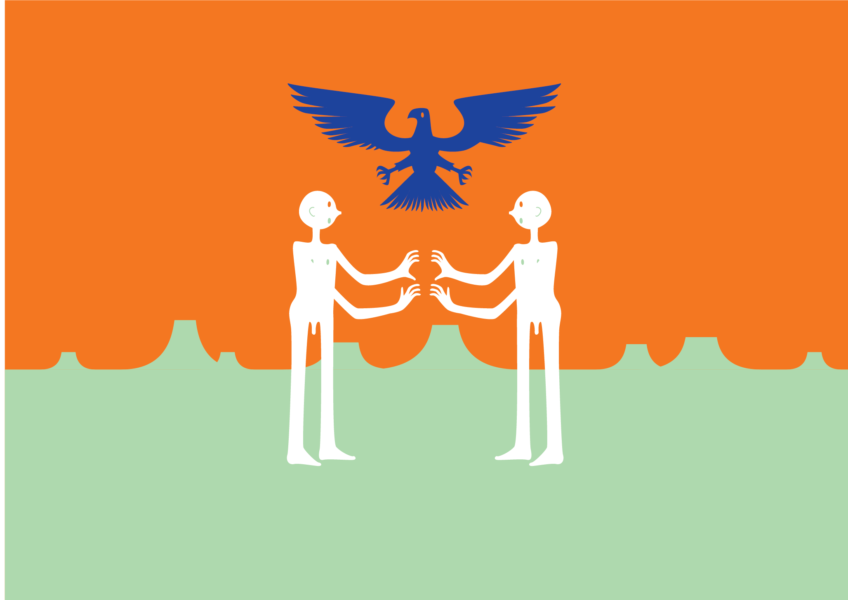Selon Duménil et Lévy, le moteur du changement ne serait pas la classe des travailleurs, mais les managers. La pratique et l’histoire contredisent cela.
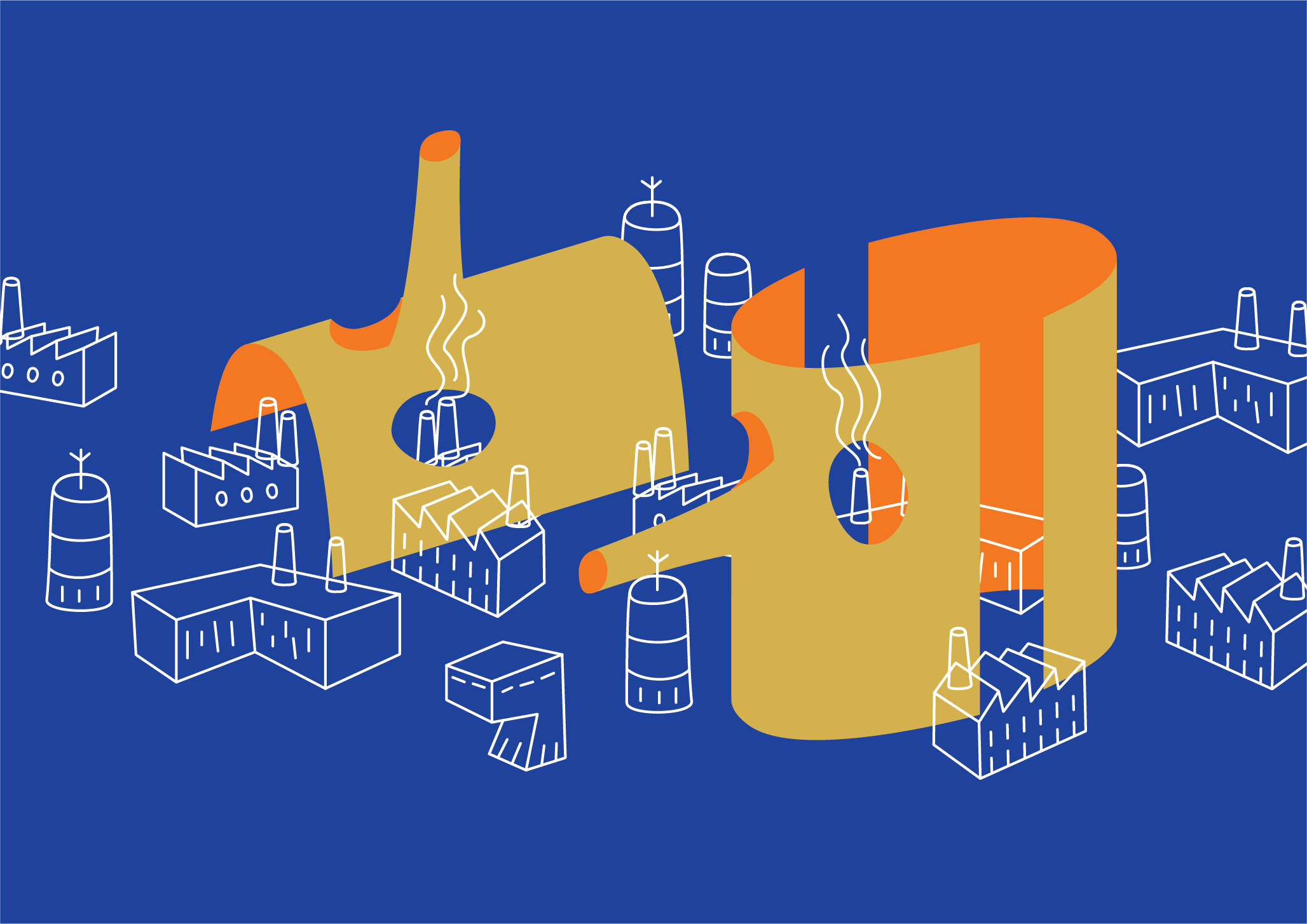
Le pouvoir des cadres dans l’économie contemporaine s’est-il accru au point d’aboutir à un nouveau système économique? La politique de classe traditionnelle est-elle obsolète? Dans leur nouveau livre, Gérard Duménil et Dominique Lévy défendent le «oui» sur les deux tableaux. Cependant, bien que Duménil et Lévy présentent un compte rendu empiriquement riche et intéressant sur le plan analytique, ils ne parviennent pas à faire valoir leur point de vue sur ces deux questions. Le pouvoir réel reste entre les mains de la classe capitaliste.
La lutte contre le capitalisme est aussi vieille que le capitalisme lui-même. Les combats ont été âpres et sanglants, avec des hauts triomphants et des bas douloureux et durables. Mais la gauche est tenace. Nous continuons à brandir le drapeau rouge, à lutter avec acharnement pour un monde meilleur, pour le socialisme. Malgré tout, nous n’abandonnons jamais.
Gérard Duménil et Dominque Lévy, deux économistes hétérodoxes très respectés, veulent que nous

renoncions. Ils en ont assez de nos luttes et de nos échecs. Pour nous convaincre, ils ont écrit un nouveau livre, Managerial Capitalism: Ownership, Management and the Coming New Mode of Production1. Ce livre affirme que notre quête a été vaine: la classe ouvrière ne se soulèvera pas pour apporter le socialisme. Si quelqu’un doit nous sauver, ce sont les médecins, les avocats, les banquiers, les consultants et les autres membres du 1%.
Cela peut sembler surprenant venant de marxistes, mais Duménil et Lévy (D&L) développent cet argument depuis longtemps. Managerial Capitalism se lit comme un opus consolidant et affinant leurs arguments empiriques et théoriques concernant la fin du capitalisme et le triomphe du capitalisme managérial: un «nouveau mode de production antagoniste».
Les cadres contrôlent le capitalisme?
Certes, D&L n’ont pas mis de côté les classes «populaires» (les 99%) qui, selon eux, ont encore un rôle à jouer. Au lieu de cela, ils soutiennent que la gauche a fait une erreur en les plaçant au centre de l’histoire, une erreur qu’ils mettent sur le dos de Marx et Engels. D&L disent que la théorie de l’histoire de Marx était erronée – enfin, en partie.
La partie correcte du modèle historique de Marx, selon D&L, était que le capitalisme a apporté une socialisation croissante (une rationalisation et une bureaucratisation en expansion et qui s’approfondit), ce qu’ils considèrent comme une bonne chose. Le modèle de Marx s’est effondré, selon les auteurs, lorsqu’il a supposé que ce processus d’arrière-plan qui consiste à faire avancer cette socialisation se combinerait finalement avec les contradictions croissantes du capitalisme (issues des divisions de classe et de la concurrence) pour permettre à la classe ouvrière de se soulever et de renverser le capitalisme, pour apporter le socialisme. Marx et Engels avaient tort, selon D&L, de croire que les gens ordinaires remplaceraient le capitalisme par le socialisme.
D&L soutiennent que la gauche a fait une erreur en plaçant les classes «populaires» au centre de l’histoire.
D&L considèrent la faiblesse du cadre historique de Marx comme une barrière analytique grave, qui nous empêche de voir les grands changements du 21e siècle: à savoir, le début d’une lente transition du capitalisme, qui valorise la propriété privée et les transferts héréditaires de richesse, au système managérial, qui donne le pouvoir aux travailleurs ayant un salaire élevé et qui repose sur les valeurs de la méritocratie. En bref, nous avons largement sous-estimé l’importance des cadres dans le processus d’accumulation.
Si nous avions pris au sérieux le rôle des cadres, affirment les auteurs, nous nous serions déjà rendu compte que, par le biais du New Deal, la classe des cadres («les salariés appartenant aux fractiles supérieurs des hiérarchies de revenus2») avait pris les rênes d’un mode d’accumulation hybride appelé capitalisme managérial. Au cours des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, ces cadres ont activement fait passer la société à un nouveau mode de production, au-delà du capitalisme. Les économistes de l’époque (Burnham, Schumpeter, Galbraith, Chandler) l’ont bien vu: les mécanismes du marché ont été restreints et le stimulant du profit atténué, les deux étant des «expressions de la distance croissante avec l’économie du capitalisme3».
Cette transition a été perturbée par la contre-révolution néolibérale qui semblait annoncer un retour aux anciennes méthodes (salaires et primes liés au cours des actions, par exemple). Dans la mêlée, on a oublié le pouvoir croissant des dirigeants, tandis que les pensées postcapitalistes de Galbraith et Schumpeter étaient évacuées. D&L soutiennent que cet oubli était une erreur. Ils déclarent qu’au cours des dernières décennies, les cadres ont conservé et accru leur contrôle, cette fois dans un compromis avec les patrons plutôt qu’avec les travailleurs. Lorsque la crise de 2007-2008 a frappé, les cadres ont utilisé leur double pouvoir sur les marchés et au gouvernement pour stabiliser le navire.
Aujourd’hui, D&L déclarent que les dirigeants sont plus puissants que jamais: ils forment une nouvelle classe dirigeante qui, contrairement aux élites d’autrefois, vit principalement des salaires plutôt que du capital. Ce sont les cadres, et non les propriétaires, affirment D&L, qui contrôlent l’économie mondiale, et si nous regardons le 20e siècle dans son ensemble, ce sont ces hauts salariés, plutôt que les propriétaires de capitaux, qui ont enregistré les gains les plus importants4.
Dix ans après la crise, nous avons atteint un tournant. Le néolibéralisme semble avoir suivi son cours, se transformant en ce que les auteurs appellent le «néolibéralisme administré», un système instable qui représente un pas de plus vers «l’établissement progressif de relations de production au-delà du capitalisme5». Mais en ce moment, ils voient aussi une ouverture… en quelque sorte. Les divisions au sein de la classe supérieure se creusent et le sommet (le 1%) a accumulé une richesse tellement inimaginable qu’elle est prête à s’envoler. D&L soutiennent que cette polarisation de l’élite crée un vide propice à l’alliance des classes populaires qui se ferait au bas de la classe supérieure, ceux qui gagnent moins d’un demi-million de dollars par an. Nous devons simplement les convaincre de se ranger du côté des gens ordinaires plutôt que du côté du capital, comme nous l’avons fait dans les années 1930. Ce faisant, nous pouvons développer un nouveau compromis qui nous apportera peut-être un jour un système que nous pouvons encore qualifier de socialiste, «telle la marque d’une affiliation retrouvée avec des efforts antérieurs6».
La seule façon pour la classe ouvrière de prendre le pouvoir est de refuser collectivement de reproduire le système.
Il y a deux éléments interconnectés du Managerial Capitalism qui arrivent à point nommé et qui méritent d’être examinés plus en détail. Le premier est l’accent mis par les auteurs sur l’évolution de la base matérielle de la classe supérieure et son importance pour l’avenir du capitalisme. D&L présentent des données montrant comment, dans les années 1920, les 1% les plus élevés ne tiraient que 40% de leurs revenus des salaires (pensions, primes, exercices d’options sur actions, etc.); le reste était un revenu en capital (somme des dividendes, intérêts et loyers). Au début des années 2000, la répartition s’est inversée; les élites tirent aujourd’hui environ 80% de leurs revenus des salaires. D&L disent que ce changement sape notre compréhension traditionnelle du capitalisme en tant que «structure sociale basée sur la propriété privée des moyens de production. Les capitalistes, en tant que propriétaires des moyens de production, forment la classe supérieure; ils prennent les décisions concernant l’utilisation des moyens de production7.» Aujourd’hui, la classe supérieure est un ensemble de salariés.
La question de savoir comment classer les travailleurs hautement rémunérés ne date pas d’hier: sont-ils dans le camp capitaliste ou dans le camp ouvrier? Des générations d’historiens, d’experts en développement, de sociologues, d’économistes et de spécialistes du travail, marxistes et non marxistes ont débattu sur la manière d’analyser qui profite du capitalisme et veut activement ou passivement le voir continuer et qui pourrait être convaincu qu’il serait mieux lotis dans le socialisme. Nous avons donné beaucoup de noms à ces travailleurs bien payés qui se trouvent dans des «milieux de classe contradictoires»: bourgeoisie salariée, bourgeoisie managériale, et ainsi de suite, mais nous n’avons jamais trouvé de solution précise à l’énigme8.
Cependant, la plupart des chercheurs, et pas seulement les radicaux, s’accordent à dire qu’une profonde fracture structurelle sépare la classe dirigeante et la classe ouvrière. La classe dirigeante possède de manière privée les moyens par lesquels les gens ordinaires gagnent leur vie. C’est elle qui décide de créer ou non des emplois. Les riches se reproduisent et accumulent les opportunités et les ressources à travers des réseaux fermés et des portes dérobées pour accéder au pouvoir. Ce n’est pas le cas de la classe ouvrière; la seule façon pour elle de prendre le pouvoir est de refuser collectivement de reproduire le système.
D&L ne sont pas satisfaits de cette conception des classes. Leur déception est grande de constater que même si «la principale fracture sociale se situe aujourd’hui entre les bas salaires et les hauts salaires, et de plus en plus en conformité avec la montée des cadres, la résistance au développement d’un nouveau cadre analytique reste très forte au sein de la gauche9». Ils considèrent que la proportion croissante des revenus de la classe supérieure provenant des salaires plutôt que du capital est d’une importance fondamentale: ce n’est pas du capitalisme si les gens les plus riches s’enrichissent principalement avec des salaires au lieu du capital.
En mettant de côté le débat sur la question de savoir si nous pouvons faire une distinction nette entre les salaires et le revenu du capital en cette ère de financiarisation10 (en particulier compte tenu des politiques de «reprise» de la Réserve fédérale américaine après 2008), le prétendu passage aux salaires comme élément vital de la classe dirigeante signifie-t-il que nous ne sommes plus dans le capitalisme ou que nous sommes en train de passer à un nouveau mode d’accumulation? Combien de capital faut-il posséder pour être capitaliste?
D&L se moquent des «cercles d’obéissance marxiste plus ou moins stricts11» mais en termes de classe et de centile, ils ont ressuscité de vieux débats. Il se peut très bien que la classe dirigeante vive maintenant avec des salaires plus élevés que par le passé, mais cela ne signifie pas que la fracture entre les riches et les pauvres s’est estompée ou est devenue plus perméable. La classe ne se réduit pas aux classes des actifs, aux sources de revenus ou aux compétences que l’on met sur le marché. La classe concerne le pouvoir des élites: des élites qui reproduisent activement leur pouvoir de classe à travers les relations, les réseaux et les institutions12. Les riches ont prospéré depuis les années 1970 alors que la classe ouvrière a vu son pouvoir réduit à son niveau d’avant le New Deal. L’écart toujours plus grand entre les riches et les autres (indépendamment de nos rêveries polanyiennes d’un mouvement vers la gauche) le démontre mieux que tout le reste.
Le capitalisme, en tant que système historique, a évolué au fil du temps et, par extension, la composition et les réseaux de son élite dirigeante ont également évolué. D&L le montrent de manière fascinante dans leur chapitre sur les structures de classe et de pouvoir impérial. À partir de la base de données marketing 2007 d’Orbis, ils illustrent le réseau mondial de propriété et de contrôle, soulignant à la fois la persistance d’un réseau mondial anglo-saxon dense et comment «la gestion de la propriété de la grande économie est essentiellement aux mains des grands financiers13».
Mais au risque d’enfoncer une porte ouverte, il ne faut pas perdre de vue qu’en dépit d’une réorganisation importante, les impératifs moteurs du capitalisme exigeant la concurrence, pour marchandiser de nouvelles sphères de vie et pour donner la priorité au profit par-dessus tout, sont restés les mêmes. La façon dont l’élite dirigeante se reproduit n’a pas modifié ces impératifs, du moins pas encore.
La plupart des richesses continuent d’être transférées de parents à enfants au sein de l’élite, et sont très inégales selon la race, la classe et le sexe.
C’est pourquoi nombreux à gauche sont ceux qui résistent à cette nouvelle conception, non pas parce que nous nous accrochons à l’idée que la classe dirigeante doit être uniquement ou principalement propriétaire des capitaux, mais parce que les impératifs moteurs du capitalisme n’ont pas changé. La classe dirigeante trouve simplement de nouvelles façons de cimenter et de reproduire son pouvoir à mesure que le capitalisme évolue.
Les cadres comme moteur de changement?
D&L ne se préoccupent pas seulement de corriger la théorie des classes de Marx pour bien mettre en évidence le rôle des cadres dans l’accumulation. Ils veulent aussi montrer comment les cadres pourraient jouer un rôle central dans la construction d’un monde meilleur. Ils le montrent en mettant l’accent sur la partie de la théorie de l’histoire de Marx qui, à leur avis, était juste: le fait d’accroître la socialisation – avec une augmentation de la bureaucratisation et de la rationalisation de la gouvernance et de la production. C’est le deuxième grand axe du livre.
D&L rassemblent les fils conducteurs de Marx et Engels qui soulignent une «tendance à la montée des degrés de socialisation, ou de manière équivalente, à la socialisation en tant que telle, notamment la socialisation de la production associée au progrès des forces productives14». Ils sont d’accord avec Marx et Engels pour dire que le capitalisme est «le grand architecte de relations économiques et, plus généralement, sociales de plus en plus sophistiquées et “efficaces”15». Ils caractérisent la socialisation croissante d’abord par «l’aspect technique de la production et la division correspondante des tâches, au sein des entreprises et entre les industries» et ensuite par le «rôle organisationnel croissant des institutions centrales étatiques ou paraétatiques, tant au niveau national qu’international16».
Ce processus de socialisation en arrière-plan est au cœur de l’analyse des auteurs. Ils disent qu’avec le temps, le capitalisme a engendré une complexité croissante des tâches, de la technologie et des processus de production, et que les besoins de la gouvernance sont devenus plus variés et plus exigeants (à mesure que l’État a accru sa portée et ses capacités), augmentant le besoin et le pouvoir des cadres. L’ancien système, soutiennent D&L, dans lequel «la propriété se transmet au sein des relations familiales par héritage ou mariage» ne suffit plus17.
Aujourd’hui, «les individus se situent dans des postes distincts selon leurs compétences. Une variété de tâches doit être accomplie; il existe une division du travail au sein des entreprises, ainsi qu’entre les entreprises reliées par les marchés ou interagissant à travers des formes données de coordination ou d’organisation centrale18.» Les cadres sont devenus «les agents clés du progrès de l’organisation» et ils arrivent là où ils sont grâce à un travail acharné et à leurs compétences, et non par héritage. Par conséquent, ils valorisent la méritocratie19.
L’ascension de la méritocratie aux dépens de l’héritage, selon D&L, était déjà visible dans la période d’après-guerre quand «l’avancée des traits managériaux, associés à la montée des nouvelles relations de production, a progressivement démantelé les fondements des pratiques capitalistes ainsi que les idéologies de la propriété privée des moyens de production, y compris leur transmission héréditaire, sous le signe de la méritocratie20».
Aujourd’hui, les idéaux méritocratiques ont encore plus d’influence. La méritocratie est à la base de l’économie du savoir, de l’ère de l’information, des «perturbateurs» de la Silicon Valley. Les progrès de la science, de la médecine, des affaires et de la finance ont rendu l’enseignement supérieur plus important que jamais. Les bons emplois exigent d’excellentes références. Tout cela nourrit non seulement la croissance des cadres, mais aussi l’«idéologie de la méritocratie» qui, selon D&L, «remplace de plus en plus les valeurs de la propriété21».
D&L accordent une grande importance à cette évolution à l’arrière-plan d’une socialisation croissante. À la fois parce qu’ils pensent qu’elle a rendu la société meilleure pour tous (une économie basée sur la connaissance est supposée être meilleure) et parce qu’elle imprègne le cadre de légitimation émergeant du système managérial qui penche davantage vers la méritocratie que vers l’hérédité ou la loi du plus fort: «compte tenu de l’amélioration, notamment, de l’interaction sociale et de l’éducation, le monopole de l’initiative sociale de la part des minorités [les élites] deviendrait de plus en plus difficile à maintenir sur la voie d’un système managérial suffisamment tourné vers le progrès social22».
D&L déclarent que la centralité de la méritocratie dans la société d’aujourd’hui détient la promesse de «construire un avenir digne sur les traits les plus progressistes de la modernité managériale23». Les gens compétents et intelligents prospéreront dans le système magérial. Avec un peu d’huile de coude et beaucoup d’études, n’importe qui peut devenir n’importe quoi. Le rêve américain pourrait bien se réaliser, après tout.
Bien que la méritocratie semble certainement plus attrayante que l’héritage, elle ne correspond pas tout à fait à la réalité. La plupart des richesses, du moins aux États-Unis sur lesquels D&L concentrent leur analyse, continuent d’être transférées de parents à enfants au sein de l’élite, et sont très inégales selon la race, la classe et le sexe. Les États-Unis ont peut-être les travailleurs salariés les plus riches, mais ils ont aussi le moins de mobilité intergénérationnelle24.
Une économie dirigée par des cadres évoluera-t-elle vers la méritocratie à l’avenir, compte tenu des connaissances et des compétences requises par le capitalisme moderne? C’est possible, mais cela semble peu probable étant donné la conjoncture actuelle. Le monde construit et défendu par les «enfants rois» de la Silicon Valley et de Wall Street est un monde marqué par l’exclusion et l’hyperconcurrence. Les secteurs les plus «avancés» créent très peu de bons emplois. Les jeunes sont plus instruits, plus productifs, plus travailleurs que jamais, mais leur situation est pire que celle de leurs parents ou de leurs grands-parents25. L’économie du savoir n’a pas besoin du savoir de la plupart des gens ou n’en veut pas, en particulier celui des pauvres et des gens de couleur26. Les gens ordinaires sont de plus en plus réduits à s’occuper des riches et à faire du shopping. S’ils ne peuvent pas fournir de service ou consommer, ils sont ignorés, laissés pour compte ou tués.
Les impératifs moteurs du capitalisme exigeant la concurrence et donnant la priorité au profit, sont restés les mêmes.
Les idéaux méritocratiques de la classe dirigeante managériale, dans la mesure où ils existent, n’ont pas pour effet de stimuler une société plus équitable.
Reconstruire le compromis keynésien?
Duménil et Lévy ne sont pas des optimistes à tout crin. Ils reconnaissent qu’un monde dirigé par des cadres pourrait être aussi mauvais que le capitalisme. Ils disent que la tendance à l’accroissement de la socialisation a créé les fondements d’une société plus équitable et que, malgré nos pertes pendant la période néolibérale, nous sommes dans une meilleure situation que beaucoup ne le croient. Tout le dur labeur des classes populaires n’a pas été vain, car «les gains s’accumulent siècle après siècle27».
D&L comptent sur les gens ordinaires, sur des «conquêtes patientes» et sur une «lutte de classe obstinée», pour faire basculer nos seigneurs les cadres de notre côté, pour les «courber vers la gauche». Ils déclarent que les «bifurcations» sont des moments de contingence. Par exemple, dans la crise des années 1970, ils soutiennent qu’il n’y avait rien «qui exigeait une transformation du compromis de l’après-guerre au profit de l’alliance des classes supérieures dans le néolibéralisme28». Prenant la suite de Marx, ils soutiennent que «des circonstances ont été créées, mais le résultat, c’est-à-dire la détermination d’une configuration spécifique d’alliances et de domination de classe, est resté contingent et déterminé par les circonstances politiques29». Aujourd’hui, ils voient un moment tout aussi contingent. Pour saisir les gains que nous voulons, ils nous implorent de regarder en arrière quand les choses allaient bien pour la classe ouvrière américaine et de reconstruire le compromis keynésien.
L’ère keynésienne, selon D&L, représentait une «nouvelle hiérarchie des pouvoirs de classe» et un «nouvel ordre social» qui «était l’expression d’un compromis politique entre les classes populaires et les classes montantes de cadres privés et publics». Dans le cadre de cet ordre social, «fondé sur une alliance entre les cadres et les classes populaires, des degrés exceptionnels de “démocratie” ont été […] atteints30».
D&L ont raison de dire qu’aujourd’hui, une ouverture existe. Mais regarder en arrière n’est pas la solution. Le compromis de l’après-guerre était branlant, exclusif, et au mieux truffé de contradictions. Les patrons n’ont jamais cédé. Ils ont continué à se battre. La seule chose qui a maintenu le compromis en vie, c’est la menace posée par l’Union soviétique, la place pour une croissance économique rentable après les dévastations de la Seconde Guerre mondiale et le pouvoir des mouvements syndicaux organisés et des mouvements sociaux de masse: un pouvoir si grand qu’il a fait trembler les élites au pouvoir31.
Les années 1970 ont marqué un grand tournant. Dans ce moment de crise profonde, les travailleurs et les mouvements sociaux ont exigé un changement plus profond et plus radical pour dépasser les contradictions du keynésianisme. La classe dirigeante a dû faire un choix. Elle aurait pu rejoindre les travailleurs, en instaurant une véritable démocratie industrielle et une redistribution significative. Il n’en fut rien. Les élites ont choisi de se ranger du côté du capital, de se serrer les coudes, plutôt que d’essayer de sortir du capitalisme.
Le compromis de l’après-guerre était branlant, exclusif, et au mieux truffé de contradictions.
Ce faisant, les élites nous ont donné une grande leçon, une leçon à retenir qui est la leçon opposée à celle du Managerial Capitalism. Au-delà d’un certain point, les riches ne voteront jamais pour diminuer leur richesse et leur pouvoir. Dans les années 1970, les professionnels hautement rémunérés savaient de quel côté leur pain était beurré. Il n’y a aucune raison de croire que cette fois-ci, ce sera différent, que les cadres pourront ou choisiront d’utiliser leur position pour mettre un terme au capitalisme. Pourquoi quelqu’un qui gagne un demi-million de dollars par an rejoindrait-il le camp de celui qui gagne trente mille dollars? Une croyance commune en la méritocratie?
Rien de tout cela ne signifie que l’analyse de D&L est sans valeur. Ils démontrent d’une main experte comment le capitalisme mondial a évolué en tant que système historique. Il est devenu plus rationalisé et bureaucratisé. Les voies par lesquelles la classe capitaliste accumule la richesse et se reproduit ont changé. Mais les moteurs fondamentaux de l’accumulation, de l’acquisition et de la reproduction du pouvoir n’ont pas bougé.
En conséquence, le rôle de la classe ouvrière reste le même. Si nous voulons un monde meilleur, c’est à nous de le faire. Duménil et Lévy ont raison de dire qu’il n’y aura pas de progression naturelle vers le socialisme, mais la gauche le sait depuis longtemps. Nous continuons malgré tout à brandir le drapeau rouge: pour maîtriser nos patrons, pour combattre l’injustice, pour bâtir un monde meilleur, ici et maintenant.
Gérard Duménil et Dominique Lévy, Managerial Capitalism: Ownership, Management, & the Coming New Mode of Production, Londres, Pluto Press, 2018.
Footnotes
- Gérard Duménil et Dominique Lévy, Managerial Capitalism: Ownership Management and the Coming New Mode of Production, Londres, Pluto Press, 2018.
- D&L, p. 11, p. 15.
- D&L, p. 14.
- D&L, p. 91.
- D&L, p. 11.
- D&L, p. 224.
- D&L, p. 53
- Quelques exemples: Erik Olin Wright, Classes, Londres, Verso, 1997; Slavov Zizek, The Year of Dreaming Dangerously, Londres, Verso, 2012; Richard Sklar, «The Nature of Class Domination in Africa», Journal of Modern African Studies, 17, no 4, 1979, p. 531-552.
- D&L, p. 84.
- Michael Roberts l’a abordé dans sa critique du livre, «Managers rule, not capitalists?», Next Recession Blog, 29 avril 2018.
- D&L, p. 29.
- Sam Gindin et Leo Panitch, «Marxist Theory and Strategy: Getting Somewhere Better», Historical Materialism, 23, n° 2, 2015, p. 3-22.
- D&L, p. 122, p. 125.
- D&L, p. 41-2.
- D&L, p. 41-2.
- D&L, p. 48.
- D&L, p. 53.
- D&L, p. 43.
- D&L, p. 44.
- D&L, 215.
- D&L, p. 54.
- D&L, p. 216.
- D&L, p. 212.
- Miles Corak, «Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility», Discussion Paper no 7520, Bonn, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, juillet 2013.
- Malcolm Harris, Kids These Days: Human Capital and the Making of Millennials, Boston, Little Brown and Company, 2017.
- William Darity, «The Undesirables, America’s Underclass in the Managerial Age: Beyond the Myrdal Theory of Racial Inequality», Daedalus, 124, no 1, hiver 1995, p. 145-165.
- D&L, p. 214.
- D&L, p. 154.
- D&L, p. 154.
- D&L, p. 99-100.
- Voir, par exemple, Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times, Londres, Verso, 1994.