La pandémie a déplacé les plaques tectoniques du capitalisme mondial. C’est un formidable défi pour ceux d’entre nous qui voulons construire le monde de l’après-capitalisme.
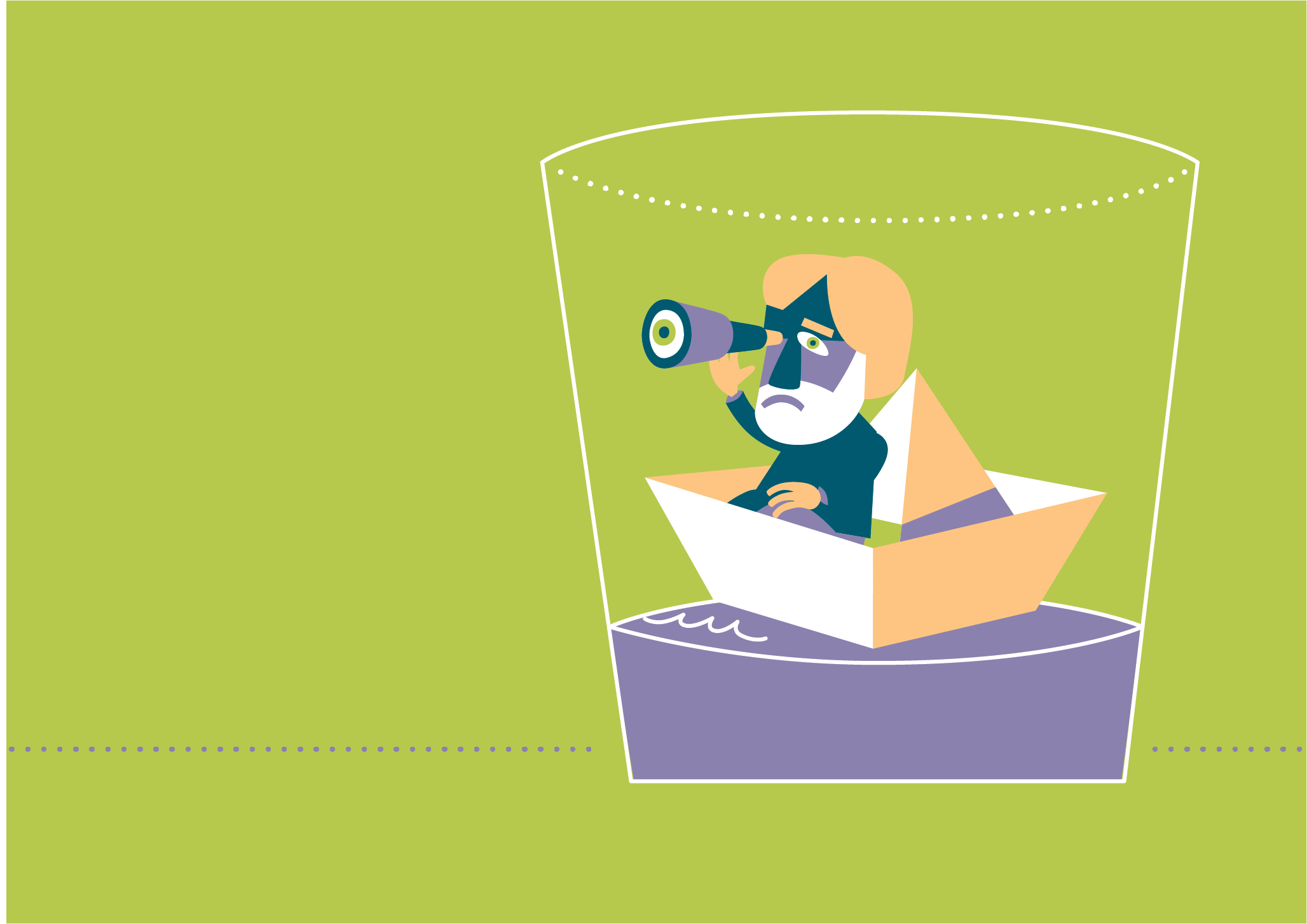
Le coronavirus a déchaîné un flot de réflexions et d’analyses qui ont pour dénominateur commun une volonté d’ébaucher les contours (diffus) du type de société et d’économie qui verra le jour une fois la pandémie maîtrisée. Il y a de nombreuses raisons de se lancer dans ce genre de spéculation, bien informée et contrôlée, espérons-le, car s’il y a une chose dont nous sommes tout à fait sûrs, c’est que la première victime fatale de la pandémie a été la version néolibérale du capitalisme. Et je dis « version » parce que je doute sérieusement que le virus en question ait miraculeusement mis fin non seulement au néolibéralisme, mais aussi à la structure qui le soutient : le capitalisme comme mode de production et comme système international. L’ère néolibérale est un cadavre encore dépourvu de sépulture, mais impossible à ressusciter. Qu’adviendra-t-il du capitalisme ? C’est précisément le sujet de cette chronique.
Une solution intermédiaire
J’ai beaucoup de sympathie pour le travail et la personne de Slavoj Žižek, mais cela ne suffit pas à lui donner raison lorsqu’il affirme que la pandémie a porté « un coup fatal au système capitaliste, à la manière Kill Bill », après quoi, selon la métaphore cinématographique, il devrait tomber raide mort au bout de cinq secondes. Cela n’est pas arrivé et n’arrivera pas parce que, comme l’a rappelé Lénine à plusieurs reprises, « le capitalisme ne tombera pas tant qu’il n’y aura pas de forces sociales et politiques pour le faire tomber ». Le capitalisme a survécu à la mal-nommée « grippe espagnole », dont nous savons aujourd’hui qu’elle est apparue en mars 1918 dans la base militaire de Fort Riley, au Kansas, et a ensuite été répandue de manière incontrôlée par les troupes américaines qui ont marché au combat pendant la Première Guerre mondiale.
Les estimations très imprécises de sa létalité oscillent entre 20, 50 et 100 millions de personnes, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’être un statisticien compulsif pour douter de la rigueur de ces estimations, qui sont néanmoins largement diffusées par de nombreuses organisations, dont la revue National Geographic Magazine. Le capitalisme a également survécu au terrible effondrement mondial provoqué par la Grande Dépression, faisant preuve d’une résilience hors du commun – déjà annoncée en guise d’avertissement par les classiques du marxisme – pour traiter les crises et même en sortir renforcé. Penser qu’en l’absence de ces forces sociales et politiques signalées par le révolutionnaire russe (qui ne sont pour l’instant perçues ni aux États-Unis ni dans les pays européens), la disparition tant attendue d’un système immoral, injuste et prédateur, ennemi mortel de l’humanité et de la nature, va maintenant avoir lieu, tient davantage de l’expression d’un désir plutôt que du fruit d’une analyse concrète.
Žižek est convaincu qu’à la suite de cette crise, l’humanité, pour se sauver, pourra recourir à « une forme de communisme réinventé ». C’est certainement possible et souhaitable. Toutefois, comme presque tout ce qui a trait à la vie sociale, cela dépendra de l’issue de la lutte des classes ; concrètement, la question de savoir si, pour en revenir à Lénine, « ceux du bas ne veulent plus et ceux du haut ne peuvent plus continuer à vivre comme avant ». Une question dont nous ignorons la réponse pour l’instant. Cependant, la bifurcation vers la sortie de cette situation présente une autre issue possible, que Žižek identifie très clairement : la « barbarie ». En d’autres termes, la réaffirmation de la domination du capital par le recours aux formes les plus brutales d’exploitation économique, de coercition politico-étatique et de manipulation des cœurs et des esprits par sa dictature médiatique jusqu’ici intacte. La « barbarie », disait Istvan Mészaros avec une dose d’ironie amère, « si nous avons de la chance … ».
Mais pourquoi ne pas songer à une solution intermédiaire, ni à la « barbarie » tant redoutée (« dont les capitalismes réellement existants nous ont longtemps administré des doses de plus en plus fortes »), ni à l’option si souhaitée d’un « communisme réinventé » ? Pourquoi ne pas penser qu’une transition vers l’après-capitalisme sera inévitablement « inégale et combinée », avec des avancées profondes dans certains domaines : la définanciarisation de l’économie, la dé-commercialisation de la santé et de la sécurité sociale, par exemple, et d’autres plus chancelantes, confrontées à une plus forte résistance de la part de la bourgeoisie, dans des domaines tels que le contrôle rigoureux du casino financier mondial, la nationalisation de l’industrie pharmaceutique (pour que les médicaments ne soient plus une marchandise produite pour le profit), les industries stratégiques et les médias, ainsi que la récupération publique de ce qu’on appelle les « ressources naturelles » (des biens communs, en fait) ? Pourquoi ne pas penser à « ces nombreux socialismes » que le grand marxiste britannique Raymond Williams a évoqués de façon prémonitoire au milieu des années 1980 ?
Quant à la notion d’un « communisme réinventé », le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han saute sur le ring pour réfuter la thèse du Slovène en se risquant à affirmer qu’« après la pandémie, le capitalisme persistera avec une vigueur renouvelée ». Il s’agit d’une déclaration téméraire, car si quelque chose se profile à l’horizon, c’est bien l’appel généralisé de toute la société à une intervention beaucoup plus active de l’État pour contrôler les effets perturbateurs des marchés sur la fourniture de services de base dans les domaines de la santé, du logement, de la sécurité sociale et des transports, entre autres. Et pour mettre fin au scandale de l’hyperconcentration de la moitié de toutes les richesses de la planète entre les mains du 1 % le plus riche de la population mondiale. Ce monde post-pandémique aura beaucoup plus d’État et beaucoup moins de marché, avec des populations « conscientes » et politisées par le fléau auquel elles ont été soumises et enclines à rechercher des solutions solidaires et collectives, voire « socialistes » dans des pays comme les États-Unis, nous rappelle Judith Butler, répudiant la course effrénée à l’individualisme et la privatisation exaltée depuis quarante ans par le néolibéralisme, qui nous a conduits à la situation tragique que nous vivons aujourd’hui. Un monde dans lequel le système international a déjà assurément adopté un format différent en présence d’une nouvelle triade dominante, même si le poids spécifique de chacun de ses acteurs n’est pas le même.
Le déclin des États-Unis
Si Samir Amin avait raison à la fin du siècle dernier lorsqu’il parlait de la triade formée par les États-Unis, l’Europe et le Japon, aujourd’hui, elle se compose des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Et contrairement à l’ordre tripolaire précédent, où l’Europe et le Japon étaient des partenaires juniors de Washington (pour ne pas dire des pions ou des laquais, ce qui semble un peu méprisant, mais est la caractérisation qu’ils méritent), aujourd’hui Washington doit faire face à la formidable puissance économique de la Chine. Celle-ci se profile désormais incontestablement comme la nouvelle locomotive de l’économie mondiale, ayant relégué les États-Unis à la deuxième place et ayant pris la tête dans la course à la technologie 5G et à l’intelligence artificielle.
Pourquoi ne pas songer à une solution intermédiaire, ni à la « barbarie » tant redoutée, ni à l ’option si souhaitée d ’un « communisme réinventé » ?
À cela s’ajoute la présence non moins menaçante d’une Russie qui est revenue sur le devant de la scène politique mondiale : riche en pétrole, en énergie et en eau ; propriétaire d’un immense territoire (presque deux fois plus grand que les États-Unis) et d’un puissant complexe industriel qui a produit une technologie militaire de pointe qui, dans certains domaines décisifs, est supérieure à celle des États-Unis, la Russie complète par sa force sur le plan militaire celle que possède la Chine sur le plan économique. Selon Han, il est d’autant plus difficile pour le capitalisme d’acquérir une force renouvelée face à une conjoncture internationale aussi peu propice. S’il a eu la force gravitationnelle et la pénétration mondiale qu’il a su avoir, c’est parce que, comme l’a dit Samuel P. Huntington, il y avait un « shérif solitaire » qui soutenait l’ordre capitaliste mondial avec sa primauté économique, militaire, politique et idéologique incontestable. Aujourd’hui, la primauté revient à la Chine et les énormes dépenses militaires américaines ne suffisent même pas à tenir tête à un petit pays comme la Corée du Nord ni à gagner une guerre contre l’une des nations les plus pauvres de la planète comme l’Afghanistan. L’ascendant politique de Washington ne tient qu’à un fil dans ce qui est communément décrit comme son « arrière-cour », à savoir : l’Amérique latine et les Caraïbes, une région qui est actuellement le théâtre d’importants bouleversements sociaux. Les États-Unis ont vu leur image internationale sérieusement ternie : la Chine a réussi à maîtriser la pandémie, mais ce n’est pas le cas des États-Unis ; la Chine, la Russie et Cuba aident à la combattre en Europe, et Cuba, exemple mondial de solidarité, envoie des médecins et des médicaments sur les cinq continents alors que la seule chose qui vient à l’esprit de ceux qui passent par la Maison-Blanche est d’envoyer 30 000 soldats pour un exercice militaire avec l’OTAN et d’intensifier les sanctions contre Cuba, le Venezuela et l’Iran, ce qui constitue un crime de guerre évident. Leur ancienne hégémonie est désormais chose du passé. Ce dont il est question aujourd’hui dans les couloirs des agences gouvernementales américaines n’est pas de savoir si le pays est en déclin ou non, mais la pente et le rythme de ce déclin. Entre-temps la pandémie accélère ce processus d’heure en heure.
S’il affirme à juste raison qu’« aucun virus n’est capable de faire la révolution », le Sud-Coréen Han fait, en revanche, un pléonasme lorsqu’il écrit que « nous ne pouvons pas laisser la révolution entre les mains du virus ». Bien sûr que non ! Remontons un instant le cours de l’histoire : la révolution russe a éclaté avant la pandémie de « grippe espagnole », et la victoire des processus révolutionnaires en Chine, au Vietnam et à Cuba n’a été précédée d’aucune pandémie. La révolution est faite par les classes subordonnées lorsqu’elles prennent conscience de l’exploitation et de l’oppression dont elles sont victimes ; lorsqu’elles entrevoient que, loin d’être une illusion irréalisable, un monde post-capitaliste est possible et, enfin, lorsqu’elles parviennent à s’organiser à l’échelle nationale et internationale pour lutter contre une « bourgeoisie impériale » qui a autrefois fortement entrelacé les intérêts des capitalistes dans les pays développés. Aujourd’hui, grâce à Donald Trump, cette unité de fer au sommet du système impérialiste a été irrémédiablement brisée et la lutte là-haut est celle de tous contre tous, tandis que la Chine et la Russie continuent patiemment et sans arrogance à construire les alliances qui soutiendront un nouvel ordre mondial.
Impossible retour au passé
Une dernière réflexion. Je pense que nous devons mesurer l’extraordinaire gravité des effets économiques de cette pandémie, qui rendra impossible un retour au passé. A l’échelle de la planète, les gouvernements se sont vus confrontés à un cruel dilemme : choisir entre la santé de la population ou celle de l’économie. Les déclarations de Donald Trump (et d’autres dirigeants tels qu’Angela Merkel et Boris Johnson) au début de la pandémie, selon lesquelles ils n’adopteraient pas de stratégie pour contenir la contagion en mettant en quarantaine de larges pans de la population au prétexte que cela paralyserait l’économie, mettent en évidence la contradiction fondamentale du capitalisme. Car, il faut le rappeler, si la population ne va pas travailler, le processus de création de valeur s’arrête et il n’y a alors ni extraction ni réalisation de plus-value. Le virus passe des personnes à l’économie, ce qui suscite la peur des gouvernements capitalistes qui hésitent à imposer ou à maintenir la quarantaine parce que le monde des affaires a besoin que les gens sortent travailler même s’ils savent que cela met leur santé en danger.
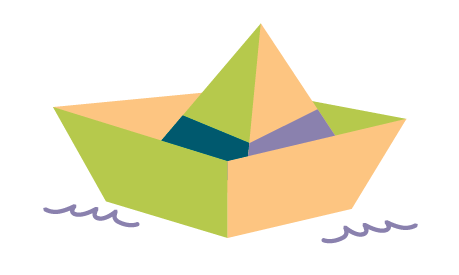 Selon Mike Davis, 45 % de la main-d’œuvre américaine « n’a pas accès à des congés de maladie payés et est pratiquement obligée d’aller travailler et de propager l’infection ou de se retrouver avec une assiette vide. » La situation est intenable du côté du capital, qui doit exploiter sa main-d’œuvre et trouve intolérable qu’elle reste à la maison ; et du côté des travailleurs qui, s’ils vont travailler, sont infectés ou en infectent d’autres, et s’ils restent à la maison, n’ont pas d’argent pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Cette croisée critique explique la belligérance croissante de Trump contre Cuba, le Venezuela et l’Iran, et son insistance à attribuer l’origine de la pandémie aux Chinois. Il doit créer un écran de fumée pour cacher les conséquences désastreuses de décennies de sous-financement du système de santé publique et de complicité avec les escroqueries structurelles de l’industrie pharmaceutique et médicale privée de son pays. Ou rejeter la responsabilité de la récession économique sur ceux qui conseillent aux gens de rester chez eux.
Selon Mike Davis, 45 % de la main-d’œuvre américaine « n’a pas accès à des congés de maladie payés et est pratiquement obligée d’aller travailler et de propager l’infection ou de se retrouver avec une assiette vide. » La situation est intenable du côté du capital, qui doit exploiter sa main-d’œuvre et trouve intolérable qu’elle reste à la maison ; et du côté des travailleurs qui, s’ils vont travailler, sont infectés ou en infectent d’autres, et s’ils restent à la maison, n’ont pas d’argent pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Cette croisée critique explique la belligérance croissante de Trump contre Cuba, le Venezuela et l’Iran, et son insistance à attribuer l’origine de la pandémie aux Chinois. Il doit créer un écran de fumée pour cacher les conséquences désastreuses de décennies de sous-financement du système de santé publique et de complicité avec les escroqueries structurelles de l’industrie pharmaceutique et médicale privée de son pays. Ou rejeter la responsabilité de la récession économique sur ceux qui conseillent aux gens de rester chez eux.
La pandémie et ses effets dévastateurs offrent une opportunité qu ’il serait impardonnable de laisser passer.
En tout état de cause, et indépendamment du fait que la sortie de cette crise sera un « communisme renouvelé » comme le souhaite Slavoj Žižek ou une expérience hybride, mais clairement orientée vers le post-capitalisme, cette pandémie (comme l’expliquent clairement Mike Davis, David Harvey, Iñaki Gil de San Vicente, Juanlu González, Vicenç Navarro, Alain Badiou, Fernando Buen Abad, Pablo Guadarrama, Rocco Carbone, Ernesto López, Wim Dierckxsens et Walter Formento dans divers articles qui circulent abondamment sur le web) a bouleversé les plaques tectoniques du capitalisme mondial et rien ne pourra plus jamais être comme avant. D’ailleurs, personne ne veut que le monde redevienne comme avant, à l’exception de la poignée de magnats qui se sont enrichis grâce aux pillages sauvages perpétrés pendant l’ère néolibérale. C’est un défi énorme pour ceux d’entre nous qui veulent construire un monde post-capitaliste, car, sans aucun doute, la pandémie et ses effets dévastateurs offrent une opportunité unique et inattendue qu’il serait impardonnable de laisser passer. Le mot d’ordre pour l’heure de toutes les forces anticapitalistes de la planète est donc : sensibiliser, organiser et lutter ; lutter jusqu’au bout, comme Fidel Castro l’a voulu lorsque, à l’occasion d’une réunion mémorable avec des intellectuels tenue dans le cadre de la Foire internationale du livre de La Havane, en février 2012, il nous a dit, avant de prendre congé de nous : « S’ils vous disent : soyez assuré que la planète est en train de s’éteindre et que cette espèce pensante est en voie d’extinction, qu’allez-vous faire, vous mettre à pleurer ? Je pense que nous devons nous battre, c’est ce que nous avons toujours fait. » Au boulot !




