Au Chili, près de 62 % de la population a rejeté le projet de nouvelle Constitution, un résultat en contradiction avec l’envie de changement marquée par les mouvements sociaux qui ont secoué le pays en 2019.
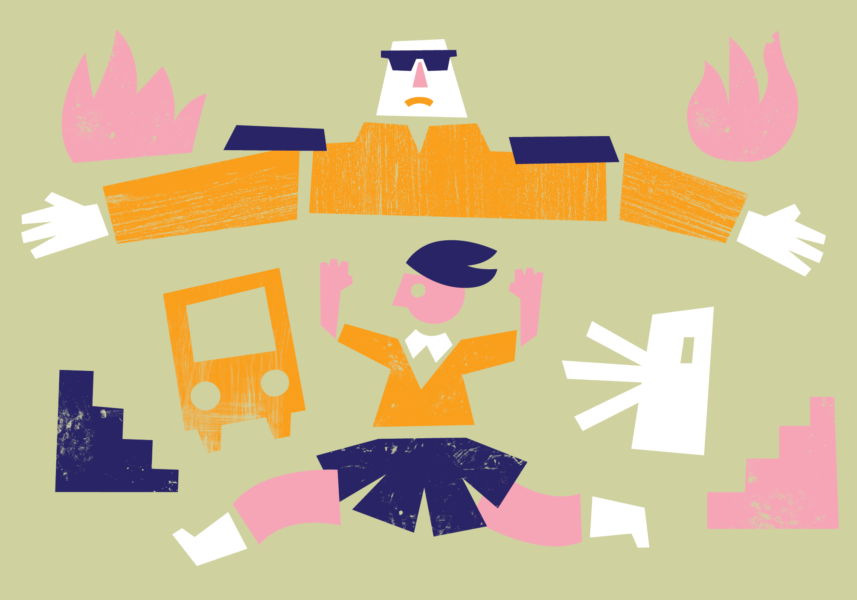
En tant que théoricienne radicale du droit constitutionnel, vous avez joué un rôle actif dans les débats sur la rédaction de la nouvelle constitution du Chili, fruit de la contestation populaire massive qui a secoué le pays en 2019. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quels problèmes pose la Constitution chilienne de 1980 actuellement en vigueur et ce qu’il fallait changer ?
Camila Vergara. La constitution de 1980 était un mécanisme juridique mis en place par la dictature de Pinochet pour codifier le néolibéralisme et empêcher l’État d’intervenir dans l’économie. C’était une sorte de camisole de force, qui s’appliquait à tout, du système électoral aux structures de pouvoir régionales, qui bloquait toute redistribution des richesses vers le bas et coupait les dirigeants politiques du mécontentement populaire. La précédente Constitution de 1925 régissait un système bien plus décentralisé ; les gouvernements régionaux, par exemple, devaient suivre les instructions des assemblées sélectionnées par les communes. Sous Pinochet, les gouverneurs et les maires étaient nommés par le président et les assemblées locales ont été abolies, ce qui a supprimé tout contrôle démocratique. Il était interdit aux syndicalistes de former un parti ou de présenter leur candidature en tant que représentants d’un parti. Le pouvoir était concentré au sommet.
Après sa défaite au plébiscite de 1988 et celle de son parti aux élections de 1989, Pinochet a insisté pour que nombre de ces dispositions antidémocratiques soient maintenues en place comme condition à son départ, ce que les partis traditionnels ont accepté. De nombreuses « poches d’autoritarisme » ont ainsi subsisté dans la Constitution. Les réformes engagées n’ont été que des simulacres de démocratisation ; par exemple, les maires sont désormais élus, mais c’est l’État central qui leur alloue la quasi-totalité de leurs fonds. Il n’était pas possible de révoquer les commandants des forces armées et de la police ; ils étaient sélectionnés par des procédures internes et le pouvoir exécutif élu n’était pas habilité à les remplacer. Le Conseil national de sécurité, cosena, composé de militaires, remplissait le rôle d’un pouvoir autonome qui surveillait et influençait le gouvernement civil. Il y avait des sénateurs désignés et des sénateurs à vie, nommés par Pinochet pour consolider sa mainmise sur l’État.
Qu’en est-il des réformes de 2005 menées par le gouvernement Lagos ? Ont-elles changé la donne ?
Les coalitions anti-Pinochet élues après 1990 ont tenté d’abolir ces « poches d’autoritarisme ». En 2005, le président socialiste Ricardo Lagos a supprimé la plupart d’entre elles, après des négociations avec les partis de droite au Congrès, et ratifié la constitution nouvellement modifiée. Mais Lagos a laissé en place une caractéristique clé du système : le système électoral binomial, qui permettait de former deux coalitions multipartites au sein desquelles la coalition minoritaire obtenait un nombre disproportionné de sièges au Congrès. Cette règle a d’abord profité aux partis pro-Pinochet, mais lorsque Lagos est entré en fonction, elle avait fini par profiter à sa coalition, la Concertación. Elle a donc été maintenue.
La constitution de 1980 mise en place par la dictature de Pinochet imposait le néolibéralisme et empêchait l’État d’intervenir dans l’économie.
En fin de compte, les réformes de Lagos ont démontré que supprimer les poches d’autoritarisme n’était pas si essentiel : le système peut toujours se renouveler, les inégalités structurelles persistent. Oui, nous nous sommes débarrassés des sénateurs à vie, mais les personnes qui les ont remplacés à ces postes étaient tout aussi conservatrices, donc, concrètement, cela ne changeait pas grand-chose. Lorsque le système électoral a été réformé en 2015, durant le deuxième mandat présidentiel de Michelle Bachelet, les circonscriptions ont été définies de manière à priver les gens de leurs droits. C’est ainsi que l’on a conservé la méthode D’Hondt (l’un des systèmes de représentation proportionnelle les moins représentatifs), qui désavantage les petits partis et renforce les blocs de coalition dominants.
Quelle est la composition de ces blocs dominants ?
La droite du spectre politique est occupée par une coalition composée de quatre mouvements différents : l’UDI, ou Unión Demócrata Independiente, créée en 1983 par des partisans purs et durs de Pinochet ; la Renovación Nacional, l’élite économique « rénovée », économiquement néolibérale et plutôt libérale sur le plan des valeurs culturelles. S’y ajoutent deux partis qui ont émergé plus récemment : Evópoli, dont le nom signifie quelque chose comme « évolution libérale », et le Parti républicain néofasciste, fondé par José Antonio Kast, candidat à la présidence lors de l’élection de 2021 et qui a quitté l’UDI, la jugeant trop modérée. Kast affirme que l’UDI a renoncé à son héritage et que le Chili devrait renouer avec l’ère Pinochet. Les Républicains ont cherché à imiter la politique de droite aux États-Unis en formant une coalition avec les évangéliques conservateurs. Ils ont actuellement quinze députés à la chambre basse.
Ensuite, il y a la Concertación. C’est la grande coalition formée en opposition à Pinochet lors du référendum de 1988. Elle rassemblait les démocrates-chrétiens (qui avaient initialement soutenu le coup d’État de 1973, puis ont fait marche arrière et rejoint l’opposition) et le parti socialiste, ainsi que le Partido por la Democracia et quelques autres petits partis. La Concertación a gouverné le pays pendant les trois premiers mandats qui ont succédé à la chute de la dictature, mais ses partisans ont petit à petit perdu espoir, car peu de choses ont changé. L’économie néolibérale a simplement accentué les inégalités. Ils ont ensuite intégré le parti communiste et se sont rebaptisés La Nueva Mayoría, « la nouvelle majorité ». Michelle Bachelet a été élue présidente pour la première fois en 2006 dans le cadre de cette nouvelle coalition.
Depuis l’effondrement du vote de La Nueva Mayoría en 2017, après que les scandales aient eu raison de Michelle Bachelet et de sa famille, le rôle de la Concertación a été supplanté par Apruebo Dignidad, « je soutiens la dignité ». Ce nouveau regroupement a été créé par le Frente Amplio (un large front de plusieurs mini-partis, allant du centriste Revolución Democrática à celui des Comunes dont le style se rapproche du mouvement Podemos) et par les communistes, pour se présenter aux élections de 2021. Cette coalition est dirigée par le président actuel, Gabriel Boric. En dehors de ces grands blocs, il y a aussi quelques petits partis écologistes et des indépendants. Mais, comme les élections au Congrès se déroulent sur la base de listes (il faut être élu dans le cadre d’une liste de candidats, et ces listes sont généralement dominées par les partis établis), ces nouvelles forces ont du mal à progresser.
Le Chili a connu une décennie de manifestations de rue contre les gouvernements conservateurs comme de centre-gauche, qui a atteint son point d’orgue avec le déferlement populaire de 2019. Qu’est-ce qui explique le caractère particulièrement explosif des manifestations de 2019, qui ont commencé en réaction à une légère augmentation du tarif du ticket de métro ? Comment décririez-vous leur caractère social et l’étendue de leur portée géographique ?
La première vague de protestations a commencé en 2006, lorsque des lycéens ont manifesté pour s’opposer à la suppression du financement du secteur de l’éducation. Le système de bons, héritage des « Chicago Boys », n’a pas fonctionné et les étudiants ont compris que ce n’était pas seulement le ministre de l’éducation qui était en cause, mais aussi la Constitution elle-même, car elle avait créé un système hybride public-privé à but lucratif. Les étudiants ont alors pris le relais des manifestations lycéennes en 2011 pour demander la suppression des frais d’inscription à l’université. Pendant ce temps, il y avait aussi des protestations en faveur de la protection de l’environnement, des manifestations syndicales, des marches pour défendre les retraites. L’un des mouvements les plus anciens, actif depuis l’époque de la dictature, était celui de la campagne pour une assemblée constituante. Lorsque Pinochet a quitté le pouvoir, les dirigeants de la Concertación l’ont assuré qu’ils ne convoqueraient pas une telle assemblée, mais gouverneraient dans le cadre constitutionnel dont ils avaient hérité. Après le soulèvement de 2019, ce n’était plus tenable.
La hausse du tarif du ticket de métro en 2019 était très faible. On parle de seulement 30 pesos chiliens ou quatre cents étasuniens, mais elle a eu un impact direct sur les familles de la classe travailleuse qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts avec leurs maigres salaires. La classe ouvrière chilienne vit depuis trente ans dans la précarité et la classe moyenne émergente est criblée de dettes. Le Chili a l’un des taux d’endettement les plus élevés de la région ; tout s’achète à crédit et la plupart des gens n’ont pas un peso d’épargne. Donc toute cette situation couve depuis longtemps.
Lorsque l’augmentation des tarifs de métro est entrée en vigueur, les lycéens (qui n’étaient pas réellement touchés par la hausse puisqu’ils payaient un tarif spécial) ont commencé à organiser une campagne massive de désobéissance civile. Tout a commencé à l’Instituto Nacional, une école qui était devenue une sorte d’emblème : une bonne école publique où 18 anciens présidents avaient fait leurs études. Le 11 octobre 2019, les étudiants ont commencé à enjamber les tourniquets du métro, se sont filmés en train de le faire et ont appelé les autres à faire de même. Des centaines d’étudiants en uniforme scolaire déferlaient chaque jour dans le métro et la police ne savait que faire. Finalement, les forces de l’ordre ont commencé à essayer de réprimer les protestations. Des vidéos montrant des policiers traînant une jeune fille par les cheveux, frappant des étudiants, etc. se sont mises à circuler et sont devenues virales. Cela a incité de plus en plus de gens à manifester leur solidarité avec les étudiants et à se joindre à ce mouvement de fraude des transports. Le pouvoir exécutif ne pouvait rien y faire.
Puis, le 18 octobre, le Chili s’est embrasé. On ne sait toujours pas exactement ce qui s’est passé, car il n’y a pas eu d’enquête, mais ce vendredi-là, le mouvement s’est étendu à tout le Chili, de Santiago aux provinces. À Santiago, l’exécutif a décidé de fermer les stations de métro centrales les plus fréquentées aux heures de pointe afin d’empêcher de nouvelles fraudes, ce qui a empêché les gens de rentrer chez eux après le travail. Tous les banlieusards sont descendus dans les rues et ont entamé une longue marche vers leurs quartiers. Plus tard dans la soirée, certaines des stations de métro fermées ont été incendiées ; personne ne savait qui étaient les responsables. Le gouvernement Piñera a immédiatement qualifié l’attentat de terroriste et mobilisé l’armée sur place (pour la première fois en trente ans) afin de réprimer les manifestations. On ne sait toujours pas qui sont les auteurs des incendies ayant ravagé les stations de métro. Il n’y a eu aucune arrestation, rien. Les stations étant construites en grande partie en métal, ce n’avait pas dû être facile. Bien sûr, on s’est beaucoup demandé si les forces armées n’étaient pas elles-mêmes à l’origine de ces incendies.
Le Conseil national de sécurité, cosena, composé de militaires, était un pouvoir autonome qui surveillait et influençait le gouvernement civil.
Les gens étaient sous le choc, mais ils ont continué à se mobiliser. Des Cabildos (des conseils démocratiques locaux) ont vu le jour un peu partout dans le pays. Lentement, dans les dix jours qui ont suivi, les différentes réclamations ont commencé à converger et le mouvement en faveur de l’assemblée constituante a pris le devant de la scène.
Les gens ont compris que toutes ces micro-luttes devaient être traitées au niveau structurel. Les réclamations se sont cristallisées de manière organique et c’est ainsi que la nécessité d’un nouveau pacte social et d’une nouvelle constitution s’est imposée. Tout le monde devait se réunir pour élaborer les règles du jeu fondamentales et se débarrasser de l’échafaudage autoritaire mis en place à l’époque de Pinochet. Lors des protestations de 2019, les gens se sont rassemblés dans les rues pour des manifestations de masse, mais ils se sont également retrouvés localement sur les places et dans les centres communautaires. Bien sûr, la dictature a laissé en héritage une défiance envers son voisin, car il pouvait très bien être un indicateur qui irait vous dénoncer à la police.
Les gens ont donc souvent tendance à taire leurs opinions politiques. Mais lorsque la cote de popularité de Piñera est passée sous la barre des 10 %, le système a perdu toute légitimité et les gens se sont sentis plus à même de discuter de nouvelles alternatives. Ils ont commencé à se demander de quoi ils avaient besoin pour construire une nouvelle société. C’est ainsi qu’ils en sont venus à réclamer une assemblée constituante. Lorsque cet objectif a commencé à sembler réalisable, ils se sont lancés dans la rédaction d’articles de cette nouvelle constitution et à faire campagne pour leurs propres réformes, sans attendre la mise sur pied de l’assemblée constituante. Aujourd’hui, ils se réunissent à nouveau pour analyser le nouveau projet de constitution. La présence des cabildos n’a jamais été entièrement cartographiée. Une étude universitaire en a recensé 1 800, mais elle se limitait à certaines régions du pays. Nous ne connaîtrons peut-être jamais leur nombre exact, mais ils étaient des milliers à travers le Chili.
M. Piñera lui-même était évidemment opposé à la tenue d’un référendum sur l’élaboration d’une nouvelle constitution. Pourquoi a-t-il cédé aux revendications du mouvement ?
C’est compliqué. Fin 2019, le taux de popularité du président atteignait à grand-peine les 7 %, voire moins ; dans la rue, les gens plaisantaient en disant qu’il se trouvait dans la marge d’erreur. L’exécutif n’avait aucun pouvoir. On a beaucoup discuté de ce qui se passerait après le départ de Piñera, s’il serait poursuivi pour violations des droits humains, etc. Les autres partis étaient également en position de faiblesse : aucun d’entre eux n’avait une base militante engagée, ils existaient surtout sur le papier et ne remportaient les élections que par défaut. Après les incendies des stations de métro, les gens ont parcouru les septante kilomètres qui séparent Santiago du Congrès, à Valparaiso, pour exiger une assemblée constituante, ce que la Constitution ne permettait pas. Tous les grands partis y étaient opposés, mais, dans les faits, ils n’avaient pas le choix ; ils ont donc essayé de devancer ce changement inévitable.
Ce qu’ils ont fait était assez malin. Le 14 novembre 2019, Piñera a réuni les dirigeants des partis de droite pour négocier avec la Concertación et le Frente Amplio. Ils se sont réunis dans l’ancien bâtiment du Congrès national à Santiago, qui a ensuite accueilli la Convention constitutionnelle, et ont convenu de discuter jusqu’à ce qu’ils parviennent à un accord. Aux premières heures du 15 novembre, près des négociations ininterrompues, les représentants sont parvenus à trouver la solution la plus conservatrice pour sortir de leur dilemme. Un tour de passe-passe qui aboutirait non pas à l’Assemblée constituante que le mouvement réclamait, mais à une « Convention constitutionnelle » qui devrait approuver chaque article à la majorité des deux tiers.
Il s’est avéré que la clé de l’accord avait été convenue dans les toilettes pour hommes entre Juan Antonio Coloma, l’un des sénateurs de droite de l’UDI, et Gabriel Boric, un dirigeant du Frente Amplio, aujourd’hui président du Chili. Ils s’y étaient rencontrés pour discuter de ce qui fallait pour faire avancer le processus. Ensemble, ils ont défini la condition de la super-majorité des deux tiers, qui impliquait que la droite pourrait opposer son veto à tout ce qui ne lui convenait pas. Cela a formé la base de l’accord final, qui a été signé à 2h30 du matin. Il a été baptisé « Accord pour la paix sociale et la nouvelle Constitution ». À partir de ce moment, le processus constitutionnel s’est divisé. Il y avait la ligne officielle d’une part, et la ligne populaire de l’autre.
Comment se compose la Convention constitutionnelle sur le plan politique ?
Au total, la Convention compte 155 sièges, dont dix-sept sont réservés aux représentants des peuples indigènes. Le bloc de droite, Vamos por Chile, pensait obtenir suffisamment de sièges pour disposer d’un veto unilatéral, mais il n’a finalement obtenu que 37 sièges, avec 21 % du vote populaire, ce qui l’a obligé à collaborer avec d’autres partis pour faire barrage aux propositions radicales. Le bloc Frente Amplio, Apruebo Dignidad, a obtenu 28 sièges, avec 19 % des voix, et la Lista del Pueblo 26 sièges, avec 16 %. Le plus grand perdant est le bloc Concertación, Lista del Apruebo, avec 25 sièges et 14 % des voix. Enfin, les indépendants non neutres ont obtenu 11 sièges, avec 8 % des voix. Cela montre l’évolution de l’opinion publique : les gens voulaient des candidats indépendants et non des candidats partisans.
Michelle Bachelet est élue présidente pour la première fois en 2006 avec la Concertación, nouvelle coalition associant le parti communiste.
On s’attendait à ce que les autochtones élus à la Convention soient progressistes, écologistes, etc. Or, la moitié d’entre eux étaient aussi membres des partis traditionnels, notamment la première présidente de la Convention, Elisa Loncón, qui a voté contre l’octroi de davantage de pouvoir politique à son propre peuple. En raison de ces divisions, la coalition des représentants autochtones s’est rapidement délitée après les élections. Certains ont commencé à voter comme les partis traditionnels, tandis que d’autres se sont rapprochés de ce qui restait de la Lista del Pueblo à la suite du scandale Rodrigo Rojas. Ensemble, ils ont créé la Coordinadora Plurinacional y Popular : un comité de coordination composé de représentants indigènes et populaires, qui est devenu la force la plus radicale de la convention.
Comment la Convention a-t-elle procédé pour rédiger la nouvelle constitution ?
En raison de l’ampleur de la tâche, la Convention a été divisée en sept commissions chargées de thématiques différentes : les droits fondamentaux, les principes constitutionnels, le système politique, la décentralisation, les institutions autonomes, la science et la culture, et l’environnement. Bien entendu, ces questions sont profondément liées entre elles, de sorte que les articles examinés par une commission étaient souvent déposés par une autre, mais la fonction de base de chaque commission était de rédiger des articles constitutionnels sur leurs sujets respectifs. Si un article obtient la majorité au sein d’une commission, il est transmis à la plénière, où il doit être adopté à la super-majorité. Les articles qui n’ont pas obtenu la super-majorité sont renvoyés à la commission qui les a rédigés révision. Ce processus a fait que les propositions progressistes ont été révisées et modérées à plusieurs reprises, jusqu’à perdre toute portée radicale.
Pour faire partie d’une commission, il fallait l’appui d’au moins 21 membres de la Convention. La droite, qui compte une trentaine de membres, pouvait donc décider des commissions dans lesquelles ses membres allaient siéger. Les indépendants avaient plus de mal à se placer, car ils devaient obtenir le soutien d’autres partis. Le processus d’auto-sélection a également eu pour conséquence le fait que tous les écologistes sont allés à la commission Environnement, par exemple. Ils ont donc pu rédiger un certain nombre d’articles ambitieux, mais aucun d’entre eux n’a obtenu les votes nécessaires pour être adopté en plénière.
La population a-t-elle participé d’une quelconque manière à ce processus ?
Lorsque la Convention a établi les détails de ses procédures, plusieurs propositions ont été faites pour créer des mécanismes de participation populaire contraignante. Les gens ordinaires voulaient être inclus dans les débats. Ils ne voulaient pas simplement élire leurs représentants et attendre un an pour voir les résultats. En effet, au moment où la Convention s’est réunie, à l’été 2021, certains cabildos avaient déjà rédigé eux-mêmes des constitutions entières. L’une des propositions était de permettre l’introduction de dispositions directement dans le texte de la Constitution si elles dépassaient un certain seuil de signatures. Une autre était d’organiser un référendum dans lequel ces dispositions seraient soumises à un vote populaire. Ces mécanismes auraient permis de contourner la règle de la super-majorité des deux tiers et d’inclure les masses dans le processus de rédaction. Cependant, les juristes traditionnels ont prétendu que c’était anticonstitutionnel et voté contre l’octroi de ce pouvoir contraignant au peuple. C’est là que les choses se sont gâtées, parce que les gens n’étaient finalement autorisés qu’à donner un avis non contraignant. Il a été décidé qu’ils seraient autorisés à présenter une idée à la tribune de la Convention s’ils recueillaient 15 000 signatures dans un délai d’un mois environ. S’ils obtenaient ces signatures, ils disposaient de dix minutes pour expliquer leur idée aux représentants, et répondre à quelques questions à son sujet. Ensuite, la Convention rejetait, acceptait ou modifiait la proposition.
La décision de conférer à cette participation un caractère non contraignant a été une déception, mais elle a néanmoins stimulé la poursuite de l’organisation sur le terrain, car les gens savaient qu’un petit cabildo ou un groupe communautaire ne parviendrait pas à réunir 15 000 signatures à lui seul, et devrait s’allier à d’autres. C’était une bonne chose en soi, même si la plupart de ces propositions de cabildo n’ont pas abouti. L’un des rares articles issus du niveau local à avoir finalement abouti dans la Constitution concerne le droit au logement. J’ai participé à la rédaction de cet article avec le groupe de campagne Movimiento de Pobladores en Lucha, « les squatteurs en lutte ». De nombreux comités pour le logement se sont réunis dans tout le Chili pour rédiger différentes versions, partager les modifications et recueillir des signatures. Le texte a finalement été intégré à la Constitution, avec peu de modifications. C’était donc une grande victoire.
Fin 2019, la popularité du président atteignait à peine 7 %. Les gens plaisantaient en disant qu’il se trouvait dans la marge d’erreur.
Il y avait une tension particulière entre les juristes, qui souhaitaient la stabilité et la modération (la transformation par petits pas, comme dirait Boric) et les secteurs populaires, qui n’étaient pas très au fait du jargon juridique. Beaucoup d’entre eux ont été découragés lorsqu’on leur a dit que leurs demandes, comme le droit au logement ou à l’eau, ne relevaient pas de la Constitution. J’ai insisté sur le fait que la Constitution est un document politique : on peut y mettre ce qu’on veut, il suffit de le présenter dans un langage constitutionnel. Le mariage entre un homme et une femme est inscrit dans de nombreuses constitutions dans le monde, on ne peut donc pas prétendre que les sujets d’importance sociale ne sont pas des questions constitutionnelles.
Que s’est-il passé avec la commission qui était chargée de la refonte du système politique ? Qui y était impliqué et qu’ont-ils fait ?
C’était la plus conservatrice de toutes les commissions. Les juristes de droite, formés dans le cadre de la Constitution de 1980, étaient surreprésentés en raison des règles d’auto-sélection de la Convention. Ils étaient chargés d’examiner la demande populaire d’abolition du Sénat. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient le remplacer par une chambre démocratique, dont l’autorité serait strictement limitée, et qui n’interviendrait que sur des questions constitutionnelles. Cependant, les juristes ont proposé un organe qui n’est pas bien différent de celui que nous avons actuellement. Ils ont cherché à mettre en place un système bicaméral asymétrique. La chambre législative basse se verrait accorder plus de pouvoir, comme la Chambre des communes, et la chambre haute serait composée de représentants des différentes régions, qui auraient le pouvoir de légiférer sur les lois régionales, y compris les taxes.
La même chose s’est produite avec le programme de réforme présidentielle. La Constitution de 1980 donne au président la prérogative exclusive d’initier toute loi qui touche au budget. Si vous voulez dépenser un centime, le président est seul à pouvoir faire en sorte que cela soit possible. Il y avait une pression pour réduire radicalement le pouvoir du président, peut-être même en instituant un modèle parlementaire avec un premier ministre. Mais ça n’a rien donné. La commission politique a proposé de réformer l’ancien système, de sorte que les lois budgétaires puissent désormais émaner de la chambre basse, mais elle a conservé le cadre présidentiel existant.
La commission a également débattu de propositions radicales visant à décentraliser la structure politique et accorder une autonomie maximale aux régions. La géographie du Chili a toujours requis une politique décentralisée. Le pays s’étend sur près de 4 200 km du nord au sud : le désert d’Atacama, au nord, est le plus sec du monde ; la vallée centrale est densément cultivée et urbanisée, avec un climat plutôt méditerranéen ; tandis que la zone méridionale possède des lacs et des montagnes similaires à ceux de la Suisse. Gouverner ces régions de la même manière n’a aucun sens. La Constitution de 1980 était fortement centralisée, le pouvoir législatif étant concentré au sein du Congrès, sur lequel le Sénat avait un droit de veto. Par conséquent, rien ne pouvait changer à moins que le président et les sénateurs ne le veuillent. La décentralisation était censée mettre un terme à cela : les maires auraient plus de pouvoirs budgétaires ; les gouverneurs seraient élus ; une nouvelle autorité législative serait établie au sein des régions.
Nous espérions créer des assemblées régionales qui pourraient agir comme des mini-congrès, légiférant uniquement sur les questions régionales. Cependant, la commission politique a freiné cela. La Concertación et la droite ont toutes deux affirmé qu’une plus grande décentralisation signerait l’arrêt de mort de l’unité chilienne. Le Chili deviendrait un État fédéraliste, et finirait par éclater. Elles ont donc approuvé les assemblées régionales, mais ne leur ont donné aucun pouvoir législatif. C’était un coup classique : créer un nouvel organe, mais limiter son pouvoir afin qu’il ne menace pas le statu quo.
Quelles forces au sein de la Convention étaient partisanes de la décentralisation et de ces autres réformes démocratiques ?
La majorité d’entre elles provenaient de la Lista del Pueblo, suivie de la Coordinadora Plurinacional y Popular, et de la liste du mouvement social, qui était liée à diverses campagnes environnementales. Ses membres venaient des régions ; beaucoup étaient des scientifiques ou des militants pour l’eau qui souhaitaient une décentralisation, afin d’arrêter l’écocide au niveau local. Dans l’ensemble, la Convention était divisée entre les forces populaires d’un côté, les forces conservatrices et la Concertación de l’autre, et le FrenteAmplio au milieu, agissant comme une sorte de charnière. Le Frente Amplio votait tantôt avec la droite, tantôt avec la gauche, en fonction de ce qui était politiquement opportun. Toutefois, dès qu’il s’agissait de participation populaire, il n’y avait plus d’ambiguïté : il se rangeait toujours derrière la droite.
Les représentants autochtones élus à l’Assemblée constituante n’étaient pas tous progressistes. La moitié siégeait au sein des partis traditionnels.
Par exemple, l’une des principales revendications du mouvement de protestation de 2019 était la tenue d’élections révocatoires. Piñera a essuyé deux motions de destitution au cours de sa présidence, et il a été sauvé à chaque fois par des législateurs de droite. Il y avait donc une pression croissante en faveur d’un mécanisme démocratique permettant de démettre un président de ses fonctions avant la fin de son mandat de quatre ans. Mais dès l’entrée en fonction de Boric, la commission chargée de trancher cette question a déclaré que cela serait trop déstabilisant. J’ai été appelée à donner mon avis et j’ai fait valoir que cela dépendait du seuil : s’il ne faut que 5 % de signatures de l’électorat pour déclencher un référendum révocatoire, il est évident que l’opposition va l’instrumentaliser.
Néanmoins, si le seuil est suffisamment élevé (et s’il existe d’autres garde-fous, comme l’impossibilité d’organiser le scrutin pendant la première année du mandat du président) ces problèmes ne se poseront pas. Au Venezuela, un référendum révocatoire a eu lieu en 2004, deux ans avant la fin du premier mandat de Chávez. Ce vote avait finalement stimulé la participation démocratique et renouvelé la légitimité du gouvernement, ainsi que celle de la Constitution vénézuélienne de 1999. Les référendums révocatoires ne sont donc pas nécessairement une mauvaise chose, pour autant que les procédures appropriées soient en place. La commission politique de la Convention a examiné environ huit propositions, avec des seuils différents : 5 %, 8 %, 10 %. La proposition la plus conservatrice était de 35 %, ce qui impliquait des millions de signatures (c’est-à-dire plus que le nombre de personnes qui ont voté pour Piñera) mais même celle-là a été rejetée.
Les élections législatives et présidentielles du Chili ont eu lieu à mi-parcours des délibérations de la Convention constitutionnelle, en novembre et décembre 2021. Considérez vous que la victoire au second tour de Boric sur Kast s’inscrit dans la même vague que le processus constitutif, ou ces deux choses sont-elles en contradiction ? Quel a été son rôle dans le processus de convention constitutive ?
Oui, je pense qu’il y a là une contradiction. Comme je l’ai dit, Boric a été l’une des parties de l’accord du 15 novembre 2019 qui a réduit le processus constitutionnel. Il est donc considéré par beaucoup dans les classes populaires comme un vendu, un traître, un jaune. En tant que leader des manifestations étudiantes de 2011- 2013, il était vaguement radical. Mais la Fédération des étudiants de l’université du Chili, dont il était le président, fait néanmoins partie de la structure de pouvoir établie : il y a un chemin tout tracé entre le rôle de leader étudiant et celui de fonctionnaire du gouvernement. Dès le début de sa carrière, Boric s’est montré favorable à des mobilisations étudiantes bien ordonnées, mais hostile aux contestations plus houleuses de la classe travailleuse.
Aujourd’hui, après presque dix ans passés au Congrès, cette position est deux fois plus marquée chez lui. Bien qu’il se présente comme anti-système (il n’a jamais porté de cravate, il a des tatouages, etc.) il s’est peu à peu adapté. Il s’est fortement rapproché de Lagos, qui a éduqué Boric dans l’espoir qu’il devienne plus mature et responsable. Et c’est précisément ce qui s’est passé.
En fin de compte, la raison pour laquelle il est président, c’est que José Antonio Kast était l’autre nom sur le bulletin de vote en 2021. Au premier tour, Boric n’a pas réussi à obtenir un tiers des voix. Mais à cause de la menace de l’extrême droite, les gens l’ont choisi comme un moindre mal. Maintenant qu’il est au pouvoir, il insiste sur le fait que le changement doit être très progressif. Peu après son élection, il a donné une interview dans laquelle il reconnaissait que le système de retraite devait être réformé, mais que cela allait prendre quarante ans. Le système actuel a été conçu par les Chicago Boys sous Pinochet, dans le but de créer un marché de capitaux au Chili. Il oblige les Chiliens à épargner eux-mêmes un pourcentage de leur salaire, une épargne qui est ensuite regroupée en clusters par des gestionnaires de fonds et placée sur les marchés de capitaux. De cette manière, le public prête de l’argent à la classe des investisseurs. Par conséquent, si on modifie le système de retraite, il faudra également remodeler radicalement les marchés de capitaux. Cela affectera le secteur financier et les oligarques résisteront. Boric cherche donc désespérément à éviter cette confrontation.
Y a-t-il une contradiction imminente entre cette approche gradualiste et certains des droits consacrés par la Convention constitutionnelle, tels que le droit à la santé et au logement ?
Tout le monde sait que nos nouveaux droits constitutionnels ne signifient pas grand-chose si nous n’avons pas les mécanismes pour les réaliser. Sans cela, ils ne sont que de bonnes intentions. Si on veut proclamer un droit au logement, il faut construire des maisons. Et alors, comment s’y prendre ? L’État va-t-il créer sa propre entreprise de construction ? Va-t-il externaliser le projet ? Combien d’argent est-il prêt à investir ? Ensuite, il y a le système de santé. À l’heure actuelle, 20 % en est détenu par des acteurs privés, et la partie publique est chroniquement sous-financée. Pour concrétiser le droit aux soins de santé, il faudrait adopter de nouvelles lois, qui devraient d’une manière ou d’une autre passer par un Sénat conservateur. Nous risquons d’être empêtrés dans cette situation pendant des décennies. Et Boric est d’accord avec ça.
Il y avait une certaine tension entre les juristes, qui visaient la stabilité et la modération, et les membres issus des milieux populaires.
Sur un point crucial, le projet de Constitution est encore plus conservateur que la précédente. Même la Constitution de 1980 n’a pas touché à la propriété publique des mines, qui avait été établie par Allende. Pinochet en avait réservé une partie des bénéfices pour les forces armées. Aujourd’hui, le discours est plus ambigu. La droite a veillé à ce que rien dans le nouveau document ne suggère que l’État puisse nationaliser des ressources. La proposition de nationaliser le lithium, par exemple, a été rejetée. Et si on ne nationalise pas les ressources, alors où trouver l’argent pour réaliser les droits sociaux de la Constitution ? Sans argent, on peut déclarer autant de droits qu’on veut, mais, concrètement, cela ne va pas changer grand-chose.
En outre, nombre de ces nouveaux droits sont en contradiction avec les accords commerciaux du Chili : le partenariat transpacifique 11 et l’accord avec l’Union européenne. Il est prévu de créer un tribunal des investisseurs au Chili, qui déciderait du montant des indemnités à verser aux entreprises touchées par des modifications législatives. En ce qui concerne le droit à l’eau (qui stipule que l’eau est un bien commun et ne peut être la propriété de quiconque) les entreprises font la queue pour poursuivre le pays en justice afin d’obtenir une compensation. La réalisation de l’un ou l’autre de ces objectifs pourrait donc prendre des décennies. C’est pourquoi des efforts organisationnels sont déjà en cours pour tenter de faire en sorte que le rythme de la transformation soit déterminé par la base, et non par le sommet.
Boric ne propose donc aucun programme de transformation sur le plan social à proprement parler ?
Lorsqu’il s’est présenté aux primaires contre le candidat communiste, Daniel Jadue, il en avait un, prévoyant notamment un revenu de base universel, ainsi que la nationalisation et une obligation de participation politique. Mais, par la suite, ces promesses se sont envolées. Il s’est présenté à la présidence via la plateforme Concertación 3.0 formée autour de l’idée d’affiner les règles du jeu actuelles et les rendre un peu plus inclusives.
À quoi le processus de rédaction de la Convention a-t-il abouti ? En quoi consiste la nouvelle Constitution du Chili ?
Les points forts du projet de Constitution sont, outre les droits sociaux, son caractère plurinational. La Constitution Pinochet- Lagos ne mentionne même pas les populations autochtones, qui représentent pourtant 10 % de la population. L’ONU a beau dénoncer ces mauvais traitements depuis des dizaines d’années, rien n’avait encore changé à ce niveau. Désormais, en plus de disposer de quotas à l’Assemblée nationale, le Chili sera défini comme un État plurinational, ce qui signifie que les différentes minorités ethniques seront reconnues et auront le droit à l’autodétermination. Par exemple, les communautés autochtones auront la possibilité de réagir aux délits d’une manière qui correspond à leurs propres traditions, plutôt que de s’en remettre aux procédures standard d’application de la loi. À cela s’ajoutent des mesures de décentralisation qui, même si elles ne vont pas assez loin, concèdent une plus grande autonomie financière et politique aux régions.
La parité entre hommes et femmes a également été introduite dans toutes les institutions gouvernementales, ce qui constitue un énorme pas en avant. L’un des articles stipule que les femmes disposent librement de leur corps. C’est une avancée majeure dans un pays où des femmes se retrouvent encore en prison pour avoir tenté de se faire avorter. En outre, tous les juges devront suivre régulièrement des cours de formation à la lutte contre les discriminations, supervisés par un organisme indépendant. Le racisme ou la misogynie seront désormais des motifs de licenciement immédiat.
Boric était favorable aux mobilisations étudiantes bien ordonnées mais hostile aux contestations houleuses de la classe travailleuse.
Il y a aussi le volet écologique. L’une des premières choses dont la Convention a convenu est que ce projet de Constitution intervient en période de crise climatique. Quelque 98 % se sont accordés sur ce point. Il faut espérer que cela nous permettra d’exercer un plus grand contrôle sur les entreprises polluantes et de désigner certaines parties de l’environnement comme des biens publics non privatisables. Notre système actuel permet toutes sortes d’irrégularités sur le plan écologique. Par exemple, Barrick Gold, une société canadienne, a trouvé de l’or sous un ancien glacier et convaincu les autorités environnementales qu’elle pouvait déplacer ce glacier afin d’extraire l’or qu’il recouvre. Grâce à la nouvelle Constitution, il devrait être possible de bloquer de tels projets. La Convention a décidé que la nature a non seulement le droit d’être protégée, mais aussi de se régénérer, et les implications de cette décision pourraient entraîner des transformations.
La Constitution prévoit-elle des compétences permettant d’organiser des référendums ?
Les référendums sont autorisés depuis toujours, mais seulement à l’initiative du Président et du Congrès. La nouvelle Constitution, cependant, devrait créer trois mécanismes donnant plus de pouvoir aux citoyens ordinaires. Le premier est le droit d’abroger les lois. Si une pétition recueille suffisamment de signatures (à savoir 5 % du nombre de votants lors des dernières élections), cela déclenche un référendum sur l’abrogation d’une loi. C’est très important, car, bien souvent, il faut abroger des lois avant d’en créer de nouvelles. Si le Congrès refuse d’adopter des réformes, l’abrogation des lois existantes pourrait l’obliger à le faire. Deuxièmement, il y a la capacité d’initier une réforme constitutionnelle.
Moyennant un seuil de signatures plus élevé (10 %), les citoyens peuvent organiser un référendum sur un nouvel amendement constitutionnel. Et, enfin, il y a le pouvoir d’initier un tout nouveau processus constitutif. C’est comme un bouton de réinitialisation. Si 25 % de l’électorat marquent leur volonté de le faire, un processus d’élection d’une nouvelle assemblée constituante chargée d’élaborer une nouvelle constitution peut commencer. Ce sont les trois mécanismes auxquels le peuple peut recourir pour exercer sa volonté. Ce n’est pas le type de démocratie pour lequel nous nous sommes battus. Nous voulions que le pouvoir local puisse opposer son veto à des propositions qui ont un impact négatif sur sa communauté. Ça n’a pas marché, mais, au moins, nous avons la possibilité de démanteler le système et de repartir de zéro.
Que va-t-il se passer maintenant ?
En mai 2022, une fois tous les articles rédigés, les sept commissions initiales ont été dissoutes et la Convention en a créé une nouvelle : la commission d’harmonisation. Elle est chargée de rédiger le préambule, ce qui est une entreprise pour le moins épineuse. Elle est également chargée de veiller à la cohérence du langage utilisé dans la Constitution, de supprimer les répétitions, etc. Ce sont des questions d’ordre rédactionnel, mais on peut exercer un réel pouvoir en apportant de telles modifications.
Au final, il n’aura fallu à la Convention que dix mois pour produire un document de 499 articles. C’est un exploit, même si cela témoigne également du fait que différentes questions n’ont pas fait l’objet de débats sérieux. Au lieu d’être consigné par écrit, l’ensemble du processus constitutionnel a été diffusé en ligne. Cependant, les commissions travaillaient en parallèle et, comme on ne peut pas regarder sept commissions en même temps, il était difficile pour les gens de suivre ce qui se passait. Et les médias grand public (qui ont toujours été vigoureusement opposés à la Convention) n’ont pas couvert les questions de fond. Le public n’a donc pas vraiment été informé du contenu du texte en lui-même. Pour y remédier, des gens se sont désormais organisés pour examiner la Constitution chapitre par chapitre, pour voir ce qu’elle contient et partager ces informations avec le grand public.
Certains estiment que 499 articles, c’est trop. Est-ce un argument fondé ?
Il est vrai que cette Constitution est l’une des plus longues du monde. Toutefois, notre précédente constitution comptait quelque 300 articles. N’oubliez pas qu’il existe deux écoles en matière de constitution : la minimaliste, dont le plus célèbre exemple est celle des États- Unis, et celle qui se veut plus exhaustive.
Au Chili, il y a tant de chose à changer qu’il faut tout expliciter. On ne peut pas se contenter d’affirmer le droit des gens au logement, sans autres précisions. De quoi parle-t-on ? Du droit à un toit dans un camp de réfugiés ? Il en va de même pour le droit à la santé. On pourrait dire qu’il signifie simplement que vous avez le droit d’acheter votre propre assurance maladie. Sans aller plus en profondeur, on ne fait que réaffirmer les choses telles qu’elles sont actuellement. Si vous regardez les constitutions sud-africaine et brésilienne, leurs articles ne font qu’une ligne chacun, ce qui signifie que les juges n’ont aucune matière à interpréter. Ils ne peuvent pas obliger le gouvernement à prendre ces dispositions au sérieux. Ainsi, plus le statu quo est inégal et biaisé, plus l’objectif de changement doit être fixé de manière explicite.
Comment le projet de Constitution a-t-il été accueilli au Chili, jusqu’à présent ?
La Concertación s’est alliée aux médias pour clamer que ce projet est voué à l’échec, que c’est une sorte de document utopique trop long et trop bavard et qu’il faut dès lors le rejeter et recommencer de zéro. Même Lagos a décrété qu’il fallait voter contre la nouvelle Constitution parce que la sienne était bien meilleure. Selon les sondages, environ 40 % des répondants veulent rejeter le projet de Constitution. On sait que ces enquêtes sont souvent manipulées. En fait, habituellement, 50 % de la population ne vote pas, et nous ne savons pas vraiment comment ces 50 % se positionneront lors d’un scrutin obligatoire. Si le projet est adopté, la lutte pour la mise en oeuvre des réformes inscrites dans la Constitution commencera, et M. Boric, au sein du bloc conservateur, fera tout pour ralentir le processus.
La droite a veillé à ce que le projet de constitution ne suggère pas de nationalisations des ressources, par exemple du lithium.
Cela créera beaucoup de mécontentement à l’égard du gouvernement vu comme progressiste, avec le risque que cela ouvre la porte à l’extrême droite. La Convention vient de décider des dispositions transitoires à mettre en place pour que la nouvelle Constitution puisse être ratifiée. M. Boric a demandé, par écrit, de maintenir les structures actuelles en place jusqu’à l’expiration naturelle des mandats. Suite à cela, la Convention a décidé que les sénateurs désignés l’année dernière conserveraient leur siège jusqu’en 2026 et que M. Boric lui-même irait jusqu’au bout de sa période de quatre ans.
Il n’y aura donc aucune tentative de remise à zéro. C’est un non-sens juridique. On ne peut pas fonder un pouvoir législatif sur des règles qui ont déjà été abolies. D’autres processus constitutifs ont déjà eu lieu en Amérique latine, avec exactement la procédure inverse : de nouvelles élections sont organisées dès que la nouvelle Constitution est adoptée. Il faudrait procéder de même au Chili, mais Boric sait qu’un nouveau scrutin ne lui sera probablement pas favorable.
Selon vous, où se situe le Chili par rapport aux diverses expériences latino-américaines de refonte des constitutions ?
Pour les pays andins, le renouveau constitutionnel a été très important. La campagne de dirigeants tels que Chávez, Evo Morales et Rafael Correa était d›ailleurs basée là-dessus.
Les conservateurs chiliens voulaient à tout prix éviter un tel processus constitutionnel typique de la vague rose. On a souvent entendu que cela nous mènerait à un « Chilezuela ». Pourtant, ces pays ont connu une dynamique différente. Au Venezuela, on était face à un processus parti du sommet : c’est Chávez qui a établi les règles du processus et l’Assemblée constituante de 1999 était dominée par les chavistes. Elle a toutefois produit une constitution pluraliste, avec des mécanismes favorisant la participation de la population.
En Bolivie, le gouvernement de droite sortant a imposé la règle de la super-majorité des deux tiers pour chaque article constitutionnel. Le processus était donc dans l’impasse, puisqu’il manquait quelques sièges à Morales pour atteindre la super-majorité. Cela a donné lieu à des mois de violence dans les rues, jusqu’à ce qu’un accord soit finalement adopté pour supprimer cette exigence de la super-majorité. En Bolivie, les communautés indigènes, largement favorables à la nouvelle Constitution mais souvent critiques à l’égard de Morales, se sont organisées de manière plus concertée.
Au Chili, beaucoup de gens sont favorables à un rejet de la nouvelle Constitution, ce qui n’a jamais été le cas ailleurs en Amérique latine. En fait, l’establishment exerce aujourd’hui à une forte pression pour prendre le contrôle du processus. Une publicité diffusée à la télévision comparait la Constitution actuelle à un ménage à revenu moyen, disant que nous allions juste ajouter un patio, remplacer les fenêtres, etc. Que nous allions rénover la maison et pas en construire une nouvelle. Et que la convention était qualifiée de constitutionnelle et non constituante, parce qu’elle devait se conformer aux règles fixées par le Congrès et ne pouvait pas être un pouvoir constituant en tant que tel. Cela signifie que le mouvement en faveur d’une assemblée constituante se poursuit, avec des appels à un processus démocratique qui ne soit ni coopté par les élites ni conçu pour exclure la participation populaire.
Dans les groupes communautaires avec lesquels je travaille, beaucoup estiment que le nouveau projet de constitution est tout simplement illégitime. J’essaierai de les convaincre que, malgré ses défauts, il constitue néanmoins une étape importante dans une lutte plus large. Mais qui sait ce qu’ils décideront ? Nous nous trouvons dans une situation très précaire. La légitimité de notre processus constitutionnel est extrêmement fragile par rapport à ses précurseurs au Venezuela, en Équateur et en Bolivie.




