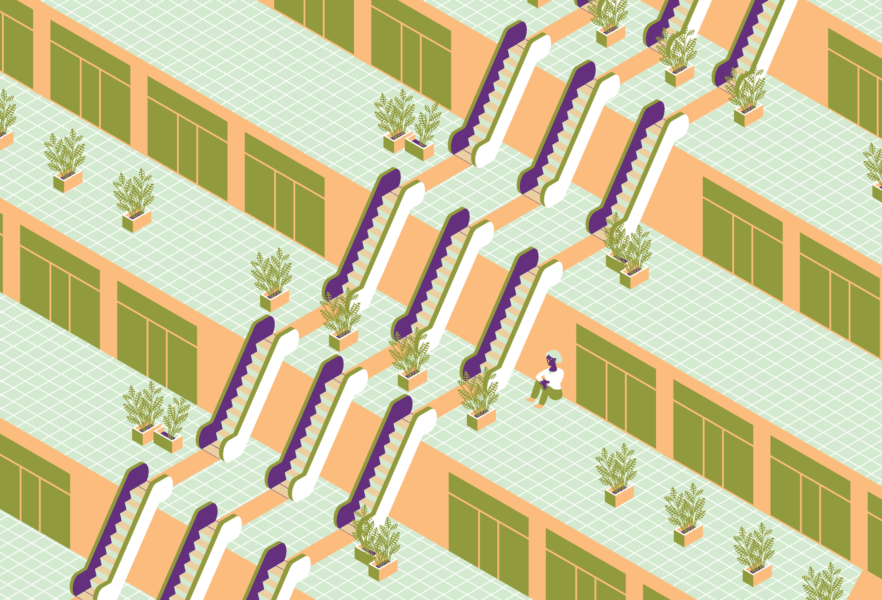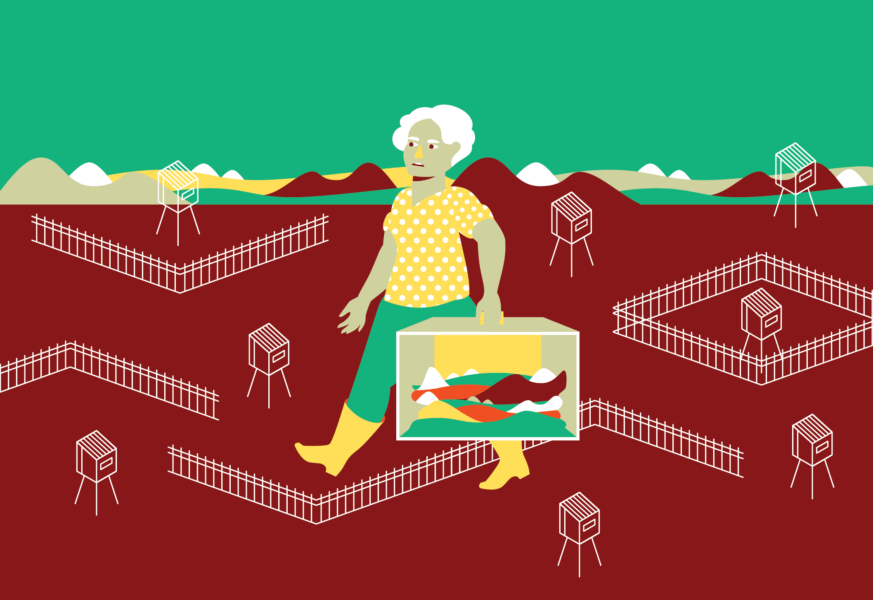Que veut dire «journalisme engagé»? Réponses du journaliste Jean-Baptiste Malet sur la rhétorique de la rébellion, la déontologie journalistique et la culpabilité individuelle.

Le journalisme d’investigation s’est réaffirmé ces dernières années : est-ce un qualificatif que vous endossez ?
Le journalisme auquel je crois est un journalisme sans étiquette, au long cours, mêlant recherches opiniâtres et reportages, à rebours de l’actualité, capable d’incarner un contre-pouvoir et d’aller là où personne ne l’attend. Tous les journalistes devraient pouvoir investiguer. Cela ne devrait pas être une spécialité. Si le « journalisme d’investigation » consiste à explorer des recoins méconnus du réel pour écrire de bonnes histoires permettant de rendre intelligible la complexité du monde, j’y souscris. Mais s’il s’agit de qualifier un journalisme spectaculaire où le frisson est « garanti », c’est non, car la visée sensationnaliste dégrade l’information en la déformant. Non encore à ce « journalisme d’investigation » s’il n’est que la caution morale d’un paysage médiatique en ruine, où l’information dégradée tend à s’imposer au détriment de l’information de qualité.

Un ancien candidat à la présidentielle n’hésitait pas à parler des médias comme « la deuxième peau du système » : qu’en pensez-vous ?
Je n’adhère pas à ce propos de Jean-Luc Mélenchon car, à mes yeux, la tournure manque cruellement de nuance. Tout d’abord, je n’adhère pas à cette opposition entre « système » et « anti-système ». C’est une vision du monde que l’on doit à la contre-culture. Elle nous dit en substance qu’il y aurait « les purs » d’un côté, et les « impurs » vendus aux puissants de l’autre. Je crois d’ailleurs comprendre que Jean-Luc Mélenchon se range parmi ceux de « l’anti-système ». Cela traduit une erreur de positionnement stratégique qu’il partage avec de larges pans de la gauche contemporaine. Ce discours opposant « système » et « anti-système » a permis au capitalisme de se régénérer ces dernières décennies, en vendant des marchandises estampillées « 100 % rebelle » ou « politiquement incorrect » aux Occidentaux — marchandises textiles, musiques, livres, journaux, etc. En réalité, à chaque fois, il s’agit toujours d’une marchandise ou d’un service au doux parfum de révolte. D’un simple segment dans l’offre. D’une part de marché. Cette sémantique du « rebelle », qui se pense et se veut libre « en dehors du système » alors même que l’entièreté de sa vie se déroule sous un régime capitaliste, cette sémantique a colonisé nos imaginaires et maintient la gauche dans un état de minorité.
Le pluralisme et l’information de qualité devraient être des biens communs et faire l’objet d’un consensus démocratique large, trans-partisan.
À la dénonciation du « système », je préfère la critique du capitalisme. Le capitalisme n’a aucune morale. Il se fiche de ce qui est « pur » et « impur », « rebelle » ou « classique », de ce qui est bon ou mauvais. Il se fiche que vous soyez tatoué ou tiré à quatre épingles. Il n’est qu’une logique d’accumulation. Construire des hôpitaux ou des bombes, des écoles ou des bagnes, fabriquer des tee-shirts imprimés ou des bottes de combat, des bougies d’anniversaire ou des engins incendiaires, imprimer des livres de poésie ou des manuels d’artilleurs : peu importe. Dans l’industrie culturelle, c’est la même chose. Les médias, l’édition, la télévision sont capables de produire le meilleur et le pire, le consentement et la critique du consentement. Ce ne sont pas seulement les médias et les journalistes qui sont soumis à la dure loi du marché, mais l’ensemble de la population.
L’idée de Jean-Luc Mélenchon est que ce qu’il nomme « système » ne peut-être nu, et que pour qu’il soit « acceptable », il lui faut un emballage, le discours médiatique. Le danger d’un tel propos, c’est de faire croire que tout discours sert en définitive ce « système » dont les contours ne sont pas définis. Que des médias étant la propriété de milliardaires puissent servir les intérêts des puissants, cela n’est pas nouveau : il en est ainsi depuis les débuts de l’industrialisation du monde. La critique des médias est nécessaire et incontournable dans une démocratie digne de ce nom. On ne dénoncera jamais assez les collusions entre certains journalistes « chiens de garde » et certaines sphères du pouvoir politique, économique ou religieux. Pour autant, le journalisme produit aussi l’oxygène vital des démocraties. Sans contre-pouvoir, sans information de qualité, sans indépendance de la presse, la liberté n’est qu’une illusion et la démocratie, un idéal inachevé. Tous les titres de presse ne se valent pas. Toutes les pratiques journalistiques ne se valent pas. Le pluralisme et l’information de qualité devraient être des biens communs et faire l’objet d’un consensus démocratique large, trans-partisan.
Aussi, selon moi, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’une force politique capable d’organiser la société en fonction des besoins des citoyens ; de nous affranchir de la domination et de l’oppression dans laquelle nous maintient le règne impitoyable du capital. À mon sens, nous n’avons pas besoin de « médias anti-système » ou « alternatifs », de « rebelles » ou de « dissidents ». Nous avons besoin de médias indépendants des puissances d’argent et des pouvoirs, et ce, quels que soient leurs postulats ou leur ligne éditoriale. À ce propos, le « projet pour une presse libre » proposé par Le Monde diplomatique est une excellente piste de réflexion1.
Vous vous êtes infiltré chez Amazon en travaillant dans un entrepôt (« En Amazonie », Fayard, 2013) et vous vous êtes déjà fait passer pour un acheteur de concentré de tomates (« L’Empire de l’or rouge », Fayard, 2017), mais vous avancez parfois à visage découvert. Comment choisissez-vous la méthode à adopter ?
Parfois, pour produire ou vérifier une information, il faut explorer certains univers inaccessibles et être prêt à entreprendre des démarches originales. Si vous souhaitez connaître les prix pratiqués par des fraudeurs de l’industrie agro-alimentaire, par exemple le pourcentage de concentré de tomates que contient réellement une boîte produite dans les conserveries de Tianjin en Chine — boîte que des industriels chinois écoulent ensuite sur les marchés d’Afrique de l’Ouest —, le seul moyen d’avoir accès à cette information ou de la vérifier est de vous faire passer pour un importateur de concentré de tomates. Pour moi, il n’y a rien de plus déontologique que de produire une information vérifiée et d’aller au fond des choses. La bonne méthode, c’est celle qui permettra de produire une information de qualité. Je n’écris pas que la fin justifie les moyens mais, dans certains cas bien précis, lorsqu’une information est absolument inaccessible « à visage découvert », un journaliste n’a pas d’autre option que de cacher temporairement son identité de journaliste pour faire correctement son métier.
Un journaliste se doit de produire une information de qualité comme un boulanger se doit de produire du bon pain
Vous assumez être politiquement situé lorsque vous dites « Écrire le roman d’une marchandise est bien évidemment une démarche d’inspiration marxiste ». Si vos écrits sont édifiants, vous avez aussi affirmé : « Mon livre ne contient pas de conclusion ni de préconisations politiques. » Peut-on être engagé en mettant l’accent essentiellement sur le factuel et le descriptif ?
Votre question m’offre l’occasion d’apporter des précisions sur cette notion d’ « engagement » dans le journalisme, notion qui prête souvent à confusion. Un journaliste n’est pas un militant, un sauveur, un justicier ou un chevalier blanc. Un journaliste se doit de produire une information de qualité comme un boulanger se doit de produire du bon pain. Je suis un journaliste engagé, mais « journaliste engagé » ne signifie pas pour moi « journaliste partisan ». Le seul engagement que je revendique, c’est celui de montrer le monde tel qu’il est. Sa complexité économique. Son extrême violence. C’est un engagement et un devoir de nommer les choses, de raconter les rapports de production, de décrire la pyramide des classes, d’ouvrir des portes jusqu’alors fermées. Lorsque vous êtes un journaliste indépendant et que vous entendez produire une enquête aussi complète que possible, alors il faut vous engager personnellement et, bien souvent, faire des sacrifices dans votre vie intime. Personne ne vous y oblige : si vous le faites, c’est parce que vous y croyez et que vous pensez cela nécessaire. Je n’ai jamais écrit pour « dénoncer le capitalisme » mais pour le raconter tel qu’il est, froidement, en dévoilant certains de ses rouages les plus impitoyables. Si L’Empire de l’or rouge ne contient pas de conclusion ni de préconisations politiques, il décrit cependant des arcanes du capitalisme. Ce travail de dévoilement des soubassements du monde, c’est ce que j’attends du journalisme. En deçà de cette exigence, il n’est que communication et flatterie à l’égard des puissants.
Face aux conditions de production qui se cachent derrière de simples produits, certains espèrent changer les choses en modifiant seulement leur comportement de consommateurs (« voter » avec son portefeuille, « consom’action »). Quelles limites y voyez-vous ? Mangez-vous encore des pâtes à la sauce tomate ?
J’ai donné un entretien à propos de mon enquête sur Pierre Rabhi publiée dans Le Monde diplomatique en août 2018. Dans cet entretien, j’ai exprimé l’idée que ceux qui souhaitent transformer le monde ne devraient pas s’encombrer de morale puritaine. J’ai ajouté : nous ne devons pas nous culpabiliser d’utiliser un téléphone portable ou des vêtements qui sont le fruit de l’exploitation des travailleurs. Certains ont alors aussitôt tronqué mon propos pour s’en indigner et m’accuser de cynisme ou d’indifférence. Pour autant, je ne faisais pas l’éloge du cynisme et je ne suis absolument pas indifférent à l’exploitation des travailleurs, ni même aux externalités des activités économiques. C’est tout le contraire : je dénonce l’attitude de ces individus des classes les plus favorisées qui affirment que pour changer le monde il serait urgent d’acheter « éthique » et d’agir individuellement selon sa « conscience éco-citoyenne ».
La course puritaine à l’achat vertueux est l’amorce d’une dépolitisation de la société par la consommation.
On ne peut que se réjouir de constater que des alternatives agricoles ou industrielles éclosent. Mais lorsqu’un intérimaire précaire achète sa nourriture dans un supermarché premier prix, s’habille avec les vêtements les moins chers et fait son plein de diesel pour aller pointer à l’entrepôt logistique, doit-il se sentir coupable de cela ? Quand nous utilisons un téléphone ou un ordinateur pour communiquer ou travailler, devons-nous nous sentir coupables de cela ? Je pense que non. Nous ne sommes pas coupables des rapports de production qui nous ont été imposés. Bien entendu, nous sommes individuellement responsables de nos actes. Mais nous le sommes aussi, et surtout, collectivement. Aujourd’hui, nous n’avons malheureusement pas le droit de connaître la provenance exacte de nos marchandises et c’est pourquoi il nous faut, parmi beaucoup d’autres choses, promouvoir la transparence la plus absolue des flux de marchandises et des rapports de production. Un boycott peut être une arme politique efficace dans certaines circonstances — l’histoire sociale le prouve. Mais rien ne changera sans lutte politique structurée. La course puritaine à l’achat vertueux est l’amorce d’une dépolitisation de la société par la consommation. Nous ne devons pas avoir honte de vivre dans un monde impitoyable et violent. Ce n’est pas en nous culpabilisant et en nous auto-flagellant que nous transformerons le monde. Il me paraît plus judicieux de montrer du doigt ceux qui devraient avoir honte des situations d’exploitation, plutôt que d’avoir honte pour eux. Si des millions d’individus en Afrique de l’Ouest consomment quotidiennement des produits alimentaires chinois frelatés, ce n’est pas parce qu’ils l’ont choisi ou qu’ils ne font pas assez de yoga afin d’ « ouvrir leur conscience ». Si des millions d’êtres humains mangent des produits frelatés, c’est parce qu’une poignée d’industriels l’a décidé pour eux, arbitrairement.
Rien ne changera sans lutte politique structurée.
J’en reviens donc au journalisme : collectivement, il nous faut savoir ce qu’il en est du monde, de ses fonctionnements dits économiques, c’est-à-dire appréhender toutes ses formes capitalistes qui déterminent notre quotidien, nos vies. Bien des aspects nous en sont masqués. Qu’il s’agisse de la sauce tomate dans nos pizzas ou des fraudes fiscales de tel ou tel dirigeant politique ou patron de l’industrie, le journalisme est un travail primordial et sans fin : tout est à faire encore et toujours.