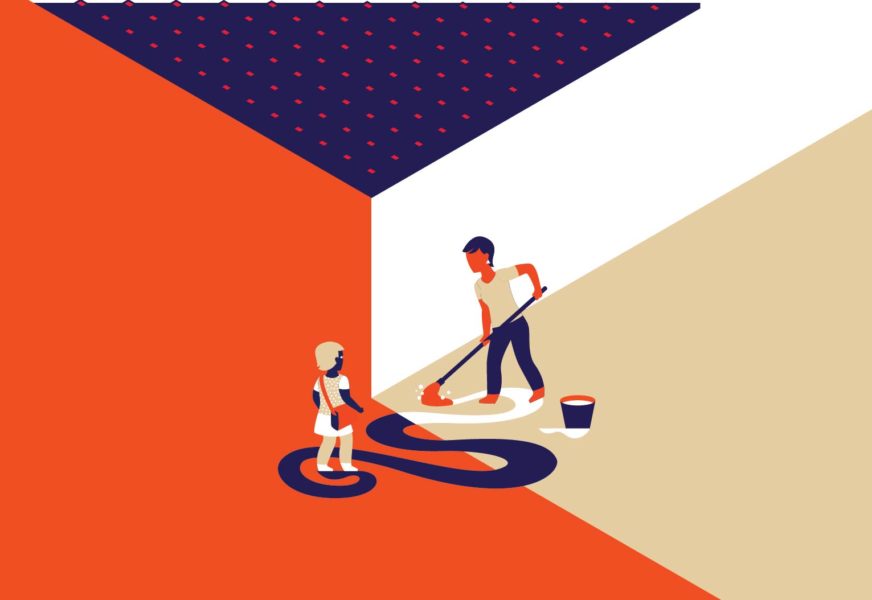- MøNøCLe | Monocle nous emmènera dans l’exploration du sens et de la signification d’un objet ou d’une œuvre particulière. Un objet au travers de son histoire, de sa fonction politique ou de son fonctionnement idéologique. Une œuvre spécifique, car, loin des commentaires généraux et souvent réducteurs sur le travail d’un artiste, chaque œuvre nécessite un regard acéré pour en décrypter le sens.
La relation de l’art à la politique est un sujet complexe. Dans cet essai sur la photographie d’un bureau de chômage, Walter Benn Michaels défend l’idée que l’art ne peut être réellement politique que s’il s’oppose à la compassion.
Le chômage est à la fois un problème et une solution. C’est un problème pour les chômeurs, qui veulent travailler et une solution pour les employeurs, qui veulent des employés au moindre coût. Disons que vous souhaitez engager un vendeur (le poste le plus commun aux États-Unis) ; si vous pouvez vous permettre de lui payer un salaire moyen de 12 dollars l’heure, c’est parce qu’il y a beaucoup de vendeurs potentiels qui sont au chômage. Ce qui signifie, en contrepartie, que non seulement le chômage est un problème pour ceux qui n’ont pas de travail, mais que c’est un problème pour ceux qui en ont. Si vous êtes vendeur, les chômeurs représentent la concurrence ; leur situation est peut-être moins bonne que la vôtre, mais votre situation est moins bonne à cause d’eux : c’est parce qu’ils existent que vous ne gagnez que 12 dollars l’heure. C’est pourquoi Karl Marx envisageait les chômeurs – « la surpopulation relative » – comme « le pivot autour duquel s’articule la loi de l’offre et de la demande du travail ». Mais pas besoin d’être communiste pour saisir l’utilité du chômage. Ou pour comprendre pourquoi la leçon à tirer est qu’il ne faut pas aller en dessous de ce que Milton Friedman — qui n’était pas exactement un communiste — appelait « le taux naturel de chômage », puisque, si cela arrivait, nous courrions le risque d’une « inflation accélérée », c’est-à-dire le risque de devoir payer des salaires plus élevés qui pourraient être exigés par les vendeurs s’ils étaient moins en concurrence.

L’inégalité créée et maintenue par le chômage diffère donc des autres inégalités comme le racisme et le sexisme. Par exemple, personne ne dit que nous avons besoin d’une certaine dose de racisme ou de sexisme pour faire marcher l’économie. Au contraire. La plupart des économistes du libre-échange pensent que la discrimination est mauvaise éthiquement parlant, mais depuis que le collègue de Friedman, Gary Becker, a écrit The Economics of Discrimination, ils savent même que c’est mauvais pour le profit. Les employeurs qui n’engagent pas de travailleurs noirs ne font que renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs blancs ; ils réduisent la concurrence des travailleurs entre eux. Contrairement au racisme, cependant, une juste quantité de chômage est bonne pour le profit. En effet, c’est bon pour le capitalisme lui-même. C’est ainsi que l’inégalité apportée par le chômage est, dans une économie capitaliste, une inégalité utile, et le problème de notre attitude envers les chômeurs (contrairement au problème de notre attitude envers les victimes du racisme ou du sexisme ou de toute autre discrimination) est à la fois compliqué et hors sujet. C’est compliqué parce que, plus nous nous voyons comme des membres de la classe ouvrière, plus notre empathie envers les chômeurs (qui n’ont pas de salaire) se mélange à du ressentiment (parce qu’ils n’ont pas de salaire, nous avons des salaires plus bas). C’est hors sujet parce que notre ressenti vis-à-vis des chômeurs ne change rien quant au fait qu’il y ait du chômage. C’est bon pour le capitalisme, que cela nous plaise ou pas.
Voilà pourquoi cet essai s’intitule « La beauté d’un problème social ». C’est une façon d’évoquer la remarque de Brecht à propos de la scène du « Chant de la grande capitulation » dans Mère Courage et ses enfants. À ses yeux, cette scène serait « un désastre » « si l’actrice qui incarne Mère Courage invite l’audience à s’identifier à elle » parce que le « spectateur » sera privé de l’opportunité « de ressentir la beauté et l’attrait d’un problème social1 ». Dans cette perspective, si nous pensons que ce qui est important dans notre relation avec les chômeurs c’est notre capacité à ressentir leur douleur, alors nous n’avons rien compris. Et si nous pensons que l’art politique doit nous permettre de nous identifier plutôt que de nous offrir quelque chose de « beau », nous n’avons toujours rien compris. Au lieu de cela, ressentir la beauté du problème c’est justement ne pas ressentir de compassion pour ceux qui souffrent à cause de ce problème ; il s’agit plutôt de comprendre le problème comme structure.
C’est pour cette raison que les photographies de Viktoria Binschtok, prises dans un bureau de chômage à Berlin, ne montrent en fait aucun chômeur. La mère Courage de Brecht est décrite comme venant se plaindre au « capitaine » parce que des soldats ont endommagé son stock ; les photos de Binschtok s’intitulent Die Abwesenheit der Antragsteller, soit « l’absence de demandeurs » plutôt que « les demandeurs ». Ces photos montrent les marques que les gens ont laissées sur le mur en s’y appuyant pendant qu’ils attendaient un entretien pour leur obtenir leur droit aux allocations. Et alors que Brecht insiste sur le fait que le personnage de Mère Courage — sa « dépravation » en particulier — ne doit pas être vu comme individuel, puisqu’il « s’agit non pas de sa dépravation à elle, mais de celle de sa classe », les chômeurs de Binschtok n’ont pas de caractéristique, dépravée ou autre. En revanche, ils ont un corps. Cependant, puisque leurs corps ne sont suggérés que par les marques sur le mur, il nous est impossible de savoir de quelle sorte de corps il s’agit, tout comme on ne peut savoir quel genre de personnage ils étaient. Autrement dit, on ne peut non seulement pas savoir s’ils étaient paresseux ou travailleurs, ni s’il s’agissait d’hommes, de femmes ou quelles étaient leurs origines ; en fait, il nous est même impossible de déterminer leur classe (ce que Brecht voulait que l’on voie chez Mère Courage). Au lieu de cela, la photo nous montre un mécanisme — « le pivot » — qui articule les rapports de classe. Ce qui signifie que replacer les personnes par les marques qu’elles ont laissées relève moins de la désindividualisation que de la dépersonnification. Il s’agit moins de représenter un groupe social de manière abstraite que de représenter sa fonction dans les rapports sociaux. Les marques représentent, sans personnification, non pas un groupe social, mais un élément structurel.
Encore que « représenter » est un terme qui pose problème ici. Les éraflures et les taches sur le mur ne sont pas des représentations de personnes ; ce sont des traces laissées par des corps. Et la photo n’est pas une représentation des éraflures et des taches. En effet, la photographie, au sens strict, est un enregistrement, une trace et non une représentation ; c’est une trace de leurs traces. En ce sens, la relation entre la photographie et les chômeurs n’est pas que c’est une photo d’eux, mais une photo causée par eux, un enregistrement de leur présence. Mais en même temps, la photo utilise d’une manière presque ostentatoire une compréhension très différente d’elle-même. Elle se présente à nous, non comme une simple trace, mais sous la forme d’une abstraction picturale (avec un clin d’œil à Cy Twombly). En ce sens, elle transforme les traces des corps des chômeurs en une abstraction. Et ce mouvement vers l’abstraction — vers quelque chose de fabriqué par l’artiste plutôt que capturé — est un autre moyen d’insister sur la fonction du chômeur plutôt que sur la détresse de ses victimes. Cela décrit les corps créés par une économie capitaliste comme principe structurel qui fait fonctionner le capitalisme. La photographie permet dès lors de représenter le mécanisme qui produit les chômeurs plutôt que les chômeurs eux-mêmes. Les principes sont eux-mêmes des abstractions ; ils ne laissent pas de trace ; ils doivent être représentés, pas enregistrés.
Il s’agit moins de représenter un groupe social de manière abstraite que de représenter sa fonction dans les rapports sociaux.
Pour le dire autrement, c’est la beauté de la photographie qui est la marque de son contenu politique — une beauté créée non pas en montrant les victimes du chômage, mais en ne les montrant pas, et en transformant la capture de leur présence en quelque chose qui ressemblerait plus à une peinture du mouvement colorfield painting qu’à une photo documentaire. En tant qu’image d’une « surpopulation relative » plutôt que de chômeurs, « Wand 1 » ne vise pas à susciter notre empathie. Au lieu de cela, c’est précisément car la population au chômage rempli sa fonction de pression sur les salaires indépendamment de nos émotions vis-à-vis de celle-ci que pour pouvoir la voir correctement, nous devons l’appréhender objectivement sans y investir le moindre sentiment ni même envisager les sentiments que les travailleurs et les chômeurs peuvent ressentir les uns pour les autres et envers eux-mêmes. Bien sûr, nous avons tous de tels ressentis. Mais le problème social ne peut pas être résolu en changeant ces ressentis ; le problème est en effet occulté par l’idée même que notre ressenti a de l’importance. Quand nous commençons à nous demander si les chômeurs ont fait de mauvais choix et sont responsables de leur détresse, ou s’ils sont les victimes de nos préjugés, racisme ou sexisme, et que nous sommes responsables de leur situation, nous avons déjà oublié le vrai problème social — qui est que, si tout le monde faisait de bons choix et s’il n’y avait pas de racisme ni de sexisme, le taux de chômage resterait inchangé.
La photo établit donc une distance avec ses sujets, et cherche à refléter cette distance avec celle qu’elle établit avec ses spectateurs, nous empêchant alors de nous identifier en ne nous donnant personne à qui nous identifier, rendant ainsi les spectateurs et leurs émotions aussi hors de propos que les sujets de la photo et leurs émotions. Le but de cette photographie est donc d’établir son propre espace, de devenir autonome. C’est tout à fait à l’opposé de ce que l’on envisage dans une relation entre la politique et l’art. On pense d’habitude que l’art « engagé » est censé être rattaché au monde, nous montrer les victimes d’un abus terrifiant et toucher profondément ses spectateurs, créant ainsi en nous le désir de corriger cet abus. Et de l’art qui ne s’adresse pas à nous de cette manière — un art qui tente d’imaginer sa séparation du monde, un art qui insiste sur ses propriétés formelles — nous avons tendance à le voir comme apolitique, voire même conservateur, peut-être passionné de beauté, mais indifférent face à la douleur.
Mais c’est une erreur. Le grand critique Hal Foster a remarqué que l’art qui l’a récemment le plus touché se caractérisait par une « absence de forme », qu’il était fait pour « évoquer, le plus directement possible, le désarroi des élites dirigeantes et la violence du capital mondialisé2 ». Mais peut-être que l’absence de forme esthétique est précisément ce dont nous avons le moins besoin. Peut-être avons-nous besoin d’un art qui représenterait moins les abus du système que, au travers de sa forme, le système lui-même. Et peut-être que c’est cet effort pour produire quelque chose qui se suffit à lui même, sans référence directe au monde réel, qui nous permet de voir dans l’art, non seulement le reflet de la forme actuelle de capitalisme néolibéral, mais aussi ce que pourrait être son alternative.
Peut-être avons-nous besoin d’un art qui représenterait moins les abus du système que, au travers de sa forme, le système lui-même.
Le chômage est utile ici, justement parce qu’il n’est pas simplement un abus arbitraire et parce qu’il a permis la hausse extraordinaire des inégalités économiques qui ont caractérisé les 35 dernières années et qui, du point de la vue du capital, est (comme le chômage lui-même) autant une caractéristique qu’un problème. Alors que les marges de profit ont augmenté et que la part du PIB revenant aux travailleurs a décliné (les salaires sont plus bas quand beaucoup ne travaillent pas), il est devenu évident pour de plus en plus de gens qu’avoir un travail n’est pas forcément mieux que de ne pas en avoir. C’est pour cela qu’il vaut mieux voir les chômeurs comme des traces sur un mur que comme des gens qui suscitent de la compassion — notre compassion est hors de propos, non seulement parce qu’elle ne (leur) sert à rien, mais parce qu’elle nous désoriente (puisque nous sommes aussi des victimes). Voilà pourquoi il est important pour une photo comme « Wand 1 » — qui est bien une photo du marché du travail comme système — qu’elle imagine sa propre autonomie de ce marché.
De façon plus générale, c’est pour cela que l’indifférence issue de cette dissociation peut être utile politiquement. D’un côté, l’œuvre d’art se sépare du monde et montre l’inutilité de nos sentiments. Mais de l’autre, elle fait appel à un ensemble de sentiments différents, notre attrait, comme le dit Brecht, pour la beauté. Aujourd’hui, nous pourrions en faire l’hypothèse, c’est seulement dans la mesure où l’art cherche la beauté — à atteindre une perfection formelle uniquement imaginable dans les œuvres d’art — qu’il peut fonctionner comme une image portant, non pas sur la façon dont nous pourrions gérer les problèmes du capitalisme en nous comportant mieux, mais plutôt sur le capitalisme lui-même en tant que problème.
- Cet essai a été publié en anglais le 3 octobre 2011 par le journal Brooklyn Rail.