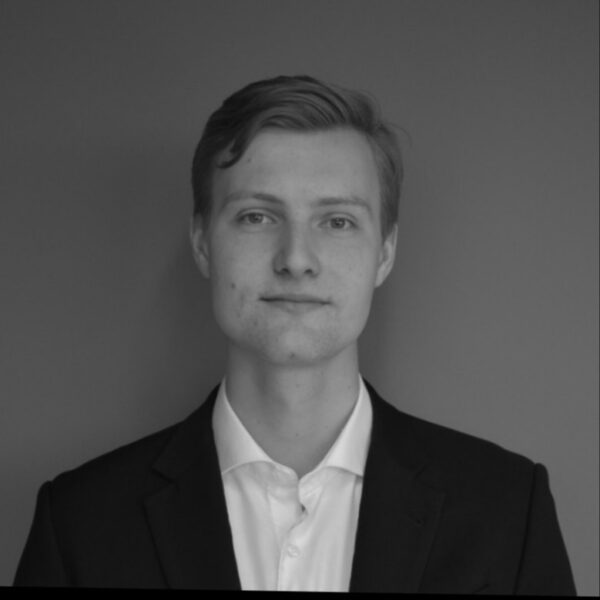« La véritable question est de savoir si nous serons capables de construire, à travers toute l’Europe, des forces à même de diriger la lutte des classes, de gagner la confiance des travailleurs et de lier clairement cette lutte à la résistance contre la militarisation ainsi qu’au combat pour le socialisme. C’est pour moi la tâche centrale pour 2026 », déclare Peter Mertens, secrétaire général du Parti du Travail de Belgique, dans un entretien avec Ana Vračar.

En 2025, les élites politiques européennes ont semblé de plus en plus désorientées. Sur le plan intérieur, les gouvernements font face à une colère sociale croissante contre le retour de l’austérité et l’accélération de la militarisation. À l’international, ils ont été régulièrement mis à l’écart et humiliés par l’administration Trump. Pourtant, les dirigeants européens continuent de foncer dans le mur, engageant des milliards via un emprunt commun pour prolonger la guerre en Ukraine, tout en soutenant les priorités impérialistes des États-Unis ailleurs, du soutien au génocide israélien à Gaza à l’approbation de menaces contre le Venezuela et d’autres pays d’Amérique latine. Ces tendances, qui se poursuivent en 2026, annoncent de sérieux risques pour la classe travailleuse européenne : à travers le risque de recrutement forcé dans l’armée, la normalisation de la logique de guerre et de nouvelles attaques contre des droits durement conquis. En même temps, ces évolutions pourraient faire émerger de nouvelles formes de résistance sur tout le continent.
C’est dans ce contexte que Peter Mertens, secrétaire général du Parti du Travail de Belgique (PTB), analyse, dans une interview pour le journal Peoples Dispatch, les opportunités qu’apporte l’année 2026 – à condition que la gauche soit prête à faire preuve d’audace. Par Ana Vračar pour Peoples Dispatch. Traduction pour LVSL.
Peoples Dispatch – En début d’année, un nouveau gouvernement a été formé en Belgique : la coalition dite Arizona. Depuis, de vastes mobilisations s’organisent contre lui. Où en est la situation avec le gouvernement, et que peut-on attendre des mobilisations à venir ?
Peter Mertens – Depuis près d’un an, la Belgique a un gouvernement très à droite, surnommé à moitié en plaisantant « coalition Arizona ». Ce qu’ils essaient de faire, c’est d’organiser un recul social massif, essentiellement un grand hold-up contre la classe travailleuse.
La résistance a été immédiate. Mi-janvier, juste avant l’entrée en fonction officielle du gouvernement, 35 000 personnes ont manifesté à Bruxelles. Un mois plus tard, il y avait déjà 100 000 personnes dans les rues. Et cela n’a pas cessé. C’est l’une des plus grandes mobilisations sociales depuis les années 1960 : en un an, 13 mobilisations nationales sur des questions sociales et économiques, qui ont pris la forme de manifestations ou de grèves générales. Maintenant, un plan d’action s’étend sur janvier, février et mars 2026, soutenu par les syndicats CSC et FGTB.
Je pense que l’une des raisons pour lesquelles la mobilisation tient aussi longtemps, c’est que les revendications sont largement partagées. Non seulement parmi les travailleurs, mais aussi par de larges couches de la société. La question centrale, ce sont les pensions. Il y a une forte résistance face aux politiques qui veulent contraindre les gens à travailler jusqu’à 67 ans.
Ensuite, il y a l’indexation des salaires. En Belgique, il y a un mécanisme d’indexation automatique des salaires, qui garantit que les salaires augmentent lorsque les prix augmentent et protègent les travailleurs de l’inflation. C’est une conquête durement gagnée par la classe travailleuse, mais le gouvernement veut affaiblir ce mécanisme. Un troisième point concerne les primes – par exemple pour le travail de nuit. Le gouvernement prévoit aussi des coupes là-dedans. Enfin, il y a une revendication positive qui unit le mouvement : une taxe des millionnaires.
Cela dit, le gouvernement refuse d’écouter les syndicats et avance coûte que coûte, avec une approche très autoritaire, très austéritaire. On ne sait donc pas encore comment cela se terminera. Mais une chose est claire : ce sera une confrontation majeure.
P. D. – Le gouvernement Arizona est aussi l’un des plus fervents défenseurs de la militarisation en Europe. Que pensez-vous de cette normalisation croissante des dépenses militaires et de la guerre ?
P. M. – Nous nous mobilisons contre cela depuis le tout début. Notre position est claire : nous sommes contre la guerre en Ukraine, et aussi contre la politique de l’Union européenne qui vise à la prolonger. Aujourd’hui, certains dirigeants européens – je les appelle des dirigeants secondaires, impopulaires dans leur propre pays – pilotent la politique de l’Union européenne et poussent à poursuivre cette guerre sanglante et insensée.
Nous nous opposons à la guerre elle-même, mais aussi plus largement à la militarisation de la société. Donald Trump a déjà imposé son agenda à l’OTAN, avec la « norme des 5 % » adoptée au sommet de La Haye en juin. Nous l’avons immédiatement appelée la « norme Trump ». Son message était clair : la guerre en Ukraine coûte trop cher aux États-Unis et ils veulent se concentrer sur la Chine. À l’Europe de payer la facture.

Dans ce contexte, la grève étudiante de masse début décembre en Allemagne a été très importante. Des dizaines de milliers de jeunes se sont mobilisés contre le retour du service militaire obligatoire. Ce débat émerge aussi en Belgique.
Ce n’est pas surprenant que beaucoup de jeunes soient inquiets. Des déclarations comme celle de Mark Rutte, affirmant récemment que les gens devaient se préparer à une guerre de grande ampleur comme ce qu’ont connu leurs grands-parents, suscitent de la peur. En réaction, nous essayons de construire un mouvement qui résiste à la militarisation de la jeunesse et de la société dans son ensemble.
Cette lutte est importante en soi, mais elle est aussi clairement liée à l’austérité. Le lien est évident. Le gouvernement veut imposer un paquet d’austérité de 32 milliards d’euros, ce qui est énorme pour la Belgique. Et en même temps, une part importante du budget part dans les dépenses militaires. Tous les secteurs de la société en Belgique, et je pense aussi en Europe, sont étouffés : la santé est sous-financée, les routes se détériorent, les services à la jeunesse s’écroulent, même les prisons souffrent de surpopulation. C’est un désastre à l’échelle de l’Europe. Le seul secteur en plein essor, c’est le militaire.
P. D. – Les gens ressentent-ils déjà les conséquences de cette austérité ?
P. M. – En Belgique, cela se traduit directement par l’austérité. Le même gouvernement qui coupe des milliards dans la sécurité sociale achète des avions de chasse F-35, de nouveaux navires de guerre, des systèmes d’armement. Nous n’avons pas besoin de tout cela. Le littoral belge fait à peine 66 kilomètres : c’est un petit pays. Un avion qui décolle de notre territoire en sort en moins d’une minute. Il ne s’agit pas de défense. Il s’agit de construire une force militaire offensive au service d’intérêts impérialistes : ceux de l’Europe, et ceux de la Belgique. C’est clair depuis le départ.
Il existe bien sûr une alternative à l’austérité. La Belgique offre des milliards d’euros d’avantages fiscaux aux grandes entreprises. Elles bénéficient d’exonérations pour tout un tas de choses, sous forme de réductions de cotisations sociales et de réductions d’impôts, pour un total de 15 milliards en 2025. En repensant même une partie de ces cadeaux, on pourrait dégager des milliards pour financer la sécurité sociale. Des milliards supplémentaires dorment dans les paradis fiscaux, sans être poursuivis, en partie parce que l’administration fiscale manque de personnel. En parallèle, des millions continuent de couler vers les États-Unis pour acheter du gaz naturel liquéfié (GNL), cher et polluant, plutôt que des alternatives moins coûteuses comme le gaz russe. Et bien sûr, il n’y a aucune taxe sérieuse sur les ultra-riches.
« À l’intérieur des frontières, ce genre de politique signifie toujours la même chose : la guerre contre la classe travailleuse, contre la sécurité sociale et contre les services publics, qui paieront le prix de la militarisation. »
Donc ce n’est pas qu’une question budgétaire, c’est une question politique. Une partie de la bourgeoisie européenne a choisi de militariser la société et de préparer la guerre contre la Russie, et maintenant ils attisent la haine un peu partout. À l’intérieur des frontières, ce genre de politique signifie toujours la même chose : la guerre contre la classe travailleuse, contre la sécurité sociale et contre les services publics, qui paieront le prix de la militarisation.

P. D. – Dans le même temps, on voit les élites européennes perdre pied sur la scène internationale. Depuis le début du deuxième mandat de Trump, beaucoup de dirigeants européens tentent ouvertement de lui plaire – sans atteindre leur but. À la place, l’Europe semble en crise. Comment décririez-vous la position de l’Europe dans le monde aujourd’hui ?
P. M. – Cette attitude presque freudienne de Mark Rutte et d’autres dirigeants européens secondaires, appelant le président Trump « papa » et essayant à tout prix de le satisfaire, est un désastre. C’est aussi le reflet de la situation plus large de l’Europe.
Que s’est-il passé cette année ? En juin, Trump a imposé la norme OTAN des 5 % de dépenses militaires. En juillet, on a vu un soi-disant « accord commercial » – qui n’en est pas un, car les biens américains entrent en Europe sans droit de douane, alors que les produits européens sont taxés à 15 %, voire 50 % pour l’acier et l’aluminium. En plus, l’Europe a promis 1 350 milliards de dollars d’investissements. C’était un été d’humiliation, il n’y a pas d’autre mot.
« Cela révèle un problème profond : cette génération de dirigeants européens n’existe quasiment pas en tant que génération politique. Ce sont des figures secondaires. »
Cela révèle un problème profond : cette génération de dirigeants européens n’existe quasiment pas en tant que génération politique. Ce sont des figures secondaires. Ce n’est pas une insulte, c’est un constat. En Allemagne, Friedrich Merz était écarté sous Merkel, jugé inapte au leadership. Aujourd’hui, il est en charge. Mark Rutte a laissé les Pays-Bas en crise. Emmanuel Macron gouverne sans soutien populaire, Keir Starmer aussi. Kaja Kallas vient d’un tout petit pays où elle n’a pas de soutien, mais se présente comme une grande figure anti-russe et anticommuniste au sein de l’Union européenne.
Ce groupe n’a ni vision, ni compréhension sérieuse de la situation globale. La réalité, c’est que le centre de gravité de l’économie mondiale se déplace vers l’Asie, vers la Chine, l’Inde, et les pays des BRICS. En réaction à ce basculement historique, les États-Unis paniquent et mettent en œuvre une nouvelle stratégie de sécurité. Et ils le disent clairement : l’Europe ne les intéresse plus. Dans ce contexte, suivre Trump comme un petit chien n’est pas la solution. Acheter du gaz GNL à Trump n’est pas la solution. Acheter des armes à Trump n’est pas la solution.
P. D. – Une autre frange des dirigeants européens tente de réagir à cette situation en poussant vers ce qu’ils appellent une autonomie militaire et stratégique.
P. M. – L’alternative à la domination américaine ne peut pas être la construction d’un nouveau bloc impérialiste européen. Pourtant, cette option devient de plus en plus populaire. Regardez à nouveau l’Allemagne : les derniers plans d’investissement concernent la construction d’une armée allemande autonome. En 2022, quand l’Allemagne a annoncé 100 milliards d’euros supplémentaires pour l’armée, c’était surtout pour acheter des armes américaines. Maintenant, il s’agit d’acheter des armes allemandes.
Nous le disons clairement : ni la politique d’agression américaine ni la politique d’agression européenne ne sont des réponses. Ce qu’il faut, c’est une position européenne complètement différente, basée sur la coopération – y compris avec les pays des BRICS – et non sur le néo-colonialisme ou le néo-impérialisme. Je crois que cela ne pourra vraiment se réaliser que quand il y aura du socialisme en Europe, et je pense que ce débat va se développer dans la prochaine décennie. L’Europe est en déclin, mais cela signifie aussi que nous sommes à un carrefour.
« L’alternative à la domination américaine ne peut pas être la construction d’un nouveau bloc impérialiste européen. »
D’un côté, il y a la politique des États-Unis, transparents sur leur stratégie de sécurité nationale : intervenir dans la politique européenne, soutenir l’extrême droite, promouvoir des politiques racistes et diviser l’Europe à travers des accords bilatéraux. De l’autre, on a des franges d’élites européennes – comme celle autour de l’industrie militaire allemande, avec des entreprises comme Rheinmetall – qui veulent une Union européenne plus forte, mais sous une forme autoritaire, en démantelant ce qui reste de contrôle populaire.
Nous rejetons ces deux options. Nous voulons une Europe complètement différente. Et nous allons essayer de faire avancer cette vision, non seulement en Belgique, mais dans toute l’Europe, avec les forces que nous avons.
P. D. – Dans ce contexte, comment analysez-vous l’incapacité de l’Europe à réagir face à l’agression américaine dans les Caraïbes, aux menaces contre le Venezuela et d’autres pays d’Amérique latine ? Comme vous le dites, il est peu probable que les gouvernements européens actuels changent de cap.
P. M. – Il faut être très clair : l’Europe, ou plutôt l’Union européenne, n’a jamais été un projet de paix. Lorsqu’elle a été lancée après la Seconde Guerre mondiale, ses pays fondateurs étaient des puissances coloniales : la Belgique, la France, l’Italie, etc. La première carte officielle de la Communauté économique européenne (CEE) incluait l’Algérie, le Congo… La plupart des territoires de la CEE étaient des colonies. Dans l’esprit de ses créateurs, l’Union européenne était dès le départ une construction impérialiste.
Cela dit, la présence de l’Union soviétique a permis l’existence de contrepoids favorables à la diplomatie et au dialogue en Europe. Cela incluait la Russie, qui est après tout un pays européen. La Russie ne va pas disparaître, elle ne va pas changer de place. Cette réalité a longtemps nourri une tradition diplomatique.
« L’Europe, ou plutôt l’Union européenne, n’a jamais été un projet de paix. »
Mais cette tradition a aujourd’hui disparu. Le changement de régime au Venezuela est désormais ouvertement discuté et soutenu dans les instances de l’Union européenne et les parlements nationaux. Des personnalités comme Kaja Kallas disent ouvertement qu’elles ne parleront même pas avec la Russie. Mais dans le même temps, elles parlent avec le régime meurtrier et génocidaire d’Israël – et le soutiennent pleinement. Non seulement elles dialoguent avec Israël, mais elles l’arment : avec des sous-marins allemands, des armes allemandes et des armes américaines acheminées via des ports européens.
Ce double standard est devenu impossible à ignorer, surtout depuis le génocide en Palestine. Les gens voient la contradiction très clairement : 19 paquets de sanctions contre la Russie, zéro contre Israël. Silence total sur les bombardements illégaux en Iran. Utilisation de bases navales à Chypre pour soutenir les opérations militaires israéliennes. Cette hypocrisie pousse les gens à remettre en question le rôle de l’Europe. C’est pour cela que nous avons vu des mobilisations massives : rien qu’en Belgique, il y a eu 12 manifestations nationales pour la Palestine.
P. D. – Si l’Union européenne n’a jamais été un projet de paix, qu’impliquent aujourd’hui ses ambitions militaires et économiques pour le reste du monde, en particulier le Sud global ?
P. M. – Prenez l’Afrique, par exemple. Selon les chiffres d’Eurostat de 2020, la France a extraits 67 milliards d’euros de chiffre d’affaires en Afrique, l’Allemagne 24 milliards, l’Italie 11 milliards. Ça fait environ 100 milliards d’euros par an qui quittent l’Afrique pour seulement trois pays européens. C’est pour cela qu’ils sont terrifiés par ce qui se passe au Sahel. Si l’accès à l’uranium est perturbé, la France fait face à une crise énergétique majeure, étant donné sa dépendance au nucléaire. C’est l’une des raisons de la réorganisation militaire de l’Europe : elle sert les intérêts impérialistes du bloc.
L’Europe n’est pas seulement une vassale soumise des États-Unis. Elle a ses propres ambitions impérialistes. L’Allemagne, la France et l’Italie ont toutes des stratégies pour défendre et étendre leurs zones d’influence. Depuis 2022, l’Allemagne déclare ouvertement vouloir redevenir une puissance militaire mondiale.
C’est un développement nouveau et dangereux. Nous savons que cette voie mène à plus de conflits, plus d’austérité, plus de racisme, et plus d’attaques contre la classe travailleuse. Mais dans ce chaos, il y a aussi une opportunité pour une force marxiste authentique, une véritable force de gauche et de la classe travailleuse, de gagner en influence.
Je suis d’accord avec Lénine quand il disait que dans les périodes calmes, les gens peuvent dormir longtemps – mais dans les périodes de tourmente, ils apprennent très vite. Les dirigeants de la classe travailleuse aussi peuvent apprendre vite. Je pense que nous approchons de cette période. Ceux d’en haut ne savent plus où ils vont, et ceux d’en bas comprennent de plus en plus que cela ne peut pas continuer comme ça. Nous n’y sommes pas encore totalement, mais nous nous en rapprochons.
P. D. – Ces dernières années, le PTB est devenu une source d’inspiration pour beaucoup à gauche dans la région. Pour conclure, quelles sont vos attentes pour 2026 et la période à venir ?
P. M. – Au niveau européen, une chose est claire : le lien entre les luttes contre l’austérité et celles contre la militarisation va s’approfondir. C’est déjà visible en Europe de l’Est, et à mesure que les gouvernements seront poussés vers la norme de 5 % de dépenses militaires, cela impliquera inévitablement des coupes budgétaires ailleurs.
Cela viendra avec des mesures autoritaires – contre la liberté d’expression, la liberté de rassemblement, le droit de manifester. On le voit déjà. Militarisation et autoritarisme vont toujours de pair. Donc la lutte des classes ne sera pas une option en Europe, elle sera présente partout, sous différentes formes et intensités. La vraie question est : serons-nous capables de construire des forces à travers l’Europe capables de mener ces luttes, de gagner la confiance des travailleurs, et de les connecter clairement à la lutte contre la militarisation et pour le socialisme ? C’est ça, pour moi, la tâche centrale de 2026.
Le débat grandit déjà. Au Royaume-Uni, par exemple, quand le parti Your Party s’est lancé, le débat portait clairement sur l’opposition à la guerre, à l’OTAN, à l’austérité, et sur le socialisme. En Allemagne, la gauche parle à nouveau de socialisme ou barbarie, en citant Rosa Luxemburg. Cette question du type de société que nous voulons va devenir centrale d’ici 2027.
Il faut aussi la relier à la solidarité avec les luttes dans le Sud global. Il n’y aura pas d’émancipation véritable en Europe sans lien avec les luttes de libération ailleurs dans le monde. On doit parler de la résistance du peuple vénézuélien contre l’impérialisme américain, de celle du peuple chilien contre ce nouveau clown d’extrême droite. Donc quand on va sur un piquet de grève, on ne doit pas parler que de la Belgique. On parlera des BRICS, des luttes internationales, et on apportera même des livres politiques sur les piquets. Cela ouvre les horizons et relie les luttes locales aux dynamiques mondiales.
Il y a de grands dangers devant nous, notamment du côté des forces petite-bourgeoises défaitistes, qui disent : « On ne peut pas gagner, tout est foutu. » Il faut surmonter cela en diffusant les exemples positifs de lutte. Le changement vient de nombreuses petites victoires : des usines où les travailleurs créent un syndicat pour la première fois, des villes où des privatisations ou des mesures d’austérité sont repoussées. Tout cela change le rapport de force.
Enfin, nous devons avoir confiance dans les gens. Les gens ne veulent pas la guerre. Ils ne veulent pas l’exploitation. Ils ne veulent pas de catastrophes climatiques, d’inondations, de sécheresses, de dévastation. Le bon sens, si on peut dire, est du côté de la classe travailleuse. Notre tâche est de le reconnaître et de l’organiser. Il y aura beaucoup de dangers, bien sûr. Il y aura des fascistes, de la violence, de la répression comme on le voit aux États-Unis. L’Europe a déjà sa propre version de l’ICE – Frontex – qui laisse des gens se noyer en Méditerranée.
Mais il y aura de vraies possibilités de changement par le bas, par la lutte des classes. Donc ma conclusion est la suivante : n’ayez pas peur. Et saisissez ces opportunités à bras-le-corps.